ARCHIVÉ - Conseil national de recherches Canada
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
2006-2007
Rapport sur le rendement
Conseil national de recherches Canada
L'honorable Jim Prentice
ministre de l�Industrie
Table des mati�res
Acronymes et abr�viationsSection I – Survol
- Message du ministre
- D�claration de la direction
- Activit�s du Conseil national de recherches Canada (CNRC) (Sommaire)
- Rendement global du CNRC en 2006-2007
- Priorit� no 1 : Recherche-d�veloppement au Canada : �conomie, environnement,
sant� et s�curit� - Priorit� no 2 : Soutien technologique et industriel : servir de catalyseur � l’innovation industrielle et � la croissance
- Priorit� no 3 : D�veloppement de grappes technologiques viables capables de cr�er
de la richesse et du capital social - Priorit� no 4 : Administration du programme de mani�re � assurer la viabilit�
de l’organisation
Acronymes et abr�viations
|
ALMA |
Grand r�seau d'astronomie millim�trique d'Atacama |
|
APECA |
Agence de promotion �conomique du Canada atlantique |
|
BVG |
Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada |
|
CBRN |
Chimique, biologique, radiologique ou nucl�aire |
|
CCFDP-CNRC |
Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques |
|
CCRS |
Centre canadien de rayonnement synchrotron |
|
CERN |
Organisation europ�enne pour la recherche nucl�aire |
|
CETO |
Centre des entreprises de technologies oc�aniques |
|
cGMP |
Bonnes pratiques de fabrication actuelles |
|
CHC-CNRC |
Centre d'hydraulique canadien du CNRC |
|
CIC |
Centre d'information du CNRC |
|
CNRC |
Conseil national de recherches Canada |
|
CRID-CNRC |
Centre de recherche sur les infrastructures durables du CNRC |
|
CRSNG |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada |
|
CRTL |
Centre de recherche en technologies langagi�res |
|
CTA-CNRC |
Centre des technologies de l'aluminium |
|
CTFA-CNRC |
Centre des technologies de fabrication en a�rospatiale |
|
CTTS-CNRC |
Centre de technologie des transports de surface |
|
DC-CNRC |
Direction de la commercialisation |
|
ETP |
�quivalent temps plein |
|
GRH |
Gestion des ressources humaines |
|
IBD-CNRC |
Institut du biodiagnostic du CNRC |
|
IBM-CNRC |
Institut des biosciences marines du CNRC |
|
IBP-CNRC |
Institut de biotechnologie des plantes du CNRC |
|
ICIST-CNRC |
Institut canadien de l'information scientifique et technique du CNRC |
|
IENM-CNRC |
Institut des �talons nationaux de mesure du CNRC |
|
IGS-CNRC |
Initiative en g�nomique et en sant� du CNRC |
|
IHA-CNRC |
Institut Herzberg d'astrophysique du CNRC |
|
IIPC-CNRC |
Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC |
|
IMI-CNRC |
Institut des mat�riaux industriels du CNRC |
|
INM |
Institut national de m�trologie |
|
INN |
Institut national de nanotechnologie |
|
IPI |
Installation de partenariat industriel |
|
IRA-CNRC |
Institut de recherche a�rospatiale du CNRC |
|
IRB-CNRC |
Institut de recherche en biotechnologie du CNRC |
|
IRC-CNRC |
Institut de recherche en construction du CNRC |
|
IRTC |
Initiative de recherche et de technologie chimique, biologique, radiologique et nucl�aire |
|
ISB-CNRC |
Institut des sciences biologiques du CNRC |
|
ISM-CNRC |
Institut des sciences des microstructures du CNRC |
|
ISNS-CNRC |
Institut des sciences nutritionnelles et de la sant� du CNRC |
|
ISSM-CNRC |
Institut Steacie des sciences mol�culaires du CNRC |
|
ITFI-CNRC |
Institut des technologies de fabrication int�gr�e du CNRC |
|
ITI-CNRC |
Institut de technologie de l'information du CNRC |
|
ITO-CNRC |
Institut des technologies oc�aniques du CNRC |
|
ITPCE-CNRC |
Institut de technologie des proc�d�s chimiques et de l'environnement du CNRC |
|
LTG-CNRC |
Laboratoire des turbines � gaz du CNRC |
|
MDN |
Minist�re de la D�fense nationale |
|
ME |
Moyenne entreprise |
|
OCDE |
Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques |
|
PARI-CNRC |
Programme d'aide � la recherche industrielle du CNRC |
|
SOFC |
Piles � combustible � oxyde solide |
|
PI |
Propri�t� intellectuelle |
|
PICA |
Partenariat pour l'investissement au Canada atlantique |
|
PLT |
Plan � long terme pour l'astronomie et l'astrophysique au Canada |
|
PME |
Petites et moyennes entreprises |
|
PPCH |
Programme de piles � combustible et d'hydrog�ne |
|
R-D |
Recherche-d�veloppement |
|
RDDC |
Recherche et d�veloppement pour la d�fense du Canada |
|
SCT |
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor |
|
S-T |
Science et technologie |
|
STM |
Scientifique, technique et m�dicale |
|
TCFH |
T�lescope Canada-France-Hawaii |
|
TJCM |
T�lescope James Clerk Maxwell |
|
TRIUMF |
Tri-University Meson Facility |
|
VTC |
Veille technologique concurrentielle |
Section I: Survol
Message du ministre
 |
Je suis heureux de vous pr�senter le Rapport sur le rendement du Conseil national de recherches du Canada pour 2006-2007.
Mon but � titre de ministre de l’Industrie et l’une des principales priorit�s du nouveau gouvernement du Canada consistent � maintenir la vitalit� du contexte �conomique au pays pour favoriser ainsi la prosp�rit� des Canadiens au sein de l’�conomie mondiale. Nous sommes t�moins d’importants changements sur le march� mondial. Les nouveaux accords commerciaux, les perc�es technologiques et l’�mergence de pays en d�veloppement font tous partie de la r�alit� des affaires d’aujourd’hui. Le Canada doit rester � la hauteur.
Mon mandat consiste en partie � aider les Canadiens � �tre plus productifs et concurrentiels. Nous voulons que nos industries poursuivent leur essor et que l’ensemble de la population canadienne continue de b�n�ficier d’un niveau de vie parmi les plus �lev�s du monde.
� cette fin, le gouvernement s’est engag� � maintenir l’�quit�, l’efficacit� et la comp�titivit� du march� — un march� qui stimule les investissements, ouvre la voie � une productivit� accrue et favorise l’innovation. Nous misons davantage sur les forces du march� et ne faisons appel � la r�glementation qu’en cas de n�cessit� absolue. Nos politiques ont permis de tirer des activit�s de recherche de nouveaux produits et de nouvelles fa�ons de faire des affaires. En outre, nous mettons tout en œuvre pour sensibiliser l’industrie canadienne aux pratiques favorisant un d�veloppement durable, en mettant l’accent sur leurs retomb�es sociales, environnementales et �conomiques.
Au cours du dernier exercice, le Minist�re et le portefeuille de l’Industrie ont r�alis� de nets progr�s dans plus d’un domaine, notamment les t�l�communications, les sciences et la recherche appliqu�e, le secteur manufacturier, la petite entreprise, la protection des consommateurs, les brevets et le droit d’auteur, le tourisme et le d�veloppement �conomique.
Industrie Canada et 10 autres organismes, soci�t�s d’�tat et organes quasi judiciaires forment le portefeuille de l’Industrie. Ensemble, ces organismes contribuent � assurer le d�veloppement industriel, scientifique et �conomique du Canada et � maintenir sa comp�titivit� sur le march� mondial.
Nous avons beaucoup accompli au cours de l’exercice. � l’aide d’Avantage Canada — le plan �conomique � long terme du gouvernement — qui nous a servi de guide, nous avons fait de grands pas en vue d’atteindre bon nombre de nos objectifs les plus importants. Nous continuerons de mettre l’accent sur ces objectifs en vue de cr�er les conditions propices � une �conomie forte — des conditions auxquelles s’attendent les Canadiens et qu’ils m�ritent bien.
Le ministre de l’Industrie,
Jim Prentice
D�claration de la direction
|
Je soumets, aux fins de d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement (RMR) de 2006‑2007 du Conseil national de recherches Canada. Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�sentation des rapports �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006-2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement :
Le pr�sident, |
Activit�s du Conseil national de recherches Canada (CNRC) (Sommaire)
Raison d'�tre
Le CNRC est la principale ressource de l'administration publique f�d�rale dans le secteur de la science et de la technologie (S-T). Voici les principaux volets de son action :
- am�liorer le bien-�tre social et �conomique des Canadiens;
- offrir un soutien technologique et industriel de nature � favoriser l'innovation et la croissance industrielles; et
- faire preuve d'excellence et de leadership en recherche-d�veloppement (R-D).
Retomb�es des activit�s du CNRC pour les Canadiens
Le CNRC s'efforce d'obtenir le r�sultat strat�gique vis� en cr�ant de la richesse, du savoir et du capital social pour les Canadiens.
Figure 1-1 : Retomb�es des activit�s du CNRC pour les Canadiens
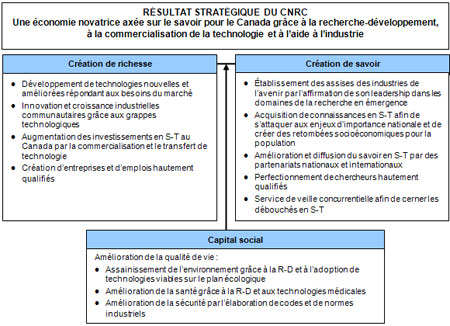
Priorit�s du CNRC pour 2006-2007 : Activit�s et gestion – Rendement obtenu
Tableau 1-1 : Ressources du CNRC en 2006-2007
| Ressources financi�res (en millions de dollars) | ||
|
Pr�vues |
Autorisations totales |
R�elles |
|
714,1 |
844,7 |
742,1 |
|
Ressources humaines (�quivalent temps plein – ETP) |
||
|
Pr�vues |
R�elles |
Diff�rence |
|
4 033 |
4 191 |
158 |
La figure 1-2 met en �vidence les plans et priorit�s �tablis pour la p�riode de 2006-2007 � 2008 2009 (tels que d�finis dans le Rapport sur les plans et priorit�s (RPP) de 2006-2007 du CNRC).
Figure 1-2 : Cadre strat�gique des plans et priorit�s du CNRC
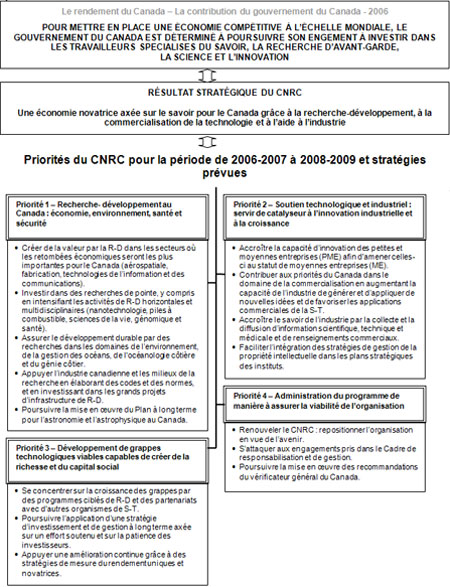
Tableau 1-2 : Priorit�s du CNRC pour 2006-2007 : activit�s et gestion
|
R�sultat strat�gique du CNRC Une �conomie novatrice ax�e sur le savoir pour le Canada gr�ce � la recherche-d�veloppement, � la commercialisation de la technologie et � l'aide � l'industrie |
Rendement obtenu* |
2006-2007 |
||
|
Priorit�s et type |
Activit� de programme et r�sultats pr�vus |
D�penses pr�vues |
D�penses r�elles |
|
|
Priorit� no 1 |
Activit� de programme : Recherche- d�veloppement |
Atteint |
390,66 |
380,8 |
|
R�sultats pr�vus :
|
||||
|
Priorit� no 2 Genre : continu |
Activit� de programme : Soutien technologique et industriel |
Atteint |
179,22 |
182,2 |
|
R�sultats pr�vus :
|
||||
|
Priorit� no 3 Genre : d�j� engag� |
Activit� de programme : Recherche-d�veloppement et Soutien technologique et industriel |
Atteint |
75,89 |
75,.2 |
|
R�sultats pr�vus :
|
||||
|
Priorit� no 4 Genre : continu |
Activit� de programme : |
Atteint |
68,28 |
103,9 |
|
R�sultats pr�vus :
|
||||
* Il convient de souligner que les r�sultats pr�vus d�finis dans le RPP de 2005-2006 s'appliquent � une p�riode de trois ans, ce qui explique que tous les r�sultats indiqu�s n'aient pas �t� atteints au cours de l'exercice financier 2005-2006; n�anmoins, on consid�re que dans l'ensemble, l'objectif de la priorit� est atteint.
** La contribution des activit�s de programme � cette priorit� est activement appuy�e par les directions centrales du CNRC qui veillent � l'�laboration des politiques, formulent des conseils et offrent un soutien � la haute direction dans la coordination et la direction des activit�s du CNRC et de son conseil d'administration. Les directions centrales ont aussi d'autres sp�cialit�s :
finances, gestion de l'information, ressources humaines, services administratifs et gestion immobili�re, et services corporatifs.
Contexte de fonctionnement du CNRC
Attributs uniques du CNRC
- Le CNRC dispose d'une infrastructure nationale de S-T qui lui donne les moyens d'accro�tre la capacit� d'innovation du Canada dans les domaines de recherche actuels et en �mergence, de constituer des r�seaux de chercheurs et d'entreprises, de former du personnel hautement qualifi�, de cr�er des entreprises et des emplois ax�s sur la technologie, de transf�rer son savoir et ses technologies aux entreprises canadiennes.
- Le CNRC cr�e de la valeur au Canada en misant sur ses principaux atouts, en l'occurrence ses quelque 4 000 employ�s talentueux et d�vou�s, ses 19 instituts de recherche, ses 15 installations de partenariat industriel, le Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI-CNRC), l'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC) et deux centres de technologie.
- Le CNRC poss�de les outils n�cessaires pour aider les entreprises � faire sortir les d�couvertes des laboratoires en participant au d�veloppement et � la construction de prototypes et � la commercialisation de produits sur les march�s mondiaux.
- Le CNRC peut axer la recherche sur des objectifs pr�cis, � court et � long termes.
- Le CNRC peut r�unir des �quipes de chercheurs multidisciplinaires capables de s'attaquer � des questions d'importance nationale.
- Le CNRC poss�de la capacit� de lancer des programmes nationaux et de les offrir dans toutes les r�gions du pays.
Infrastructure nationale de S-T
Le CNRC offre un programme national de S-T en s'appuyant sur ses laboratoires, ses centres et ses installations r�partis dans des collectivit�s partout au Canada (www.nrc-cnrc.gc.ca/contactIBP_f.html).
Propri�t�, gestion et entretien des immobilisations
Assumant l'enti�re responsabilit� de ses activit�s techniques, tr�s sp�cialis�es et complexes, le CNRC assure la gestion d'un parc immobilier de 175 �difices dont la superficie totale atteint environ 517 406 m�tres carr�s.
Financement
Le CNRC obtient son financement sous la forme de cr�dits parlementaires. En contrepartie des services techniques rendus � des entreprises et � d'autres organisations, il per�oit des sommes correspondant � ses co�ts et les r�investit dans le fonctionnement et l'entretien de ses �quipements et installations.
Contexte
Facteurs internes
Nouvelle orientation strat�gique du CNRC : �tablissement d'une carte routi�re pour garantir la p�rennit� de l'organisation
L'exercice 2006-2007 a d�but� avec la publication officielle de la nouvelle strat�gie du CNRC, La Science � l'œuvre pour le Canada, � l'intention des employ�s et des principaux intervenants de l'organisation. Peu apr�s, le CNRC a lanc� la mise en œuvre de quatre initiatives importantes, avec le concours d'�quipes transorganisationelles poss�dant les comp�tences
requises :
- Programmes de recherche
- Examen des activit�s
- Gestion de la planification, du rendement et des ressources (GPRR)
- Organisation viable
Tel qu'illustr� ci-dessous, � l'automne 2006, les �quipes de mise en œuvre ont formul� et pr�sent� au Comit� de la haute direction (CHD) des recommandations dans le cadre de l'exercice annuel de fixation des priorit�s du CNRC. Les d�cisions prises par le CHD ont servi de trame de fond au plan d'activit�s inaugural du CNRC, dont une �bauche avait d�j� �t� pr�par�e pour la fin de l'exercice 2006‑2007. La version finale de ce plan devrait �tre en place au d�but de 2007-2008.
Figure 1-3 : Processus de mise en œuvre de la strat�gie du CNRC
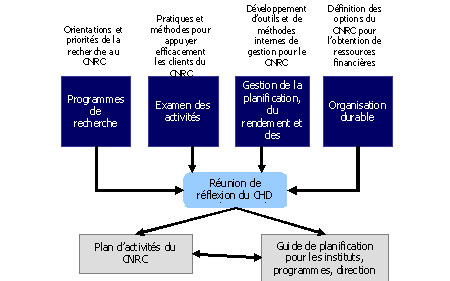
Voici un r�sum� des principales recommandations des �quipes de mise en œuvre, qui ont �t� approuv�es par le CHD :
Programmes de recherche
Le CNRC concentrera ses efforts de R-D dans neuf secteurs cl�s : a�rospatiale, agriculture, automobile, construction, fabrication, instruments �lectroniques, mat�riaux et biopharmaceutique, produits chimiques, et technologies de l'information et des communications. Cette liste a �t� �tablie � la suite d'une importante analyse quantitative et qualitative et de consultations
tenues tout au long de 2006-2007 aupr�s des parties int�ress�es internes et externes. Chaque vice-pr�sident, Recherche du CNRC assumera la responsabilit� d'un ou plusieurs secteurs. � partir de 2007-2008, des directeurs g�n�raux (DG) seront d�sign�s pour diriger l'�laboration des plans et des objectifs dans chaque secteur.
En outre, le CNRC collaborera �troitement avec d'autres minist�res f�d�raux, des entreprises et des universit�s afin de s'attaquer aux priorit�s nationales dans le domaine de la sant� et du mieux-�tre, de l'�nergie durable et de l'environnement. � titre de premi�re initiative majeure dans le cadre de la nouvelle strat�gie, le CNRC s'est engag�, en collaboration avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, � mettre en place un programme national des bioproduits qui r�pondra aux deux derni�res priorit�s nationales mentionn�es. La responsabilit� globale de ce programme a �t� confi�e � un vice-pr�sident, un directeur g�n�ral a �t� plac� � la t�te du projet et un groupe de travail a �t� affect� � son d�veloppement. Le lancement du Programme national des bioproduits devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 2008-2009.
Le CNRC a aussi cern� la possibilit� de s'appuyer sur un programme transorganisationnel existant pour lancer un deuxi�me programme national dans le domaine des piles � combustible et de l'hydrog�ne. Le lancement officiel de cet autre programme est pr�vu pour 2009-2010, mais le travail de planification commencera en fait en 2007-2008.
Examen des activit�s
La strat�gie du CNRC pr�voit des activit�s accrues de sensibilisation et une collaboration plus �troite avec les clients et principaux intervenants du syst�me d'innovation. Il a donc �t� d�cid� de mettre en œuvre un examen des activit�s afin de mieux d�finir les m�thodes et les pratiques du CNRC (� l'�gard des clients, collaborateurs et autres tiers) et de recommander des
changements qui concr�tiseront le virage du CNRC vers une strat�gie ax�e sur le client.
Dans la foul�e de cette initiative, le CNRC s'est engag� � faire en sorte que ses instituts, directions et programmes misent davantage sur les relations avec les clients afin de maximiser la valeur que l'organisme est en mesure de leur offrir. Il a donc �t� d�cid� de faire une priorit� de la mise en place d'un syst�me informatis� de gestion des relations avec la client�le, et le CNRC a r�serv� les ressources financi�res et non financi�res requises � cette fin.
Le CNRC formera �galement mieux les employ�s qui interagissent directement avec la client�le, augmentera ses capacit�s de commercialisation et reverra certaines de ses m�thodes internes, comme le processus d'examen et d'approbation des contrats. En collaboration avec d'autres �l�ments de l'organisation, le vice-pr�sident, Soutien technologique et industriel, pr�sentera � la fin de 2006-2007 une analyse de rentabilisation qui �tablira les ressources n�cessaires pour mettre en œuvre ces recommandations.
Gestion de la planification, du rendement et des ressources (GPRR)
L'initiative de GPRR insiste sur l'�tablissement et l'am�lioration des pratiques de gestion au CNRC. Voici quelques-unes des r�alisations dans le cadre de cette initiative mise en œuvre en 2006‑2007 :
a) �tablissement d'un nouveau processus de planification des activit�s applicable � l'ensemble de l'organisation. Ce processus a �t� �labor� et mis � l'essai en 2006-2007. Il int�gre la planification strat�gique et op�rationnelle, la mesure du rendement, la gestion des risques et la gestion des ressources (financi�res, humaines et mat�rielles). Tous les instituts, directions et programmes du CNRC devront � l'avenir se doter d'un plan d'activit�s triennal � horizon mobile.
b) �tablissement d'un nouveau cadre de gestion du rendement � l'appui de la strat�gie du CNRC. Le d�veloppement d'un cadre de gestion du rendement fond� sur le tableau de bord prospectif a d�but� en 2006-2007. � la fin de l'exercice financier, on disposait d'une �bauche proposant de nouveaux indicateurs de rendement. De nouvelles consultations sont pr�vues en 2007-2008, puis on parach�vera le cadre et on le mettra en œuvre int�gralement dans l'ensemble du CNRC.
c) Cr�ation d'une nouvelle architecture d'activit�s de programme (AAP) pour le CNRC. Au quatri�me trimestre de 2006-2007, le CHD a approuv� la nouvelle AAP du CNRC. Celle-ci servira de base � toutes les activit�s de planification � l'avenir. L'AAP sera examin�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT) en 2007-2008. Une analyse de rentabilisation fixant tous les d�tails des exigences li�es � la mise en œuvre devrait �tre d�pos�e au premier trimestre de 2007-2008.
Organisation durable
L'initiative de mise en œuvre du concept d'organisation durable visait � d�finir les options qui s'offrent au CNRC afin d'assurer sa viabilit� financi�re � long terme. L'�quipe du projet a formul� un certain nombre de recommandations initiales qui ont �t� pr�sent�es au CHD et auxquelles on a mis la derni�re main avant la fin de l'exercice. Plus pr�cis�ment, le
CNRC :
- concentrera les priorit�s de R-D de l'organisation dans des domaines pr�cis : secteurs cl�s, priorit�s nationales, innovations r�gionales et communautaires (y compris les grappes technologiques) et domaines relevant de son mandat national;
- dressera la liste des gains d'efficacit� op�rationnels possibles � l'interne;
- collaborera davantage avec des tiers;
- r�pertoriera les domaines ou des investissements et du financement seront n�cessaires.
Facteurs externes
Conjoncture �conomique – L'�conomie canadienne est demeur�e vigoureuse en 2006, le PIB r�el affichant un taux de croissance de 2,7 %, un l�ger ralentissement par rapport au taux de 2,9 % enregistr� l'ann�e pr�c�dente1.
En 2006, le march� de l'emploi est demeur� dynamique au Canada, le nombre d'emplois cr��s se chiffrant � 314 600, soit une augmentation de 1,9 % – un taux sup�rieur � cellui de chacune des deux ann�es pr�c�dentes. La majorit� de ces nouveaux emplois sont aussi des emplois � temps plein (2,3 %), les emplois � temps partiel ne repr�sentant que 0,4 % de l'augmentation. Le taux de ch�mage au Canada a atteint un plancher historique, se situant en moyenne � 6,3 % en 2006, en baisse par rapport � 6,8 % en 2005. Le taux de ch�mage a termin� l'ann�e � 6,1 % en d�cembre 20062.
Le dollar canadien s'est appr�ci� de 6,8 % par rapport au dollar am�ricain en 2006 et de 6,0 % et 5,6 % par rapport � l'euro et � la livre sterling respectivement. Cette appr�ciation s'explique en partie par la pouss�e des prix des produits de base. Malgr� l'appr�ciation du huard, les exportations canadiennes de marchandises ont augment� l�g�rement en 2006 (1,2 %)3.
Les d�penses personnelles des consommateurs (produits et services) ont progress� de 4,1 % en 2006, la plus forte augmentation depuis 1997. Cette vigueur des d�penses des particuliers n'est pas �tonnante puisque le revenu des travailleurs et les b�n�fices des entreprises ont tous deux augment� d'environ 6 %4.
Atteignant la valeur de 598 millions de dollars au premier trimestre de 2007, les investissements en capital de risque �taient en tr�s nette croissance partout au Canada, tant sur une base annuelle que sur une base trimestrielle. L'augmentation a �t� de 62 % par rapport aux 370 millions de dollars investis au cours du premier trimestre de 2006 et de 16 % par rapport aux 517 millions de dollars investis au cours du trimestre pr�c�dent (quatri�me trimestre de 2006). C'est en Ontario que la croissance des investissements en capital de risque a �t� la plus forte : 302 millions de dollars y ont �t� investis, soit plus du double des 149 millions de dollars investis au premier trimestre de 20065.
Les investissements en biopharmaceutique et dans les autres sciences de la vie ont aussi augment� au premier trimestre de 2007, 25 entreprises recevant 206 millions de dollars en nouveau capital de risque (en hausse de 44 % par rapport aux 143 millions du premier trimestre de 2006). Les investissements en capital de risque dans les technologies environnementales � propres � ont �galement affich� une forte croissance durant le trimestre, 35 millions de dollars ayant �t� investis dans neuf entreprises, comparativement � 15 millions de dollars investis dans sept transactions au cours du premier trimestre de 20066.
Lien avec les r�sultats strat�giques du gouvernement du Canada – Au fil de son histoire, le CNRC a accumul� des d�couvertes scientifiques qui ont contribu�, et contribuent encore, au bien-�tre de l'ensemble de la population canadienne, de l'industrie du pays et d'autres personnes et industries partout dans le monde. Les efforts du CNRC sont venus appuyer deux grands r�sultats strat�giques du gouvernement du Canada d�crites ci‑dessous :
- Une �conomie novatrice ax�e sur le savoir : L'am�lioration des conditions de vie de tous les Canadiens est la priorit� la plus �lev�e du gouvernement f�d�ral7, qui s'efforce de rehausser le niveau de vie et la qualit� de vie de ses citoyens. Le d�ploiement d'efforts productifs en science et en technologie, en �ducation et en commercialisation est essentiel � l'atteinte de cet objectif. Le CNRC appuie l'av�nement d'une �conomie novatrice et ax�e sur le savoir du Canada en mettant l'accent sur l'excellence et le leadership en R-D; la croissance des grappes technologiques; la valeur ajout�e cr��e au Canada par transferts de connaissances; et le perfectionnement des employ�s exceptionnels par l'�ducation et la formation.
- Un monde plus s�r gr�ce � la coop�ration internationale : Le Canada cherche � jouer un r�le majeur dans l'att�nuation des difficult�s mondiales dans le domaine de l'�conomie, de la sant�, de l'environnement et de la s�curit�. Gr�ce � ses recherches en g�nomique et en sant� et sur les technologies propices au d�veloppement durable et � l'environnement, ainsi que par l'attention qu'il accorde aux projets de recherche conjoints internationaux et � l'aide � la recherche internationale, le CNRC contribue au d�veloppement d'une �conomie prosp�re qui est � l'avantage des Canadiens et du monde entier.
1 Le commerce international du Canada : Le point sur le commerce et l'investissement – 2007, 7 juin 2007, http://www.dfait-maeci.gc.ca/eet/pdf/07-1989-DFAIT-fr.pdf
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Canada's Venture Capital Industry in Q1 2007, Thomson Financial. 2007, http://www.canadavc.com/files/Q12007OverviewFrench.pdf.
6 Ibid.
7 Discours du budget (mai 2006), honorable Jim Flaherty, ministre des Finances, www.fin.gc.ca/budget06/pdf/speechf.pdf.
Section II : Analyse des activit�s de programme
La pr�sente section donne un aper�u des activit�s de programme du CNRC (fond�es sur l'Architecture d'activit�s de programme �tablie en 2004) et de la mani�re dont elles ont contribu� � l'atteinte des quatre priorit�s de l'organisation (�tablies dans le RPP de 2006-2007) et � l'obtention du r�sultat strat�gique recherch� par le CNRC : une �conomie novatrice ax�e sur le savoir pour le Canada gr�ce � la recherche-d�veloppement, � la commercialisation de la technologie et � l'aide � l'industrie.
Aper�u des activit�s de programme
Les activit�s de programme du CNRC se r�partissent en deux grands secteurs d'activit� (Recherche-d�veloppement et Soutien technologique et industriel). Le CNRC atteint ainsi un �quilibre entre ses activit�s de R-D et l'offre de services de soutien technique et � l'innovation tant � l'industrie qu'au public.
Tableau 2-1 : Profil des activit�s de programme
Programmes du CNRC
En 2006-2007, outre ses activit�s particuli�res de Recherche-d�veloppement et de Soutien technologique et industriel, le CNRC a concentr� ses efforts dans des programmes qui appuient les grandes priorit�s du Canada. Nombre de ces programmes sont des initiatives multidisciplinaires et transorganisationnelles auxquelles participent un certain nombre d'entit�s du CNRC (instituts de recherche, laboratoires, centres, installations, programmes et services). Ces programmes conjoints contribuent aux priorit�s gouvernementales visant � optimiser les investissements en S-T ainsi qu'� accro�tre la valeur que les Canadiens en tirent et leur port�e. On trouvera des exemples des efforts de programmation du CNRC dans ces domaines dans les sections � Pleins feux sur les programmes � suivantes :
- Initiative en g�nomique et en sant� (IGS)
- Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI-CNRC)
- Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC)
Rendement global du CNRC en 2006-2007
Priorit� no 1 : Recherche-d�veloppement au Canada : �conomie, environnement, sant� et s�curit�
|
Indicateurs de rendement (d�finis dans le RPP de 2006-2007) |
|
Les indicateurs de rendement qui ne changent pas d'un exercice � l'autre ne sont pas analys�s annuellement.
En 2006-2007, le portefeuille de Recherche-d�veloppement a contribu� � l'avancement dans des domaines reconnus comme prioritaires pour le Canada gr�ce � ses atouts de base : des instituts de recherche nationaux et des activit�s d'innovation dans des domaines technologiques importants pour le Canada; la cr�ation de valeur gr�ce aux transferts de savoir et de technologies; l'ex�cution de recherches de pointe int�gr�es dans des domaines interdisciplinaires en �mergence; et la cr�ation de retomb�es �conomiques et sociales pour les Canadiens. Le soutien continu � l'industrie canadienne et aux milieux de la recherche par l'�laboration de codes et de normes, par l'acc�s aux installations nationales et par la g�rance des grandes installations scientifiques canadiennes reste le fondement qui permet aux chercheurs canadiens d'acc�der aux march�s mondiaux et de conclure des alliances internationales en R-D. Le portefeuille a continu� de d�velopper de nouvelles technologies afin de cr�er des possibilit�s de commercialisation pour l'industrie canadienne.
L'obtention d'un brevet est une �tape cl� dans le continuum menant de la d�couverte � l'innovation. La gestion strat�gique de la propri�t� intellectuelle (PI) contribue � accro�tre la capacit� d'innovation des entreprises. En 2006-2007, le CNRC a demand� 215 nouveaux brevets et en a obtenu 78 � la suite de demandes ant�rieures. Quarante cinq pour cent de ces brevets ont �t� accord�s aux �tats-Unis, un indicateur de comp�titivit� reconnu par l'Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques (OCDE). S'appuyant sur les r�sultats d'une �tude comparative effectu�e en 2003 et portant sur plusieurs pratiques exemplaires de gestion de la PI, le CNRC modifie son approche en �vitant les divulgations trop h�tives. Il effectue des �tudes de march� et des analyses de brevets, et revoit r�guli�rement son portefeuille de PI afin d'en tirer le maximum de valeur commerciale et de mieux d�celer et d�velopper la propri�t� intellectuelle pr�sentant � un potentiel commercial �lev� �.
Le partenaire du CNRC qui n�gocie l'obtention d'une licence d'utilisation d'une des technologies de l'organisme confirme, ce faisant, le m�rite de la recherche effectu�e au CNRC. Ces contrats de licence contribuent directement � la transformation des innovations en applications commerciales. Le CNRC a conclu 102 nouveaux contrats de licence en 2006-2007 et les redevances touch�es sur sa propri�t� intellectuelle en 2006-2007 se sont �lev�es � 5 millions de dollars (voir la figure 2-1).
Figure 2-1 : Portefeuille de la PI du CNRC (de 2002 � 2007)
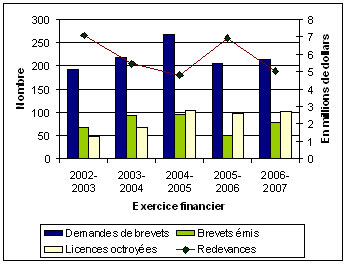
Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006
Un peu plus de 2,3 millions de dollars des revenus g�n�r�s par la PI en 2006-2007 viennent directement du vaccin contre la m�ningite C d�velopp� par l'Institut des sciences biologiques du CNRC (ISB-CNRC). Le d�veloppement de mat�riel informatique et de logiciels par l'Institut de technologie de l'information du CNRC (ITI-CNRC) a par ailleurs g�n�r� des redevances de 1,1 million de dollars.
Voici quelques exemples des technologies du CNRC c�d�es sous licence � l'industrie en 2006 2007 :
- En d�cembre 2006, la soci�t� canadienne Nstein Technologies Inc. a annonc� la signature d'un contrat de licence de dix ans et d'un accord de recherche conjointe de trois ans li� � l'utilisation de la technologie d'exploration de texte � Factor � du CNRC. D�velopp� par l'ITI-CNRC, Factor est un outil de recherche d'avant-garde qui permettra � Nstein de se d�marquer de ses concurrents sur le march� de l'analyse de texte. D'une valeur de plus de 7,5 millions de dollars, ce partenariat ax� sur la recherche et la technologie figure parmi les plus importants accords de commercialisation conclus par l'ITI-CNRC.
- L'Institut des �talons nationaux de mesure du CNRC (IENM-CNRC), un chef de file mondial dans le domaine de la dosim�trie des radioth�rapies, continue de tirer des redevances de la licence accord�e � MDS Nordion pour l'utilisation du code de Monte Carlo qui sert au calcul des faisceaux d'�lectrons. Cette entreprise canadienne a vendu en 2003 son portefeuille de logiciels en oncologie � une soci�t� internationale, Nucletron� B.V. et la licence a �t� prolong�e de cinq ans jusqu'en d�cembre 2012.
- L'Institut des sciences des microstructures du CNRC (ISM-CNRC) a particip� activement au d�veloppement d'OLED (dispositifs organiques �lectroluminescents) en collaboration avec des partenaires canadiens et internationaux. Un partenariat avec l'Universit� nationale Tsing Hua de Taiwan a permis � cet �tablissement d'enseignement de synth�tiser un nouveau compos� organique qui a men� � la fabrication de dispositifs prometteurs sur le plan commercial, d'o� le d�p�t de demandes de brevet au Canada, aux �tats-Unis et � Taiwan.
Lorsque le CNRC d�veloppe une technologie ayant un potentiel commercial important sans qu'il y ait au Canada une entreprise capable d'absorber cette technologie, de nouvelles entreprises sont parfois cr��es afin de la commercialiser. Ces nouvelles entreprises g�n�rent des produits et services novateurs pour le march� mondial et cr�ent des emplois pour les Canadiens. En 2006 2007, le CNRC a ainsi lanc� une nouvelle entreprise, ce qui porte � 68 le total de nouvelles entreprises cr��es depuis 1995, soit environ 604 emplois � temps plein et des investissements cumulatifs estim�s � 437 millions de dollars — une diminution de 6 % par rapport � l'an dernier8. En 2006, les investissements de toutes provenances dans les nouvelles entreprises cr��es par le CNRC se sont �lev�s � 63 millions de dollars.
Voici une br�ve description de l'entreprise cr��e en 2006-2007 :
- Kent Imaging Inc. – S'appuyant sur une technologie brevet�e par le CNRC, Kent Imaging a mis au point un syst�me de cam�ra qui permettra aux m�decins et aux chirurgiens travaillant en salle d'urgence de sonder les tissus bless�s ou reconstruits afin d'�tablir leur �tat de sant�. La prise d'images de � viabilit� � des tissus au moyen de ce syst�me donnera aux m�decins de l'information sur la quantit� de sang et d'oxyg�ne qui atteint les tissus en question. Les m�decins auront ainsi une meilleure id�e du potentiel de survie de ces tissus. Ce sont l� des �l�ments d'information essentiels qui contribueront � la prise de d�cisions critiques lors de l'�valuation initiale des blessures, pendant les interventions chirurgicales et pendant la r�cup�ration postchirurgicale.
Le nombre d'articles scientifiques publi�s dans les grandes revues savantes � comit� de lecture et dans les comptes rendus de conf�rences est une mesure reconnue � l'�chelle internationale de la qualit� et de la pertinence des recherches effectu�es. Ces articles sont aussi un outil cl� de diffusion du savoir et de cr�ation de richesses � long terme pour le Canada. Au cours des cinq derni�res ann�es, les chercheurs du CNRC ont constamment produit plus d'un millier d'articles dans des publications � comit� de lecture. En 2006-2007, ils ont notamment publi� 1 403 articles dans des revues � comit� de lecture. Les chercheurs du CNRC ont par ailleurs pr�sent� 870 communications dans le cadre de conf�rences scientifiques et technologiques et produit 1 239 rapports techniques pour le compte de clients (voir la figure 2-2).
Figure 2-2 : Nombre d'articles publi�s (de 2002 � 2007)
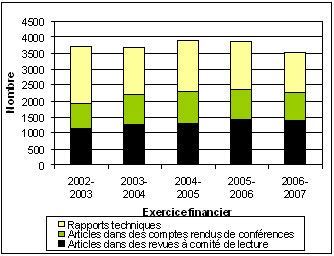
Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006
La participation des chercheurs du CNRC aux activit�s de r�seaux et de centres d'excellence regroupant de multiples chercheurs ainsi que le nombre de projets de recherche �valu�s par un comit� et subventionn�s par des organismes externes t�moignent aussi de mani�re �loquente de l'excellence des recherches effectu�es. En 2006-2007, les chercheurs du CNRC ont particip� aux travaux de 110 r�seaux de recherche, occup� 217 postes au sein de comit�s de r�daction de revues scientifiques et ont �t� nomm�s � 499 postes de professeur auxiliaire dans des universit�s canadiennes. Gr�ce � 174 subventions, les chercheurs du CNRC et leurs partenaires ont obtenu 36 millions de dollars pour la dur�e de vie de leurs projets. On trouvera � la section IV – Prix et r�alisations, des exemples de prix venant d'organisations ext�rieures re�us par des chercheurs du CNRC l'ann�e derni�re.
En participant aux travaux de 593 comit�s nationaux et en organisant 206 conf�rences et ateliers, les chercheurs et instituts du CNRC ont d�montr� l’innovation dont ils sont capables et le leadership qu’ils exercent � l’�chelle nationale dans le domaine de la R-D.
Figure 2-3: Collaborations canadiennes (2002 � 2007)
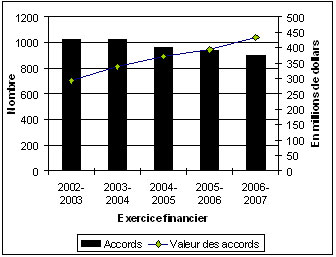
Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006
En 2006-2007, le CNRC a sign� avec des partenaires canadiens 361 nouveaux accords de recherche conjointe officiels d'une valeur globale de 149 millions de dollars. La valeur totale des accords pendant toute leur dur�e pr�vue a grimp� � 434 millions de dollars en 2006-2007 (voir la figure 2-3). Le nombre et la valeur des accords de collaboration constituent des indicateurs permettant de pr�voir l'intensit� future des activit�s de recherche au Canada. Pour chaque dollar investi par le CNRC, ses partenaires canadiens investissent 1,48 $.
La participation � des projets et consortiums internationaux expose les �tudiants, les chercheurs et les entreprises du Canada � ce qui se fait de mieux dans le monde. En 2006-2007, le CNRC a sign� avec des partenaires internationaux 99 nouveaux accords formels de collaboration d’une valeur totale de 41 millions de dollars. Le nombre total d’accords de collaboration internationaux en vigueur est semblable � celui enregistr� l’an dernier (voir la figure 2-4), leur valeur sur l’ensemble de leur dur�e atteignant presque 145 millions de dollars. Pour chaque dollar investi par le CNRC, ses partenaires internationaux investissent 5,30 $.
Figure 2-4: Projets conjoints internationaux du CNRC (de 2002 � 2007)
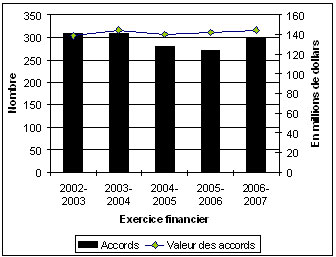
Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 2006
8 Adventus Research Inc., Economic Impact of National Research Council Canada Spin-Off Companies 2007 Survey, 25 f�vrier 2007.
Strat�gie : Cr�er de la valeur par la R-D dans les secteurs o� les retomb�es �conomiques seront les plus importantes pour le Canada. |
Faciliter la transition vers la prochaine g�n�ration d'a�ronefs – L'exercice 2006-2007 repr�sentait le deuxi�me exercice du Centre des technologies de fabrication en a�rospatiale du CNRC (CTFA-CNRC) dans ses nouveaux locaux � Montr�al. Au cours de l'exercice, le Centre a lanc� un projet de d�monstration technologique de 9 millions de dollars gr�ce � une aide financi�re de D�veloppement �conomique Canada pour les r�gions du Qu�bec. Ce projet est centr� sur la fabrication de gros composants structurels d'a�ronef au moyen de mat�riaux composites. Le projet a pour objectif strat�gique de faciliter le d�veloppement au Canada d'un int�grateur de gros sous-composants de niveau 2 au sein de la cha�ne d'approvisionnement de l'industrie a�rospatiale.
En 2006-2007, le Laboratoire des turbines � gaz du CNRC (LTG-CNRC), de concert avec la Direction g�n�rale de l'a�rospatiale et de la d�fense d'Industrie Canada, a cr�� un r�seau national pour le d�veloppement d'une carte routi�re technologique et d'une capacit� de d�monstration technologique dans le domaine de la gestion des diagnostics, des pronostics et de la viabilit� des a�ronefs. Ce r�seau, constitu� des grands �quipementiers canadiens (Bell Helicopter, Pratt & Whitney et Bombardier), d'organismes publics, d'universit�s et de petites et moyennes entreprises (PME) du secteur de l'a�rospatiale, a r�pertori� les besoins technologiques prioritaires dans le cadre de 14 projets et trouv� le financement n�cessaire � deux nouveaux projets au cours de 2006-2007. Ce r�seau relie pour la premi�re fois tous les maillons du syst�me d'innovation dans ce domaine. Environ 80 participants ont collabor� � l'avancement du processus de cr�ation des �quipes. Un comit� directeur national dirige les activit�s dans le cadre de r�unions tenues � intervalles r�guliers et au moyen d'un site Web. L'�tablissement de ce r�seau et la mise en œuvre en �quipe d'innovations au sein du milieu sont � l'avantage de l'industrie a�rospatiale canadienne et permettront la mise au point d'un mod�le de fonctionnement pour l'�laboration d'une carte routi�re technologique dans le domaine de la dynamique des fluides num�riques ax�e sur la combustion.
L'Institut de recherche a�rospatiale du CNRC (IRA-CNRC) et GE Aviation, en partenariat avec A�roports de Montr�al, ont construit une nouvelle installation pour proc�der � des essais de givrage pour la certification de gros moteurs. La construction de cette installation � l'extr�mit� de la piste de l'A�roport international de Mirabel de Montr�al a pris fin en f�vrier 2007. Combin�e aux installations existantes � Ottawa, cette nouvelle installation du CNRC pourrait faire du Canada un centre d'excellence mondiale en essais de givrage � des fins de certification.
Faire de l'industrie canadienne un acteur cl� dans le domaine des technologies de fabrication avanc�e – En 2006-2007, l'Institut des mat�riaux industriels du CNRC (IMI-CNRC) a continu� de se concentrer sur le secteur de la transformation et du formage. Des progr�s �normes ont �t� accomplis dans le secteur des biomat�riaux, des technologies li�es aux mousses m�talliques, du formage de l'aluminium, des membranes environnementales, des composites en fibres naturelles et des polym�res biod�gradables. Parmi les secteurs desservis, mentionnons l'automobile, les dispositifs m�dicaux, l'a�rospatiale et la fabrication g�n�rale des produits en m�tal et en plastique. L'IMI-CNRC, notamment, a d�velopp� un mod�le math�matique int�gr� pour l'hydroformage de composantes structurelles d'automobile en aluminium. Cet institut a aussi fait preuve d'innovation en d�veloppant de nouvelles pi�ces de suspension arri�re en aluminium pour automobiles. Ces pi�ces seront int�gr�es aux automobiles fabriqu�es de 2010 � 2012. Le concept a �t� optimis� pour faciliter leur assemblage au moyen de mat�riel de soudage robotis�.
Le CTFA-CNRC a obtenu rapidement des r�sultats appr�ciables dans le cadre de quelques projets men�s avec General Motors et Bombardier. Un projet de collaboration avec General Motors du Canada (GMC) sur l'usinage � haute vitesse de l'acier et de la fonte nodulaire a permis d'obtenir une vitesse d'enl�vement de la mati�re plus �lev�e que jamais auparavant, ce qui a des retomb�es favorables importantes sur la productivit� et r�duit les co�ts de fabrication des vilebrequins et des arbres � cames chez GMC. En collaboration avec Bombardier A�rospatiale (BA), le CTFA-IRA-CNRC a aussi d�velopp� le premier syst�me de positionnement � haute pr�cision du monde pour le rivetage des panneaux de fuselage au moyen d'assistants robotis�s. De nouvelles m�thodes d'�talonnage et le recours � la m�trologie pour contr�ler le positionnement ont accru la pr�cision du positionnement de la pi�ce sur les panneaux. Selon les pr�visions de Bombardier, la mise en œuvre de ce syst�me entra�nera une r�duction de 50 % � 75 % des co�ts de production des composants du fuselage et r�duira par ailleurs l'incidence des maladies professionnelles, car il �liminera la n�cessit� d'avoir un op�rateur humain dans un milieu de travail bruyant. Selon le client, cette perc�e garantira le maintien � Montr�al de la production des panneaux de fuselage de la plupart des a�ronefs de BA plut�t que sa d�localisation � l'�tranger.
En collaboration avec des partenaires de l'industrie, des universit�s et de l'administration publique, l'Institut des technologies de fabrication int�gr�e du CNRC (ITFI-CNRC) a organis� six rencontres avec des membres actuels et potentiels de trois groupes d'int�r�t sp�ciaux : le Groupe d'int�r�t en technologies de fabrication de pr�cision de forme libre (PFFTech), le Groupe d'int�r�t en technologies de microfabrication de pr�cision (PMFTech) et le Groupe d'int�r�t en technologies de fabrication reconfigurable et flexible (RFMTech).
L'Institut de technologie des proc�d�s chimiques et de l'environnement du CNRC (ITPCE-CNRC) a maintenu deux grandes orientations : les m�thodes ax�es sur l'efficacit� �nerg�tique et les mat�riaux ax�s sur les solutions dans un contexte de d�veloppement durable. L'Institut a collabor� avec Environnement Canada, Industrie Canada, Ressources naturelles Canada et Five Winds International au perfectionnement de SAFT V2, un outil qui peut aider les chercheurs des entreprises � d�terminer la durabilit� globale des m�thodes de recherche et des proc�d�s industriels propos�s. Dans le cadre de l'�valuation, l'outil a �t� appliqu� � plusieurs projets sur les bioproduits actuellement en cours au CNRC. L'ITPCE-CNRC a aussi continu� de miser sur ses capacit�s de recherche dans le secteur des piles � combustible, cr�ant de nouveaux mat�riaux qui seront sup�rieurs aux membranes commerciales actuelles sur le plan des co�ts et du rendement. Dans le domaine des sables bitumineux, l'ITPCE-CNRC a d�velopp� et renouvel� des liens de collaboration avec le R�seau canadien pour la recherche-d�veloppement sur les sables p�trolif�res (CONRAD) et avec Syncrude. Cette collaboration avec l'industrie compl�te l'investissement significatif d'autres minist�res dans le programme de recherche de l'ITPCE-CNRC afin de mettre au point une m�thode scientifique fondamentale pour le traitement chimique des sables bitumineux qui r�duira de mani�re appr�ciable la quantit� d'�nergie requise et simplifiera les m�thodes associ�es � la production de p�trole brut synth�tique.
En 2006-2007, le programme de R-D de l'Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC (IIPC‑CNRC) visait � faire progresser la science fondamentale li�e aux piles � combustible et leurs applications technologiques, ainsi qu'� acc�l�rer l'adaptation et la commercialisation de ces technologies. Pour contribuer � ces objectifs, l'Institut a r�uni une �quipe multidisciplinaire de scientifiques, d'ing�nieurs et de techniciens poss�dant des comp�tences reconnues dans les technologies li�es aux piles � combustible et � l'hydrog�ne. En 2006-2007, l'IIPC-CNRC a franchi plusieurs �tapes cruciales dans le domaine des nouveaux mat�riaux et de la fabrication de pointe. Ces perc�es r�duiront le co�t des mat�riaux n�cessaires � la fabrication de piles � combustible � membrane �changeuse de protons (PEM) et de piles � combustible � oxyde solide (SOFC), ce qui permettra � l'industrie canadienne des piles � combustible et de l'hydrog�ne de se lancer dans la production � grande �chelle de mat�riaux pour la fabrication de piles � combustible.
- S'appuyant sur la technologie de d�p�t r�actif par pulv�risation, l'IIPC-CNRC a d�velopp� des modules membrane-�lectrode � haut rendement avec des couches catalytiques � faible capacit� de charge en nanoplatine. Gr�ce au d�veloppement d'une technique perfectionn�e d'enduit catalytique pour membrane et au recours � une base aspirante d�velopp�e � l'interne, l'IIPC-CNRC a r�ussi � am�liorer consid�rablement le rendement des membranes qui est maintenant sup�rieur � celui de nombreux modules membrane-�lectrode de base. Ces succ�s font de l'IIPC‑CNRC un chef de file dans le d�veloppement de modules membrane-�lectrode � haut rendement.
- Des m�thodes rentables de fabrication des SOFC ont �t� d�velopp�es. Ces m�thodes pourraient �tre utilis�es pour la fabrication de masse. La production de nanopoudres pour les SOFC au moyen d'un proc�d� de projection plasma avec alimentation par injection axiale, la fabrication de mat�riaux de couche mince pour les SOFC et le d�p�t d'�lectrolytes minces de SOFC parfaitement �tanches au gaz permettent la production de SOFC � des co�ts et � des temp�ratures moindres, ce qui am�liore consid�rablement le rendement global de ces piles � combustible et leur viabilit� commerciale.
- Le concept technique d'une cathode � air � deux couches, dot�e d'une couche de diffusion hydrophobe et d'une couche maill�e impr�gn�e d'un catalyseur, a �t� d�velopp� en remplacement de la cathode � air � quatre couches actuellement offerte sur le march�. Cette nouvelle cathode, qui offre une performance et une stabilit� �lev�es, a permis d'obtenir plusieurs brevets qui sont devenus la technologie de base de l'un des partenaires de la grappe locale dont l'IIPC-CNRC est le noyau. Gr�ce � cette technologie, ce client industriel a d�velopp� son premier produit rentable.
R�duire les risques et les co�ts des entreprises qui travaillent au d�veloppement des technologies de l'information et des communications de la prochaine g�n�ration – En 2006‑2007, l'Institut des sciences des microstructures du CNRC (ISM-CNRC) et l'Institut de technologie de l'information du CNRC (ITI-CNRC) ont continu� de participer au d�veloppement des capacit�s de la prochaine g�n�ration dans le secteur des technologies de l'information et des communications. Les domaines de recherche prioritaires de l'ITI-CNRC sont la transformation des donn�es en savoir, les syst�mes ax�s sur les personnes et les affaires �lectroniques, ce qui am�ne l'Institut � s'int�resser entre autres � l'exploration de donn�es, � la cybers�curit� et � la traduction automatique.
Situ� sur le campus principal de l'Universit� du Qu�bec en Outaouais (UQO), le Centre de recherche en technologies langagi�res (CRTL) r�unit des chercheurs d'organisations partenaires (le Bureau de la traduction du Canada, l'UQO, Industrie Canada et l'ITI-CNRC) ainsi que l'Association de l'industrie de la langue (AILIA), le Bureau de liaison universit�-milieu (BLUM) et le Programme d'aide � la recherche industrielle du CNRC (PARI-CNRC). Ce groupe a r�ussi � regrouper une �quipe compl�te de chercheurs compos�e d'�tudiants dipl�m�s et de boursiers postdoctoraux. Trois technologies actuellement dans les cartons du groupe pr�sentent un potentiel de commercialisation : TransCheck (un logiciel de d�tection des erreurs de traduction), Bar�ah (un logiciel de soutien terminom�trique) et Portage (un syst�me de traduction automatique statistique). En d�cembre 2006, l'ITI-CNRC a sign� ses premiers accords de collaboration avec l'industrie pour l'utilisation de certains �l�ments de la technologie Portage, qui pourrait am�liorer les produits existants d'aide � la traduction.
En 2006-2007, le contrat de recherche de l'ITI-CNRC en vertu duquel la technologie PORTAGE est utilis�e dans le cadre du programme de recherche GALE (Global Autonomous Language Exploitation) dot� d'une enveloppe de plusieurs millions de dollars a �t� renouvel� pour une deuxi�me ann�e. Le projet GALE, parrain� par la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) de l'administration am�ricaine, a pour objectif de rendre les langues �trang�res �crites et parl�es (notamment l'arabe et le chinois) accessibles aux personnes unilingues anglaises, particuli�rement dans un contexte militaire. L'ITI-CNRC est le seul participant canadien � l'effort de R-D du projet GALE, le plus important projet au monde de traitement des langues naturelles. Cette participation est porteuse de rendements � venir. En travaillant avec les meilleurs chercheurs au monde, l'ITI-CNRC participe en effet au d�veloppement de technologies qui pourront, au bout du compte, �tre adopt�es par l'industrie canadienne et accro�tre la productivit� du Canada dans ce secteur en �mergence. La technologie PORTAGE a aussi contribu� au lancement d'un nouveau projet de recherche baptis� SMART, qui cible le d�veloppement de nouvelles techniques de traduction automatique en collaboration avec un consortium de laboratoires europ�ens.
L'ISM-CNRC estime aussi qu'il sera important dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) de travailler � l'�chelle nanom�trique et � l'�chelle quantique. Les travaux de l'ISM-CNRC avec les points quantiques auto‑assembl�s jettent les bases de sources futures de photons uniques et enchev�tr�s qui contribueront � accro�tre la s�curit� des transferts de donn�es au moyen de canaux de communication s'appuyant sur la fibre optique. Dans un autre domaine, l'ISM-CNRC a dirig� les travaux d'une �quipe regroupant des chercheurs de trois pays dont l'objet �tait de d�tecter sur le plan optique une fraction de la charge d'un �lectron, une perc�e qui a fait l'objet d'un article dans la prestigieuse revue Nature Physics.
Une �quipe de l'ISM-CNRC a fait la d�monstration du premier circuit �lectronique fonctionnel compos� de trois � spins � uniques plac�s dans un transistor � effet de champ et, en cons�quence, a �t� invit�e � s'associer � QuantumWorks, une nouvelle plate-forme d'innovation de l'Universit� de Waterloo financ�e par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada (CRSNG). Cette plateforme a pour objectif de mettre les chercheurs canadiens en contact avec des partenaires de l'industrie et des organismes publics afin que le Canada soit partie prenante � la r�volution technologique quantique et nanotechnologique.
En 2006, les chercheurs de trois instituts du CNRC ont fait la d�monstration du fonctionnement du premier �l�ment de capteur � fil photonique � champ �vanescent (PWEF) en silicium. Comme les �l�ments des capteurs optiques PWEF peuvent occuper sur une puce �lectronique un espace inf�rieur � quelques dizaines de microm�tres, cette technologie se pr�te particuli�rement bien � leur int�gration � une batterie de capteurs multiplexes, une exigence essentielle � la cr�ation d'une technologie pratique de captage mol�culaire. Cette technologie est �galement compatible avec les m�thodes de fabrication standard sur silicium et, par cons�quent, elle pourrait devenir une solution viable sur le plan de la fabrication, comblant ainsi le besoin de r�seaux de capteurs sans �tiquette pour l'�tablissement de diagnostics et la recherche en g�nomique et en prot�omique ainsi que pour le d�pistage de m�dicaments dans le secteur de la pharmaceutique.
Strat�gie : Investir dans des recherches de pointe, y compris en intensifiant les activit�s de R-D horizontales et multidisciplinaires. |
Contribuer au leadership du Canada dans le secteur des piles � combustible – Le Programme de piles � combustible et d'hydrog�ne mobilise les comp�tences et les atouts d'un r�seau d'instituts de recherche du CNRC partout au Canada, et notamment ceux de l'Institut d'innovation en piles � combustible (IIPC-CNRC) de Vancouver, l'organisme phare de ce programme pour lequel le CNRC a re�u une enveloppe budg�taire globale de 6,2 millions de dollars sur cinq ans (de 2003‑2004 � 2007-2008) afin d'en faire une initiative horizontale cl�. En 2006-2007, sept projets de recherche sur les piles � combustible � membrane �changeuse de protons et sur les piles � combustible � oxyde solide (SOFC) ont �t� financ�s � hauteur de 1,1 million de dollars dans cinq instituts du CNRC. Gr�ce � une contribution de contrepartie de chaque institut, la valeur totale du programme a �t� port�e � 4,5 millions de dollars. En 2006‑2007, 35 articles scientifiques ont �t� publi�s dans des revues � comit� de lecture et deux demandes de brevets ont �t� d�pos�es. Les r�ussites des chercheurs du CNRC dans le cadre de ce programme transorganisationnel ont �t� reconnues par le milieu universitaire. Le CNRC est d'ailleurs un partenaire important dans la formulation des projets de r�seaux de recherche soumis au Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada (CRSNG) pour tout ce qui concerne la recherche sur les SOFC, l'hydrog�ne et les PMEC. La recherche fondamentale effectu�e et la solidit� des comp�tences d�velopp�es dans le cadre du programme ont rechauss� la r�putation internationale de l'Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC (IIPC-CNRC), ce qui a permis � celui-ci de s'engager dans cinq projets conjoints avec des entreprises canadiennes de pointe dans le secteur des piles � combustible ainsi qu'avec la soci�t� Nissan du Japon. Les travaux se poursuivent en collaboration avec Ballard Power Systems, Hyteon Inc., Tekion Inc. et Northwest Mettech, et la technologie se rapproche chaque jour davantage du stade de la commercialisation. Ces projets � d�riv�s � d�coulent directement des recherches effectu�es dans le cadre du programme. Le financement de ce programme devra �tre renouvel� en 2008-2009.
Compte tenu des r�sultats des recherches et des comp�tences qu'il a acquises en tant qu'institut directeur du programme, l'IIPC joue un r�le central dans la croissance du secteur canadien de l'hydrog�ne et des piles � combustible. Au cours des cinq ans �coul�s depuis la cr�ation de l'Institut, la grappe de l'hydrog�ne et des piles � combustible en Colombie-Britannique est pass�e de simple noyau de quelques entreprises � une v�ritable grappe dynamique en pleine �mergence. Aujourd'hui, la Colombie-Britannique est dans une large mesure consid�r�e comme le si�ge de l'une des grappes d'entreprises et d'organisations les plus avanc�es au monde dans le secteur des piles � combustible et des technologies de l'hydrog�ne. L'IIPC-CNRC a collabor� � 19 projets conjoints avec l'industrie, a �t� invit� � participer au Sixi�me Programme-cadre de l'Union europ�enne auquel participent 18 organisations europ�ennes, et a �t� l'une des trois organisations �trang�res invit�es � participer au programme international sur les piles � combustible du New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) du Japon.
Intensifier les synergies dans le secteur des bioproduits – Conform�ment � sa nouvelle strat�gie, le CNRC mettra en œuvre une s�rie de programmes nationaux pour mieux r�pondre aux priorit�s canadiennes, soit la sant� et le mieux-�tre, l'environnement et l'�nergie durable. Multidisciplinaires, ces programmes seront � ax�s sur les r�sultats � et feront appel � des ressources vari�es au sein du CNRC et d'autres organisations de recherche et organisations commerciales (notamment d'autres minist�res et acteurs industriels). En avril 2007, le CNRC a annonc� que le vice-pr�sident, Sciences de la vie, assumerait la responsabilit� de la mise en œuvre du premier programme national sur les bioproduits. En 2006-2007, plusieurs �tapes ont aussi �t� franchies dans la cr�ation de ce nouveau programme : mise au diapason des orientations, intervenants (y compris Agriculture et Agroalimentaire Canada qui codirige la mise en œuvre de ce programme), d�termination des comp�tences et des capacit�s du CNRC correspondant aux objectifs du programme et �laboration d'un ciblage potentiel. Le d�veloppement des bioproduits accro�tra la valeur des ressources vierges du Canada et permettra de d�couvrir des applications � valeur accrue pour des produits actuellement peu exploit�s comme les d�chets des secteurs agricoles et forestiers, les r�sidus urbains solides, les mati�res organiques r�siduelles et d'autres ressources organiques sous-utilis�es en plus d'avoir des retomb�es sur deux priorit�s canadiennes : l'environnement et l'�nergie durable.
Contribuer � l'am�lioration de la sant� des Canadiens : vaccins, immunologie et maladies neurod�g�n�ratives – S'appuyant sur les succ�s de son vaccin contre la m�ningite C pour personnes de tous �ges, l'Institut des sciences biologiques du CNRC (ISB-CNRC) a continu� de s'attaquer � des probl�mes de sant� publique importants. Il applique ses connaissances en neurologie et en glycobiologie pour att�nuer les effets des maladies li�es au vieillissement et des maladies infectieuses et tenter de d�velopper, entre autres choses, un vaccin efficace contre la maladie d'Alzheimer. Il effectue �galement de la recherche pour trouver des solutions in�dites pour le traitement des l�sions c�r�brales dans le cadre d'un nouveau programme de neuroglycobiologie. En 2006-2007, le CNRC a ouvert des laboratoires d'immunologie et de neuroglycobiologie et embauch� du personnel pour assurer l'expansion de ces nouvelles activit�s. L'ISB-CNRC continue de collaborer avec Dow AgroSciences dans ses travaux pour r�duire la charge de pathog�nes alimentaires dans les animaux, contribuant de ce fait � la s�curit� de l'approvisionnement mondial de viande.
Aide � la s�curit� nationale – Le CNRC dirige un des projets men�s dans le cadre de l'Initiative de recherche et de technologie chimique, biologique, radiologique et nucl�aire (CBRN) et participe � trois autres. En partenariat avec l'Institut Steacie des sciences mol�culaires du CNRC (ISSM‑CNRC), l'Universit� Laval, Sant� Canada et Recherche et d�veloppement pour la d�fense Canada (RDDC) Suffield, l'Institut des mat�riaux industriels du CNRC (IMI-CNRC) con�oit et fabrique des substrats et des dispositifs � base de plastique n�cessaires � la manipulation micromagn�tique � des fins de d�tection. La partie du projet men�e par l'ISSM-CNRC comprend la conception d'architectures de nanomat�riaux pour la d�tection et la capture d'�l�ments pathog�nes. Cette technologie poss�de un large �ventail d'applications possibles qui contribueront � la rapidit� et � l'efficacit� des diagnostics tant en mati�re th�rapeutique qu'en mati�re de s�curit� nationale.
La s�curit� est une pr�occupation croissante � laquelle les diff�rents gouvernements consacrent beaucoup d'efforts. L'IMI-CNRC s'appuie sur des programmes horizontaux pour d�velopper des technologies de production de mat�riaux utilisables dans des syst�mes de s�curit�, et plus particuli�rement dans des appareils de d�tection des pathog�nes chimiques ou biochimiques, en collaboration avec des organismes publics canadiens (D�fense nationale, G�nome Canada, IGS-3 et d'autres instituts du CNRC), avec d'autres centres de recherche et des universit�s ainsi qu'avec plusieurs intervenants importants du secteur de la s�curit�.
L'IMI-CNRC participe � de nombreux projets en collaboration avec la D�fense nationale. Voici quelques exemples :
- D�veloppement de d�tecteurs intelligents pour diagnostiquer les structures a�rospatiales et pr�dire l'�volution de leur �tat. Des r�seaux de d�tecteurs pi�zo�lectriques � ultrasons ont �t� int�gr�s aux structures a�rospatiales fabriqu�es avec diff�rents mat�riaux. Cette exp�rience a d�montr� que les probl�mes structurels des a�ronefs peuvent �tre d�tect�s � une grande distance tant sur les surfaces plates que courbes.
- Mise au point de rev�tements anticorrosion pour accro�tre la dur�e de vie utile des structures d'a�ronef.
- D�veloppement d'un rev�tement d'aluminium pour les anodes obtenu soit par d�p�t thermique ou par d�p�t � faible temp�rature, offrant une protection contre l'oxydation sous tension et contre la fatigue-corrosion des alliages d'aluminium, tout en pr�servant leurs propri�t�s m�caniques initiales.
- D�veloppement, en collaboration avec plusieurs groupes de recherche de l'Universit� Laval, d'un syst�me de manipulation microfluidique capable de concentrer et de filtrer de l'ADN cibl� pour la d�tection d'agents bact�riologiques (anthrax).
- D�monstration de la capture et de la d�tection par confinement magn�tique d'ADN cibl� � un niveau de concentration inf�rieur � 1 000 copies/ml.
- D�veloppement d'une m�thode de fabrication de fibres polym�res nanom�triques poss�dant des propri�t�s particuli�res comme la conductivit� �lectrique, la thermochromie, etc.
En 2006-2007, le Centre de technologie des transports de surface du CNRC (CTTS-CNRC) a jou� un r�le cl� dans l'int�gration, par les Forces arm�es canadiennes, des syst�mes dans les blind�s Leopard 2. Les Forces arm�es ont en effet d�cid� de recourir davantage aux v�hicules � chenille, comme le char Leopard 2, pour mieux prot�ger les troupes, accro�tre la mobilit� des v�hicules et la capacit� de d�fense et att�nuer les risques associ�s � l'utilisation de routes locales sur les th��tres d'op�ration. Les nouveaux chars L�opard sont cependant d�pourvus de bon nombre des syst�mes canadiens de communication, de connaissance de la situation et de commande et de contr�le. Dans des d�lais tr�s serr�s, afin de r�pondre � la volont� des autorit�s d'envoyer en Afghanistan des blind�s op�rationnels et complets, le CTTS a fait partie int�grante de l'�quipe de travail, car on avait besoin de ses m�thodes uniques de conception et d'int�gration virtuelles. Par ailleurs, le CTTS a contribu� � l'�valuation et � l'analyse des options possibles pour l'installation de syst�mes de climatisation � l'int�rieur des chars afin de combattre les temp�ratures �lev�es inh�rentes � l'utilisation d'un v�hicule blind� m�tallique de 66 tonnes dans le d�sert. La contribution de l'�quipe du CTTS � ce travail a contribu� � r�duire de mani�re significative le nombre de pertes de vie li�es au danger de se d�placer sur les routes dans Kandahar et ses environs, en Afghanistan. Ces travaux repr�sentent la contribution du CNRC � la protection de la vie des soldats canadiens et � l'accroissement de la capacit� du Canada de fonctionner efficacement dans ce milieu dangereux.
Participer � des projets conjoints internationaux dans un r�le non traditionnel – � l'automne 2006, le CNRC, en collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des mus�es de France (C2RMF), a annonc� l'ach�vement de la plus importante �tude scientifique jamais entreprise sur la Joconde de L�onard de Vinci. Dans le cadre de ce projet de deux ans men� en collaboration par les deux organismes, un certain nombre de technologies de pointe ont �t� utilis�es pour examiner les propri�t�s physiques de la peinture. On a notamment eu recours � un appareil de balayage tridimensionnel au laser et en couleur, con�u et construit par le CNRC, qui a �t� apport� � Paris afin de pouvoir proc�der � l'analyse du c�l�bre tableau. Cet appareil est capable de num�riser des images tridimensionnelles � une r�solution de profondeur de dix microm�tres, soit environ le dixi�me du diam�tre d'un cheveu humain. Le mod�le tridimensionnel a �t� utilis� pour documenter et mesurer pr�cis�ment la forme des panneaux de bois sur lesquels est peinte la Joconde, pour analyser les caract�ristiques de la composition et des craquelures de la peinture, et afin d'�tudier l'�tat de conservation du tableau. Cette technologie poss�de un �ventail tr�s large d'applications mus�ales et patrimoniales et est tr�s largement reconnue.
Int�grer la recherche sur les nanotechnologies et l'innovation – Pour �tablir ses comp�tences et miser davantage sur ses ressources et ses connaissances, le CNRC travaille actuellement � la mise sur pied d'une initiative horizontale en nanotechnologie (NRCNano) qui favorisera l'int�gration du savoir-faire dans l'ensemble du CNRC en plus de faciliter la collaboration avec des partenaires de l'ext�rieur, y compris d'autres minist�res f�d�raux, des universit�s et des entreprises. Ce programme sera men� de concert avec un r�seau de nanotechnologie encore embryonnaire, mais qui est en train de prendre forme autour de l'Institut national de nanotechnologie (INN). Des centres sp�cialis�s en nanotechnologie de partout au Canada �tablissent actuellement des liens dans le cadre de ce r�seau et partagent de l'information, ce qui permet l'organisation de projets conjoints.
Entre autres exemples r�v�lateurs de la mani�re dont les instituts du CNRC collaborent d�j� dans le secteur des nanotechnologies, mentionnons les recherches effectu�es par trois instituts du CNRC dans le domaine des nanotubes monoparoi. L'ISSM-CNRC poss�de des capacit�s uniques au monde dans la fabrication et la fonctionnalisation de nanotubes monoparoi d'un tr�s grand degr� de puret�. L'IMI-CNRC met � contribution son savoir et son exp�rience concr�te dans la combinaison et la fixation des param�tres des proc�d�s permettant d'obtenir des m�langes uniques de polym�res et d'additifs. L'IRA-CNRC met � contribution ses capacit�s dans le domaine de l'essai des mat�riaux et de sa compr�hension approfondie des besoins � venir de l'industrie a�rospatiale canadienne.
Pleins feux sur le programme – Initiative en g�nomique et en sant� du CNRC
S'attaquer aux probl�mes sociaux et �conomiques par des recherches int�gr�es en g�nomique et en sant�.
|
Description : Le CNRC m�ne � lui seul plus de la moiti� de la recherche f�d�rale en biotechnologie et il est un intervenant majeur dans les importants progr�s de la recherche en g�nomique, en prot�omique et en sant� accomplis dans le cadre de l'Initiative en g�nomique et en sant� du CNRC (IGS-CNRC), lanc�e en 1999 pour accro�tre les capacit�s du CNRC en g�nomique et en sciences de la sant�, int�grer les capacit�s de recherche du CNRC et contribuer � l'effort national de recherche en g�nomique et en sant� en collaboration avec d'autres organismes f�d�raux, des entreprises et des universit�s. L'IGS regroupe actuellement six programmes de recherche � grande �chelle et divers autres programmes de recherche en biotechnologie s'appuyant sur trois plateformes technologiques (biopuces, s�quen�age de l'ADN et prot�omique). L'IGS est la plus importante initiative de recherche horizontale � laquelle participe le CNRC. Plus de dix instituts du CNRC et plus de 400 de ses employ�s y participent actuellement. Plans : En 2006-2007, l'IGS-CNRC amorcera la deuxi�me ann�e de sa troisi�me phase. L'Initiative continuera de centrer les efforts dans six programmes de recherche ax�s sur le diagnostic; le traitement et la pr�vention des maladies humaines et animales; le d�veloppement de technologies de d�tection des agents pathog�nes; l'avancement des nouvelles technologies de soins cardiaques; et la production de cultures agricoles viables sur le plan commercial. Le CNRC a proc�d� � une �valuation de l'Initiative en g�nomique et en sant� en 2005-2006. Les r�sultats de cette �tude contribueront � une �valuation plus large de l'initiative de R-D en g�nomique interminist�rielle entreprise en 2005-2006 et en 2006-2007. Le CNRC dirige cette �valuation au nom des six minist�res participants. Processus reconnu d'administration du programme : Le CNRC s'est engag� � adopter des pratiques efficaces dans l'administration de son programme de recherche et a int�gr� les le�ons tir�es des deux premi�res phases de l'IGS-CNRC pour perfectionner son processus concurrentiel de s�lection des programmes pour la troisi�me phase. Un groupe d'experts de l'ext�rieur comptant des repr�sentants de l'industrie a pass� en revue toutes les propositions de programmes afin d'�tablir leur qualit� et leur pertinence. Le CNRC applique des crit�res de s�lection qui favorisent l'int�gration des capacit�s de recherche de ses diff�rents instituts, qui stimulent la collaboration avec des partenaires de l'ext�rieur, d'autres minist�res f�d�raux, des universit�s et des entreprises, et qui mettent en valeur le potentiel commercial des technologies. Le CNRC a �galement institu� et applique un cadre administratif formel � tous les programmes de l'IGS-CNRC, et il exerce un suivi strict des progr�s accomplis en s'appuyant sur une liste d'indicateurs et de produits � livrer tr�s pr�cise. Les progr�s sont �valu�s tous les trimestres et tous les ans. Un nouveau mod�le de gouvernance complet pour l'IGS-CNRC a �t� r�uni pour la troisi�me phase afin de s'assurer que les diff�rentes responsabilit�s ont �t� clarifi�es et comprises. Approuv�e par le Comit� de la haute direction du CNRC, la structure de gouvernance de l'IGS‑CNRC est en voie d'acqu�rir ses titres de noblesse en tant que mod�le pour les programmes horizontaux du CNRC. |
||
|
Ressources financi�res pour 2006-2007 |
||
|
Pr�vues |
Autorisations totales* |
R�elles** |
|
11,0 millions de dollars |
11,57 millions de dollars |
10,94 millions de dollars |
|
*Des cr�dits annuels de 6 millions de dollars sont conditionnels � leur renouvellement par le Conseil du Tr�sor. L'autorisation actuelle du CT couvre la p�riode d'avril 2006 � mars 2008. R�sultats pr�vus (selon le Rapport sur les plans et priorit�s de 2006-2007)
Rendement en 2006-2007 Au nom des six minist�res participants, le CNRC a proc�d� � une �valuation de l'initiative interminist�rielle de recherche et de d�veloppement en g�nomique en 2006-2007 et r�vis� son Cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats (CGRR). Le processus de renouvellement de l'IGS en vue d'une �ventuelle quatri�me phase (IGS-4) a �t� lanc� en 2006‑2007. Les �quipes de chercheurs du CNRC ont �t� invit�es � d�montrer leur capacit� d'int�grer plusieurs disciplines de recherche et de technologie afin de pouvoir r�aliser des progr�s pertinents sur le plan commercial dans les domaines � la fine pointe de la g�nomique et des sciences de la sant� tout en assurant l'harmonisation avec la nouvelle strat�gie du CNRC. Nous avons choisi au moyen de lettres d'intention les projets qui pourront faire l'objet d'une proposition en bonne et due forme, et de nouveaux investissements sont envisag�s dans les domaines qui touchent aux maladies c�r�brovasculaires et infectieuses. Production scientifique : Les six programmes de l'IGS-CNRC ont g�n�r� les r�sultats de recherche suivants au cours du dernier exercice :
Voici quelques exemples des retomb�es de certains programmes de recherche s�lectionn�s de l'IGS‑CNRC :
Retomb�es �conomiques
En outre, les programmes de l'IGS-CNRC ont b�n�fici� de plusieurs projets de collaboration et contrats de service avec des partenaires de l'ext�rieur :
Engagement des citoyens
nstituts de recherche du CNRC participants (2006-2007) : IRB-CNRC, ITI-CNRC, IBD-CNRC, IBM‑CNRC, ISB-CNRC, IBP-CNRC, ISSM-CNRC, IMI-CNRC, INN, ISM-CNRC. Site Web : http://ghi-igs.nrc-cnrc.gc.ca/home_f.html |
||
Strat�gie : Assurer le d�veloppement durable par des recherches dans les domaines de l'environnement, de la gestion des oc�ans, de l'oc�anologie c�ti�re et du g�nie c�tier. |
Continuer � appuyer l'engagement du Canada de r�duire les �missions de gaz � effet de serre et d'assainir l'environnement9– Le CNRC travaille avec d'autres minist�res f�d�raux � la prestation de programmes interminist�riels sur les sources d'�nergie propre et le changement climatique. Il apporte ses principales contributions dans deux domaines : les activit�s de R-D sur l'hydrog�ne et les piles � combustible et le nouveau programme national sur les bioproduits. En partenariat avec un collaborateur de l'industrie, l'IIPC-CNRC a d�velopp� une technologie pour produire de l'hydrog�ne � la demande. Ce dispositif g�n�re de l'hydrog�ne pur � 99,99 % et peut �tre facilement lanc� et arr�t� au moyen d'un simple � interrupteur �. La puret� de l'hydrog�ne produit en fait une technologie id�ale pour alimenter les piles � combustible � membrane �changeuse de protons et produire du gaz � l'intention des laboratoires et aux fins des proc�d�s industriels. Lorsqu'il est question d'utiliser de l'hydrog�ne, la s�curit� est une pr�occupation primordiale, surtout lorsque ce gaz doit �tre stock� en grandes quantit�s ou transport� au moyen des infrastructures de transport public. Comme ce dispositif nouvellement d�velopp� g�n�re de l'hydrog�ne � la demande et n'exige aucune capacit� de stockage, il r�pond au probl�me de s�curit� de mani�re tr�s efficace. Gr�ce aux principales caract�ristiques de ces dispositifs et � leur variabilit� dimensionnelle, le CNRC s'attend � ce que cette technologie soit utilis�e dans un certain nombre d'applications comme les appareils �lectroniques portatifs, les syst�mes de production d'�nergie de secours et, �ventuellement, les automobiles. Cette technologie est actuellement commercialis�e et elle permettra de franchir une �tape de plus vers la concr�tisation des avantages environnementaux cr��s par l'utilisation de l'hydrog�ne comme carburant.
Les scientifiques de l'ISB-CNRC ont con�u un processus enzymatique pour �liminer efficacement la pectine des fibres de chanvre et ont d�pos� une demande pour faire breveter ce proc�d�. Une soci�t� de Vancouver, Naturally Advanced Technologies, pr�voit commercialiser ce proc�d� sous licence et produire des v�tements en chanvre souple capable de livrer concurrence au coton. Contrairement au coton, le chanvre peut �tre cultiv� sans pesticides ni herbicides et la pluie suffit � irriguer les champs de chanvre. Cette plante absorbe par ailleurs cinq fois plus efficacement le dioxyde de carbone qu'une superficie �quivalente de for�t et il peut donc contribuer � lutter contre l'effet de serre. Le d�veloppement d'un traitement pour les fibres de chanvre par l'ISB-CNRC contribuera au maintien d'une industrie agricole canadienne � valeur ajout�e durable et donnera aux agriculteurs canadiens les moyens de s'imposer sur le lucratif march� mondial des tissus. Il est impossible de cultiver le coton au Canada, ce qui emp�che toute pr�sence canadienne sur ce march�.
En 2006, l'Institut de recherche en biotechnologie du CNRC (IRB-CNRC) a assum� conjointement la responsabilit� d'un projet de d�monstration technologique environnementale majeur consistant � tester des technologies d'assainissement (biologique) des eaux souterraines, y compris des nanotechnologies. Le budget total de ce projet s'�levait � 1,56 million de dollars. Cette technologie est en voie d'�tre transf�r�e � une entreprise canadienne.
� Montr�al, un ancien site d'enfouissement sanitaire municipal et industriel, le Technoparc, laissait �chapper un lixiviat toxique et des huiles dans le fleuve, ce qui mena�ait la vie aquatique dans le fleuve Saint-Laurent. Ce site a �t� transform� en un parc technologique de pointe. L'IRB-CNRC, gr�ce � une plate-forme technologique cr��e en collaboration avec la province de Qu�bec, la ville de Montr�al, Environnement Canada, D�veloppement �conomique Canada et des entreprises du secteur environnemental a particip� � l'essai de ces technologies, � l'�valuation du rendement de la technologie industrielle et � la gestion de l'ensemble du projet, �tablissant des liens avec les intervenants (priv�s et publics) et diffusant de l'information au public. L'IRB-CNRC continue de promouvoir ce projet qui devrait �voluer pour devenir un projet de d�monstration technologique � grande �chelle d'une valeur estim�e � 4,5 millions de dollars en 2007-2008. Au bout du compte, le site vis� pourrait �tre remis en valeur par la Soci�t� du havre de Montr�al.
L'Institut de recherche en construction du CNRC (IRC-CNRC) a mis au point un mod�le int�gr� de qualit� de l'air int�rieur, un logiciel qui donne un aper�u int�gr� des probl�mes de pollution environnementale int�rieure, notamment les polluants (vapeurs et particules), les sources de pollution (int�rieures et ext�rieures) et les m�canismes de devenir ou de transport qui influent sur la quantit� de polluants int�rieurs. Ce logiciel aide les entreprises du secteur de la construction (et des secteurs connexes) � r�duire les �missions toxiques des mat�riaux, � r�duire la charge de ventilation et � rehausser la s�lection des mat�riaux.
Le Centre canadien de technologie r�sidentielle (CCTR) a men� un certain nombre de projets visant dans une large mesure � �valuer les produits et syst�mes de construction novateurs, � accro�tre l'efficacit� �nerg�tique des habitations et � r�duire la production connexe de gaz � effet de serre (GES). En 2006-2007, le Centre a �t� le pivot d'un certain nombre de projets de recherche et de projets strat�giques conjoints. Voici quelques faits saillants de ces projets :
- Rendement in situ d'une chaudi�re au gaz � combustion � deux vitesses. � la suite du projet d'�valuation des chaudi�res � efficacit� moyenne par rapport aux chaudi�res � haute efficacit�, l'�valuation d'une chaudi�re au gaz avec br�leur � deux vitesses s'est poursuivie pendant plusieurs semaines dans diff�rentes conditions.
- Syst�me RAD de commande par zone pour les maisons. Un contr�leur novateur permettant de r�gler la chaleur � des temp�ratures diff�rentes dans chaque pi�ce d'une maison au moyen d'un syst�me de chauffage � ventilation forc�e a �t� �valu� pendant deux saisons.
- Recul et avance du thermostat. Une �tude d�taill�e et un rapport ont �t� produits documentant les effets du recul du thermostat en hiver et de son avance en �t�.
- StART–�lectrolyseur d'hydrog�ne. Un prototype de g�n�rateur d'hydrog�ne fond� sur l'�lectrolyse de l'eau a �t� mis en service au CCTR lors d'une exp�rience de validation de principe dans le cadre de laquelle on a produit de l'hydrog�ne sur place dans la maison exp�rimentale. Cet hydrog�ne a ensuite �t� m�lang� � l'approvisionnement en gaz naturel r�sidentiel de la maison et subs�quemment �t� br�l� pour r�cup�rer l'�nergie sous forme de chaleur.
- Technologies de vitrage – Comparaison entre les technologies de vitrage � gain solaire �lev� et faible et � faible �missivit�. Une exp�rience de vitrage visant � comparer le rendement d'une maison dont les diverses fen�tres � faible �missivit� affichent des gains solaires diff�rents a �t� effectu�e. Il y a eu quatre semaines d'essais en hiver et quatre semaines d'essais en �t�. L'analyse et la mod�lisation sont maintenant termin�es.
Assurer un d�veloppement durable gr�ce aux sciences oc�aniques – La fiabilit� du rendement des technologies dans l'environnement marin poss�de une valeur commerciale pour tous les secteurs d'activit� li�s aux oc�ans. L'�valuation de ce rendement est un outil important pour assurer la s�curit� des personnes et des biens et la protection de l'environnement marin. Ces pr�occupations ont men� � une demande croissante de syst�mes rentables pour exploiter les sources d'�nergie renouvelables dans l'oc�an. En 2006-2007, l'Institut des technologies oc�aniques du CNRC (ITO-CNRC) a commenc� � mettre � l'essai de nouvelles technologies � l'�chelle de maquettes, en utilisant le bassin d'�tude des ouvrages de haute mer de l'Institut. Les r�sultats serviront � la tenue d'essais sur le terrain de syst�mes pleine grandeur, ce qui procurera aux promoteurs canadiens un avantage international dans ce secteur en �mergence.
Le secteur canadien de l'�nergie a aussi profit� de l'�valuation qui a �t� effectu�e du rendement des tubes prolongateurs souples dans l'exploitation des ressources extrac�ti�res de p�trole et de gaz. Ces tubes sont souvent sujets � des vibrations caus�es par les tourbillons. L'ITO‑CNRC a proc�d� � des essais physiques pour mesurer la r�action du tube expos� aux courants marins. Cette information a �t� utilis�e pour d�velopper un mod�le num�rique des vibrations auxquelles sont assujettis les tubes prolongateurs souples. Cette capacit� de mod�liser et d'�valuer les technologies utilisables en eau profonde procure des avantages � l'industrie extrac�ti�re de la c�te Est du Canada et peut ensuite �tre commercialis�e sur le march� international par des PME canadiennes.
En 2006-2007, le Partenariat pour les sciences et les technologies des oc�ans (PSTO) a r�ussi, gr�ce � des consultations intensives men�es partout au Canada, � cr�er des liens entre les chercheurs s'int�ressant aux sciences oc�aniques et les innovateurs travaillant dans l'administration publique, l'industrie, des universit�s, des localit�s c�ti�res et des organisations r�gionales. Ces relations ont amen� un resserrement des liens � l'�chelle nationale entre les r�seaux r�gionaux, intensifi� le partage d'information et les activit�s de sensibilisation, facilit� la mobilisation de fonds, et permis la cr�ation de projets de d�monstration de commercialisation technologique, de partenariats et de co-entreprises. Comme on l'avait envisag�, le PSTO est aussi devenu le porte-parole national du milieu des technologies oc�aniques en 2006-2007. En plus d'�laborer une � strat�gie intelligente pour les oc�ans � (Smart Oceans Strategy), le PSTO a d�velopp� un r�pertoire Internet o� les int�ress�s trouveront de l'information sur les principaux fournisseurs canadiens de solutions technologiques et de services de recherche connexes dans les sciences oc�aniques.
Le PARI-CNRC a contribu� � l'�volution du PSTO, jouant le r�le de conseiller du Conseil d'administration et encadrant le d�veloppement des produits � livrer par sa participation aux r�unions du Conseil d'administration et ses interactions avec le chef de projet et certains membres du Conseil d'administration. On peut obtenir des renseignements additionnels sur le site Web du PSTO, � l'adresse http://www.ostp-psto.ca
9 En tant qu'�tablissement public mentionn� � l'annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques, le CNRC n'est pas assujetti aux modifications de 1995 � la Loi sur le v�rificateur g�n�ral exigeant l'�tablissement d'une strat�gie de d�veloppement durable (SDD). Il demeure que le CNRC dispose d'une Politique de gestion de l'environnement afin que ses op�rations favorisent le d�veloppement durable. Le CNRC facilite l'int�gration de strat�gies et de pratiques de d�veloppement durable partout au pays et dans les processus d'innovation des PME canadiennes.
Strat�gie : Appuyer l'industrie canadienne et les milieux canadiens de la recherche en �laborant des codes et des normes et en investissant dans les grands projets d'infrastructure de R-D. |
Harmoniser les �talons de mesure internationaux – L'IENM-CNRC est l'institut national de m�trologie du Canada (INM). Il d�termine les �talons physiques et les m�thodes de mesure qui ont une incidence directe sur la capacit� des entreprises canadiennes de faire du commerce � l'�chelle internationale en �liminant les obstacles non tarifaires au commerce. Les travaux de l'IENM‑CNRC aident l'industrie canadienne � acc�der aux march�s mondiaux. L'IENM-CNRC a maintenant termin� la mise en œuvre d'un syst�me de gestion de la qualit� (SGQ) pour tous ses services d'�talonnage et de mesure, conform�ment aux exigences de la norme ISO/IEC 17025, soit la norme internationale de qualit� pour les laboratoires d'�talonnage et d'essai. Un SGQ est obligatoire pour participer pleinement aux activit�s pr�vues dans l'Accord de reconnaissance mutuelle (ARM) dont le Comit� international des poids et mesures (CIPM) fait la promotion.
L'�limination des obstacles li�s aux mesures, qui nuisent � l'innovation et d�coulent de la rapidit� du d�veloppement de certaines technologies comme la nanotechnologie et la biotechnologie, tout en maintenant sa capacit� essentielle d'�talonnage et de mesure dans des domaines plus traditionnels est l'une des difficult�s constantes auxquelles se heurte l'IENM-CNRC. Cet institut a consid�rablement �largi la palette de services offerts afin de r�pondre aux besoins d'�talons de mesure cr��s par l'�mergence de la nanotechnologie, une priorit� �tablie dans son plan strat�gique pour la p�riode de 2002 � 2007. L'IENM-CNRC joue un r�le de chef de file � l'�chelle nationale et internationale dans les activit�s faisant la promotion d'un d�veloppement harmonieux de la r�glementation et des �talons de mesure qui �tayeront toutes les innovations dans le domaine de la nanotechnologie. Les nouvelles capacit�s de mesure et d'�talonnage de l'Institut appuieront les activit�s dans le secteur des nanosciences dans d'autres instituts du CNRC ainsi que les possibilit�s de commercialisation d�coulant de ces activit�s. Dans le domaine de la biotechnologie, l'IENM-CNRC collabore avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments � la production d'un ensemble de mat�riaux de r�f�rence pour le canola modifi� g�n�tiquement (MG). Ces mat�riaux serviront � accro�tre la pr�cision des analyses chimiques utilis�es pour d�terminer le contenu MG. Ces mat�riaux de r�f�rence, les premiers du genre dans le monde, ont attir� l'attention d'autres INM, et, encore plus important, de grandes soci�t�s du secteur de l'agrobiotechnologie qui pourront utiliser ces mat�riaux de r�f�rence pour r�pondre � des probl�mes de marketing et d'�tiquetage.
Codes du b�timent ax�s sur les objectifs : clart�, souplesse et uniformit� – Lanc�s en 2005, les nouveaux codes du b�timent ax�s sur les objectifs de l'IRC-CNRC facilitent l'�valuation des produits de remplacement et des solutions de conception, ce qui rend les codes du b�timent canadiens plus propices � l'innovation et mieux adapt�s � la r�novation d'�difices existants et au commerce international. Pour que les utilisateurs des codes soient inform�s des changements les plus importants apport�s aux codes de 2005, l'IRC-CNRC, en coordination avec les provinces et territoires, a offert en 2005-2006 et 2006-2007 environ 40 s�minaires qui ont attir� plus de 6 200 participants. Mille autres intervenants du milieu ont particip� � des pr�sentations additionnelles portant sur des sujets particuliers reli�s aux codes. En ao�t 2006, les codes ont �t� publi�s sur CD-ROM.
Miser sur les partenariats pour la r�alisation des � grands projets scientifiques � – L'installation TRIUMF (Tri-University Meson Facility) est l'une des grandes infrastructures scientifiques canadiennes dans laquelle le Canada a investi le plus d'argent. Cette installation comprend des laboratoires de recherche de calibre mondial en physique subatomique, en physique nucl�aire, en astrophysique nucl�aire, en sciences de la vie et en recherche sur la mati�re condens�e. Elle encourage le transfert des technologies d�velopp�es dans ses laboratoires vers le march�. Le CNRC finance cette installation au nom du gouvernement du Canada en vertu d'un accord de contribution et supervise par ailleurs l'investissement f�d�ral. TRIUMF vient de terminer la deuxi�me ann�e de son plan quinquennal pour la p�riode de 2005 � 2010 qui b�n�ficie d'une enveloppe budg�taire globale de 222 millions de dollars. Une subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) a �t� obtenue par les milieux universitaires canadiens pour mettre en place la passerelle d'entr�e de donn�es ATLAS qui sera install�e dans les locaux de TRIUMF. Les milieux universitaires canadiens ont aussi obtenu une subvention de la FCI pour le faisceau M20 de TRIUMF.
Strat�gie : Poursuivre la mise en œuvre du Plan � long terme pour l'astronomie et l'astrophysique au Canada. |
L'Institut Herzberg d'astrophysique du CNRC (IHA-CNRC) joue un r�le unique dans la mise en œuvre du Plan � long terme pour l'astronomie et l'astrophysique au Canada (PLT), une strat�gie nationale guidant la recherche en astronomie – L'astronomie a �volu�, se d�tournant progressivement de sa port�e surtout nationale pour devenir une activit� internationale ax�e sur des partenariats r�gionaux ou des soci�t�s en commandite.
Le projet ALMA, priorit� absolue d�finie dans le PLT, est maintenant bien lanc� et des efforts consid�rables ont �t� d�ploy�s afin de mieux d�finir le r�le du Canada dans la phase op�rationnelle qui devrait s'amorcer progressivement au cours de l'exercice 2008-2009. L'IHA-CNRC a respect� son engagement de produire des cartouches r�ceptrices qui seront la contribution canadienne � ce projet. Apr�s des tests d'acceptation rigoureux, les deux premi�res cartouches r�ceptrices de la Bande 3 ont �t� livr�es par l'IHA-CNRC au centre d'int�gration du projet ALMA en Virginie in 2006‑2007. Un contrat a par la suite �t� accord� � NanowaveTechnologies Inc. en Ontario, pour la production d'autres cartouches.
Le projet TMT en est encore � la phase de d�veloppement du concept. L'IHA-CNRC apporte une contribution en nature fond�e sur son savoir-faire scientifique et technique. Les employ�s de l'Institut continuent de jouer un r�le cl� dans le cadre de ce projet en assurant notamment les activit�s de d�veloppement des instruments principaux et en d�finissant les exigences de haut niveau pour la construction. Le directeur de la structure du TMT continue de travailler avec Dynamic Structures Ltd., le partenaire industriel du projet.
Le travail de l'IHA-CNRC dans le cadre du projet SKA s'est modifi� avec la publication du concept de r�f�rence. L'Union europ�enne a d�sign� le SKA comme un projet mondial d'int�r�t pour l'Europe, ouvrant ainsi la porte � une participation �trang�re � l'Europe au programme de financement FP7. L'IHA-CNRC participe actuellement � une demande de financement appuy�e par 27 organisations internationales.
En 2006-2007, le CNRC a sign� une entente avec la CSIRO d'Australie pour pouvoir solliciter des fonds afin de devenir partenaire du Mileura International Radio Array (MIRA), un projet de d�monstration reli� au SKA. Le MIRA est un t�lescope orienteur dot� de fonctions scientifiques qui sera construit en Australie de l'Ouest au cours de la prochaine d�cennie. L'IHA-CNRC travaille de concert avec l'Australia Telescope National Facility du CSIRO � l'�tablissement des devis, � la mise en œuvre du projet et � la d�finition des r�les des diff�rentes parties dans le cadre de celui-ci.
Le PLT reconna�t �galement l'importance des ressources computationnelles et de l'acc�s � de vastes quantit�s de donn�es. Le Centre canadien de donn�es astronomiques de l'IHA-CNRC (CCDA) permet justement aux chercheurs d'acc�der aux donn�es recueillies par les t�lescopes. En 2006-2007, les am�liorations apport�es � ce chapitre ont permis de rendre disponibles les ensembles de donn�es brutes produits par les t�lescopes Gemini, 15 minutes apr�s leur acquisition. En 2006, les auteurs de plus de 106 publications ext�rieures � comit� de lecture ont reconnu avoir utilis� le CCDA, une indication que l'utilisation des donn�es archiv�es fait de plus en plus partie int�grante de la recherche en astronomie, � la fois gr�ce � l'augmentation des observations originales et gr�ce aux nouvelles applications d'exploration de donn�es qui d�pendent enti�rement de la disponibilit� de telles archives. L'IHA-CNRC est largement reconnu pour son savoir-faire dans ce domaine.
Le savoir-faire de l'IHA-CNRC en mati�re num�rique est actuellement sollicit� dans la construction d'un superordinateur de 20 millions de dollars qui sera au cœur du radiot�lescope � tr�s large faisceau du U.S. National Radio Astronomy Observatory au Nouveau-Mexique. Lorsque sa construction sera termin�e en 2010, cet ordinateur sera le plus gros corr�lateur du monde. Les �l�ments centraux du syst�me sont constitu�s de plusieurs gigantesques cartes de circuits imprim�s dont la conception et la fabrication ont constitu� un d�fi, m�me avec les m�thodes � la fine pointe de la technologie. Ces cartes de circuits imprim�s ont �t� con�ues et produites � l'IHA‑CNRC.
Mise en œuvre de la phase II du PLT
|
Une �valuation de la contribution de l'IHA-CNRC au PLT a �t� publi�e. Cette �valuation, qui a exig� la tenue de plus de 50 entrevues avec des pairs et intervenants au Canada et � l'�chelle internationale, a confirm� la pertinence de la contribution de l'IHA-CNRC � la mise en œuvre du PLT pour les intervenants universitaires et industriels et a mis en �vidence l'absence de d�doublement des efforts du CNRC et des universit�s. L'Institut continue de centrer son attention sur les divers �l�ments du Plan � long terme pour l'astronomie canadienne (PLT). Le financement accord� pour la phase I du PLT visait la p�riode de 2002 2003 � 2006-2007, |
Priorit� no 2 : Soutien technologique et industriel : servir de catalyseur � l'innovation industrielle et � la croissance
|
Indicateurs de rendement (d�finis dans le RPP de 2006-2007) |
|
Les indicateurs de rendement qui ne changent pas d'un exercice � l'autre ne sont pas analys�s annuellement.
� l'appui de la priorit� accord�e par le gouvernement du Canada � la commercialisation, le portefeuille du Soutien technologique et industriel du CNRC (STI) travaille en �troite collaboration avec le portefeuille de Recherche- d�veloppement du CNRC afin d'accro�tre la commercialisation des fruits de la recherche par l'octroi de licences, la prestation d'une aide � la pr�commercialisation, la prestation de services de mentorat et la communication de renseignements commerciaux aux entreprises canadiennes, l'acc�s � des r�seaux nationaux et internationaux d'une importance cruciale, la diffusion de savoir et de comp�tences, et l'aide � la cr�ation de nouveaux produits et de nouvelles technologies. Il collabore aussi avec certains partenaires cl�s � l'�laboration d'initiatives strat�giques visant � acc�l�rer la commercialisation et � accro�tre la comp�titivit� des nouvelles technologies. Le portefeuille du STI contribue �galement � la croissance des PME et � l'augmentation de leur capacit� d'innovation et il simplifie constamment sa d�marche en gestion de la propri�t� intellectuelle et en transfert de technologies.
Strat�gie : Accro�tre la capacit� d'innovation des petites et moyennes entreprises (PME) afin d'amener celles ci au statut de moyennes entreprises (ME). |
Pleins feux sur le programme – Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI-CNRC) : Assurer la croissance des PME gr�ce � l'aide � l'innovation et au savoir-faire.
|
Description : Le PARI-CNRC est un programme d'aide � l'innovation et � la technologie que le CNRC a mis en œuvre � l'intention des PME canadiennes. Depuis sa cr�ation il y a pr�s de 60 ans, ce programme a �largi son objectif strat�gique, qui se limitait au d�part � transf�rer des technologies, et qui consiste maintenant � accro�tre la capacit� d'innovation des PME canadiennes. Aujourd'hui, le PARI-CNRC offre des services complets d'aide � l'innovation aux PME ax�es sur la technologie, dans pratiquement tous les secteurs industriels d'importance pour le d�veloppement �conomique actuel et futur du Canada. Plans : Les PME qui s'engagent dans des activit�s de R-D hautement risqu�es et technologiquement avanc�es sont confront�es � des difficult�s dont la complexit� va croissant. Le PARI-CNRC entend aider ces PME ax�es sur la technologie � assurer leur croissance et � devenir plus concurrentielles. Il y parviendra en se concentrant sur l'acc�l�ration de la croissance des PME, en multipliant le nombre de PME qui arrivent � commercialiser leurs produits, leurs services et leurs m�thodes, en favorisant les collaborations internationales possibles pour des projets de d�veloppement technologique et en offrant des d�bouch�s internationaux aux clients qui veulent acqu�rir des connaissances pour faire progresser leurs projets de R-D. Miser sur le succ�s du programme exp�rimental de veille technologique concurrentielle (VTC) : Le PARI-CNRC et l'ICIST-CNRC continueront de d�velopper les services de VTC afin d'offrir des conseils strat�giques hors pair aux participants des grappes technologiques de l'Atlantique et d'optimiser les investissements du CNRC. Par exemple, le PARI-CNRC et l'ICIST-CNRC travaillent actuellement � l'ajout d'un analyste commercial technique � St. John's (T.-N.-L.) et int�grent les conseils issus de la VTC au portefeuille de services du PARI-CNRC offerts aux entreprises de l'Atlantique et du Nunavut. L'ICIST-CNRC et le PARI-CNRC collaborent afin d'offrir la VTC aux PME d'autres r�gions du Canada. Le PARI-CNRC s'est dot� d'une capacit� interne de collecte des renseignements de VTC et, dans le cadre de la prochaine �tape, int�grera cette information � la planification strat�gique et aux strat�gies commerciales des entreprises clientes. |
||
|
Ressources financi�res pour 2006-2007 |
||
|
Pr�vues |
Autorisations totales |
R�elles |
|
143,3 millions de dollars |
172,2 millions de dollars |
157,6 millions de dollars |
|
R�sultats pr�vus (selon le RPP de 2006-2007)
Rendement obtenu en 2006-2007
Veille technologique concurrentielle (VTC)
Instituts de recherche du CNRC participants : Le PARI-CNRC s'associe avec tous les instituts du CNRC afin de contribuer aux projets technologiques qui r�pondent aux besoins des PME et qui sont conformes aux orientations technologiques des instituts du CNRC. Site Web : http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca/main_f.html |
||
Strat�gie : Contribuer aux priorit�s du Canada dans le domaine de la commercialisation en augmentant la capacit� de l'industrie de g�n�rer et d'appliquer de nouvelles id�es et de favoriser les applications commerciales de la S-T. |
Le CNRC examine actuellement la fa�on dont il pourrait compl�ter ses programmes de soutien industriel et de R-D reconnus � l'�chelle internationale et utiliser ceux-ci ci pour contribuer � l'accroissement g�n�ral des efforts de commercialisation du Canada – Le CNRC stimule la croissance de grappes technologiques partout au pays et le fait avec un souci constant pour les activit�s de commercialisation. La mise en œuvre de cette strat�gie exige du CNRC qu'il mise sur les atouts des secteurs public et priv� � l'�chelle nationale, r�gionale et communautaire. Reconnaissant que l'appui aux grappes technologiques prend une importance croissante dans les activit�s du PARI‑CNRC, la haute direction du programme a adopt� en ao�t 2006 une strat�gie pour encadrer la participation du CNRC � ces grappes ainsi qu'� d'autres grappes technologiques au Canada. Les gestionnaires du PARI-CNRC surveillent l'appui que sera en mesure d'offrir le programme au cours des prochaines ann�es pour d�terminer le degr� le plus appropri� d'aide � accorder aux PME appartenant � des grappes technologiques par rapport aux autres PME.
Strat�gie : Accro�tre le savoir de l'industrie par le d�veloppement et la diffusion d'information scientifique, technique et m�dicale et de renseignements commerciaux. |
Pleins feux sur le programme – Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC) : mettre l'information au service de l'innovation
|
Description : L'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC) est la biblioth�que scientifique nationale du Canada et la plus importante source d'information scientifique, technique et m�dicale (STM) en Am�rique du Nord. Gr�ce � son service d'�dition, les Presses scientifiques du CNRC, l'ICIST-CNRC est aussi le plus important �diteur de publications scientifiques au Canada. En r�ponse aux exigences des grappes technologiques et dans le cadre des initiatives de commercialisation des instituts du CNRC qui avaient besoin de renseignements commerciaux et de services d'information, l'ICIST-CNRC a d�cid� en 2001 de miser sur ses comp�tences en information scientifique et technologique mondiale et a cr�� le groupe des Services d'information. Aujourd'hui, les centres d'information du CNRC desservent les chercheurs des secteurs public et priv� associ�s aux instituts du CNRC et aux grappes technologiques partout au Canada. Plans : Le plan strat�gique de 2005-2010 de l'ICIST-CNRC �nonce sa vision : �tre un chef de file dans l'exploitation de l'information scientifique afin de cr�er de la valeur pour les Canadiens. Sa mission consiste � faire progresser la recherche et l'innovation gr�ce � des donn�es de grande valeur et � des services d'�dition dans les domaines scientifiques, technologiques et m�dicaux. L'ICIST-CNRC cr�era de la valeur pour les Canadiens en am�liorant de trois mani�res le flux de donn�es scientifiques :
|
||
|
Ressources financi�res pour 2006-2007 |
||
|
Pr�vues |
Autorisations totales |
R�elles |
|
47,8 millions de dollars |
57,4 millions de dollars |
52,6 millions de dollars |
|
R�sultats pr�vus (selon le RPP de 2006-2007)
Rendement en 2006-2007 Collection canadienne d'information STM – Ressource de calibre mondial, l'ICIST-CNRC compte sur une importante collection d'information scientifique, technique et m�dicale (STM). En 2006-2007, il a maintenu sa collection sur support papier � un niveau similaire � celui de l'exercice pr�c�dent avec ses quelque 49 121 revues scientifiques et il reste abonn� � 9 073 d'entre elles. La collection comprend �galement 757 500 monographies et une importante collection de rapports techniques. L'ICIST est aussi sp�cialis� dans les comptes rendus de conf�rences, offrant 205 400 titres de ce type de publication. Les chercheurs du CNRC ont acc�s � 6 123 revues �lectroniques, une augmentation de 20 % par rapport � 2005-2006 et ils ont acc�s � 20 335 autres ressources Web, une augmentation de 14 %. La collection du d�p�t num�rique de l'ICIST-CNRC s'est enrichie et compte d�sormais 6,2 millions d'articles STM en format plein texte extraits de 3 600 revues. Les acquisitions et les licences �lectroniques r�pondent aux nouveaux besoins du CNRC en mati�re d'information STM multidisciplinaire et sectorielle et d'information commerciale afin que ces services soient conformes aux priorit�s d�crites dans la strat�gie du CNRC lanc�e en 2006-2007. Par exemple, l'ICIST-CNRC a n�goci� avec succ�s l'obtention d'une licence pour utiliser une ressource �lectronique pr�cieuse appel�e Business Insights offerte aux chercheurs du CNRC par l'entremise de la Biblioth�que virtuelle du CNRC. Acc�s aux documents et livraison – Offrir aux Canadiens les publications de recherche STM du monde entier. Si la plus grande partie des commandes canadiennes d'articles en 2006-2007 est venue de clients des milieux universitaire (37 %) et industriel (28 %), les commandes de documents venant de clients du secteur m�dical canadien ont augment� de 27 %. Dans la foul�e de la transition du format papier au format num�rique, l'ICIST-CNRC ne cesse d'am�liorer son infrastructure num�rique et ses syst�mes de livraison de documents. Entre autres am�liorations, mentionnons qu'en mars 2007, l'ICIST-CNRC a lanc� un service d'achat d'articles individuels qui offre un acc�s en ligne imm�diat au contenu num�rique charg� localement dans le d�p�t num�rique de l'ICIST-CNRC. Ce d�p�t num�rique compte actuellement pr�s de 1 million d'articles et ce nombre augmente constamment. L'ICIST-CNRC continue d'�largir l'acc�s au contenu et aux services de livraison qu'il offre aux Canadiens et � ses clients internationaux gr�ce � des partenariats conclus avec des chefs de file dans le secteur international des services d'information. En ao�t 2006, l'ICIST-CNRC a conclu une nouvelle alliance avec FIZ Autodoc, un courtier allemand en livraison de documents qui est associ� � des biblioth�ques scientifiques internationales et nationales, des revendeurs et des �diteurs de r�putation mondiale. Gr�ce � cette alliance, l'ICIST-CNRC �tend l'acc�s � ses collections partout dans le monde et permet � FIZ Autodoc d'ajouter de nombreux nouveaux titres � son service. On trouvera de l'information sur les normes de service de l'ICIST-CNRC au tableau 3-7B. Dans le num�ro de juin 2006 du Product Satisfaction Scorecard, Outsell Inc. signale que l'ICIST-CNRC arrive au sommet de la liste des cinq fournisseurs d'information, obtenant la plus haute note dans trois des cinq cat�gories : satisfaction globale, recommandation et justesse des prix. En 2007, l'ICIST-CNRC a lanc� un projet-pilote d'archivage des publications du CNRC (NPArC) qui permettra au CNRC de mieux promouvoir ses activit�s de recherche, de mesurer son rendement et de rendre ses publications directement accessibles � l'ensemble de la communaut� scientifique. �dification de l'infostructure scientifique canadienne – Rendre accessible l'information STM num�rique. En 2006-2007, l'ICIST-CNRC a �largi ses activit�s de soutien au partenariat, augmentant l'effectif de son Bureau de d�veloppement des partenariats afin qu'il �tablisse des contacts avec des partenaires actuels et potentiels au sujet de certaines initiatives, dont la biblioth�que scientifique f�d�rale �lectronique et le r�seau national de biblioth�ques sur la sant�. La n�gociation des licences d'utilisation du contenu �lectronique constitue un �l�ment cl� de l'acc�s en ligne � ce contenu. Veille technologique concurrentielle et services d'information – Cro�tre pour r�pondre � la demande. En 2006-2007, les employ�s du Centre d'information du CNRC de la grappe de l'Atlantique ont proc�d� � des recherches pour le compte de plus de 2 600 clients, une augmentation de 16 % du nombre de clients desservis par rapport � l'exercice pr�c�dent. En r�action � l'accent qui est mis sur la commercialisation des fruits de la R-D dans la nouvelle strat�gie du CNRC, l'ICIST-CNRC a �largi en 2006-2007 ses services de veille technologique concurrentielle (VTC) offerts aux chercheurs, aux agents de d�veloppement des affaires des instituts et � la haute direction du CNRC ainsi qu'aux PME canadiennes par l'entremise du PARI-CNRC. Les d�cideurs appr�cient les services de VTC qui �valuent le potentiel commercial de nouvelles technologies, valident la demande sur le march�, identifient les concurrents et les partenaires potentiels, proposent des ajustements au produit et recommandent un prix pour le produit. Cette information donne aux organisations un avantage concurrentiel sur le march� international et favorise l'obtention d'investissements en capital pour la R-D qui, eux-m�mes, engendreront des retomb�es �conomiques substantielles pour le Canada. L'ICIST‑CNRC a achemin� 250 rapports de VTC � ses clients en 2006-2007, comparativement � 75 en 2004-2005. Presses scientifiques du CNRC – Rendre les fruits de la recherche canadienne accessibles aux Canadiens et aux chercheurs de partout dans le monde. Les Presses scientifiques du CNRC publient la moiti� des 16 revues scientifiques du CNRC au moyen d'un syst�me d'�dition � la fine pointe de la technologie qui situe les Presses scientifiques du CNRC � l'avant-garde des technologies d'�dition scientifique, sur un pied d'�galit� avec les autres chefs de file dans ce secteur. Dans le cadre du Programme de monographies et de publication d'ouvrages, les Presses scientifiques du CNRC publient des trait�s scientifiques et des comptes rendus de conf�rences. Les Presses scientifiques du CNRC ont mis en œuvre une nouvelle politique donnant un acc�s libre et � ouvert � � certains articles et revues s�lectionn�s. Tous les utilisateurs ont donc acc�s gratuitement � aux articles qui font la manchette. De plus, l'auteur, l'organisme de financement ou tout autre commanditaire peut d�sormais payer des frais pour couvrir les co�ts d'examen par les pairs et de publication, s'assurant ainsi que l'acc�s � cet article particulier dans une revue sera gratuit. Instituts de recherche du CNRC participants : L'ICIST-CNRC participe aux activit�s de sensibilisation aupr�s de tous les instituts du CNRC afin de promouvoir et d'offrir un ensemble de services d'information scientifique, technique et m�dicale int�gr�s pour mieux appuyer les entreprises canadiennes. Site Web : http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca/main_f.html |
||
Strat�gie : Faciliter l'int�gration des strat�gies de gestion de la propri�t� intellectuelle dans les plans strat�giques des instituts. |
Am�liorer la gestion de la propri�t� intellectuelle du CNRC – L'examen des activit�s du CNRC, qui a pris fin en 2006-2007, a mis en �vidence la n�cessit� d'int�grer � l'�chelle de l'ensemble de l'organisation les pratiques exemplaires de gestion de la propri�t� intellectuelle. Pour relever ce d�fi, en mai 2007, le portefeuille du soutien technologique et industriel (STI) a mis sur pied � titre exp�rimental un nouveau groupe dont le mandat est d'offrir un soutien commercial aux instituts et aux programmes afin de leur permettre de prendre les meilleures d�cisions possibles en ce qui concerne la gestion de la propri�t� intellectuelle. Dans un premier temps, ce groupe se penchera sur certains enjeux cl�s : analyse de la divulgation des inventions, processus permettant aux instituts d'obtenir l'aide des agents de brevet du CNRC pour �tablir la brevetabilit� et la qualit� marchande des nouvelles technologies avant d'engager des fonds pour prot�ger la propri�t� intellectuelle ou de la c�der sous licence. Le groupe du STI collabore �galement avec les instituts afin de faciliter l'int�gration des strat�gies de gestion de la propri�t� intellectuelle dans leurs plans d'activit� et pour s'assurer que cette fonction importante demeure un �l�ment cl� de la contribution des instituts � la strat�gie du CNRC.
Priorit� no 3 : D�veloppement de grappes technologiques viables capables de cr�er de la richesse et du capital social
|
Indicateurs de rendement (d�finis dans le RPP de 2006-2007) |
|
Les indicateurs de rendement qui ne changent pas d'un exercice � l'autre ne sont pas analys�s annuellement.
Le CNRC est d�termin� � favoriser la croissance de grappes technologiques communautaires partout au Canada. Il s'appuie pour cela sur les atouts d�j� pr�sents dans les localit�s en question en mettant en œuvre des programmes de R-D qui appuient l'industrie locale et r�pondent � ses besoins, en offrant des installations � la fine pointe de la technologie, du personnel d�ment form�, des possibilit�s d'incubation d'entreprises et d'autres services sp�cialis�s (PARI-CNRC, ICIST‑CNRC), et en favorisant le recentrage des activit�s des principaux intervenants en fonction des atouts locaux. Le CNRC a re�u de nouveaux cr�dits (110 millions de dollars sur les cinq prochaines ann�es) afin de mettre en œuvre sa strat�gie nationale de d�veloppement de grappes technologiques au Canada atlantique et en 2006-2007, il a sollicit� de nouveaux cr�dits pour la phase II de son projet de grappes technologiques dans l'Est, le centre et l'Ouest du Canada. Au bout du compte, l'avantage pour les Canadiens sera l'�mergence de grappes technologiques concurrentielles � l'�chelle mondiale qui stimuleront la productivit�, la cr�ation d'emplois et le commerce international.
Strat�gie : Se concentrer sur la croissance des grappes gr�ce � des programmes cibl�s de R-D et des partenariats avec d'autres organismes de S-T. |
Miser sur les succ�s des initiatives de l'Atlantique du CNRC, phase I – Le CNRC a continu� � favoriser la croissance de grappes au Canada atlantique en maintenant des capacit�s de recherche � la fine pointe (infrastructure et capital humain), en d�veloppant des projets de recherche conjointe avec les entreprises appartenant aux grappes, en favorisant un r�seautage et un partage des connaissances accrus et en appuyant la participation d'entreprises et d'autres partenaires aux activit�s de la grappe.
-
Technologie de l'information (Nouveau-Brunswick) – L'ITI-CNRC travaille en �troite collaboration avec l'Agence de promotion �conomique du Canada atlantique (APECA) afin d'identifier des possibilit�s de R-D vers lesquelles les ressources pourraient �tre dirig�es de mani�re � appuyer les PME les plus novatrices et poss�dant un fort potentiel de commercialisation de la propri�t� intellectuelle. Dans un r�cent octroi d'enveloppes de financement par le Fonds d'innovation de l'Atlantique, un projet appuy� par l'APECA et l'ITI-CNRC a �t� s�lectionn�. Il s'agit du projet D�couverte de biomarqueurs g�n�tiques pour le d�pistage du cancer. L'Atlantic Cancer Research Institute (ACRI) recevra du Fonds 2,9 millions de dollars sur trois ans pour ce projet men� en collaboration avec l'ITI-CNRC. Le r�le de l'ITI-CNRC consiste � valider les biomarqueurs du cancer de la prostate avec l'intention de trouver un partenaire qui assurera la commercialisation de cette d�couverte. L'ITI-CNRC utilisera un algorithme similaire pour identifier et valider des groupes de biomarqueurs du cancer du sein, des ovaires, du poumon et des lymphomes. Le but ultime consiste � fournir une panoplie de biomarqueurs pour le d�pistage de multiples cancers.
L'Universit� de Moncton s'est unie � l'ITI-CNRC et � une soci�t� pr�pond�rante dans le secteur du logiciel de t�l�apprentissage, Desire2Learn, pour lancer une initiative de recherche visant � mettre au point une s�rie logicielle qui diminuera de mani�re appr�ciable les d�lais et les co�ts de production du d�veloppement de contenu �lectronique � des fins d'apprentissage virtuel. Le co�t total estimatif du projet est de 5,5 millions de dollars.
- Technologies oc�aniques (Terre-Neuve-et-Labrador) – Une �tude ind�pendante r�cemment men�e pour le compte d'Industrie Canada et d'OceansAdvance confirme que la grappe de Terre Neuve et Labrador est en bonne sant� et dynamique.
Les installations de calibre mondial de l'ITO-CNRC ainsi que son savoir-faire dans l'�valuation du rendement et l'ex�cution de projets de recherche de qualit� sup�rieure attirent les projets de recherche et cr�ent des d�bouch�s commerciaux pour les entreprises de la grappe. Le Centre des entreprises de technologies oc�aniques de l'ITO-CNRC continue d'accueillir des entreprises d�veloppant des produits commerciaux dans le secteur des technologies oc�aniques. Gr�ce aux installations de l'ITO-CNRC, les entreprises priv�es de la grappe g�n�rent des revenus annuels de plus de 6 millions de dollars, ce qui a contribu� � faire de St. John's et de l'ITO-CNRC des chefs de file mondiaux dans le domaine de l'�valuation du rendement en milieu marin. L'ITO-CNRC stimule les activit�s de recherche et de d�veloppement de technologies au sein de la grappe en favorisant la collaboration entre les entreprises locales, ce qui leur permet d'acqu�rir des comp�tences et une capacit� technologique.
OceansAdvance est n�e d'un partenariat entre l'ITO-CNRC, le PARI-CNRC et la province de Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.). Cette soci�t� a �t� lanc�e avec la conviction qu'en faisant une promotion plus proactive du concept de � grappe � dans le secteur des technologies oc�aniques – une sp�cialit� technique et industrielle qui �tait d�j� pr�sente � Terre-Neuve-et-Labrador – on stimulerait le rendement �conomique de la r�gion. L'ITO-CNRC continue d'�tre le si�ge d'un bon nombre d'activit�s de d�veloppement de la grappe et poss�de l'infrastructure n�cessaire � ce d�veloppement. OceansAdvance compte sur un conseil d'administration compos� de repr�sentants du secteur priv� et est financ� horizontalement par le PARI-CNRC, l'APECA, la province de T.-N.-L. et Industrie Canada.
- Sciences de la vie (Nouvelle-�cosse) – Les dirigeants industriels et communautaires locaux s'approprient actuellement le processus d'�tablissement de la carte routi�re technologique de la grappe � laquelle participe l'Institut des biosciences marines du CNRC (IBM-CNRC). Cet exercice est men� afin de garantir que les ressources disponibles sont � la
hauteur des objectifs et de la vision de la grappe. Le Centre de commercialisation de l'Atlantique a �t� cr�� en 2006-2007 et s'est �tabli au sein de l'installation de partenariat industriel de l'IBM-CNRC. Il est dot� d'une �quipe sp�cialis�e dirig�e par un agent principal de d�veloppement des sciences de la vie. Ce centre offre des services de commercialisation � l'ensemble du
milieu des sciences de la vie, y compris au secteur priv� et aux entreprises prometteuses n�es des activit�s de recherche men�es dans la r�gion.
L'Institut du biodiagnostic du CNRC (Atlantique) (IBD-CNRC -Atlantique), un �tablissement satellite de l'IBD-CNRC dont les installations principales se trouvent � Winnipeg, a continu� de mener des recherches de calibre mondial qui permettront d'effectuer des progr�s dans l'�valuation, le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles c�r�braux. Il a �galement continu� � transf�rer au secteur priv� des innovations technologiques m�dicales qui profiteront � l'�conomie du Canada atlantique. De concert avec l'Institut des biosciences marines du CNRC, l'Izaak Walton Killam Hospital et l'Universit� Dalhousie, l'IBD-CNRC a encore �largi l'infrastructure des sciences de la vie � Halifax gr�ce � la cr�ation du Laboratoire d'imagerie par r�sonance magn�tique biom�dicale. Ce laboratoire, qui sera enti�rement op�rationnel en 2007-2008, permettra aux chercheurs de relier des mod�les pr�cliniques au diagnostic et aux traitements centr�s sur le patient d'un large �ventail de maladies. La recherche se concentrera sur les �tudes d'imagerie par r�sonance magn�tique et notamment sur le d�veloppement et la production de m�dicaments et sur l'imagerie cellulaire et mol�culaire.
Stimuler la participation et l'engagement des partenaires de la grappe – En 2006-2007, le CNRC s'est inspir� des le�ons acquises au moment de l'�valuation de ses initiatives de grappes du Canada atlantique et a mis� sur ses succ�s existants. Voici quelques exemples :
- Technologies des dispositifs m�dicaux (Manitoba) – Le Centre pour la commercialisation des technologies biom�dicales du CNRC (CCTB-CNRC) acc�l�re le d�veloppement d'une grappe � Winnipeg. Entreprise d�riv�e des activit�s de l'IBD-CNRC, Biomedical Commercialization Canada offre un large �ventail de services d'aide � la commercialisation aux entreprises en
d�marrage. Quatre nouvelles entreprises qui en �taient � diff�rentes �tapes du mentorat se sont inscrites au programme de mentorat en commercialisation en 2006-2007, et l'inscription de quatre autres entreprises �tait imminente. Quinze autres organisations sont locataires de ce centre. Outre de petites entreprises � vocation scientifique, on compte parmi les locataires des
associations commerciales, comme Health Care Products of Manitoba et d'autres organisations scientifiques comme le International Centre for Infectious Diseases, le PARI-CNRC et le CRSNG. D'autres locataires, notamment un cabinet d'avocats et une soci�t� d'experts-conseils en gestion, sont install�s au CCTB-CNRC afin d'offrir leurs services aux entreprises en incubation.
- Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques (Ontario) – Le Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques (CCFDP-CNRC) a �t� le pivot des efforts d�ploy�s en 2006-2007 pour maintenir le Canada parmi les pays de t�te dans le secteur de la photonique. En plus de ses installations de fabrication industrielle de calibre mondial, le CCFDP-CNRC offre ses services � l'�chelle r�gionale et nationale, comblant ainsi le vide actuel entre la recherche de pointe en photonique et la commercialisation. La plus importante grappe de photonique au Canada se trouve � Ottawa et compte pr�s de 85 entreprises, universit�s et laboratoires f�d�raux offrant des solutions ax�es sur la photonique et 1 800 entreprises de haute technologie comptant 76 000 employ�s engag�s dans le secteur des technologies de l'information, des communications, des sciences de la vie et de la s�curit�. � la suite des compressions d'effectif dans les laboratoires de JDS Uniphase et de Nortel � Ottawa, de nombreuses petites entreprises de technologie de pointe ont �t� cr��es par les employ�s les plus entreprenants et celles-ci se tournent d�sormais vers le CCFDP-CNRC pour avoir acc�s � des installations de fabrication qu'il leur serait impossible de d�velopper � l'interne. En outre, le CCFDP-CNRC est devenu un v�ritable centre de formation pour la prochaine g�n�ration de main-d'œuvre sp�cialis�e qui maintiendra le Canada � la fine pointe de la R-D en photonique. Gr�ce � un accord conclu avec l'Universit� Carleton, 30 �tudiants ont eu acc�s aux installations du CCFDP-CNRC en 2006-2007. Du personnel hautement qualifi� (PHQ) suppl�mentaire a eu acc�s � ses installations par l'entremise de CMC Microsystems. Par ailleurs, 24 �tudiants ont assist� � un cours de deux jours organis� par le Coll�ge Algonquin. En 2006-2007, le CCFDP-CNRC a sign� des contrats d'une valeur de plus de 1 million de dollars avec des clients industriels.
De l’�mergence au d�veloppement : assurer le progr�s des grappes – La majorit� des grappes technologiques r�cemment cr��es en sont encore aux �tapes initiales de leur d�veloppement : construction d’installations, recrutement de ressources humaines comp�tentes et d�veloppement de r�seaux avec des partenaires des secteurs public et priv� et obtention d’une aide � la R-D. En 2006-2007, le CNRC a continu� de stimuler leur croissance en d�veloppant une base solide de r�seaux et de partenaires, en consolidant ses infrastructures, en s’effor�ant d’embaucher des chercheurs hautement qualifi�s et en accordant une aide strat�gique � la R-D. Le CNRC a aussi maintenu sa participation au sein des grappes plus �volu�es comme celles ax�es sur la biotechnologie des plantes (� Saskatoon) et la biopharmaceutique (� Montr�al). Voici quelques exemples de grappes naissantes dont le CNRC a continu� de favoriser le d�veloppement en 2006-2007 :
- Nanotechnologie (Alberta) – En juin 2006, l’Institut national de nanotechnologie (INN) a c�l�br� l’inauguration de l’une des installations de recherche les plus avanc�es du monde sur le plan technologique. L’INN est le fruit d’un partenariat entre le CNRC, le gouvernement de l’Alberta et l’Universit� de
l’Alberta, visant � cr�er un �tablissement de R-D unique qui combinerait la culture universitaire ax�e sur la cr�ativit� et la comp�titivit� et la culture davantage ax�e sur la strat�gie et les r�sultats d’un laboratoire f�d�ral. Ce partenariat entretient aussi des liens uniques et nouveaux avec le secteur priv�, ce qui favorise le lancement de projets de recherche
conjoints avec des partenaires industriels. � ce jour, des accords de collaboration ont �t� sign�s avec un certain nombre d’entreprises comme Xerox, HP et plusieurs entreprises de la r�gion. La valeur de ces accords d�passe les 4 millions de dollars, y compris des investissements provinciaux.
Une grappe a commenc� � prendre forme gr�ce aux travaux de nanoMEMS Edmonton, une organisation de d�veloppement communautaire r�unissant le CNRC, la Ville d'Edmonton, l'Universit� de l'Alberta, D�veloppement de l’�conomie de l’Ouest Canada, Micralyne Inc., Bigbandwidth et d’autres promoteurs industriels qui ont tous � cœur de stimuler la croissance des recherches en nanotechnologie dans la r�gion. L’INN est au cœur de la strat�gie de l’Alberta dans le secteur de la nanotechnologie, qui a �t� publi�e en mai 2007. Dans le cadre de cette strat�gie, la province attribue des cr�dits de 130 millions de dollars sur cinq ans aux projets de R-D qui engendreront des retomb�es �conomiques dans les secteurs suivants : �nergie durable; technologies m�dicales et de la sant�; et technologies li�es � l'agriculture, � l'alimentation et � la foresterie.
- Nutraceutique et aliments fonctionnels (Saskatchewan) – La r�gion de Saskatoon compte environ 30 entreprises du secteur de la � nutraceutique � et des � aliments fonctionnels �. Ces entreprises luttent pour augmenter leur part de march� et g�n�rent un chiffre d'affaires annuel collectif de pr�s de 60 millions de dollars. Le nombre d'entreprises de ce
secteur ne cesse d'augmenter dans l'Ouest du Canada. Le CNRC a donc d�fini les principaux enjeux auxquels sont confront�es les entreprises de ce secteur : absence de renseignements commerciaux et de connaissance du march�, formation en gestion, comp�tences en gestion des technologies, connaissance de la r�glementation et capitaux de d�marrage. Pour combler ces lacunes, le CNRC a
officiellement lanc� en novembre 2006 le Centre de commercialisation BioAccess pour aider les PME du secteur des aliments sant� et des produits de sant� naturels de l'Ouest canadien � survivre � l'�tape cruciale du d�marrage. Install� � l'Institut de biotechnologie des plantes du CNRC (IBP-CNRC) � Saskatoon, ce nouveau centre sert en quelque sorte de guichet unique o� les
entreprises du secteur des aliments sant� et des produits de sant� naturels de l'Ouest canadien ont acc�s � des services d'aide � la recherche, � des comp�tences en affaires et � des services de veille technologique concurrentielle.
- Technologies de l'aluminium (Qu�bec) – Le Centre des technologies de l'aluminium du CNRC (CTA-CNRC) offre � l'industrie canadienne le savoir-faire et le soutien technique n�cessaires au d�veloppement de produits et de services � forte valeur ajout�e li�s � l'aluminium. L'objectif du CTA-CNRC est de d�velopper, de concert avec ses partenaires, des
technologies de pointe qui int�resseront les entreprises du secteur de la fabrication de pi�ces en aluminium. En 2006-2007, le CTA-CNRC a commenc� � collaborer avec des fabricants de pi�ces d'automobile et un important constructeur du secteur de l'automobile afin d'�valuer le rendement de pi�ces d'automobile et de composants structurels en aluminium form�. La capacit� de ces
structures d'absorber l'�nergie en cas de collision catastrophique est essentielle afin de garantir la s�curit� des passagers des v�hicules. En augmentant la quantit� d'aluminium entrant dans la fabrication des automobiles, il serait possible de r�duire leur poids, d'o� une diminution de l'�nergie n�cessaire pour les mouvoir et donc, une baisse de la consommation d'�nergie et une
r�duction des �missions de gaz � effet de serre.
- Infrastructures urbaines (Saskatchewan) – Au d�part, le Centre de recherche sur les infrastructures durables du CNRC (CRID-CNRC) s'int�ressait surtout au d�veloppement et � la gestion d'infrastructures durables des eaux et des eaux us�es. En 2006-2007, les travaux se sont poursuivis afin de mieux comprendre la mod�lisation en d�veloppement des
interactions sol-tuyaux qui a pour objet de simuler le comportement des conduites d'eau dans diff�rents sc�narios environnementaux typiques; de d�velopper des prototypes de mat�riel informatique et de logiciels permettant de proc�der � une surveillance continue du d�bit dans les r�seaux d'�gouts sanitaires et pluviaux; de d�velopper un algorithme novateur pour la planification du
renouvellement des r�seaux d'aqueduc, d'�gouts et de routes; et afin d'offrir un soutien en nature � la ville de Regina afin d'�valuer la contribution des dalots souterrains � l'�coulement des eaux pluviales dans le r�seau municipal d'�gouts domestiques. Ces projets s'appuient sur le soutien en nature et la collaboration �troite de la ville de Regina en sa qualit� de partenaire et
de � laboratoire vivant �.
- Biosciences (�le-du-Prince-�douard) – L'Institut des sciences nutritionnelles et de la sant� du CNRC (ISNS-CNRC), install� � Charlottetown, et ses partenaires de l'Agence de promotion �conomique du Canada atlantique, de la province de l'�le-du-Prince-�douard (�.-P.-�.) et de l'Universit� de l'�.-P.-�. aident la collectivit� � d�velopper et � �largir ses
comp�tences actuelles et ses capacit�s dans le domaine des bioressources.
L'ISNS-CNRC apporte � la grappe locale des comp�tences qu'il met � contribution pour d�terminer de quelle mani�re les compos�s bioactifs trouv�s dans la nature pourraient �tre utilis�s afin d'am�liorer la sant� humaine et animale, plus particuli�rement dans trois domaines cl�s : troubles neurologiques (comme la maladie d'Alzheimer); troubles li�s � l'ob�sit� (comme le diab�te) et infections et probl�mes immunitaires (comme les infections virales). En plus de mettre � la disposition des milieux locaux des scientifiques de calibre mondial, de l'�quipement et une infrastructure, l'Institut est l'expression d'un mod�le nouveau et audacieux de partenariat de recherche � l'int�rieur duquel les scientifiques des universit�s, de l'administration publique et du secteur priv� travaillent c�te � c�te sur un th�me commun ax� sur la d�couverte, l'innovation et la commercialisation. Ces scientifiques collaborent avec leurs coll�gues de la r�gion et d'ailleurs dans le monde, s'assurant que les plus r�centes technologies et m�thodologies sont utilis�es afin de r�agir aux probl�mes de sant� critiques qui touchent les Canadiens et la population mondiale.
La grappe de l'�.-P.-�. peut d�j� s'enorgueillir de certains chiffres impressionnants en termes de cr�ation d'emplois et de revenus. En 2006-2007, 650 personnes travaillaient dans le secteur cibl�, dont 400 dans 20 entreprises priv�es, et 250 dans 10 organisations publiques. En 2005, la grappe des bioressources de l'�.-P.-�. a g�n�r� des revenus de 61 millions de dollars dans des entreprises priv�es. La PEI BioAlliance s'est fix� les cibles suivantes pour 2010 : 1 000 employ�s dans le secteur priv�, 200 millions de dollars de revenus dans le secteur priv� et augmentation des d�penses en R-D de l'ordre de 40 � 60 millions de dollars. Le CNRC jouera un r�le cl� dans la poursuite de ces objectifs.
�largir le r�seau d'installations de partenariat industriel (IPI) – � l'appui de ses activit�s de d�veloppement de grappes technologiques, le CNRC a continu� de concevoir, de construire et d'assurer le fonctionnement d'IPI partout au Canada. Ces installations uniques sont de v�ritables sanctuaires de recherche conjointe, un terreau fertile pour les entreprises naissantes et pour les entreprises d�riv�es des activit�s du CNRC. Elles servent en outre de ressources communautaires en offrant des services de mentorat, de financement pour l'innovation et de veille technologique concurrentielle aux entreprises naissantes. En 2006-2007, le CNRC comptait 15 IPI r�parties un peu partout au pays et celles-ci h�bergeaient un total de 122 entreprises en incubation, 9 locataires s'�tant �mancip�s en cours d'ann�e. En 2006-2007, deux nouvelles installations ont ouvert leurs portes, ce qui a port� la superficie totale de locaux offerts � l'industrie dans les IPI � un peu moins de 30 000 m�tres carr�s. On trouvera ci-dessous un tableau dressant la liste des IPI d�j� ouvertes et de celles dont la construction est pr�vue.
Tableau 2-2 : Installations de partenariat industriel du CNRC – Ouvertes et planifi�es
|
|
Emplacement |
Superficie totale (en m2) |
Statut |
Date d'ach�vement |
Pourcentage de la superficie occup�e |
|
1 |
Institut des technologies oc�aniques (St. John's, Terre-Neuve) |
4411 |
en exploitation |
2003-2004 |
88 % |
|
2 |
Institut des biosciences marines (Halifax, Nouvelle-�cosse) |
1 0362 |
en exploitation |
2004-2005 |
22 % |
|
3 |
Institut de technologie de l'information (Fredericton, Nouveau-Brunswick) |
6273 |
en exploitation |
2002-2003 |
87,5 % |
|
4 |
Institut de recherche en biotechnologie (Montr�al, Qu�bec) |
9 800 |
en exploitation |
1997-1998 |
95 % |
|
5 |
Institut des mat�riaux industriels (Boucherville, Qu�bec) |
2 180 |
en exploitation |
2003-2004 |
52 % |
|
6 |
Installation de partenariat industriel du CNRC, �difice M-50 (Ottawa, Ontario), (partag�e par plusieurs instituts) |
1 604 |
en exploitation |
1998-1999 |
82 % |
|
7 |
Installation de partenariat industriel du CNRC, �difice M-23A (Ottawa, Ontario), (partag�e par plusieurs instituts) |
297 |
en exploitation |
2004-2005 |
14 % |
|
8 |
Installation de partenariat industriel du 100, Sussex (Ottawa, Ontario), (partag�e par plusieurs instituts) |
509 |
en exploitation |
2003-2004 |
90 % |
|
9 |
Institut du biodiagnostic (Winnipeg, Manitoba) |
1 194 |
en exploitation |
2005-20064 |
59 % |
|
10 |
Institut de biotechnologie des plantes (Saskatoon, Saskatchewan) |
7 314 |
en exploitation |
2002-2003 |
99 % |
|
11 |
Institut d'innovation en piles � combustible (Vancouver, Colombie‑Britannique) |
1 209 |
en exploitation |
1999-2000 |
85 % |
|
12 |
Institut Herzberg d'astrophysique (Penticton, Colombie-Britannique)5 |
1416 |
en exploitation |
2001-2002 |
73 % |
|
13 |
Institut des sciences nutritionnelles et de la sant� (Charlottetown, �le‑du‑Prince‑�douard) |
477 |
en exploitation |
2006-2007 |
54 % |
|
14 |
Institut de recherche en a�rospatiale (Montr�al, Qu�bec) |
929 |
en exploitation |
2006-2007 |
0% 7 |
|
15 |
Centre d'innovation de l'INN (Edmonton, Alberta) |
2 700 |
en chantier |
2007-2008 |
- |
|
|
Total |
30 448 |
|||
1 Superficie totale r�duite de 60 m�tres carr�s lorsque des locaux temporaires ont cess� d'�tre utilis�s (ITO-CNRC).
2 La superficie indiqu�e de 691 m�tres carr�s en 2005-2006 �tait inexacte (IBM-CNRC).
3 La superficie indiqu�e de 1 000 m�tres carr�s en 2005-2006 �tait inexacte (ITI-CNRC).
4 477 m�tres carr�s de ces locaux sont op�rationnels depuis 1995-1996 (IBD-CNRC).
5 Des locaux pr�c�demment d�sign�s comme appartenant � l'IPI de Victoria ont �t� attribu�s aux �quipes du PLT (IHA-CNRC).
6 Des locaux additionnels ont �t� attribu�s � l'Okanagan Research and Innovation Centre (ORIC) (IHA-CNRC).
7 L'absence de locataires est imputable au fait que l'installation a ouvert ses portes en f�vrier 2007.
Rapprocher entre eux les groupes communautaires et faciliter leur engagement gr�ce � un soutien horizontal (PARI-CNRC et ICIST-CNRC) – Une des priorit�s du PARI-CNRC au cours des derni�res ann�es a �t� de rapprocher les groupes r�gionaux et de faciliter leur participation � l'�tablissement des r�seaux techniques, financiers et d'affaires essentiels au d�veloppement des grappes. En 2006-2007, le PARI-CNRC a maintenu son r�le de chef de file en collaborant avec les intervenants r�gionaux et en d�veloppant entre eux des partenariats afin de renforcer l'infrastructure r�gionale d'innovation n�cessaire au d�veloppement des grappes. Dans plusieurs grappes, l'ICIST-CNRC a ouvert des centres d'information (CIC) qu'il a install�s dans des instituts du CNRC. Les CIC offrent des services d'analyse et d'information scientifique, technique et m�dicale aux chercheurs du CNRC, aux entreprises situ�es sur place et aux clients de l'ext�rieur dans la r�gion. En 2006-2007, l'ICIST-CNRC s'est associ� aux activit�s de sensibilisation des instituts afin de promouvoir l'offre d'un ensemble int�gr� de services � la client�le r�gionale.
Strat�gie : Poursuivre l'application d'une strat�gie d'investissement et de gestion � long terme ax�e sur un effort soutenu et sur la patience des investisseurs. |
Am�liorer la collaboration par des partenariats – Le plein d�veloppement des initiatives de grappes technologiques du CNRC est un engagement � long terme, car il faut au moins 15 � 20 ans avant qu'une grappe atteigne sa pleine maturit�. Le CNRC a intensifi� ses efforts afin de stimuler la collaboration et les partenariats avec l'industrie et d'amener les intervenants � contribuer au d�veloppement des grappes un peu partout au Canada. On trouvera au tableau 2-3 un sommaire des initiatives de d�veloppement de grappes technologiques du CNRC actuellement en cours et une indication des ressources financi�res aff�rentes.
Tableau 2-3 : R�partition des ressources pour le d�veloppement des initiatives de d�veloppement des grappes technologiques du CNRC
|
Emplacement |
Domaine |
Ressources |
|
De 2005-2006 � 2009-2010 |
||
|
Halifax (N.-�.) |
Sciences de la vie (IBM-CNRC et IBD-CNRC) |
19,5 millions $ |
|
Fredericton, Moncton et Saint John (N.-B.) |
Technologie de l'information |
48,0 millions $ |
|
St. John's (T.-N.-L.) |
Technologies oc�aniques |
16,0 millions $ |
|
Canada atlantique |
Coordination, administration, �tudes sp�ciales, aide � l'innovation, diffusion d'information et de connaissances en S-T |
26,5 millions $ |
|
De 2002-2003 � 2006-2007 |
||
|
Saguenay-Lac-Saint-Jean (Qu�bec) |
Technologies de l'aluminium |
|
|
Ottawa (Ont.) |
Photonique |
30,0 millions $ |
|
Winnipeg (Man.) |
Technologies des dispositifs m�dicaux |
10,0 millions $ |
|
Saskatoon (Sask.) |
Nutraceutique |
10,0 millions $ |
|
Edmonton (Alb.) |
Nanotechnologie |
60,0 millions 3 |
|
Vancouver (C.-B.) |
Piles � combustible |
20,0 millions |
|
De 2003-2004 � 2007-2008 |
||
|
Charlottetown (�.-P.-�.) |
Sciences nutritionnelles et sant� |
20,0 millions $ |
|
Regina (Sask.) |
Infrastructures urbaines durables |
10,0 millions $ |
1 Une somme additionnelle de 5 millions de dollars a �t� re�ue en 2001-2002.
2 D�veloppement �conomique Canada pour les r�gions du Qu�bec (DEC) a vers� une somme �gale.
3 La province de l'Alberta a �galement vers� 60 millions de dollars.
Strat�gie : Appuyer une am�lioration continue gr�ce � des strat�gies de mesure du rendement uniques et novatrices. |
Le CNRC a mis au point une m�thode de mesure du rendement des grappes s'appuyant sur les recherches du Innovation Systems Research Network (ISRN). Parfaitement adapt�e au CNRC, cette m�thode int�gre un mod�le de d�veloppement des grappes qui tient compte du r�le et de la contribution du CNRC ainsi que de ceux des autres principaux intervenants (entreprises, administrations publiques, clients et concurrents). Parmi les �l�ments cl�s de cette m�thode, mentionnons le cadre qui fixe un ensemble global d'indicateurs de d�veloppement des grappes et une s�rie d'outils pour d�terminer o� chaque grappe est situ�e en termes de d�veloppement. Les outils utilis�s comprennent le relev� complet des entreprises de la grappe, la tenue d'entrevues avec des repr�sentants des entreprises et les principaux intervenants, et une analyse du r�seau social. En 2006-2007, le CNRC a achev� des projets cl�s de d�veloppement d'indicateurs de base afin d'�valuer le progr�s des grappes de Winnipeg, de Saskatoon, d'Edmonton, de Vancouver, du Saguenay et d'Ottawa. Ces projets ont g�n�r� l'information n�cessaire pour appuyer les efforts en vue d'obtenir le renouvellement du financement des initiatives de d�veloppement des grappes.
Le CNRC maintient son engagement d'�valuer le progr�s de ses initiatives de d�veloppement de grappes afin de s'assurer que celles-ci atteignent bien leurs objectifs. En 2006‑2007, le CNRC a �valu� les initiatives de d�veloppement de grappes qui ont re�u des cr�dits pour la p�riode de 2002-2003 � 2006-2007 (grappes de la deuxi�me phase). Le CNRC a recueilli des donn�es de plusieurs sources, y compris des donn�es issues d'analyses du rendement, de documents et de la litt�rature en la mati�re, d'entrevues avec les intervenants et avec des repr�sentants du CNRC et d'une analyse de la situation s'appuyant sur les donn�es de base. Gr�ce � ces �valuations, il est possible d'�tablir la pertinence des initiatives, leurs succ�s � ce jour, leur efficacit� et de cerner des possibilit�s d'am�lioration. On peut consulter ces rapports � http://www.nrc-cnrc.gc.ca/aboutUs/audit_f.html.
Priorit� no 4 : Administration du programme de mani�re � assurer la viabilit� de l'organisation
|
Indicateurs de rendement (d�finis dans le RPP de 2006-2007) |
|
Les indicateurs de rendement qui ne changent pas d'un exercice � l'autre ne sont pas analys�s annuellement.
En 2006-2007, le CNRC a r�pertori� les grands secteurs de programme o� il entend concentrer ses ressources :
- Neuf secteurs industriels cl�s
- Innovation r�gionale et communautaire ax�e principalement sur les initiatives de d�veloppement de grappes technologiques du CNRC
- Priorit�s nationales en sant� et en mieux-�tre, en �nergie durable et en environnement
- Initiatives nationales en science et en innovation, y compris les programmes o� le CNRC s'acquitte d'un mandat national et les programmes faisant appel aux infrastructures majeures en S-T
S'appuyant sur des consultations men�es aupr�s des intervenants, le CNRC estime que la concentration de ses efforts et de ses ressources dans ces domaines est le moyen id�al d'en maximiser les retomb�es et la valeur cr��e pour le Canada.
Toujours en 2006-2007, le Comit� de la haute direction (CHD) du CNRC a approuv� un projet applicable � l'ensemble de l'organisation (d�but pr�vu en 2007-2008) qui vise � quantifier le r�investissement n�cessaire pour maintenir les infrastructures physiques et les immobilisations les plus importantes de l'organisation : installations, �quipement et technologies de l'information (mat�riel et logiciels). Les �quipes du projet produiront � l'intention du CHD des rapports dans lesquels elles formuleront des recommandations sur les investissements prioritaires et la valeur totale des cr�dits n�cessaires au cours des trois � cinq prochaines ann�es.
Strat�gie : Renouveler le CNRC – repositionner l'organisation en vue de l'avenir et s'attaquer aux engagements pris dans le Cadre de responsabilisation et de gestion. |
Voici quelques-uns des projets cl�s � l'appui de l'Initiative de renouvellement du CNRC :
Nouvelle orientation strat�gique de l'organisation – Comme nous en avons trait� � la section I – Survol, quatre projets de mise en œuvre de la strat�gie ont �t� lanc�s en 2006-2007 : programmes de recherche; analyse des activit�s; gestion de la planification, du rendement et des ressources (GPRR) et organisation durable. Les recommandations cl�s au sujet de ces projets sont r�sum�es dans l'�bauche du Plan d'activit�s du CNRC �tabli pour la p�riode de 2007, 2008, 2009 et 2010. L'�laboration de ce plan devrait �tre termin�e au d�but de 2007-2008. Celui-ci servira de guide � tous les instituts, directions et programmes dans la mise en œuvre de la strat�gie du CNRC.
Strat�gies pour l'obtention de ressources durables – Confront� � des pressions constantes en mati�re de ressources, le CNRC devra utiliser celles qui lui seront confi�es en effectuant des choix strat�giques. Voici ce que cela suppose :
-
S'attaquer aux probl�mes de financement – En 2006-2007, le Comit� de la haute direction du CNRC (CHD) s'est entendu sur la d�marche suivante pour r�soudre le probl�me caus� par l'obtention de ressources financi�res � long terme pour le CNRC :
- Concentrer les ressources de l'organisation sur les priorit�s de R-D suivantes :
- D�finir les possibilit�s de gains d'efficacit� op�rationnels � l'interne.
Le vice-pr�sident, Services corporatifs, a re�u le mandat d'orchestrer les efforts d�ploy�s pour mettre fin aux d�doublements inutiles de t�ches et cerner les possibilit�s d'augmenter le nombre de services organisationnels partag�s.
- Travailler de plus en plus avec des collaborateurs.
Le CNRC peut maximiser l'incidence de ses activit�s au Canada en collaborant avec d'autres organismes (minist�res, universit�s, entreprises priv�es) � la recherche de solutions aux probl�mes sociaux et �conomiques � saveur scientifique et technologique complexe. Ce genre de collaboration permettra au CNRC d'obtenir les ressources n�cessaires pour entreprendre des activit�s de R-D.
- D�finir et cibler les besoins d'investissements futurs.
� l'appui de sa strat�gie, le CNRC d�finira les secteurs cibles susceptibles d'exiger de nouveaux investissements ou des investissements accrus. Le CNRC proc�dera � une analyse de rentabilisation d�crivant les secteurs exigeant de nouveaux investissements, exposant les motifs qui justifient les investissements dans ces secteurs et d�crivant les retomb�es attendues pour le Canada.
La mise en œuvre de ces mesures destin�es � assurer un financement durable devrait s'amorcer en 2007-2008. La plupart d'entre elles devraient �tre permanentes et seront ensuite vis�es par le processus annuel de planification et d'attribution des ressources du CNRC.
- Concentrer les ressources de l'organisation sur les priorit�s de R-D suivantes :
-
Recruter, conserver et former des personnes qualifi�es en S-T – La strat�gie de gestion des ressources humaines du CNRC (GRH) est actuellement reconsid�r�e dans la foul�e de l'adoption des nouveaux plans d'activit�s et des nouveaux plans strat�giques du CNRC. Dans le cadre de ce processus, les cinq pierres d'assise de la strat�gie de GRH sont en voie
d'�tre r�vis�es afin de s'assurer qu'elles sont conformes � la strat�gie du CNRC applicable jusqu'en 2011. Voici quelques-uns des progr�s les plus marquants accomplis en 2006-2007 dans la poursuite des objectifs �tablis dans le plan pr�c�dent des RH :
- En 2006-2007, le CNRC a accompli des progr�s remarquables dans l'ex�cution de son programme de formation. Des s�ances d'orientation par �mission Web destin�es aux nouveaux employ�s ont �t� lanc�es partout au sein du CNRC. Dans le cadre d'un effort visant � faire progresser les aptitudes au leadership des chefs de groupe, des ateliers intitul�s � Diriger des �quipes
scientifiques � ont �t� organis�s. Ils ont suscit� un taux de participation int�ressant chez les chefs de groupe et directeurs du CNRC. Les ressources du Centre d'apprentissage de la DRH-CNRC figurent de nouveau dans le catalogue de l'ICIST-CNRC, ce qui facilite l'acc�s aux ressources � des fins de perfectionnement personnel et professionnel. Une conf�rence sur le soutien
administratif (SA), la troisi�me en son genre consacr�e au d�veloppement de carri�res en SA, a �t� organis�e avec succ�s en cours d'exercice. Finalement, une s�ance de planification a eu lieu � laquelle ont particip� des repr�sentants d'employ�s du CNRC et des partenaires ext�rieurs � la communaut� scientifique et technologique f�d�rale afin de d�finir les d�fis et les
possibilit�s d'am�lioration dans le d�veloppement d'un plan d'apprentissage pour le CNRC.
- Le d�veloppement et la mise en œuvre continus du programme Leadership : Enrichissement, apprentissage et d�veloppement (ou programme LEAD) et notamment, de ses quatre volets : l'Orientation en gestion, l'Enjeu ex�cutif, le D�veloppement acc�l�r� en leadership et l'Apprentissage continu en leadership se sont poursuivis. Apr�s un processus de s�lection rigoureux,
17 candidats ont �t� s�lectionn�s parmi plus de 70 postulants au programme LEAD. Ces participants viennent des instituts du CNRC situ�s un peu partout au Canada et poss�dent diff�rentes comp�tences en recherche, en d�veloppement des affaires, en gestion et en partenariat communautaire. Depuis avril 2006, et pendant 18 mois, ces participants travaillent sur les enjeux
auxquels est v�ritablement confront� le CNRC et ce faisant, am�liorent leurs comp�tences en leadership. Ce premier groupe de participants terminera le cours � l'automne 2007 et un nouveau concours sera bient�t annonc� pour recruter des participants � la deuxi�me �dition du Programme LEAD.
- En 2006-2007, des mesures importantes ont �t� prises pour fusionner le processus d'examen au m�rite des employ�s de la cat�gorie MG avec le processus d'examen et de planification du rendement de ces m�mes employ�s. Le processus r�sultant correspond plus �troitement au cadre de responsabilisation et de gestion du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT) ainsi qu'au projet
de processus int�gr� de gestion de la planification, du rendement et des ressources du CNRC de m�me qu'aux autres syst�mes de gestion des RH servant notamment au recrutement, � la dotation en personnel, au perfectionnement et aux programmes de primes. Par ailleurs, le fardeau administratif de ces processus a �t� all�g�. Pour chaque membre de la cat�gorie MG, les nouveaux
processus sont encadr�s par un accord de responsabilit� de la gestion (ARG). Tous ces accords ont pris effet en 2006-2007.
- Plusieurs initiatives ont �t� �labor�es ou lanc�es en 2006-2007 afin d'assurer la diversit� au sein de l'effectif du CNRC. Des s�ances de formation visant � promouvoir un milieu de travail, des communications et un processus de r�glement des litiges respectueux des diff�rences religieuses et sexuelles et des probl�mes de sant� mentale en milieu de travail ont �t�
organis�es en cours d'exercice � l'intention d'une grande diversit� de publics cibles. Les directeurs g�n�raux du CNRC se sont efforc�s d'atteindre les objectifs de diversit� �tablis en vertu des accords individuels de responsabilisation en mati�re de gestion de la diversit�, un processus qui avait �t� lanc� il y a plusieurs ann�es et qui a �t� renforc� en 2006-2007 par
l'ajout d'indicateurs de rendement. Enfin, une �valuation des risques en mati�re de diversit� a �t� effectu�e � la suite de laquelle plusieurs initiatives visant � att�nuer les risques li�s � la diversit� ont �t� r�pertori�s et int�gr�s au Plan de diversit� du CNRC pour la p�riode de 2005 � 2008.
- La planification des RH � l'appui du plan d'activit�s du CNRC a �t� enrichie. On a notamment inclus � titre d'essai des plans d'activit�s de RH aux plans d'activit�s des instituts, des programmes et des directions. On a �galement mis en œuvre un plan d'activit�s de RH qui sera �tay� par une analyse de l'environnement en ressources humaines et par des rapports
am�lior�s sur les RH.
Le CNRC a recrut� 506 employ�s, portant ainsi son effectif total � 4 257 employ�s10 . Plus de 1 273 �tudiants, boursiers postdoctoraux (BPD) et adjoints de recherche (AR) ont travaill� au sein d'�quipes de recherche dans les instituts du CNRC. Ces personnes ont eu la possibilit� de travailler dans un milieu de recherche stimulant, avec des experts en vue dans leur discipline et, ainsi, d'acqu�rir une pr�cieuse exp�rience et de la formation. En 2006-2007, 493 �tudiants dipl�m�s, 401 �tudiants ayant accept� un emploi d'�t� ou travaillant dans le cadre d'un projet travail-�tudes, 263 BPD invit�s par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada et 111 AR ont travaill� pour le CNRC (voir la figure 2-5).
Figure 2-5 : Programmes de formation du CNRC
(de 2002 � 2007)
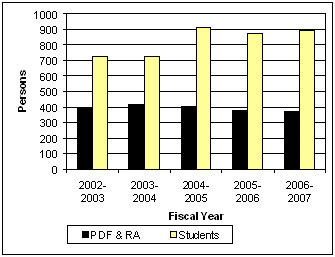
Source : Base de donn�es sur le rendement du CNRC, 200610 Employ�s salari�s au 31 mars 2007.
Taux de roulement – Le taux de roulement a �t� relativement constant au cours des trois derniers exercices, le roulement des employ�s permanents �tant consid�rablement inf�rieur � celui des employ�s temporaires.
2006-2007
2005-2006
2004-2005
(pourcentage)
Taux de roulement total
11,39
10,75
11,08
Taux de roulement des employ�s permanents
3,36
3,16
3,2
(Le taux de roulement total comprend les employ�s arriv�s � la fin de leur contrat et les employ�s � court terme, et �tait donc pr�vu.)�quit� en mati�re d'emploi – Au niveau de l'organisation, la repr�sentation des minorit�s visibles a exc�d� la disponibilit� tandis que la repr�sentation des femmes, des Autochtones et des personnes handicap�es a �t� quelque peu inf�rieure aux pr�visions. Compte tenu de ces r�sultats, le CNRC a proc�d� � un ajustement de ses objectifs d'�quit� en mati�re d'emploi � l'�chelle de l'organisation, des instituts, des programmes et des directions afin de r�gler tous les probl�mes restants de sous-repr�sentation. Il adaptera en outre ses mesures d'appui, le cas �ch�ant, afin d'atteindre ces objectifs.
Groupe d�sign�
Repr�sentation
Disponibilit�*
Diff�rence (nombre)
number
percentage
number
percentage
Femmes
1 531
35,3
1 567
36,2
-36
Autochtones
41
0,9
57
1,3
-16
Personnes handicap�es
171
3,9
175
4,0
-4
Minorit�s visibles
676
15,6
625
14,4
+51
Total de l'effectif
4 334
*Source : Recensement de 2001 et Enqu�te sur la participation et les limitations d'activit� (EPLA).Formation – Gr�ce � la formation donn�e � l'interne comme � l'externe, aux conf�rences et aux possibilit�s d'apprentissage, le CNRC investit dans le perfectionnement de sa main-d'œuvre. En 2006-2007, 5,1 millions de dollars ont �t� ainsi investis dans l'apprentissage, ce qui repr�sente 1,7 % des d�penses salariales (un pourcentage conforme � celui de 2004-2005 et de 2005-2006).
Conventions collectives – Le Groupe des relations avec les employ�s du CNRC a pour mandat de n�gocier et d'administrer les conventions collectives au nom du CNRC et de favoriser la mise en place et le maintien de m�canismes de consultation efficaces et productifs avec les agents n�gociateurs de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et de l'Association des employ�s du Conseil de recherches (AECR), qui repr�sentent la majorit� des employ�s du CNRC. En 2006-2007, dix conventions collectives au total �taient administr�es par ce groupe, dont sept ont �t� n�goci�es en 2006-2007 et trois ont �t� soumises au conseil d'arbitrage pour r�glement final en avril 2007.
Langues officielles –Le CNRC maintient son engagement d'atteindre les objectifs qu'il s'est fix�s dans le cadre du Programme des langues officielles. La proportion de dirigeants du CNRC qui r�pondent aux exigences linguistiques de leur poste a l�g�rement diminu�, passant de 84 % en 2006 � 77 % en 2007. Cette baisse est attribuable � une augmentation marqu�e du nombre de dirigeants embauch�s dans des postes � bilingues non imp�ratifs �. Toutes les personnes nouvellement embauch�es rencontrent le conseiller aux langues officielles afin de fixer avec lui un plan de formation linguistique et de s'engager � respecter les objectifs du Programme des langues officielles. Dans l'ensemble, 89 % des employ�s r�pondent aux exigences linguistiques de leur poste (sur les 11 % qui ne r�pondent pas � ces exigences, pratiquement tous suivent actuellement un programme de formation linguistique ou se sont dot�s d'un tel plan de formation). La Campagne de maintien des acquis en langue seconde du CNRC continue de g�n�rer beaucoup d'int�r�t de la part des membres d'autres organisations f�d�rales. Par exemple, en 2006-2007, le CNRC a re�u des demandes non sollicit�es pour donner des pr�sentations sur ses pratiques exemplaires en la mati�re. Voici quelques-unes des organisations f�d�rales qui ont ainsi sollicit� le CNRC : Patrimoine canadien, le Bureau de la biblioth�que et des archives des sous-ministres adjoints, le Bureau du surintendant des institutions financi�res et Citoyennet� et Immigration Canada.
- En 2006-2007, le CNRC a accompli des progr�s remarquables dans l'ex�cution de son programme de formation. Des s�ances d'orientation par �mission Web destin�es aux nouveaux employ�s ont �t� lanc�es partout au sein du CNRC. Dans le cadre d'un effort visant � faire progresser les aptitudes au leadership des chefs de groupe, des ateliers intitul�s � Diriger des �quipes
scientifiques � ont �t� organis�s. Ils ont suscit� un taux de participation int�ressant chez les chefs de groupe et directeurs du CNRC. Les ressources du Centre d'apprentissage de la DRH-CNRC figurent de nouveau dans le catalogue de l'ICIST-CNRC, ce qui facilite l'acc�s aux ressources � des fins de perfectionnement personnel et professionnel. Une conf�rence sur le soutien
administratif (SA), la troisi�me en son genre consacr�e au d�veloppement de carri�res en SA, a �t� organis�e avec succ�s en cours d'exercice. Finalement, une s�ance de planification a eu lieu � laquelle ont particip� des repr�sentants d'employ�s du CNRC et des partenaires ext�rieurs � la communaut� scientifique et technologique f�d�rale afin de d�finir les d�fis et les
possibilit�s d'am�lioration dans le d�veloppement d'un plan d'apprentissage pour le CNRC.
-
Maintenir et mettre � niveau l'infrastructure de S-T du CNRC – Le Plan d'investissement � long terme (PILT) du CNRC pour la p�riode de 2006 � 2010 sera mis � jour afin de tenir compte des d�cisions d�coulant de la nouvelle strat�gie du CNRC et sera pr�sent� au SCT � l'automne 2007. Le PILT comprend une liste compl�te des besoins en immobilisations au
cours des cinq prochaines ann�es, tant sur le plan des nouvelles installations que sur celui de l'�quipement de recherche. Il est pr�vu que le PILT soit reformul� en fonction de l'analyse du nouveau processus int�gr� de planification des activit�s du CNRC et des donn�es recueillies dans le cadre des �tudes d'�valuation des �tablissements et des immeubles qui se terminera
� l'�t� ou � l'automne 2007.
Le CNRC continue de recapitaliser ses �l�ments d'actif par l'affectation de 2,5 millions de dollars afin de r�pondre aux besoins les plus pressants en mati�re d'infrastructures, l'accent �tant mis sur la sant� et la s�curit� et sur la gestion du cycle de vie de l'�quipement. Voici quelques-uns des projets de recapitalisation men�s � bien en 2006-2007 :
- Remplacement du r�servoir de stockage souterrain (M54, Ottawa)
- Enl�vement du r�servoir de stockage souterrain (U62, Ottawa)
- Remplacement d'un compresseur � air (M06, Ottawa)
- Am�liorations aux infrastructures (M17, Ottawa)
- Nouveau refroidisseur (M23, Ottawa)
- Mise � niveau du mat�riel de commutation (M50, Ottawa)
- Conduites d'eau refroidie (M50, Ottawa)
- Nouveau refroidisseur et remplacement du CCM (M55, Ottawa)
- R�paration des murs ext�rieurs et mise � niveau du syst�me de CVCA (U66, Ottawa)
- Mise � niveau du mat�riel de commutation (U70, Ottawa)
- Remplacement de la chaudi�re (IBD-CNRC, Winnipeg)
- Remplacement du groupe �lectrog�ne d'urgence (ITO-CNRC, St. John's)
- Remplacement du g�n�rateur de vapeur et de la batterie de condensateurs (IRB-CNRC, Montr�al)
- Remplacement des puits de lumi�re (IMI‑CNRC, Boucherville)
- R�paration des murs ext�rieurs (IBM-CNRC, Halifax)
Par ailleurs, tout au long de l'ann�e, le CNRC a particip� � l'examen des immobilisations dirig� par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor et � l'exercice d'int�gration des obstacles � la science et � la technologie.
- �laborer une strat�gie triennale de communication pour le CNRC – Le CNRC a �labor� et mis en œuvre une strat�gie de communication interne et externe � court terme (un an) � la place d'un aper�u triennal des communications. Cette strat�gie vise � mieux appuyer le lancement initial et la mise en œuvre de la premi�re �tape de la nouvelle
strat�gie du CNRC La Science � l'œuvre pour le Canada : Une strat�gie pour le Conseil national de recherches du Canada 2006 � 2011. Outre les initiatives et les besoins commerciaux du CNRC, cette strat�gie prend en compte les priorit�s commerciales, strat�giques et technologiques du gouvernement du Canada ainsi que les r�sultats de l'Initiative de renouvellement du CNRC et
des �tudes sur ses m�thodes de fonctionnement. L'�laboration d'un aper�u complet des communications sur trois ans – qui sera lanc� en 2007-2008 – a aussi �t� entam�e. Cet aper�u sera �tay� par des enqu�tes d'opinion sur le CNRC, ses services et ses m�thodes de prestation des services, il contribuera � la mise en œuvre int�grale du plan d'activit�s du CNRC et � la
poursuite de ses principaux engagements en mati�re de R-D, de soutien industriel, de stimulation de la croissance �conomique des collectivit�s, et il appuiera sa d�cision de se concentrer sur les enjeux cruciaux en sant�, en environnement et en �nergie.
En 2006-2007, le CNRC a �galement poursuivi ses efforts de communication avec d'autres minist�res et avec l'ensemble de l'administration f�d�rale en mati�re de S-T et ses initiatives d'innovation. Voici quelques exemples : la Commission d'int�gration des S-T; le nouveau programme de sensibilisation � la science et certaines initiatives comme la Grande aventure scientifique canadienne et le leadership exerc� par le CNRC dans le cadre du concours national canadien Marsville; l'Initiative de repr�sentation accrue Canada-Etats-Unis; et le portail Internet du gouvernement du Canada sur la science et la technologie. De plus, le CNRC s'est associ� � un certain nombre d'autres minist�res f�d�raux pour d�velopper la campagne publicitaire des Services pour les entreprises afin d'appuyer les efforts de sensibilisation � l'ensemble des services offerts aux entreprises par le Portefeuille de l'Industrie.
- V�rification interne – En r�action directe � la nouvelle politique du SCT sur la v�rification interne qui a pris effet le 1er avril 2006, la fonction de v�rification interne au CNRC a fait l'objet d'une restructuration importante et des cr�dits additionnels lui ont �t� attribu�s. Outre la dotation d'un poste nouvellement cr�� de directeur, V�rification interne, qui agira �galement en tant que chef de la v�rification au sein du Conseil, deux postes de gestionnaire, V�rification, ont aussi �t� dot�s par des v�rificateurs agr��s exp�riment�s. Une charte de v�rification interne r�vis�e et un plan de v�rification pluriannuel ax� sur les risques ont tous les deux �t� approuv�s par le Comit� de la v�rification, de l'�valuation et de la gestion des risques du CNRC. Certains retards sont survenus dans la mise en œuvre int�grale du plan de v�rification � cause des d�lais requis pour embaucher le personnel appropri�. Toutefois, on pr�voit que les travaux de v�rification entrepris en 2006-2007 relativement � la gestion de la s�curit� informatique, au Programme d'aide � la recherche industrielle et aux v�rifications de conformit� en ce qui concerne les frais de d�placement, les frais d'accueil, les contrats et les cartes d'achat seront finalis�s d�s 2007-2008.
Strat�gie : Poursuivre la mise en œuvre des recommandations du v�rificateur g�n�ral du Canada. |
Mettre en œuvre le plan d'action pour l'application des recommandations du v�rificateur g�n�ral du Canada– Le Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada (BVG) a proc�d� � une v�rification du CNRC en 2003-2004 visant � �valuer les syst�mes et les pratiques par lesquels le CNRC �tablit les orientations strat�giques de ses activit�s de recherche, afin de d�terminer si le CNRC a g�r� ses activit�s de mani�re � maximiser les r�sultats obtenus et d'�valuer si le CNRC a mesur� les r�sultats et les retomb�es de ses efforts et les a communiqu�s de mani�re satisfaisante. En 2006-2007, le BVG a examin� les progr�s accomplis par le CNRC en r�ponse aux recommandations faisant suite � la v�rification effectu�e par le BVG en 2004 sur la gestion de la recherche de pointe au CNRC. On trouvera davantage de d�tails au tableau 3-11.
Section III – Renseignements suppl�mentaires
Renseignements sur l'organisation
Mandat du CNRC
En vertu de la Loi sur le Conseil national de recherches, il incombe au CNRC :
- d'effectuer, de soutenir ou de promouvoir des travaux de recherche scientifique et industrielle dans diff�rents domaines d'importance pour le Canada;
- de mettre sur pied une biblioth�que scientifique nationale, d'en assurer le fonctionnement et de la tenir � jour;
- de publier, vendre ou diffuser de l'information scientifique ou technique si le CNRC le juge n�cessaire;
- d'�tudier des unit�s et techniques de mesure;
- de travailler � la normalisation et � l'homologation d'appareils et d'instruments scientifiques et techniques ainsi que de mat�riaux utilis�s ou utilisables par l'industrie canadienne;
- d'assurer le fonctionnement et la gestion des observatoires astronomiques �tablis ou exploit�s par le gouvernement du Canada;
- d'administrer les activit�s de recherche-d�veloppement du CNRC, y compris d'assurer le processus d'attribution des subventions et des contributions vers�es dans le cadre de projets internationaux;
- d'assurer aux chercheurs et � l'industrie les services scientifiques et technologiques essentiels.
Consulter le site http://lois.justice.gc.ca/fr/N-15/index.html pour de plus amples renseignements sur le cadre l�gislatif qui r�git le CNRC.
Cadre de responsabilisation du CNRC
Le CNRC rel�ve directement du Parlement canadien par l'entremise du ministre de l'Industrie. Le CNRC travaille en partenariat avec les organismes membres du Portefeuille de l'Industrie afin de pouvoir miser sur les ressources compl�mentaires qu'ils ont � offrir et d'exploiter les synergies possibles dans des domaines comme la croissance des petites et moyennes entreprises (PME),
l'innovation au sein des entreprises gr�ce � la S-T et la croissance �conomique des collectivit�s canadiennes. Le Conseil d'administration du CNRC formule l'orientation strat�gique et examine le rendement de l'organisation, et conseille le pr�sident. Il appartient au pr�sident de s'assurer que les strat�gies de l'organisation sont mises en œuvre et qu'elles donnent les r�sultats
escompt�s. Cinq vice-pr�sidents (Sciences de la vie, Sciences physiques, G�nie, Soutien technologique et industriel et Services corporatifs) assument la responsabilit� d'un portefeuille d'instituts de recherche, de programmes et de centres de technologie. La figure 3-1 donne un aper�u de la structure du CNRC.
Figure 3-1 : Organigramme du CNRC
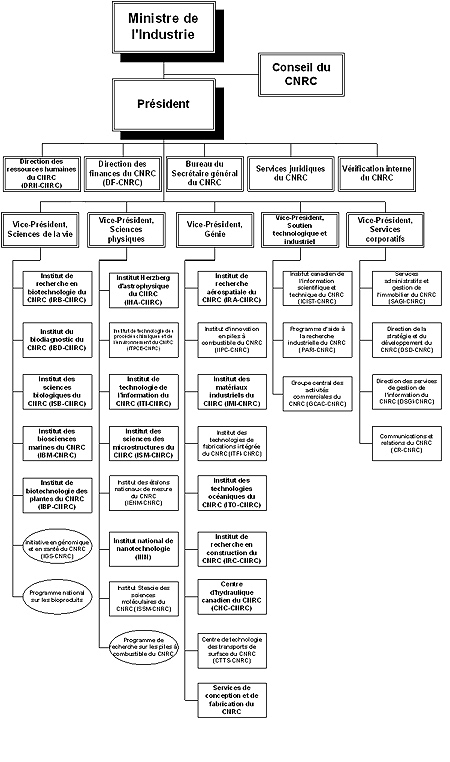
Ressources du CNRC
|
Comparaison des d�penses pr�vues aux d�penses r�elles, y compris les ETP |
|
|
Ressources par Utilisation des ressources par activit� de programme |
|
|
Postes vot�s et l Postes vot�s et l�gislatifs |
|
|
Services re�us � titre gracieux |
|
|
Sources des revenus disponibles |
|
|
Besoins en ressources par direction et secteur d'activit� |
|
|
A. Frais d'utilisation |
|
|
Renseignements sur les d�penses de projets |
|
|
Renseignements sur les programmes de paiements de transfert |
|
|
�tats financiers |
|
|
R�ponse aux comit�s parlementaires, aux v�rifications et aux �valuations |
|
|
Initiatives horizontales |
|
|
Politiques sur les voyages – sur support �lectronique seulement |
|
|
R�servoirs de stockage – sur support �lectronique seulement |
|
|
2006-2007 |
|||||||||
|
Activit� de programme |
D�penses r�elles 2004-2005 |
D�penses r�elles 2005-2006 |
Budget principal des d�penses(1) |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
||||
|
Recherche- d�veloppement |
498,4 |
519,1 |
498,0 |
508,9 |
613,0 |
530,0 |
||||
|
Soutien technologique et industriel |
214,0 |
215,8 |
194,4 |
205,2 |
231,7 |
212,0 |
||||
|
Total |
712,4 |
734,9 |
692,4 |
714,1 |
844,7 |
742,0 |
||||
|
|
||||||||||
|
Total |
712,4 |
734,9 |
692,4 |
714,1 |
844,7 |
742,0 |
||||
|
Moins : D�penses des revenus tir�s des activit�s conform�ment � l'alin�a 5(1)e) de la Loi sur le CNRC |
(59,4) |
(85,2) |
s. o. |
(73,5) |
s. o. |
(55,6) |
||||
|
Plus : Co�t des services re�us � titre gracieux(2) |
21,1 |
25,0 |
s. o. |
25,9 |
s. o. |
27,6 |
||||
|
Co�t net pour le minist�re |
674,1 |
674,7 |
s. o. |
666,5 |
s. o. |
714,0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
�quivalents temps plein (ETP) |
4,178 |
4,155 |
s. o. |
4,033 |
s. o. |
4,191 |
||||
Nota
- Les revenus disponibles et les r�gimes d'avantages sociaux des employ�s figurent d�j� dans le total du Budget principal des d�penses.
- Les services re�us � titre gracieux comprennent habituellement les locaux fournis par TPSGC, la part des primes d'assurance des employ�s pay�e par l'employeur, les services de v�rification re�us du BVG, les services d'administration de la paie fournis par TPSGC, l'indemnisation des victimes d'accidents du travail assur�e par Ressources humaines et D�veloppement social Canada et les services re�us du minist�re de la Justice Canada (voir le tableau 3-4).
|
D�penses budg�taires |
||||||
|
Activit� de programme |
Fonctionnement(1) |
Immobilisations |
Subventions et contributions |
Total : D�penses budg�taires brutes |
Postes l�gislatifs(2) |
Total |
|
Recherche- d�veloppement |
|
|
|
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
347,8 |
45,6 |
58,9 |
452,3 |
45,7 |
498,0 |
|
D�penses pr�vues |
358,0 |
46,3 |
58,9 |
463,2 |
45,7 |
508,9 |
|
Autorisations totales |
403,1 |
48,6 |
65,4 |
517,1 |
95,9 |
613,0 |
|
D�penses r�elles |
346,2 |
48,0 |
59,1 |
453,3 |
76,8 |
530,0 |
|
Soutien technologique et industriel |
|
|
|
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
93,8 |
1,4 |
71,4 |
166,6 |
27,8 |
194,4 |
|
D�penses pr�vues |
104,4 |
1,6 |
71,4 |
177,4 |
27,8 |
205,2 |
|
Autorisations totales |
111,7 |
1,3 |
80,5 |
193,5 |
38,2 |
231,7 |
|
D�penses r�elles |
99,2 |
2,0 |
77,0 |
178,2 |
33,7 |
212,0 |
|
Total |
|
|
|
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
441,6 |
47,0 |
130,3 |
618,9 |
73,5 |
692,4 |
|
D�penses pr�vues |
462,4 |
47,9 |
130,3 |
640,6 |
73,5 |
714,1 |
|
Autorisations totales |
514,8 |
49,9 |
145,9 |
710,6 |
134,1 |
844,7 |
|
D�penses r�elles |
445,4 |
50,0 |
136,1 |
631,5 |
110,5 |
742,0 |
Nota
- Les d�penses de fonctionnement englobent les cotisations aux r�gimes d'avantages sociaux des employ�s.
- D�penses des revenus tir�s des activit�s du CNRC conform�ment � la Loi sur le CNRC.
|
|
2006-2007 |
||||
|
Poste vot� ou l�gislatif |
Libell� tronqu� du poste vot� ou l�gislatif |
Budget principal des d�penses |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles totales |
|
|
Programme du CNRC |
|
|
|
|
|
55 |
D�penses de fonctionnement |
393,5 |
414,3 |
460,2 |
445,6 |
|
60 |
D�penses en immobilisations |
47,0 |
47,9 |
49,9 |
49,9 |
|
65 |
Subventions et contributions |
130,3 |
130,3 |
145,9 |
136,0 |
|
(L) |
Engagement des revenus tir�s des activit�s conform�ment � la Loi sur le Conseil national de recherches |
73,5 |
73,5 |
133,7 |
55,6 |
|
(L) |
Cotisations aux r�gimes d'avantages sociaux des employ�s |
48,1 |
48,1 |
54,6 |
54,6 |
|
(L) |
Engagement du produit de la vente des biens de la Couronne |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
|
(L) |
Honoraires des agences de recouvrement |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
|
|
Total |
692,4 |
714,1 |
844,7 |
742,1 |
|
|
2006-2007 |
|
Cotisations couvrant la part de l'employeur des primes d'assurance des employ�s et d�penses pay�es par SCT (� l'exclusion des fonds renouvelables) |
25,8 |
|
Traitement et d�penses connexes li�s aux services juridiques fournis par le minist�re de la Justice Canada |
0,6 |
|
Indemnisation des victimes d'accidents du travail assur�e par Ressources humaines et D�veloppement social Canada |
0,4 |
|
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
0,2 |
|
Services de traitement de la paie fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
0,2 |
|
Services de v�rification fournis par le Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada |
0,5 |
|
Total des services re�us � titre gracieux en 2006-2007 |
27,6 |
|
|
|
|
2006-2007 |
||||
|
Activit� de programme |
Revenus r�els 2004-2005 |
Revenus r�els 2005-2006 |
Budget principal des d�penses |
Revenus pr�vus |
Autorisations totales |
Revenus r�els |
|
|
Recherche-d�veloppement |
|
|
|
|
|
|
|
|
Honoraires pour services rendus |
29,6 |
38,7 |
31,4 |
31,4 |
54,0 |
54,0 |
|
|
Revenus locatifs |
2,8 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
|
|
Redevances |
4,9 |
6,3 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
Publications |
1,8 |
3,0 |
7,3 |
7,3 |
4,6 |
4,6 |
|
|
Autres |
5,2 |
3,1 |
2,7 |
2,7 |
|
- |
|
|
Revenus disponibles report�s des exercices ant�rieurs |
- |
- |
- |
- |
38,4 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Soutien technologique et industriel |
|
|
|
|
|
|
|
|
Honoraires pour services rendus |
6,7 |
6,1 |
1,1 |
1,1 |
7,8 |
7,8 |
|
|
Revenus locatifs |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
|
|
Redevances |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
|
Publications |
22,4 |
21,3 |
21,4 |
21,4 |
15,5 |
15,5 |
|
|
Autres |
1,7 |
1,6 |
0,7 |
0,7 |
2,7 |
2,7 |
|
|
Revenus disponibles report�s des exercices ant�rieurs |
- |
- |
- |
- |
2,2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Respendable Revenues |
75,2 |
83,3 |
73,5 |
73,5 |
133,7 |
93,1 |
|
Nota
Conform�ment � l'alin�a 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches, le CNRC est autoris� � d�penser les revenus tir�s de ses activit�s et par cons�quent, ceux-ci ne sont pas affect�s aux cr�dits.
|
2006-2007 |
|||
|
Organisation |
Recherche- d�veloppement |
Soutien technologique et industriel |
Total |
|
Instituts de recherche |
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
498,0 |
|
498,0 |
|
D�penses pr�vues |
521,3 |
|
521,3 |
|
Autorisations totales |
613,0 |
|
613,0 |
|
D�penses r�elles |
530,1 |
|
530,1 |
|
Programme d'aide � la recherche industrielle |
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
|
144,5 |
144,5 |
|
D�penses pr�vues |
|
143,3 |
143,3 |
|
Autorisations totales |
|
172,2 |
172,2 |
|
D�penses r�elles |
|
157,6 |
157,6 |
|
Information scientifique et technique |
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
|
48,2 |
48,2 |
|
D�penses pr�vues |
|
47,8 |
47,8 |
|
Autorisations totales |
|
57,4 |
57,4 |
|
D�penses r�elles |
|
52,6 |
52,6 |
|
Centres de technologie |
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
|
1,7 |
1,7 |
|
D�penses pr�vues |
|
1,7 |
1,7 |
|
Autorisations totales |
|
2,0 |
2,0 |
|
D�penses r�elles |
|
1,9 |
1,9 |
|
TOTAL |
|
|
|
|
Budget principal des d�penses |
498,0 |
194,4 |
692,4 |
|
D�penses pr�vues |
521,3 |
192,8 |
714,1 |
|
Autorisations totales |
613,0 |
231,7 |
844,7 |
|
D�penses r�elles |
530,1 |
212,0 |
742,1 |
|
|
|||
|
A. Frais d’utilisation |
Type de frais |
Pouvoir de fixation des frais |
Date de la derni�re modification |
|
Frais exig�s pour le traitement des demandes d�pos�es en vertu de la Loi sur l’acc�s � l’information (LAI) |
Autres produits et services (O) |
Loi sur l’acc�s � l’information |
1992 |
|
B. Date de la derni�re modification : s. o. |
|||
|
C. Autres renseignements : Le Conseil national de recherches du Canada per�oit des frais d’utilisation aupr�s des personnes qui pr�sentent des demandes de renseignements conform�ment � la Loi sur l’acc�s � l’information. Les frais totaux d’utilisation per�us en 2006-2007 comprenaient les frais de traitement des demandes seulement. |
|||
|
2006-2007 |
||||
|
Revenu pr�vu |
Revenu r�el |
Co�t total |
Normes de rendement1 |
R�sultats de rendement1 |
|
265 $ |
265 $ |
160 650 $ Ces co�ts comprennent le salaire du coordonnateur de la LAI et un petit pourcentage du salaire des employ�s de soutien administratif. |
R�ponse fournie dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande. Ce d�lai peut �tre prolong� en vertu de l’article 9 de la LAI. Un avis de prolongation doit cependant �tre exp�di� dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande. La Loi sur l’acc�s � l’information donne plus de d�tails : http://laws.justice.gc.ca/fr/A-1/218072.html. |
Le CNRC a r�pondu � 53 demandes d’acc�s � l’information et � 33 demandes de consultations venant d’autres minist�res. Le CNRC renonce habituellement aux frais, conform�ment aux lignes directrices du SCT. |
|
Total |
|
160 650 $ |
|
|
|
Ann�es de planification |
||
|
Exercice financier |
Revenu pr�vu |
Co�t total estimatif |
|
2007-2008 |
750 $ |
200 000 $ |
|
2008-2009 |
750 $ |
200 000 $ |
|
2009-2010 |
750 $ |
200 000 $ |
|
Total |
2 250 $ |
600 000 $ |
|
B. Date de la derni�re modification : s. o. |
|
C. Autres renseignements : Le Conseil national de recherches du Canada per�oit des frais d’utilisation aupr�s des personnes qui pr�sentent des demandes de renseignements conform�ment � la Loi sur l’acc�s � l’information. Les frais totaux d’utilisation per�us en 2006-2007 comprenaient les frais de traitement des demandes seulement. |
1 Nota : Selon les opinions juridiques obtenues, lorsque la fixation des frais correspondants ou leur modification la plus r�cente est survenue avant le 31 mars 2004 :
- la norme de rendement, le cas �ch�ant, peut ne pas avoir fait l'objet d'un examen parlementaire;
- les normes de rendement, le cas �ch�ant, peuvent ne pas respecter toutes les exigences de l'�tablissement en vertu de la Loi sur les frais d'utilisation (par exemple, comparaison internationale, r�ponse � des plaintes ind�pendantes);
- les r�sultats, le cas �ch�ant, ne sont pas assujettis formellement � l'article 5.1 de la Loi sur les frais d'utilisation concernant l'obligation de r�duire les frais si les normes de rendement n'ont pas �t� respect�es.
|
En novembre 2004, les ministres du Conseil du Tr�sor ont approuv� la Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation. Cette politique exige des minist�res qu’ils produisent un rapport sur les normes qui encadrent la prestation des services rendus moyennant certains frais sur une base autre que contractuelle. Dans le cas du CNRC, cette politique s’applique aux programmes suivants :
Des renseignements suppl�mentaires sur les Normes de service pour les frais d'utilisation se trouvent � http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp. |
|
Des renseignements suppl�mentaires sur les d�penses relatives aux projets se trouvent � http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp. |
Tableau 3-9 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
|
Le CNRC g�re les programmes de paiements de transfert suivants :
Des renseignements suppl�mentaires sur ces projets se trouvent � l'adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp. |
Tableau 3-10 �tats financiers du CNRC
COMMENTAIRES ET ANALYSE DES �TATS FINANCIERS
Les commentaires et l'analyse des �tats financiers qui suivent (CAEF) devraient �tre lus de concert avec les �tats financiers v�rifi�s du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) pour l'exercice financier ayant pris fin le 31 mars 2007 et avec les notes compl�mentaires � ces �tats financiers. Les �tats financiers ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du
Conseil du Tr�sor et aux directives de fin d'exercice �mises par le Bureau du contr�leur g�n�ral, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus par le Canada (PCGR) pour le secteur public. Les CAEF ont �t� pr�par�s apr�s la publication de l'�nonc� de pratiques recommand�es dans le secteur public (PR‑1).
La responsabilit� de la pr�paration des CAEF incombe � la direction du CNRC. Les CAEF ont pour objet de permettre au lecteur de mieux saisir la situation financi�re et les r�sultats d'exploitation du CNRC. D'autres donn�es de rendement seront publi�es dans le Rapport minist�riel sur le rendement du CNRC de 2006-2007.
Les pr�sents CAEF comprennent trois parties : � Faits saillants �, � Risque financier et incertitude � et � Analyse financi�re �. Tous les montants pr�sent�s dans le pr�sent document sont libell�s en dollars canadiens, sauf mention contraire.
Note sp�ciale concernant les d�clarations prospectives
Les mots � estimer �, � fera �, � avoir l'intention de �, � devrait �, � pr�voir � ainsi que les expressions similaires et les verbes portant la marque du futur sont utilis�s dans le contexte des d�clarations prospectives. Ces �nonc�s refl�tent des hypoth�ses et des attentes du CNRC fond�es sur son exp�rience et sa perception des tendances et de la conjoncture actuelle. M�me si le CNRC estime que les attentes exprim�es dans ces d�clarations prospectives sont raisonnables, elles pourraient ne pas se concr�tiser et par cons�quent, les r�sultats r�els du CNRC pourraient �tre substantiellement diff�rents des attentes exprim�es dans les pr�sents CAEF. Plus particuli�rement, les facteurs de risque d�crits � la section Risque financier et incertitude du pr�sent rapport pourraient faire en sorte que les r�sultats r�els ou les �v�nements soient consid�rablement diff�rents de ceux envisag�s dans les d�clarations prospectives.
FAITS SAILLANTS
V�rification
Au cours des derni�res ann�es, le gouvernement du Canada a men� � l'�chelle de l'ensemble de l'administration f�d�rale un projet visant � accro�tre la qualit� de la gestion des finances publiques et des m�canismes de contr�le internes, une initiative � laquelle le CNRC a adh�r�. Ce projet consiste dans une large mesure � accro�tre l'efficacit� des pratiques de gestion des finances publiques et � appliquer la m�thode de la comptabilit� d'exercice pour la pr�paration d'�tats financiers. La t�che est cependant difficile par le fait que l'on exige encore du CNRC qu'il ait recours � la m�thode de comptabilit� de caisse modifi�e pour rendre compte de certains r�sultats financiers au gouvernement du Canada.
L'exercice 2006-2007 est le deuxi�me exercice pour lequel le CNRC fait v�rifier ses �tats financiers par le Bureau du v�rificateur g�n�ral, conform�ment aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada (PCGR) pour le secteur public et conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor. C'est le premier exercice o� le CNRC produit des �tats financiers v�rifi�s comparatifs.
Strat�gie du CNRC de 2006 � 2011
La strat�gie du CNRC – La science � l'oeuvre pour le Canada – a �t� approuv�e par le Conseil du CNRC en mars 2006 et couvre la p�riode de cinq ans d�butant le 1er avril 2006.
En vertu de sa vision, le CNRC veut �tre consid�r� comme le meilleur organisme national de recherche et d'innovation dans le monde et �tre un instrument essentiel du gouvernement pour traduire les avanc�es scientifiques et technologiques en mieux-�tre social et �conomique pour le Canada.
Le CNRC a �tabli trois objectifs pour lui permettre de concr�tiser cette vision. Le premier est de contribuer � la comp�titivit� mondiale de l'industrie canadienne dans des secteurs cl�s et � la viabilit� �conomique des collectivit�s. Le second est de renforcer le syst�me d'innovation du Canada. Enfin, le troisi�me objectif est d'apporter une contribution importante aux priorit�s du Canada dans les secteurs de la sant�, de l'�nergie durable et de l'environnement, autant de domaines cruciaux pour l'avenir du Canada.
Pour atteindre ces objectifs, le CNRC s'est dot� d'une strat�gie en quatre volets. Le premier volet vise � pr�voir et entreprendre des activit�s de recherche et d�veloppement (R‑D) dans des domaines qui am�liorent la comp�titivit� mondiale de l'industrie canadienne. Le deuxi�me volet consiste � soutenir l'industrie en mobilisant les acteurs cl�s. Le troisi�me consiste � investir dans les points forts et les comp�tences du CNRC et � les concentrer sur des secteurs d'importance pour le Canada. Enfin, le quatri�me volet s'attache � cr�er un organisme de recherche et d'innovation national durable et souple pour le Canada.
Le CNRC mesurera ses progr�s dans la gestion et dans l'ex�cution de cette strat�gie au moyen d'un cadre de gestion du rendement con�u � cette fin. Le CNRC proc�de actuellement � la mise en place de sa nouvelle structure de programme et de son nouveau cadre de mesure du rendement � l'appui de sa strat�gie.
Le CNRC �laborera des mesures particuli�res, tant pour r�aliser sa vision globale que pour atteindre chacun des objectifs qu'il s'est fix�, se dotant ainsi d'une base solide pour ses activit�s de planification et de gestion visant l'atteinte des jalons et des r�sultats cl�s escompt�s. Certains aspects du syst�me de gestion du rendement et de rapports du CNRC seront ajust�s pour refl�ter ces nouveaux objectifs et ces nouvelles strat�gies, ce qui permettra au CNRC de rendre compte de ses r�alisations et de ses r�sultats dans la mise en œuvre de ses plans.
Gouvernance
Conform�ment � l'objectif global du gouvernement de rehausser la qualit� de la gestion et � la Strat�gie du CNRC de 2006 � 2011, le CNRC a continu� de mettre en œuvre un certain nombre de projets pour am�liorer ses m�thodes de gouvernance.
Le Comit� ex�cutif du Conseil a amorc� une r�vision du r�le du Conseil et de ses comit�s de v�rification, d'�valuation et de gestion des risques et des ressources humaines pour s'assurer que ces deux comit�s fonctionnent d'une mani�re qui est conforme au mandat qui leur a �t� attribu� par le Conseil. Le Conseil a aussi mis sur pied des groupes de travail pour fournir au CNRC des conseils sur des questions strat�giques, telles que la gestion de la propri�t� intellectuelle et le r�le du CNRC dans l'�cosyst�me d'innovation canadien.
Dans le cadre de la strat�gie du CNRC, le Comit� de la haute direction (CHD) du CNRC a cr�� en 2005-2006 un Comit� de la strat�gie et des priorit�s (CSP) qui continue de conseiller la haute direction sur les priorit�s et sur l'orientation strat�gique du CNRC.
Le CNRC a mis en place une gestion par portefeuille pour ses instituts et ses programmes de recherche. En vertu de cette structure, les vice-pr�sidents jouent un r�le plus important dans la fixation des orientations strat�giques des diff�rents instituts et dans la r�partition des ressources en fonction des priorit�s �tablies. La gestion par portefeuille a rehauss� la capacit� du CNRC d'entreprendre et de g�rer des projets interorganisationnels en plus d'assurer que la recherche effectu�e correspond bien � la vision g�n�rale et aux priorit�s strat�giques du CNRC.
En 2005-2006, le CNRC a adopt� le mod�le de gestion financi�re propos� par le Bureau du contr�leur g�n�ral en vertu duquel un chef de la direction financi�re (CDF) est responsable devant le contr�leur g�n�ral ainsi que devant l'administrateur g�n�ral de la gestion financi�re au sein de l'organisation. � l'appui du mod�le du chef de la direction financi�re, le CNRC a termin� en 2006-2007 la centralisation de la fonction des finances amorc�e l'ann�e pr�c�dente, en nommant des conseillers financiers au sein du portefeuille de chaque vice-pr�sident et en exigeant l'approbation de l'information financi�re par chaque gestionnaire responsable. La mise en œuvre int�grale de ces changements entra�nera une responsabilisation encore plus grande � tous les paliers de l'organisation et un assainissement des m�thodes de gestion financi�re.
Le CNRC continue d'avoir recours au cycle rigoureux de planification et d'examen des d�penses et revenus qu'il a mis en place en 2005-2006.
En 2006-2007, le CNRC a redynamis� sa fonction de v�rification interne, conform�ment � la nouvelle Politique du Conseil du Tr�sor en mati�re de v�rification interne, en cr�ant et en dotant un poste de directeur de la v�rification qui rel�ve directement du pr�sident. Deux postes de gestionnaire de la v�rification vacants ont par la suite �t� dot�s par des professionnels d'exp�rience accr�dit�s. Toujours pour se conformer � la nouvelle politique, le CNRC prend actuellement des mesures pour que les membres de son Comit� de v�rification soient nomm�s par le Conseil du Tr�sor.
Revenus
Il est important pour le CNRC de g�n�rer des revenus, non seulement pour financer ses d�penses de fonctionnement et ses d�penses en immobilisations, mais aussi parce que ces revenus sont, dans une certaine mesure, r�v�lateurs de la valeur que les clients et collaborateurs du CNRC accordent aux services qu'ils re�oivent. Le taux de croissance des revenus du CNRC s'est �tabli � 6,4 % en 2006-2007, passant de 159,9 millions de dollars en 2005-2006 � 170,2 millions de dollars en 2006-2007. Cette croissance est attribuable principalement � des revenus accrus provenant de la prestation de services de nature non r�glementaire; ces derniers sont en effet en hausse, s'�tablissant � 65 millions de dollars en 2006-2007 comparativement � 56,1 millions de dollars en 2005-2006. Les principaux contributeurs � l'origine de cette hausse sont l'Institut des sciences biologiques du CNRC (ISB-CNRC), le Centre de technologie des transports de surface du CNRC (CTTS-CNRC), l'Institut Herzberg d'astrophysique du CNRC (IHA-CNRC), le Centre d'hydraulique canadien du CNRC (CHC-CNRC) et la Direction des services administratifs et de gestion de l'immobilier (DSAGI). On trouvera de plus amples d�tails � la section Analyse financi�re du pr�sent rapport, � la rubrique Revenus.
Voici la ventilation des revenus du CNRC par cat�gorie en 2006-2007 et 2005-2006 :
Revenus par cat�gorie
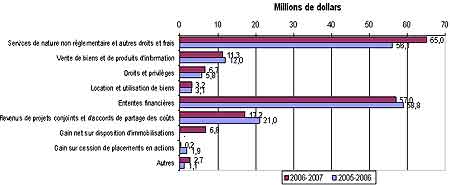
Charges
En 2006-2007, les charges du CNRC se sont chiffr�es � 846,7 millions de dollars, comparativement � 832,8 millions de dollars en 2005-2006, ce qui repr�sente une augmentation de 1,7 %. De celles-ci, environ 49,6 % repr�sentent les co�ts associ�s aux salaires et aux avantages sociaux, alors que cette proportion n'�tait que de 47,5 % en 2005-2006. Le co�t total des subventions et contributions a �t� de 143 millions de dollars en 2006-2007. La plus grande partie de cette somme a �t� vers�e � des petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre du Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI) du CNRC. Aux fins de comparaison, rappelons que les subventions et contributions totalisaient 129,9 millions de dollars en 2005-2006.
Cet accroissement des charges est d� principalement � une hausse de 23,6 millions de dollars dans les salaires et les prestations futures des employ�s, compens�e par une diminution des charges au titre des services publics, fournitures et approvisionnements et des services professionnels et sp�ciaux. La hausse dans les salaires et les prestations futures des employ�s est attribuable au r�glement en mati�re d'�quit� salariale intervenu avec l'Association des employ�s du Conseil de recherches en 2006-2007 et au paiement des salaires et des avantages sociaux r�troactifs d�coulant de la signature de trois conventions collectives au mois de mai 2007, des facteurs qui n'�taient pas pr�sents en 2005-2006. Un accroissement des niveaux de dotation pour r�pondre aux besoins accrus en mati�re de reddition de comptes et de g�n�ration de revenus a aussi contribu� � cette hausse des charges. La hausse des subventions et contributions et la diminution des mauvaises cr�ances en 2006-2007 sont dues principalement � un ajustement inhabituel pour des cr�ances jug�es irr�couvrables associ�es aux contributions remboursables du PARI-PTC de 2005-2006 suite � un important exercice de suivi cette ann�e-l�. Aucun ajustement substantiel n'a �t� requis lors du suivi de ces contributions remboursables au cours de l'exercice courant. En outre, la charge d'amortissement a augment� de 6,3 millions de dollars en 2006-2007. On trouvera de plus amples d�tails � la section Analyse financi�re, aux rubriques Cr�ances et Charges.
Voici les principales cat�gories de charges en 2006-2007 et 2005-2006 :
Charges par cat�gorie
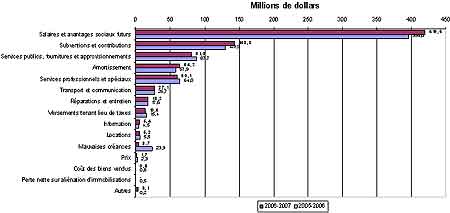
RISQUE FINANCIER ET INCERTITUDE
Le CNRC fait face � des compressions budg�taires importantes qui d�coulent de pressions internes et externes.
En tant qu'�tablissement public de l'administration f�d�rale, le CNRC finance la majorit� de ses d�penses salariales, de ses d�penses de fonctionnement et de ses d�penses en immobilisations au moyen de cr�dits parlementaires. La portion autre que salariale de ces cr�dits est fixe et ne comprend aucune mesure d'indexation. En cons�quence, le pouvoir d'achat r�el du CNRC n'a cess� de diminuer au cours des dix derni�res ann�es. L'augmentation des co�ts imputables aux imp�ts fonciers et aux services publics est particuli�rement importante pour le CNRC.
Le CNRC poss�de et g�re 186 immeubles sp�cialis�s d'une superficie globale approximative de 524 028 m�tres carr�s. Il est aussi propri�taire de syst�mes informatiques et d'�quipements d'une valeur comptable nette approximative de 202,8 millions de dollars (194,7 millions de dollars en 2005-2006). La capacit� du CNRC de financer la mise � niveau ou le remplacement de ces �l�ments d'actifs au moyen de ses cr�dits actuels est limit�e et il devra donc trouver � cette fin des fonds � l'ext�rieur de l'organisation.
De plus, au cours des trois derni�res ann�es, le gouvernement f�d�ral a annonc� une s�rie de compressions budg�taires touchant tous les minist�res dans le cadre de sa strat�gie de r�alignement et de son initiative visant � accro�tre son efficacit�. Ces compressions ont �t� durement ressenties par le CNRC et posent � l'organisation toute une s�rie de d�fis. L'effet cumulatif de ces r�ductions s'�tablit, � ce jour, � 20,4 millions de dollars, auxquelles s'ajoutera une r�duction minimum planifi�e de 12,9 millions de dollars par ann�e. � court terme, le CNRC a r�ussi � faire face � ces pressions budg�taires en r�duisant ses investissements dans certains de ses programmes centraux.
Pour se positionner de mani�re � pouvoir surmonter ces d�fis, le CNRC a mis en œuvre en 2005-2006 et en 2006-2007 des modifications � sa structure de gouvernance et a accompli des progr�s notables dans l'�laboration d'une nouvelle strat�gie bien cibl�e (comme nous l'avons pr�c�demment expos� en d�tail � la section Faits saillants). Ces deux initiatives am�lioreront la planification des activit�s, ainsi que l'attribution et la surveillance des ressources, ce qui contribuera ensuite � att�nuer certaines des pressions financi�res actuellement exerc�es sur le CNRC.
Le CNRC a amorc� un examen complet de l'attribution de ses ressources afin de s'assurer que les recherches dans les domaines prioritaires d�finis dans sa strat�gie seront suffisamment financ�es � l'avenir. Des efforts importants sont �galement en cours afin de trouver des moyens d'all�ger les pressions budg�taires. De nombreuses avenues sont actuellement explor�es, dont le r�alignement des programmes, la g�n�ration accrue de revenus, les �conomies de co�ts et les gains d'efficacit�, et un meilleur positionnement du CNRC pour obtenir de nouveaux fonds strat�giques. Des efforts sont en marche pour obtenir l'appui du minist�re de l'Industrie et des organismes centraux sur ces questions.
Des d�tails sur les autres facteurs qui expliquent les pressions budg�taires et l'incertitude ressentie par le CNRC sont fournis ci-dessous.
Financement temporaire
Afin d'assurer une optimisation des ressources, le Conseil du Tr�sor a adopt� une pratique qui consiste � financer les nouvelles initiatives sur une base temporaire. Cette pratique fait en sorte que plut�t que d'accorder au CNRC une augmentation permanente de ses cr�dits, le gouvernement lui octroie des fonds destin�s � certaines initiatives sur une p�riode donn�e, avec possibilit� de renouvellement. Ce renouvellement est conditionnel au rendement, � l'alignement des programmes sur les priorit�s et � la disponibilit� du financement. Bien que cette mani�re de proc�der soit reconnue comme une bonne pratique de gestion g�n�rale au sein de l'administration publique, elle cr�e dans les faits une bonne part d'incertitude et d'instabilit� au sein d'un organisme de recherche comme le CNRC.
M�me si leur financement n'est pas n�cessairement garanti sur une base continue, les initiatives approuv�es par le gouvernement, comme la cr�ation de grappes technologiques dans diff�rentes collectivit�s du Canada, exigent souvent du CNRC qu'il prenne des engagements continus en ce qui a trait � la construction et l'entretien de nouvelles installations sp�cialis�es et � l'embauche d'employ�s. Par ailleurs, les collectivit�s qui appuient ces initiatives et qui parfois, y investissent de l'argent, s'attendent �galement � ce qu'elles soient maintenues au-del� de la p�riode de financement donn�e. Ces d�fis ajoutent � la complexit� des activit�s de planification, de budg�tisation et d'exploitation de l'organisme.
Devises
Le CNRC proc�de chaque ann�e � des achats d'une valeur approximative de 50 millions de dollars qu'il r�gle dans une devise autre que le dollar canadien, ce qui l'expose aux variations du taux de change. La majorit� des achats payables en monnaie �trang�re (en moyenne 88 % au cours des quatre derni�res ann�es) sont n�goci�s en dollars am�ricains. Gr�ce au renforcement du dollar canadien au cours de la derni�re ann�e, le pouvoir d'achat du CNRC a augment� d'environ 5 millions de dollars US par rapport � 2003-2004. Si la pouss�e � la hausse du dollar canadien se poursuit, le CNRC sera avantag� tandis que toute d�pr�ciation du dollar canadien par rapport au dollar am�ricain aura pour effet de r�duire le pouvoir d'achat du CNRC.
L'augmentation du pouvoir d'achat enregistr�e en 2006-2007 a par ailleurs �t� quelque peu contrebalanc�e par la diminution des recettes per�ues en dollars canadiens sur les ventes � l'�tranger. En 2006-2007, le CNRC a touch� 33,8 millions de dollars canadiens sur des ventes de 29,5 millions de dollars US. En comparaison, en 2003-2004, le CNRC avait touch� des recettes de 35,9 millions de dollars canadiens sur des ventes de 26,5 millions de dollars US.
D�pendance � l'endroit des revenus
La d�pendance du CNRC � l'endroit des revenus venant de sources ext�rieures ne cesse d'augmenter depuis le d�but des ann�es 1990. La partie des d�penses de fonctionnement et des d�penses d'immobilisations du CNRC financ�es � m�me ces revenus se situait � environ 11 % en 1991-1992. En 2006-2007, ce pourcentage a grimp� et est l�g�rement sup�rieur � 17 %.
En effet, le CNRC compte des centres de technologie qui d�pendent des sources de revenus externes pour financer la plus grande partie de leurs activit�s. Ce sont notamment le Centre de technologie des transports de surface (CTTS-CNRC) et le Centre d'hydraulique canadien (CHC-CNRC). De plus, deux des plus gros instituts du CNRC – l'Institut de recherche a�rospatiale du CNRC (IRA-CNRC) et l'Institut canadien de l'information scientifique et technique du CNRC (ICIST-CNRC) d�pendent de sources ext�rieures de revenus pour financer plus de 40 % de leurs activit�s. Tout ralentissement �conomique marqu� des industries ou des �tablissements f�d�raux que ces groupes appuient aurait des r�percussions importantes sur la capacit� du CNRC de maintenir ses activit�s aux niveaux actuels.
Finalement, il importe de souligner que le CNRC doit trouver un point d'�quilibre subtil entre la n�cessit� de fournir les services de recherche qui g�n�rent les revenus dont il a besoin et la n�cessit� d'accomplir de la recherche financ�e par des fonds publics pour se maintenir � la fine pointe de la science, de la technologie et de l'innovation. S'il accorde trop d'importance aux contrats de recherche g�n�rateurs de revenus, le CNRC pourrait compromettre sa base de connaissances et son bassin de technologies de pointe, ce qui � long terme, diminuera sa capacit� de desservir l'industrie et de r�pondre aux besoins de recherche nationaux dans des domaines cruciaux comme l'�nergie, l'environnement, la sant� et le bien-�tre, et les autres domaines prioritaires d�crits dans la strat�gie.
ANALYSE FINANCI�RE
L'analyse financi�re qui suit explique la signification de certains �l�ments des �tats financiers qui sont uniques au gouvernement f�d�ral, et fournit les raisons pour les �carts importants constat�s entre 2006-2007 et 2005-2006.
ACTIFS
Montant � recevoir du Tr�sor
Ce montant repr�sente le montant d'encaisse que le CNRC peut puiser au Tr�sor f�d�ral. Il repr�sente donc les sommes au comptant � lib�rer pour lesquelles le CNRC a d�j� re�u un cr�dit, ainsi que les revenus re�us mais non d�pens�s.
L'augmentation de 30,9 millions de dollars enregistr�e pour de poste entre 2005-2006 et 2006-2007 est attribuable, en grande partie, � la hausse des cr�dits disponibles pour emploi dans les exercices ult�rieurs.
Cr�ances
Contributions remboursables du PARI-PTC
Le Programme d'aide � la recherche industrielle du CNRC (PARI-CNRC) assure depuis 1998 la prestation du Programme PARI-PTC au nom de Partenariat technologique Canada (PTC), un organisme de service sp�cial d'Industrie Canada. Ce programme offre des contributions � remboursement conditionnel aux petites et moyennes entreprises (PME) afin d'appuyer la pr�commercialisation de leurs nouvelles technologies. Ce programme de contributions � remboursement conditionnel exige dans la plupart des cas le remboursement trimestriel des contributions vers�es en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires brut du b�n�ficiaire. Ce programme a �t� aboli le 31 mars 2006, mais les accords d�j� conclus seront honor�s. Les contributions accord�es seront donc vers�es et le remboursement des contributions continuera d'�tre exig� au cours de la phase de r�duction progressive des activit�s.
Il importe de souligner que ce programme appuyait des petites entreprises en d�marrage dont l'avenir �tait souvent tributaire d'une technologie unique. Les entreprises dont la technologie n'a pas r�ussi � percer le march� ont parfois ferm� leurs portes. Toutefois, malgr� la nature tr�s risqu�e de ce programme, au 31 mars 2007, le CNRC a touch� des remboursements s'�levant � approximativement � 20 % des contributions vers�es (17 % en 2006). Avec plus de 300 projets encore administr�s, ce pourcentage devrait vraisemblablement augmenter au cours de la prochaine d�cennie.
Les cr�ances du PARI-PTC au 31 mars 2007 s'�levaient � 10,7 millions de dollars (7,6 millions de dollars en 2006) avec une provision correspondante pour cr�ances douteuses de 7,1 millions de dollars (6,7 millions de dollars en 2006).
| (en millions de dollars) |
2006-2007 |
2005-2006 |
| Solde, au d�but de l'exercice |
7,6 |
1,0 |
|
14,2 |
35,6 |
|
(8,5) |
(11,4) |
|
(2,6) |
(17,6) |
|
Solde, � la fin de l'exercice |
10,7 |
7,6 |
En 2006-2007, le CNRC a continu� d'�valuer tous les accords de contribution actifs afin de d�terminer si les conditions pour la phase de remboursement avaient �t� satisfaites. Cette initiative majeure a d�but� durant l'exercice 2005-2006 lorsque des montants substantiels de PARI-PTC ont �t� radi�s puisqu'ils repr�sentaient la valeur de la dette associ�e � des entreprises qui avaient cess� leurs activit�s au cours des derni�res ann�es.
Cr�ances d'exploitation et recouvrements d�coulant de la v�rification du PARI
Au 31 mars 2007, les �tats financiers du CNRC indiquaient un solde des cr�ances de clients externes de 19,6 millions de dollars (18,6 millions de dollars en 2006) et une provision correspondante pour cr�ances douteuses de 2,2 millions de dollars (2 millions de dollars en 2006). Ce montant repr�sente les cr�ances pour des travaux men�s conjointement avec des clients externes ainsi que les cr�ances d�coulant des r�sultats de la v�rification du PARI. Les radiations en 2006-2007 se sont �lev�es � 603 000 $ (637 000 $ en 2005-2006), ce qui est tr�s peu compte tenu de la valeur des revenus du CNRC.
Cr�ances class�es chronologiquement
Le classement chronologique de toutes les cr�ances au 31 mars se pr�sente comme suit :
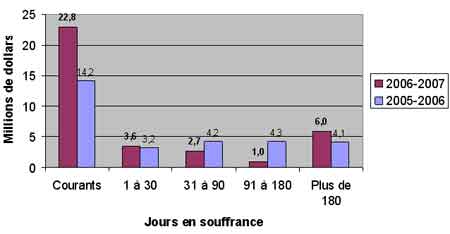
Stocks destin�s � la revente
Le CNRC produit un certain nombre de biens qui sont achet�s par des clients de l'ext�rieur, nomm�ment les codes mod�les nationaux du b�timent, des monographies et des mat�riaux de r�f�rence certifi�s. Les stocks destin�s � la revente ont diminu� de 716 00 dollars (20 %) par rapport aux valeurs de cl�ture de 2006, en raison de la cr�ation d'une provision de 600 000 dollars pour d�su�tude des stocks.
Immobilisations destin�es � la vente
Au 31 mars 2006, le CNRC occupait un immeuble se trouvant sur un terrain lou� sur le campus de l'Universit� de la Colombie-Britannique (UBC) � Vancouver. � la demande de l'UBC, le CNRC a accept� de construire un nouvel immeuble sur ce campus et de c�der l'immeuble actuel ainsi que le bail sur le terrain moyennant une contrepartie de 15 millions de dollars. Cette ali�nation est survenue en 2007 et les produits de cette-ci ont �t� constat�s en 2006-2007, ce qui s'est traduit par un gain de 7,4 millions de dollars. Le CNRC ne poss�de aucune autre immobilisation destin�e � la vente.
Placements en actions
Dans le cadre de son mandat consistant � promouvoir l'innovation industrielle au Canada, le CNRC aide financi�rement des entreprises en leur donnant acc�s � de l'�quipement, � des propri�t�s intellectuelles et � des locaux d'incubation � proximit� de ses laboratoires et dans ses installations de partenariat industriel. Comme ces entreprises n'en sont tr�s souvent qu'� leurs premiers balbutiements, elles n'ont pas la capacit� financi�re d'assumer le co�t int�gral de l'aide re�ue du CNRC. Il arrive donc que le CNRC prenne une participation dans une entreprise en contrepartie de l'aide fournie. Cette mani�re de proc�der aide l'entreprise � survivre � la phase critique qu'est le d�veloppement de sa technologie. En contrepartie, le CNRC obtient parfois sur son investissement un rendement � la hauteur des risques qu'il a accept� de prendre lorsque l'entreprise conna�t du succ�s. La direction n'a pas l'intention de maintenir des placements en actions pour une longue p�riode. Le CNRC envisagera de se dessaisir au moment opportun de placements en actions en tenant compte des int�r�ts et de la croissance pr�vue de l'entreprise, de la fluidit� du march� et de la possibilit� de recevoir un juste rendement du capital investi au nom des Canadiens.
La valeur int�grale figurant au bilan est celle des placements en actions du CNRC dans des soci�t�s inscrites � la bourse seulement, puisque ses parts dans des soci�t�s ferm�es sont r�put�es n'avoir aucune valeur marchande. Voici le d�tail des placements du CNRC dans des soci�t�s ouvertes :
|
Nom de l'entreprise |
Nombre d'actions |
Montant inscrit dans les �tats financiers |
Valeur marchande au 31 mars 2007 |
|
PharmaGap Inc. |
1 305 425 |
392 933 $ |
261 085 $ |
|
Chemaphor Inc. |
1 260 305 |
252 061 $ |
441 107 $ |
|
ACE Aviation Holdings Inc. |
33 |
743 $ |
1 005 $ |
|
Pure Energy Visions Corp. |
210 000 |
1 $ |
53 550 $ |
|
Lions Petroleum Inc. |
1 050 |
1 $ |
545 $ |
|
Total |
2 776 813 |
645 739 $ |
757 292 $ |
La diminution de 409 000 dollars (39 %) des placements en actions entre 2005-2006 et 2006-2007 est attribuable � la vente de toutes les actions de JDS Uniphase, vente qui a permis au CNRC de r�aliser un gain de 142 000 $.
Placements de fonds de dotation
Le fonds de dotation Holmes est issu d'un placement l�gu� au CNRC en juillet 1994. Une somme correspondant aux deux tiers du revenu net annuel de la fiducie sert � financer annuellement la bourse accompagnant le prix H.L. Holmes remis � des �tudiants de niveau postdoctoral qui ont ainsi la possibilit� d'�tudier dans des �coles d'�tudes sup�rieures ou des instituts de recherche de r�putation mondiale sous la supervision d'�minents chercheurs. En 2006-2007, le CNRC a octroy� 95 000 dollars au laur�at du prix H.L. Holmes 2005 du CNRC, lequel aura re�u au total 200 000 dollars d'ici septembre 2007, date � laquelle prendra fin sa bourse. Cette bourse lui servira � financer deux ann�es de recherche en collaboration avec l'Universit� de Toronto et l'Institut Max Born � Berlin, en Allemagne.
Charges pay�es d'avance
Les charges pay�es d'avance ont connu une hausse, passant d'un total de 5,5 millions de dollars au 31 mars 2006 � 12,8 millions de dollars au 31 mars 2007. Cette augmentation de 7,3 millions de dollars entre 2005-2006 et 2006-2007 est due principalement � la hausse des charges pay�es d'avance pour les abonnements et pour les versements tenant lieu d'imp�ts fonciers.
Abonnements
L'Institut canadien de l'information scientifique et technique du CNRC (ICIST-CNRC) est la biblioth�que scientifique du Canada. Cet institut est abonn� � de nombreuses revues et bases de donn�es scientifiques et techniques de grande renomm�e dans le monde. Les charges pay�es d'avance pour ces abonnements ont augment�, passant de 3,4 millions de dollars en 2005-2006 � 9 millions de dollars en 2006-2007 en raison, principalement, de l'adoption d'une m�thode plus juste et pr�cise en ce qui a trait le suivi et la compilation des donn�es de la portion pay�e d'avance de ces abonnements.
Versements tenant lieu d'imp�ts fonciers
La Ville de Montr�al a modifi� ses proc�dures de facturation en 2006-2007, exigeant d�sormais un versement couvrant la totalit� des imp�ts fonciers pour l'ann�e. Ce changement s'est traduit par une augmentation de 844 000 dollars de la portion pay�e d'avance de ces imp�ts pour l'Institut de recherche a�rospatiale du CNRC (IRA-CNRC) et l'Institut de recherche en biotechnologie du CNRC (IRB-CNRC) � Montr�al.
Immobilisations
La valeur des immobilisations s'est accrue de 9 %, passant de 1 195 millions de dollars en 2005-2006 � 1 307 millions de dollars en 2006-2007. Cette augmentation de 112 millions de dollars est attribuable � des acquisitions se chiffrant � 120 millions de dollars, compens�es par des transferts, des ali�nations et des radiations au montant de 8 millions de dollars.
Acquisitions
Le CNRC a d�pens� 62,1 millions pour l'acquisition d'immobilisations en 2006-2007; ce montant est inf�rieur au montant de 74,3 millions de dollars d�pens�s en 2005-2006. La principale raison de cette r�duction est l'ach�vement, en 2006-2007, de nouvelles installations de laboratoire pour l'Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC (IIPC-CNRC). Le CNRC a d�pens� 1,7 million de dollars pour ces laboratoires en 2006-2007, comparativement � 13,5 millions de dollars en 2005-2006.
Les principales d�penses en immobilisations de 2006-2007 sont d�taill�es ci-apr�s
- Le CNRC a engag� des d�penses � l'Institut de recherche en a�rospatiale du CNRC (IRA-CNRC) pour apporter des modifications et des am�liorations au b�timent abritant le Centre des technologies de fabrication en a�rospatiale � Montr�al (1,7 million de dollars), ainsi qu'� l'Institut des sciences des microstructures du CNRC (ISM-CNRC) � Ottawa (1 million de dollars) pour la
relocalisation des laboratoires et des bureaux du groupe Physique quantique.
- Environ 40 millions de dollars ont �t� d�pens�s pour de la machinerie, de l'�quipement, du mobilier et du mat�riel informatique en 2006-2007. Les principaux achats ont �t� :
- Le remplacement des refroidisseurs, au co�t de 667 000 $ pour fournir un milieu de travail plus confortable aux occupants et des temp�ratures et des niveaux d'humidit� ad�quats pour les installations informatiques � l'�difice M-55 qui abrite l'Institut canadien de l'information scientifique et technique du CNRC (ICIST-CNRC).
- L'Infostructure scientifique canadienne de l'Institut canadien de l'information scientifique et technique du CNRC (ICIST-CNRC), au co�t de 990 000 $. Cette infostructure �lectronique comprend la mise au point d'infrastructures et d'applications sophistiqu�es faisant appel aux technologies de l'information et la production de contenus riches soutenus par des outils de recherche et d'analyse intelligents.
- L'ach�vement des travaux de construction et des r�novations � l'Institut de recherche a�rospatiale du CNRC (IRA-CNRC) � Montr�al au co�t, respectivement, de 1,1 million de dollars et de 559 000 $.
- Un syst�me de simulation de l'effet de sol pour l'Institut de recherche a�rospatiale du CNRC (IRA-CNRC), au co�t de 506 000 $. L'IRA-CNRC a aussi pay� 3 millions de dollars pour un syst�me de placement de fibres pour la fabrication de mat�riaux composites.
- Des d�penses additionnelles, �valu�es � 549 000 $, ont �t� engag�es pour le syst�me d'imagerie � r�sonance magn�tique de 3-teslas de l'Institut du biodiagnostic du CNRC (IBD-CNRC), portant la valeur totale de cette immobilisation � 4,2 millions de dollars.
- Un projet d'am�lioration du rendement �nerg�tique de 1 million de dollars � l'Institut de technologie des proc�d�s chimiques et de l'environnement du CNRC (ITPCE-CNRC).
- Un spectrom�tre de masse � temps de vol quadripolaire de Waters qui a co�t� 680 000 $ pour l'Institut des biosciences marines du CNRC (IBM-CNRC). Cet instrument permet d'analyser des �chantillons biologiques hautement complexes avec une tr�s grande pr�cision.
- Le remplacement de la plage du bassin d'�tude des ouvrages de haute mer de l'Institut des technologies oc�aniques du CNRC (ITO-CNRC), au co�t de 684 000 $.
- Le remplacement de puits de lumi�re au co�t de 587 000 $ � l'Institut des mat�riaux industriels du CNRC (IMI-CNRC).
- De nouveaux bureaux et laboratoires d'une valeur de 1 million de dollars � l'�difice M-50 pour l'Institut des sciences des microstructures du CNRC (ISM-CNRC).
- Un spectrom�tre de masse hybride LTQ-Orbitrap valant 578 000 $ pour l'Institut des �talons nationaux de mesure du CNRC (IENM-CNRC).
- Un microscope �lectronique � transmission (MET) en science des mat�riaux et un MET pour mat�riaux mous pour l'Institut national de nanotechnologie du CNRC (INN) au co�t, respectivement, de 900 000 $ et de 1 million de dollars.
- Un syst�me � plasma inductif pour l'Institut Steacie des sciences mol�culaires du CNRC (ISSM-CNRC), d'une valeur de 523 000 $.
- Un montant additionnel de 2,4 millions dollars a �t� d�pens� pour des am�liorations locatives � l'Institut national de nanotechnologie du CNRC (INN) en 2006-2007, portant le total � 8 millions de dollars. Un montant de 733 000 $ a �galement �t� d�pens� pour des am�liorations locatives � l'Institut des sciences nutritionnelles et de la sant� du CNRC (ISSN-CNRC) en 2006-2007.
D'autres acquisitions, d'une valeur totale de 58,1 millions de dollars, ont aussi �t� r�alis�es pour des immobilisations lou�es :
- Le 23 mai 2006, le CNRC a pris possession d'une nouvelle installation et conclu une transaction non mon�taire avec l'Universit� de l'Alberta (UofA) en vue d'abriter l'Institut national de nanotechnologie du CNRC (INN). Cette installation lou�e est fournie au CNRC au co�t symbolique de 1 dollar par ann�e. Le b�timent a �t� comptabilis� comme immobilisation lou�e � sa juste valeur de 44,4 millions de dollars. L'amortissement annuel de l'immobilisation, qui se chiffre � 1,8 million de dollars, est compens� au complet par l'amortissement de l'apport report� li� au b�timent lou�.
- Le 1er septembre 2006, le CNRC a pris possession d'une nouvelle installation et conclu une op�ration non mon�taire avec l'Universit� de l'�le-du-Prince-�douard (UPEI) en vue d'abriter l'Institut national des sciences nutritionnelles et de la sant� du CNRC (ISSN-CNRC). Le b�timent a �t� comptabilis� comme immobilisation lou�e � sa juste valeur de 13,7 millions de dollars. L'amortissement annuel de l'immobilisation, qui se chiffre � 548 000 $, est compens� au complet par l'amortissement de l'apport report� li� au b�timent lou�.
Transferts, ali�nations et radiations
L'am�lioration locative aff�rente � l'ancien bail de l'Institut national de nanotechnologie (INN) a fait l'objet d'une ali�nation au co�t de 2,5 millions de dollars en 2006-2007. Le solde r�siduel se compose d'ali�nations et de radiations de divers �quipements, machineries, mobiliers et mat�riels informatiques.
PASSIFS
Cr�diteurs et charges � payer
Les comptes cr�diteurs et charges � payer ont augment� de 7,4 millions de dollars en 2006-2007. Cette augmentation est principalement attribuable � des �v�nements subs�quents � la fin de l'exercice li�s � des obligations existantes au 31 mars 2007, comme par exemple les obligations relatives au paiement de la portion r�troactive des salaires et des avantages sociaux d�coulant de trois conventions collectives sign�es en mai 2007.
Indemnit�s de vacances et cong�s compensatoires
En comparaison avec l'exercice pr�c�dent, ce poste est en hausse de 8 %, soit une augmentation de 2,8 millions de dollars, principalement engendr�e par l'augmentation des indemnit�s de vacances. Le passif au titre des indemnit�s de vacances s'est accru de 7 % (2,7 millions de dollars), passant de 36,4 millions de dollars en 2005-2006 � 39,1 millions. Cette augmentation est principalement attribuable au fait que certaines conventions collectives n'imposent pas de maximum au report � l'exercice suivant des cong�s de vacances acquis en raison de la nature des activit�s men�es au CNRC.
Revenus report�s
Comptes � fins d�termin�es
Le CNRC entreprend en collaboration avec ses clients des travaux � l'avantage des deux parties. Le financement fourni par le collaborateur est vers� dans un compte � fins d�termin�es (CFD) et utilis� pendant la dur�e du projet. Le solde de ces CFD en fin d'exercice est inscrit au poste des revenus report�s, en pr�vision que ces montants seront utilis�s pour le projet concern�, et ce, au cours de l'exercice � venir. � la fin de l'exercice 2006-2007, ce montant a atteint 13,1 millions de dollars, une hausse modeste de 4 % par rapport au total de l'exercice pr�c�dent.
Autres
Les autres revenus report�s comprennent essentiellement les revenus report�s tir�s des activit�s des presses scientifiques, ainsi que les revenus report�s provenant des inscriptions aux conf�rences et aux s�minaires. Le montant inscrit en 2005-2006 comprenait cependant les revenus report�s r�sultant de la disposition d'immobilisations destin�es � la vente.
Les revenus report�s du CNRC s'�levaient � 9,2 millions de dollars au 31 mars 2007, contre 23,6 millions de dollars � pareille date en 2006. Cette diminution est principalement attribuable aux produits de 15 millions de dollars r�alis�s � la vente d'un immeuble de l'Universit� de la Colombie-Britannique (UBC) � la suite du d�m�nagement des installations de l'Institut d'innovation en piles � combustible du CNRC (IIPC-CNRC). � la demande de l'UBC, le CNRC a accept� de construire un nouveau b�timent sur le campus et de restituer � l'UBC la propri�t� du terrain et de l'ancien immeuble occup� par l'IIPC en contrepartie d'une somme de 15 millions de dollars. Au 31 mars 2006, cette somme avait �t� vers�e d'avance au CNRC et �tait donc incluse dans les revenus report�s. Par le fait que la transaction a �t� compl�t�e en 2006-2007, le produit a �t� supprim� des revenus report�s et comptabilis� comme produit de la vente de la propri�t�.
Presses scientifiques - L'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC) publie des p�riodiques de recherche qui sont offerts pour achat sur abonnement. Lorsque le CNRC re�oit le paiement d'un abonnement, il comptabilise le montant au poste des revenus report�s, puis constate le revenu tous les mois � la publication de chaque num�ro.
Inscriptions aux conf�rences et s�minaires - Le CNRC organise nombre de conf�rences et s�minaires auxquels les participants doivent souvent s'inscrire plusieurs mois � l'avance. Les revenus d'inscription ainsi re�us � l'avance sont port�s au poste des revenus report�s et sont constat�s � la date o� la conf�rence a lieu.
Apports li�s aux immobilisations lou�es
Le CNRC a pris possession de deux installations au cours de l'exercice 2006-2007, la premi�re en mai 2006 � l'Universit� de l'Alberta (UofA), et la seconde en septembre 2006 � l'Universit� de l'�le-du-Prince-�douard (UPEI). En plus du contrat de location-acquisition conclu avec l'Universit� de Western Ontario (UWO) d�j� comptabilis� en 2005-2006, les deux installations sont lou�es au montant de 1 dollar chacune. En cons�quence, pour chacun de ces contrats de location-acquisition, un montant �quivalant � la valeur de l'immobilisation lou�e a �t� comptabilis� comme apport non mon�taire dans les revenus report�s. Ce montant est constat� dans les revenus selon les m�mes conditions que l'amortissement de l'immobilisation lou�e.
Avantages sociaux futurs
Ce poste correspond au passif constitu� par les indemnit�s de d�part futures. L'�cart de 3,5 millions de dollars par rapport au solde de 2005-2006 correspond � la diff�rence entre les charges constitu�es en 2006-2007 diminu�es des avantages sociaux vers�s au cours de l'exercice.
Passif environnemental
Un passif environnemental a �t� �tabli au montant de 300 000 $ pour un site contamin� � Penticton (Colombie-Britannique). Il s'agit d'un lieu d'emprunt utilis� pour des projets de construction et qui a subs�quemment �t� utilis� comme aire de d�p�t. Le co�t de restauration du site est estim� � 300 000 $. Cette somme est identique � celle comptabilis�e l'exercice pr�c�dent et aucun autre �l�ment de passif environnemental ne s'est ajout�.
REVENUS
Comme il a �t� mentionn� � la section Faits saillants, les revenus du CNRC pour 2006-2007 s'�l�vent � 170,2 millions de dollars, en hausse sur les 159,9 millions de 2005-2006. L'accroissement � ce poste est principalement attribuable � l'augmentation des revenus au titre des services de nature non r�glementaire, qui de 56,1 millions de dollars en 2005-2006 sont pass�s � 65 millions de dollars en 2006-2007.
Services de nature non r�glementaire et autres droits et frais
En 2006-2007, le CNRC a tir� 38 % de ses revenus (65 millions de dollars) de la prestation de services de nature non r�glementaire, qui comprennent principalement les services de recherche assur�s directement � une client�le form�e d'entreprises et d'�tablissements universitaires. En comparaison, ces revenus se sont �lev�s � 56,1 millions de dollars en 2005-06, soit 35 % des revenus totaux. En 2006-2007, la quote-part des revenus tir�s des services offerts par l'Institut de recherche a�rospatiale (IRA-CNRC) et l'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC) repr�sentait 46 % des revenus totaux du CNRC, en baisse sur les 56 % de 2005-2006.
La majeure partie de l'augmentation des revenus tir�s des services en 2006-2007 provient des activit�s d'instituts du CNRC qui ne figurent pas normalement dans la liste des plus lucratifs, � savoir l'Institut des sciences biologiques du CNRC (ISB-CNRC) et l'Institut Herzberg d'astrophysique du CNRC (IHA-CNRC), ainsi que de la Direction des services administratifs et de gestion de l'immobilier (DSAGI-CNRC). De vastes projets de recherche men�s en collaboration avec l'industrie ont favoris� la croissance des revenus de 3 millions de dollars pour l'ISB-CNRC et de 1,95 million de dollars pour l'IHA-CNRC. Quant � la DSAGI-CNRC, elle a enregistr� des gains de 1,86 million sous forme de droits d'inscription � des conf�rences. Comme le CNRC continue d'�largir ses relations avec l'industrie, les instituts qui traditionnellement ne sont pas des sources de revenus majeures devraient voir les revenus qu'ils tirent de la prestation de services s'accro�tre.
Les deux centres technologiques du CNRC fortement ax�s sur la prestation de services aux entreprises et aux autres minist�res f�d�raux ont �galement connu une croissance dans leurs revenus. Le Centre de technologie des transports de surface (CTTS-CNRC) a enregistr� une hausse de 1,2 million de dollars de ses revenus gr�ce � un projet d'envergure r�alis� par la Division ferroviaire, tandis que l'augmentation du nombre et de la valeur des contrats conclus avec des clients du secteur priv� a accru de 1,2 million de dollars les revenus du Centre d'hydraulique canadien (CHC-CNRC).
Vente de biens et de produits d'information
Dans la poursuite de son objectif de diffusion d'information scientifique et technique importante � l'industrie, le CNRC offre � titre on�reux � sa client�le des publications ainsi que des mat�riaux de r�f�rence certifi�s. Les ventes totales de biens et de produits d'information, qui ont atteint 12 millions de dollars en 2005-2006, se sont chiffr�es � 11,3 millions en 2006-2007. Le recul est attribuable � la baisse des ventes de revues, de monographies et autres publications par l'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC).
Droits et privil�ges
Le CNRC touche des redevances lorsqu'il c�de sous licence � une tierce partie le droit d'utiliser une de ses technologies. Ces redevances repr�sentent habituellement un pourcentage des ventes du titulaire de la licence. En 2006-2007, le CNRC a comptabilis� des redevances de 6,7 millions de dollars, une hausse sur les 5,8 millions de dollars enregistr�s l'exercice pr�c�dent. De cette somme, 3,5 millions de dollars (3,8 millions en 2005-2006) proviennent de l'Institut des sciences biologiques du CNRC (ISB-CNRC), principalement gr�ce aux redevances per�ues sur le vaccin de la m�ningite de type C.
Location et utilisation de biens
Les mesures prises pour faciliter l'acc�s � ses chercheurs et � ses installations constituent un �l�ment important du transfert des technologies. Le CNRC fournit donc � cette fin, sur une base commerciale, des laboratoires � des entreprises, souvent dans le cadre d'accords de collaboration ou de transfert de technologie. Les revenus tir�s de la location et de l'utilisation des installations se sont �lev�s � 3,2 millions de dollars en 2006-2007, contre 3,1 millions de dollars en 2005-2006.
Ententes financi�res avec d'autres minist�res gouvernementaux
Le CNRC effectue de la recherche pour le compte d'autres minist�res f�d�raux dans le cadre d'arrangements financiers en vertu desquels les co�ts diff�rentiels engag�s par le CNRC afin d'effectuer ces travaux lui sont rembours�s. En 2006-2007, la valeur des travaux ainsi effectu�s pour le compte d'autres minist�res f�d�raux a atteint 57 millions de dollars (58,8 millions en 2005-2006). La plupart de ces mandats ont �t� attribu�s par le minist�re de la D�fense nationale (24,8 millions de dollars en 2006-2007; 25,2 millions de dollars en 2005-2006), ainsi que par Ressources naturelles Canada (7,2 millions de dollars en 2006-2007; 7,3 millions en 2005-2006). Une somme de 15 millions de dollars (18,8 millions de dollars en 2005-2006) re�ue d'Industrie Canada par l'entremise de Partenariat technologique Canada est aussi incluse dans les revenus issus des ententes financi�res. Cette somme a �t� re�ue par le CNRC dans le cadre d'un programme de contributions remboursables et a �t� utilis�e pour verser de l'aide financi�re � des entreprises (11,6 millions en 2006-2007; 16,2 millions en 2005-2006) et pour couvrir les co�ts de fonctionnement de ce programme (3,4 millions de dollars en 2006-2007; 2,6 millions en 2005-2006). Comme le PARI-PCT a �t� aboli le 31 mars 2006, seuls les accords d�j� conclus se poursuivent.
Revenus de projets conjoints et d'accords de partage des co�ts
Le CNRC touche �galement des revenus dans le cadre de projets de recherche conjoints r�gis par des accords de partage des co�ts, qui visent principalement la cr�ation de nouvelles comp�tences ou la mise au point de nouvelles technologies. En 2006-2007, les fonds g�n�r�s par ces projets conjoints dans tous les secteurs du CNRC se sont �lev�s � 17,1 millions de dollars. Il s'agit d'une baisse de 18 % par rapport aux 21 millions de dollars inscrits en 2005-2006, qui s'explique principalement par l'ach�vement d'un important projet r�alis� en collaboration avec G�nome Atlantique au d�but de 2007.
Gain net sur disposition d'immobilisations
Le gain de 7,4 millions de dollars r�alis� � la disposition d'une immobilisation destin�e � la revente a �galement un impact consid�rable sur les revenus du CNRC. Le 12 d�cembre 2002, le CNRC a conclu une entente avec l'Universit� de la Colombie-Britannique de c�der un terrain existant et le b�timent s'y rattachant en contrepartie d'une somme de 15 millions de dollars. Comme il a �t� indiqu� pr�c�demment � la rubrique Revenus report�s, la vente a eu lieu en 2007 et le produit de disposition comptabilis� en 2006-2007 a donn� lieu � un gain de 7,4 millions de dollars. Ce gain a �t� compens� par une perte sur disposition d'immobilisations de 546 000 $.
CHARGES
Comme il a �t� mentionn� � la section Faits saillants, les charges du CNRC ont augment�, passant de 832,8 millions de dollars en 2005-2006 � 846,7 millions en 2006-2007. Les salaires et avantages sociaux repr�sentent approximativement 49,6 % de cette somme (47,5 % en 2005-2006). L'accroissement des charges r�sulte essentiellement d'une augmentation de 23,6 millions de dollars au titre des salaires et des avantages sociaux futurs.
Salaires et avantages sociaux futurs
La hausse au titre des salaires et des avantages sociaux futurs est en grande partie attribuable au r�glement en mati�re d'�quit� salariale intervenu en 2006-2007 avec l'Association des employ�s du Conseil de recherches. Le montant du r�glement a �t� vers� en r�mun�ration des gains perdus et des int�r�ts courus � tous les employ�s admissibles qui occupaient un poste de cat�gorie AD, CR ou ST entre le 1er avril 1989 et le 31 mars 1999. En outre, les salaires et les avantages sociaux r�troactifs d�coulant de la signature de trois conventions collectives en mai 2007 totalisent 4 millions de dollars. Il y a par ailleurs eu une hausse g�n�rale des salaires attribuable aux augmentations de salaire annuelles, aux promotions et � l'embauche pour satisfaire les nouvelles exigences en mati�re de responsabilit� et les hausses de r�mun�ration. Cette �volution d�note les variations typiques des niveaux de dotation en personnel du CNRC d'un exercice � l'autre.
Subventions et contributions
Le co�t total des subventions et contributions a �t� de 143 millions de dollars, en hausse de 13,1 millions sur les 129,9 millions de dollars de 2005-2006. La plus grande partie de ce financement a �t� redistribu�e � des petites et moyennes entreprises (PME) dans le cadre du Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI) du CNRC.
L'augmentation des subventions et contributions s'explique en grande partie par un ajustement extraordinaire pour mauvaises cr�ances au titre du programme de contributions remboursables du PARI-PTC (Partenariat technologique Canada) en 2005-2006 � la suite d'un vaste exercice de suivi r�alis� au cours de cet exercice.
Le programme PARI-PTC, administr� par le CNRC pour le compte d'Industrie Canada, offre aux PME une aide financi�re remboursable pour des projets de d�veloppement technologique � l'�tape de la pr�commercialisation. Puisque le programme a pris fin le 31 mars 2006, le total des contributions vers�es aux entreprises a diminu� de 4,7 millions en 2006-2007. La hausse nette des subventions et contributions enregistr�e en 2006-2007 est attribuable essentiellement au traitement comptable du recouvrement de ces contributions remboursables. Lorsque les contributions remboursables en vertu du programme PARI-PTC sont factur�es, les sommes en jeu sont constat�es comme un recouvrement de contributions remboursables, tandis qu'une charge d'un montant �quivalent est imput�e comme paiement de transfert � Industrie Canada. Cependant, lorsqu'une cr�ance correspondant � une contribution remboursable est pass�e en charges comme cr�ance irr�couvrable, soit dans la provision pour l'irr�couvrabilit� ou qu'il est simplement radi�, la charge pour le paiement de transfert � Industrie Canada est diminu�e en cons�quence. � la suite de l'examen men� au cours de l'exercice 2005-2006, un montant extraordinaire de 24,1 millions de dollars a �t� comptabilis� au titre du programme PARI-PTC dans les cr�ances douteuses et comme recouvrement du paiement de transfert. Aucun montant de la sorte n'a eu � �tre comptabilis� en 2006-2007, �tant donn� que la charge pour mauvaises cr�ances � l'�gard de ce programme s'est chiffr�e � 2,9 millions de dollars. Pour de plus amples explications � ce sujet, se reporter aux rubriques Cr�ances et Mauvaises cr�ances de la section Analyse financi�re.
D'autres facteurs ont influ� sur les subventions et contributions, dont la diminution de 6,5 millions de dollars des subventions vers�es aux entreprises dans le cadre du PARI–CNRC en raison de la baisse du financement disponible � cette fin en 2006-2007; l'augmentation de 3,2 millions de dollars des contributions accord�es aux t�lescopes internationaux pour de nouveaux instruments, et une subvention de 1,5 million de dollars vers�e au laboratoire national de physique nucl�aire et des particules.
Services publics, fournitures et approvisionnements
La baisse de 6,8 millions de dollars au titre des services publics, fournitures et approvisionnements r�sulte principalement de l'emploi d'une m�thode am�lior�e pour comptabiliser les charges pay�es d'avance, et en particulier les abonnements pay�s d'avance, comme il est expliqu� � la rubrique Charges pay�es d'avance de l'Analyse financi�re. Un autre facteur expliquant la r�duction enregistr�e � ce poste en 2006-2007 est la diminution de 1 million de dollars du financement accord� � l'Initiative en g�nomique et en sant�.
Services professionnels et sp�ciaux
Les charges en services professionnels et sp�ciaux se sont �lev�es � 60,1 millions de dollars en 2006-2007, contre 64 millions de dollars en 2005-2006. Cette baisse r�sulte principalement de la diminution des contrats de construction et autres services li�s � la construction d'immobilisations.
Mauvaises cr�ances
La charge de mauvaises cr�ances du CNRC est pass�e de 23,9 millions de dollars en 2005-2006 � 3,7 millions de dollars en 2006-2007. L'importance de la charge en 2005-2006 r�sultait de l'examen du programme PARI-PTC entrepris au cours de cette p�riode. Cet examen a donn� lieu � une radiation unique de cr�ances totalisant 17,6 millions de dollars et � une provision pour l'irr�couvrabilit� de 6,5 millions de dollars, ce qui a port� la charge de mauvaises cr�ances li�e au programme PARI-PTC � 24,1 millions de dollars. En 2006-2007, cette charge s'�tablissait � 2,9 millions de dollars, car les dossiers �taient � jour et aucune circonstance exceptionnelle n'est survenue. On trouvera de plus amples d�tails aux rubriques Cr�ances et Subventions et contributions de l'Analyse financi�re.
Autres charges
L'augmentation des autres charges est principalement caus�e par la partie du r�glement sur l'�quit� salariale vers�e en dommages-int�r�ts � l'ensemble des employ�s admissibles membres de l'Association des employ�s du Conseil de recherches en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
�tats financiers
Conseil national de recherches du Canada
31 mars 2007
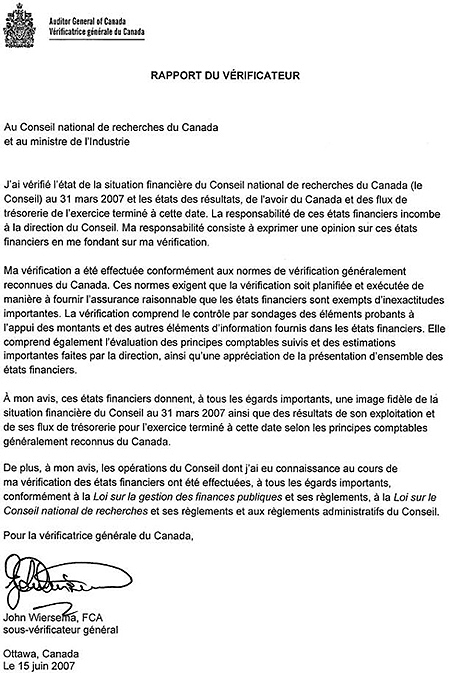
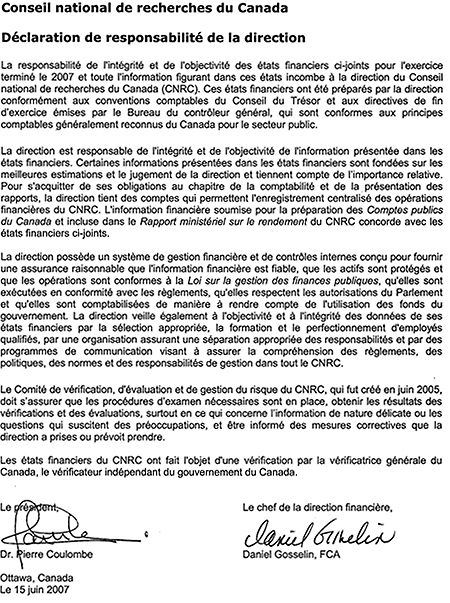
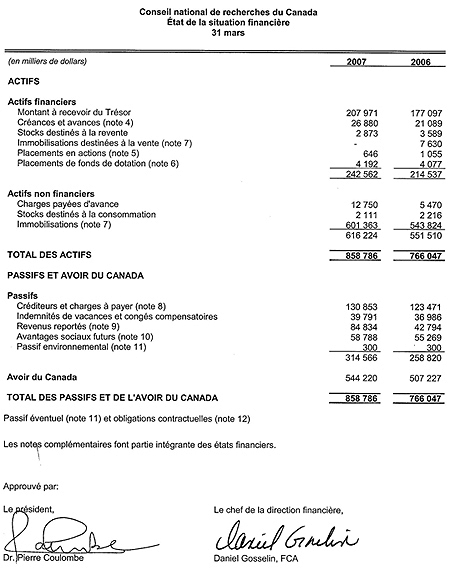
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
|
|
|
|
Charges (note 13) |
|
|
|
Recherche et d�veloppement |
600 627 |
566 534 |
|
Soutien technologique et industriel |
246 028 |
266 296 |
|
Total |
846 655 |
832 830 |
|
|
|
|
|
Revenus (note 14) |
|
|
|
Recherche et d�veloppement |
109 621 |
96 363 |
|
Soutien technologique et industriel |
60 536 |
63 503 |
|
Total |
170 157 |
159 866 |
|
|
|
|
|
Co�t de fonctionnement net |
676 498 |
672 964 |
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers.
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
|
|
|
|
Avoir du Canada d�but de l'exercice |
507 227 |
519 055 |
|
Co�t de fonctionnement net |
(676 498) |
(672 964) |
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement (note 3) |
655 005 |
624 083 |
|
Variation du montant � recevoir du Tr�sor |
30 874 |
11 113 |
|
Services re�us gratuitement (note 15) |
27 612 |
25 940 |
|
|
|
|
|
Avoir du Canada fin de l'exercice |
544 220 |
507 227 |
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers.
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
|
|
|
|
Activit�s de fonctionnement |
|
|
|
Co�t de fonctionnement net |
676 498 |
672 964 |
|
�l�ments n'affectant pas l'encaisse |
|
|
|
Amortissement des immobilisations |
(64 210) |
(57 916) |
|
Gain sur cession de placements en actions |
223 |
1 935 |
|
Gain net (perte nette) sur l'ali�nation d'immobilisations |
6 823 |
(490) |
|
Services re�us gratuitement (note 15) |
(27 612) |
(25 940) |
|
Autre |
2 451 |
- |
|
Variations dans l'�tat de la situation financi�re |
|
|
|
Augmentation (diminution) des cr�ances et avances |
5 791 |
(4 860) |
|
(Diminution) augmentation des stocks destin�s � la revente |
(716) |
255 |
|
Augmentation des placements de fonds de dotation |
115 |
152 |
|
Augmentation des charges pay�es d'avance |
7 280 |
1 081 |
|
Diminution des stocks destin�s � la consommation |
(105) |
(202) |
|
Augmentation des passifs |
(55 746) |
(34 864) |
|
Encaisse utilis�e pour les activit�s de fonctionnement |
550 792 |
552 115 |
|
|
|
|
|
Activit�s d'investissement en immobilisations |
|
|
|
Acquisitions d'immobilisations |
120 172 |
74 334 |
|
Produit d'ali�nation d'immobilisations |
(15 327) |
(683) |
|
Encaisse utilis�e pour les activit�s d'investissement en immobilisations |
104 845 |
73 651 |
|
|
|
|
|
Activit�s d'investissement |
|
|
|
Produit de cession de placements en actions |
(632) |
(1 683) |
|
Encaisse utilis�e pour les activit�s d'investissement |
(632) |
(1 683) |
|
|
|
|
|
Activit�s de financement |
|
|
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada (note 3) |
(655 005) |
(624 083) |
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers.
Conseil national de recherches du Canada
Notes compl�mentaires aux �tats financiers
Exercice termin� le 31 mars 2007
1. Pouvoirs et objectifs
Le Conseil national de recherches du Canada (le � CNRC �) a �t� cr�� en vertu de la Loi sur le Conseil national de recherches et est un �tablissement public conform�ment � l’annexe II de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le CNRC a pour objectifs de cr�er et d’acqu�rir des connaissances scientifiques et techniques pour r�pondre aux besoins des
Canadiens en mati�re de d�veloppement �conomique, r�gional et social et d’en promouvoir l’application, ainsi que d’encourager l’utilisation de l’information scientifique et technique par le public et le gouvernement du Canada.
Dans le cadre de l’accomplissement de son mandat, le CNRC fait rapport en fonction des programmes d’activit�s suivants :
- recherche et d�veloppement;
- soutien technologique et industriel.
Ces programmes d’activit�s incluent �galement les priorit�s du CNRC consistant � favoriser le d�veloppement de grappes technologiques viables capables de cr�er de la richesse et du capital social, et � administrer le programme de mani�re � assurer la viabilit� de l’organisation.
2. Sommaire des principales conventions comptables
Les pr�sents �tats financiers ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor et aux directives de fin d’exercice publi�es par le Bureau du contr�leur g�n�ral, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public. Les principales conventions comptables sont les suivantes :
a) Cr�dits parlementaires
Le CNRC est financ� par le gouvernement du Canada au moyen de cr�dits parlementaires. Les cr�dits consentis au CNRC ne correspondent pas aux montants pr�sent�s dans les rapports financiers pr�par�s conform�ment aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada �tant donn� que les cr�dits sont fond�s, dans une large mesure, sur les besoins de tr�sorerie. Par cons�quent, les
�l�ments comptabilis�s dans l'�tat des r�sultats et dans l'�tat de la situation financi�re ne sont pas n�cessairement les m�mes que ceux qui sont pr�vus par les cr�dits parlementaires. La note 3 pr�sente un rapprochement g�n�ral entre les deux m�thodes de pr�sentation des rapports financiers.
b) Encaisse nette fournie par le gouvernement
Le CNRC fonctionne au moyen du Tr�sor, qui est administr� par le receveur g�n�ral du Canada. La totalit� de l'encaisse re�ue par le CNRC est d�pos�e au Tr�sor, et tous les d�caissements faits par le CNRC sont pr�lev�s sur le Tr�sor. L'encaisse nette fournie par le gouvernement est la diff�rence entre toutes les rentr�es de fonds et toutes les sorties de fonds, y compris les op�rations
entre les minist�res (incluant les organismes) au sein du gouvernement f�d�ral.
c) Montant � recevoir du Tr�sor
Le montant � recevoir du Tr�sor repr�sente le montant d’encaisse que le CNRC peut puiser au Tr�sor sans cr�dit suppl�mentaire.
d) Revenus / Revenus report�s
- Les revenus sont comptabilis�s dans l’exercice o� les op�rations ou les faits sous‑jacents surviennent.
- Les revenus provenant des droits de licence, des projets conjoints de recherches et d’autres sources sont d�pos�s au Tr�sor et le CNRC peut les utiliser.
- Les droits de licence per�us pour les p�riodes de licence d’exercices ult�rieurs sont comptabilis�s � titre de revenus report�s et amortis sur la p�riode de licence.
- Les fonds re�us de tiers � des fins d�termin�es sont comptabilis�s � leur r�ception � titre de revenus report�s et sont constat�s comme revenus dans l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engag�es.
- Les apports li�s aux immobilisations lou�es sont report�s et amortis aux r�sultats selon la m�me m�thode que pour les immobilisations amortissables connexes.
e) Charges
- Les subventions sont comptabilis�es dans l’exercice au cours duquel le b�n�ficiaire a satisfait aux crit�res d’admissibilit�, tandis que les contributions sont comptabilis�es dans l’exercice au cours duquel les crit�res de paiement sont satisfaits.
- Les indemnit�s de vacances et de cong�s compensatoires sont pass�es en charges au fur et � mesure que les employ�s en acqui�rent le droit en vertu de leurs conditions d’emploi respectives.
- Les services fournis gratuitement par d’autres minist�res et organismes du gouvernement f�d�ral sont comptabilis�s � titre de charges de fonctionnement � leur co�t estimatif.
f) Avantages sociaux futurs
- Prestations de retraite
Les employ�s admissibles participent au R�gime de retraite de la fonction publique, un r�gime multi‑employeurs administr� par le gouvernement du Canada. Les cotisations du CNRC au R�gime sont pass�es en charges dans l'exercice au cours duquel elles sont engag�es et elles repr�sentent l'obligation totale du CNRC d�coulant du r�gime. En vertu des dispositions l�gislatives en vigueur, le CNRC n'est pas tenu de verser des cotisations au titre de l'insuffisance actuarielle du r�gime. - Indemnit�s de d�part
Les employ�s ont droit � des indemnit�s de d�part, pr�vues dans les contrats de travail ou les conditions d'emploi. Le co�t de ces indemnit�s s'accumule � mesure que les employ�s effectuent les services n�cessaires pour les gagner. L’obligation d�coulant des avantages sociaux gagn�s par les employ�s est calcul�e � l'aide de l'information provenant des r�sultats du passif d�termin� sur une base actuarielle pour les indemnit�s de d�part pour l'ensemble du gouvernement.
g) Cr�ance
Les cr�ances sont comptabilis�es en fonction des montants que l’on pr�voit r�aliser. Une provision est �tablie pour les cr�ances dont le recouvrement est incertain.
h) Contributions remboursables avec condition
Les contributions remboursables avec condition sont des contributions remboursables, en tout ou en partie, lorsque les conditions �tablies dans l'entente se r�alisent. Par cons�quent, elles sont comptabilis�es dans l'�tat de la situation financi�re uniquement lorsque les conditions �tablies dans l'entente sont satisfaites; elles sont alors comptabilis�es comme cr�ance et en r�duction
des charges au titre de paiements de transfert. Une provision estimative pour l'irr�couvrabilit� est comptabilis�e au besoin.
i) Passif �ventuel
Le passif �ventuel repr�sente des obligations possibles qui peuvent devenir des obligations r�elles selon que certains �v�nements futurs se produisent ou non. Dans la mesure o� l'�v�nement futur risque de se produire ou non et si l'on peut �tablir une estimation raisonnable de la perte, on comptabilise un passif estimatif et une charge. Si la probabilit� ne peut �tre d�termin�e ou
s'il est impossible de faire une estimation raisonnable du montant, l'�ventualit� est pr�sent�e dans les notes compl�mentaires aux �tats financiers.
j) Passifs environnementaux
Les passifs environnementaux refl�tent les co�ts estimatifs li�s � la gestion et � la remise en �tat des sites contamin�s. � partir des meilleures estimations de la direction, on comptabilise un passif et une charge lorsque la contamination se produit ou lorsque le CNRC est mis au courant de la contamination et est oblig� ou probablement oblig� d'assumer ces co�ts. S'il n'est pas
possible de d�terminer la probabilit� de l'obligation du CNRC d'assumer ces co�ts ou s'il est impossible de faire une estimation raisonnable du montant, les co�ts sont pr�sent�s � titre de passif �ventuel dans les notes compl�mentaires aux �tats financiers.
k) Stocks
Les stocks destin�s � la revente et � la consommation sont inscrits au moindre du co�t (selon la m�thode du co�t moyen) ou de la valeur de r�alisation nette. Le co�t est imput� aux charges de fonctionnement dans l’exercice o� les articles sont vendus ou utilis�s.
l) Placements en actions
Les placements en actions comprennent des actions dans des soci�t�s publiques et priv�es. Les placements en actions du CNRC sont g�n�ralement obtenus en raison de n�gociations de r�glement de dettes ou en raison d’op�rations non mon�taires (le CNRC fournit de l'aide financi�re � des conditions sup�rieures � celles du march� aux soci�t�s par l'acc�s � la propri�t� intellectuelle,
au mat�riel et � l'espace d’incubation dans les laboratoires) et sont enregistr�s � la juste valeur. La juste valeur des placements en actions est fond�e sur le prix du march�. Si la juste valeur devient inf�rieure � la valeur comptable et que cette moins‑value est jug�e durable, la valeur des placements en actions est r�duite � la juste valeur. Si les estimations des
op�rations non mon�taires ne peuvent �tre d�termin�es, les placements en actions sont comptabilis�s � leur valeur nominale.
m) Placements de fonds de dotation
Les dotations sont des dons affect�s assujettis � des restrictions externes stipulant que les ressources doivent �tre maintenues en permanence. Les revenus de placements des dotations ne peuvent servir qu’aux fins �tablies par les donateurs.
Les dotations sont comptabilis�es � titre d’actif si l’on peut raisonnablement estimer le montant � recevoir et que la perception finale est raisonnablement garantie. Les revenus de dotation sont inscrits � titre de revenus report�s et comptabilis�s comme revenus dans l’exercice o� les charges aff�rentes sont engag�es.
Les fonds re�us pour les dotations sont investis dans des obligations et comptabilis�s au co�t non amorti. La prime ou l’escompte d�termin� au moment de l’acquisition est amorti jusqu’� l’�ch�ance de l’obligation. La juste valeur des obligations est fond�e sur le prix du march�.
n) Op�rations en devises
Les op�rations en devises sont converties en dollars canadiens en s'appuyant sur le taux de change en vigueur � la date de l'op�ration. Les actifs et les passifs mon�taires libell�s en devises sont convertis en dollars canadiens en utilisant le taux de change en vigueur � la fin de l'exercice. Les gains et les pertes r�sultant de la conversion de devises sont pr�sent�s �
l'�tat des r�sultats selon les activit�s auxquelles ils se rapportent. Les gains et les pertes nets li�s � la vente de biens et services en devises sont inclus dans les revenus. Les gains et les pertes nets li�s � l'achat de biens et services en devises sont inclus dans les charges.
o) Immobilisation et amortissement
Toutes les immobilisations et les am�liorations locatives dont le co�t initial est d’au moins 5 000 $ sont comptabilis�es � leur co�t d’achat. Les apports en immobilisations sont enregistr�s � la valeur marchande, et ce, � la date de l’apport. Le CNRC n’inscrit pas � l’actif les biens incorporels, les œuvres d’art ou les tr�sors historiques
ayant une valeur culturelle, esth�tique ou historique. Les biens acquis selon les contrats de location‑acquisition sont au d�part inscrits � la valeur actualis�e des paiements minimums exigibles en vertu du bail. Les immobilisations destin�es � la vente sont enregistr�es au moindre de la valeur comptable ou de la juste valeur diminu�e des frais de vente. Aucun amortissement
n’est enregistr� pour cette cat�gorie de biens. Les immobilisations sont amorties selon la m�thode lin�aire sur la dur�e de vie utile estimative de l’immobilisation, comme suit:
|
Cat�gorie d’immobilisations |
P�riode d’amortissement |
|
Terrains |
Sans objet |
|
B�timents et installations |
25 ans |
|
Travaux et infrastructure |
25 ans |
|
Machinerie, mat�riel et mobilier de bureau |
10 ans |
|
Mat�riel informatique |
5 ans |
|
Logiciels |
5 ans |
|
V�hicules |
5 ans |
|
A�ronef |
10 ans |
|
Am�liorations locatives |
Le moindre du reste de la dur�e du bail ou de la vie utile de l’am�lioration |
|
Actifs en construction |
Une fois en service, selon la cat�gorie d’immobilisations |
|
Immobilisations lou�es |
Selon la cat�gorie d’immobilisations |
Lorsque le CNRC conclut � une valeur nominale des baux pour des terrains, l’op�ration est trait�e comme une op�ration non mon�taire et enregistr�e � la juste valeur. La juste valeur de l’op�ration est fond�e sur le prix du march�. Si les estimations des op�rations non mon�taires ne peuvent �tre d�termin�es, le montant de l’op�ration est enregistr� � la valeur nominale.
p) Incertitude relative � la mesure
La pr�paration des pr�sents �tats financiers conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor du Canada et aux directives de fin d’exercice publi�es par le Bureau du contr�leur g�n�ral, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, exige de la direction qu'elle fasse des estimations et pose des hypoth�ses qui
influent sur les montants d�clar�s des actifs, des passifs, des revenus et des charges pr�sent�s dans les �tats financiers. Au moment de la pr�paration des pr�sents �tats financiers, la direction consid�re que les estimations et les hypoth�ses sont raisonnables. Les principaux �l�ments pour lesquels des estimations sont faites sont le passif �ventuel, les passifs environnementaux, le
passif pour Ies indemnit�s de d�part, la provision pour cr�ances douteuses, la juste valeur des op�rations non‑mon�taires li�es aux immobilisations lou�es ainsi que la dur�e de vie utile des immobilisations. Les r�sultats r�els pourraient diff�rer des estimations de mani�re significative. Les estimations de la direction sont examin�es p�riodiquement et, � mesure que les
rajustements deviennent n�cessaires, ils sont constat�s dans les �tats financiers de l'exercice o� ils sont connus.
3. Cr�dits parlementaires
Le CNRC re�oit la plus grande partie de son financement par des cr�dits parlementaires annuels. Les �l�ments comptabilis�s � l’�tat des r�sultats et � l’�tat de la situation financi�re d’un exercice donn� peuvent �tre financ�s par des cr�dits parlementaires des exercices pr�c�dents, courant ou ult�rieurs. En cons�quence, le CNRC affiche des r�sultats de
fonctionnement nets diff�rents pour l’exercice selon qu'ils sont pr�sent�s selon le financement octroy� par le gouvernement ou selon la m�thode de comptabilit� d’exercice. Le rapprochement des diff�rences est pr�sent� dans les tableaux qui suivent :
|
(en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
|
|
|
|
Co�t de fonctionnement net |
676 498 |
672 964 |
|
|
|
|
|
Rajustements pour les �l�ments ayant une incidence sur le co�t de fonctionnement net mais non sur les cr�dits : |
|
|
|
Ajouter (d�duire) : |
|
|
|
Revenus |
170 157 |
159 866 |
|
Amortissement des immobilisations |
(64 210) |
(57 916) |
|
Ententes financi�res avec d'autres minist�res et organismes du gouvernement f�d�ral |
(56 974) |
(58 842) |
|
Services re�us gratuitement |
(27 612) |
(25 940) |
|
D�caissements pour les comptes � fins d�termin�es |
(17 182) |
(20 994) |
|
Augmentation des salaires courus |
(5 527) |
- |
|
Avantages sociaux futurs |
(3 519) |
(5 698) |
|
Remboursements des charges des exercices ant�rieurs |
3 056 |
719 |
|
Indemnit�s de vacances et cong�s compensatoires |
(2 805) |
(3 434) |
|
Augmentation des frais de litiges � payer |
(1 012) |
(538) |
|
(Charge) recouvrement de mauvaises cr�ances |
(784) |
745 |
|
Charges li�es � Justice Canada |
(541) |
(486) |
|
Diminution (augmentation) des paiements tenant lieu d’imp�ts fonciers � verser |
371 |
(670) |
|
Perte sur l’ali�nation d’immobilisations |
- |
(490) |
|
Autres |
3 637 |
109 |
|
Total des �l�ments ayant une incidence sur le co�t de fonctionnement net mais non sur les cr�dits |
(2 945) |
(13 569) |
|
|
|
|
|
Rajustements pour les �l�ments n’ayant pas d’incidence sur le co�t de fonctionnement net mais en ayant une sur les cr�dits : |
|
|
|
Ajouter (d�duire) : |
|
|
|
Acquisitions d’immobilisations et ajouts aux actifs en construction |
62 072 |
74 334 |
|
Augmentation des charges pay�es d’avance |
7 280 |
1 081 |
|
(Diminution) augmentation des stocks |
(821) |
53 |
|
Total des �l�ments n’ayant pas d’incidence sur le co�t de fonctionnement net mais en ayant une sur les cr�dits |
68 531 |
75 468 |
|
|
|
|
|
Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
742 084 |
734 863 |
|
(en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
|
|
|
|
Cr�dits parlementaires vot�s : |
|
|
|
Cr�dit 55 – D�penses de fonctionnement |
460 203 |
356 428 |
|
Cr�dit 55 – Mandats sp�ciaux de la gouverneure g�n�rale |
- |
37 877 |
|
Cr�dit 60 – D�penses en capital |
49 943 |
53 919 |
|
Cr�dit 60 – Mandats sp�ciaux de la gouverneure g�n�rale |
- |
13 548 |
|
Cr�dit 65 – Subventions et contributions |
145 858 |
113 760 |
|
Cr�dit 65 – Mandats sp�ciaux de la gouverneure g�n�rale |
- |
27 070 |
|
Montants l�gislatifs : |
|
|
|
Revenus selon l'article 5(1) de la Loi sur le Conseil national de recherches |
133 706 |
125 839 |
|
Cotisations aux r�gimes d’avantages sociaux |
54 647 |
56 606 |
|
Produit de l'ali�nation de biens de surplus de la Couronne |
335 |
683 |
|
Frais d'agences de recouvrement |
51 |
66 |
|
Moins : |
|
|
|
Cr�dits disponibles pour emploi dans les exercices ult�rieurs |
(78 168) |
(40 628) |
|
Cr�dits p�rim�s |
(24 491) |
(10 305) |
|
Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
742 084 |
734 863 |
|
(en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
|
|
|
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement |
655 005 |
624 083 |
|
Revenus |
170 157 |
159 866 |
|
Recettes et d�penses sans incidence sur les cr�dits parlementaires |
(132 918) |
(88 658) |
|
(Augmentation) diminution des cr�ances et avances |
(5 791) |
4 860 |
|
Augmentation des placements de fonds de dotation |
(115) |
(152) |
|
Augmentation des passifs |
55 746 |
34 864 |
|
Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
742 084 |
734 863 |
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Cr�ances de tierces parties |
19 612 |
18 642 |
|
Cr�ances d’autres minist�res et organismes du gouvernement f�d�ral |
5 846 |
3 536 |
|
Avances aux employ�s |
48 |
54 |
|
|
25 506 |
22 232 |
|
Moins : provision pour cr�ances douteuses sur les cr�ances externes |
(2 180) |
(1 969) |
|
|
23 326 |
20 263 |
|
|
|
|
|
Contributions remboursables |
10 659 |
7 553 |
|
Moins : provision pour irr�couvrabilit� |
(7 105) |
(6 727) |
|
Contributions remboursables nettes |
3 554 |
826 |
|
|
|
|
|
Total |
26 880 |
21 089 |
5. Placements en actions
Les placements en actions comprennent des actions dans les soci�t�s publiques et priv�es. La direction n’a pas l’intention de maintenir des placements en actions pour une longue p�riode. Le CNRC envisagera de se dessaisir au moment opportun de placements en actions en tenant compte des int�r�ts et de la croissance pr�vue de l’entreprise, de la fluidit� du march� et
de la possibilit� de recevoir un juste rendement du capital investi au nom des Canadiens. De tous les placements de portefeuille o� le CNRC d�tient une participation dans les capitaux propres, six �taient pour des r�glements de dettes pour une valeur totale de 644 839 $ (trois �valu�s � 537 135 $ en 2006) et vingt ont �t� obtenus par des op�rations non mon�taires
(vingt‑deux en 2006), dont huit (onze en 2006) sont inactifs ou ont d�clar� faillite. Un estim� pour les op�rations non mon�taires ne peut �tre d�termin� d� au fait que la valeur de l'aide financi�re est fortement sp�culative.
La juste valeur des placements en actions au 31 mars 2007 �tait 757 292 $ (1 567 687 $ en 2006).
6. Placements de fonds de dotation
Le compte a �t� cr�� en application de l’alin�a 5(1)f) de la Loi sur le Conseil national de recherches afin d’inscrire le reliquat de la succession de feu H.L. Holmes. Jusqu’� deux tiers du revenu annuel net du fonds de dotation sert � financer annuellement le prix H.L. Holmes. Ce prix offre aux �tudiants de niveau post‑doctoral la possibilit�
d’�tudier dans des �coles sup�rieures ou des instituts de recherches de r�putation mondiale sous la direction de chercheurs de renom.
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Encaisse et placements affect�s, d�but de l’exercice |
4 077 |
3 925 |
|
Revenu net de la dotation |
210 |
232 |
|
Prix donn�s |
(95) |
(80) |
|
Encaisse et placements affect�s, fin de l’exercice |
4 192 |
4 077 |
Le portefeuille avait un rendement effectif moyen de 5,02 % (5,53 % en 2006) et un terme � �ch�ance moyen de 5,07 ann�es au 31 mars 2007 (5,21 ann�es au 31 mars 2006). La valeur marchande des placements de dotation au 31 mars 2007 �tait de 4 261 721 $ (4 135 889 $ en 2006).
7. Immobilisations
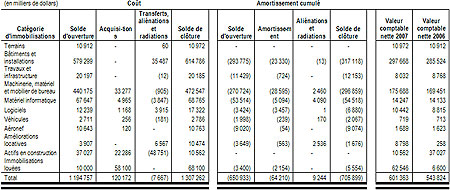
La charge d’amortissement pour l’exercice termin� le 31 mars 2007 est de 64 209 615 $ (57 915 678 $ en 2006).
Au 31 mars 2007, le CNRC d�tenait huit baux pour des terrains (huit en 2006) pour un co�t annuel nominal de un dollar avec des universit�s. Dans ces cas, le CNRC poss�de le b�timent sur le terrain lou�. La juste valeur du terrain pour ces op�rations non mon�taires ne peut pas �tre d�termin�e.
Le 21 mars 1996, le CNRC a conclu une op�ration non mon�taire, soit un bail avec l'Universit� Western de l’Ontario pour la relocalisation de l'Institut des technologies de fabrication int�gr�e (ITFI) par lequel la propri�t� lou�e a �t� fournie au CNRC pendant vingt‑cinq ann�es � un co�t nominal de un dollar. Le CNRC n'a aucun autre engagement envers l'Universit� Western de l’Ontario. La propri�t� a �t� comptabilis�e comme immobilisation lou�e � sa juste valeur de 10 millions de dollars. L'amortissement annuel de 400 000 $ pour l’immobilisation est compens� au complet par l'amortissement de l’apport report� li� � la propri�t� lou�e.
Le 23 mai 2006, le CNRC a pris possession de nouvelles installations et a conclu une op�ration non mon�taire avec l'Universit� de l'Alberta. Le CNRC est en processus de ren�gociation pour les termes d'un nouveau bail avec l'Universit� concernant la localisation de l'Institut national de nanotechnologie du CNRC (INN), par lequel la propri�t� lou�e est fournie au CNRC � un co�t nominal de un dollar par ann�e. Le bail propos� offre un terme de un an avec des options de renouvellement sur dix occasions s�quentielles, chacun des neuf premiers renouvellements �tant d'une p�riode de cinq ans, et le dixi�me �tant d'une p�riode de quatre ans. Le b�timent a �t� comptabilis� comme immobilisation lou�e � sa juste valeur de 44,4 millions de dollars. L'amortissement annuel de 1 776 000 $ pour l’immobilisation est compens� au complet par l'amortissement de l’apport report� li� au b�timent lou�.
Le 1er septembre 2006, le CNRC a pris possession de nouvelles installations et a conclu une op�ration non mon�taire avec l'Universit� de l'�le‑du‑Prince‑�douard. Le CNRC a conclu un bail avec l'Universit� pour la localisation de l'Institut des sciences nutritionnelles et de la sant� du CNRC (ISNS), par lequel la propri�t� lou�e est fournie au CNRC � un co�t nominal de un dollar par ann�e. Le bail offre un terme de dix‑neuf mois avec des options de renouvellement pour sept p�riodes additionelles de cinq ans, et une p�riode additionelle de trois ans et cinq mois (jusqu'au 31 ao�t 2046). Le b�timent a �t� comptabilis� comme immobilisation lou�e � sa juste valeur de 13,7 millions de dollars. L'amortissement annuel de 548 000 $ pour l’immobilisation est compens� au complet par l'amortissement de l’apport report� li� au b�timent lou�.
Le 12 d�cembre 2002, le CNRC a conclu une entente avec l'Universit� de la Colombie‑Britannique d'abandonner un bail pour un terrain existant et le b�timent s’y rattachant pour 15 millions de dollars. La disposition a eu lieu en 2007 et ces revenus ont �t� comptabilis�s en 2007.
Le tableau suivant pr�sente la valeur comptable des immobilisations destin�es � la vente:
| (en milliers de dollars) |
Co�t |
Amortissement cumul� |
Valeur comptable nette 2007 |
Valeur comptable nette 2006 |
|
Immobilisations destin�es � la vente |
- |
- |
- |
7 630 |
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Fournisseurs |
102 188 |
98 175 |
|
Sommes � payer aux autres minist�res et organismes du gouvernement f�d�ral |
14 017 |
15 339 |
|
Salaires et avantages sociaux � payer |
13 773 |
7 965 |
|
Retenues de garantie |
745 |
865 |
|
Taxes de vente � payer |
130 |
1 127 |
|
Total |
130 853 |
123 471 |
| (in thousands of dollars) |
2007 |
2006 |
|
Revenus report�s – comptes � fins d�termin�es |
|
|
|
Solde, d�but de l’exercice |
12 596 |
11 054 |
|
Fonds re�us |
17 679 |
22 536 |
|
Revenus comptabilis�s |
(17 182) |
(20 994) |
|
Solde, fin de l’exercice |
13 093 |
12 596 |
|
|
|
|
|
Revenus report�s – autres |
|
|
|
Solde, d�but de l’exercice |
23 598 |
12 783 |
|
Fonds re�us |
9 129 |
18 614 |
|
Revenus comptabilis�s |
(23 532) |
(7 799) |
|
Solde, fin de l’exercice |
9 195 |
23 598 |
|
|
|
|
|
Revenus report�s – apports li�s aux immobilisations lou�es |
|
|
|
Solde, d�but de l’exercice |
6 600 |
7 000 |
|
Apports re�us |
58 100 |
- |
|
Apports comptabilis�s comme revenus |
(2 154) |
(400) |
|
Solde, fin de l’exercice |
62 546 |
6 600 |
|
|
|
|
|
Total |
84 834 |
42 794 |
10. Avantages sociaux futurs
Les employ�s du CNRC ont droit � des avantages sociaux sp�cifiques en fin d'emploi ou � la retraite, tels que le pr�voient les diverses conventions collectives ou conditions d'emploi.
a) Prestations de retraite
Le CNRC et tous les employ�s admissibles participent au R�gime de retraite de la fonction publique, qui est parrain� et administr� par le gouvernement du Canada. Les prestations de retraite s’accumulent jusqu’� un maximum de 35 ans � un taux de 2 p. 100 par ann�e de service ouvrant droit � pension, multipli� par la moyenne des gains des cinq meilleures ann�es cons�cutives. Les prestations sont int�gr�es au R�gime de pensions du Canada et au R�gime de rentes du Qu�bec et sont index�es � l’inflation.
La charge de 40 275 048 $ (41 888 165 $ en 2006) repr�sente approximativement 2,3 fois (2,6 fois en 2006) les cotisations des employ�s. Les employ�s et le CNRC versent des cotisations � l’�gard du co�t du R�gime. Au 31 mars 2007, les cotisations sont comme suit ::
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Cotisations du CNRC |
40 275 |
41 888 |
|
Cotisations des employ�s |
17 825 |
15 818 |
La responsabilit� du CNRC � l’�gard du R�gime se limite � ses cotisations. Les exc�dents et d�ficits actuariels sont comptabilis�s aux �tats financiers du gouvernement du Canada, � titre de r�pondant du R�gime.
b) Indemnit�s de d�part
Le CNRC verse des indemnit�s de d�part aux employ�s en fonction de l'admissibilit�, des ann�es de service et du salaire final. Ces indemnit�s ne sont pas capitalis�es d'avance. Les indemnit�s seront pr�lev�es sur les cr�dits futurs. Voici les indemnit�s de d�part au 31 mars :
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Obligation au titre des indemnit�s constitu�es, d�but de l’exercice |
55 269 |
49 571 |
|
Charges pour l’exercice |
7 180 |
8 707 |
|
Indemnit�s vers�es pendant l’exercice |
(3 661) |
(3 009) |
|
Obligations au titre des indemnit�s constitu�es, fin de l’exercice |
58 788 |
55 269 |
11. Passif �ventuel
a) Passif environnemental
Les �l�ments de passif sont comptabilis�s afin d'inscrire les co�ts estimatifs li�s � la gestion et � la remise en �tat des sites contamin�s lorsque le CNRC est oblig� ou probablement oblig� d'assumer ces co�ts. Le CNRC a identifi� un site (un site en 2006) o� des mesures sont possibles et pour lesquels un passif de 300 000 $ (300 000 $ en 2006) a �t� constat�. Les efforts d�ploy�s par le CNRC pour �valuer les sites contamin�s peuvent entra�ner des passifs environnementaux additionnels pour des sites nouvellement �tablis ou pour des modifications aux estimations ou � l'utilisation pr�vue des sites existants. Ces �l�ments de passif seront comptabilis�s par le CNRC pendant l'exercice o� ils seront connus.
b) R�clamations et litiges
Des r�clamations ont �t� faites aupr�s du CNRC dans le cours normal de ses activit�s. Certains de ces passifs �ventuels peuvent devenir des passifs r�els selon que certains �v�nements futurs se produisent ou ne se produisent pas. Dans la mesure o� l’�v�nement futur est susceptible de se produire, et une �valuation raisonnable de la perte peut �tre faite, un passif estimatif et une charge sont comptabilis�s dans les �tats financiers du CNRC.
Au 31 mars 2007, le CNRC faisait �tat de treize r�clamations non r�gl�es (dix‑sept en 2006) dont trois (cinq en 2006) �taient reli�es � des frais susceptibles de devenir un passif et deux dont l'issue �tait ind�terminable (aucune en 2006). � l’heure actuelle, les trois r�clamations reli�es � des frais susceptibles de devenir un passif (quatre en 2006) peuvent �tre raisonnablement estim�es alors qu'aucune (une en 2006) ne peut pas �tre estim�e. Une provision de 1 550 000 $ (537 600 $ en 2006) a �t� comptabilis�e selon l'�valuation juridique du CNRC de ce passif �ventuel.
12. Obligations contractuelles
De par leur nature, les activit�s du CNRC peuvent donner lieu � des contrats et des obligations importants en vertu desquels le CNRC sera tenu d'effectuer des paiements futurs lorsque les services auront �t� rendus et que les biens auront �t� re�us. Voici les principales obligations contractuelles pour lesquelles une estimation raisonnable peut �tre faite :
| (en milliers de dollars) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 and au‑del� |
Total |
|
Paiements de transfert |
92 907 |
60 540 |
54 900 |
10 530 |
17 295 |
236 172 |
|
Contrats d'exploitation |
31 542 |
12 157 |
8 433 |
763 |
- |
52 895 |
|
Total |
124 449 |
72 697 |
63 333 |
11 293 |
17 295 |
289 067 |
13. Charges
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Salaires et avantages sociaux futurs |
419 566 |
395 985 |
|
Subventions et contributions |
142 963 |
129 902 |
|
Services publics, fournitures et approvisionnements |
81 026 |
87 777 |
|
Amortissement |
64 210 |
57 916 |
|
Services professionnels et sp�ciaux |
60 111 |
64 044 |
|
Transport et communications |
27 127 |
26 667 |
|
R�parations et entretien |
18 180 |
17 616 |
|
Versements tenant lieu d’imp�ts fonciers |
13 649 |
15 373 |
|
Information |
5 377 |
4 492 |
|
Locations |
5 244 |
5 460 |
|
Mauvaises cr�ances |
3 658 |
23 879 |
|
Prix |
1 707 |
2 261 |
|
Co�t des biens vendus |
745 |
807 |
|
Perte nette sur ali�nation d’immobilisations |
- |
490 |
|
Autre |
3 092 |
161 |
|
Total |
846 655 |
832 830 |
14. Revenus
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Ventes de biens et services |
|
|
|
Services de nature non r�glementaire et autres droits et frais |
64 995 |
56 097 |
|
Vente de biens et de produits d’information |
11 349 |
11 981 |
|
Droits et privil�ges |
6 663 |
5 834 |
|
Location et utilisation de biens |
3 221 |
3 060 |
|
Total |
86 228 |
76 972 |
|
|
|
|
|
Ententes financi�res avec d'autres minist�res et organismes du gouvernement f�d�ral |
56 974 |
58 842 |
|
Revenus de projets conjoints et d’accords de partage des co�ts |
17 182 |
20 994 |
|
Gain net sur disposition d'immobilisations |
6 823 |
- |
|
Gain sur cession de placements en actions |
223 |
1 935 |
|
Autres |
2 727 |
1 123 |
|
Total |
170 157 |
159 866 |
15. Op�rations entre apparent�s
En vertu du principe de propri�t� commune, le CNRC est apparent� � tous les minist�res, organismes et soci�t�s d'�tat du gouvernement du Canada. Le CNRC conclut des op�rations avec ces entit�s dans le cours normal de ses activit�s et selon des modalit�s commerciales normales. Voir les notes 4 et 8 pour les cr�ances et cr�diteurs aupr�s d’autres minist�res et organismes du
gouvernement f�d�ral. De plus, au cours de l’exercice, le CNRC a re�u des services, sans frais, d’autres minist�res et organismes du gouvernement f�d�ral. Ces services fournis gratuitement ont �t� comptabilis�s comme suit � l’�tat des r�sultats du CNRC :
| (en milliers de dollars) |
2007 |
2006 |
|
Cotisations de l’employeur aux r�gimes de soins de sant� et de soins dentaires fournies par le Conseil du Tr�sor |
25 786 |
24 478 |
|
Services juridiques fournis par Justice Canada |
635 |
376 |
|
Services de v�rification fournis par le Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada |
500 |
427 |
|
Indemnit�s d’accidents du travail fournies par Ressources humaines et D�veloppement social Canada |
360 |
336 |
|
Services de paye fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
174 |
163 |
|
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
157 |
160 |
|
Total |
27 612 |
25 940 |
Les services juridiques fournis par Justice Canada totalisent 1 176 429 $ (862 638 $ en 2006). De ce montant, des services pour 635 462 $ (376 326 $ en 2006) ont �t� fournis gratuitement.
16. Instruments financiers
Les instruments financiers du CNRC se composent de cr�ances et avances, de placements, de cr�diteurs et charges � payer ainsi que de revenus report�s. Sauf mention contraire, la direction est d’avis que le CNRC n’est pas expos� � des risques importants en mati�re d’int�r�ts, de change ou de cr�dit d�coulant de ces instruments financiers. Sauf indication contraire
dans les pr�sents �tats financiers, la direction est d’avis que les valeurs comptables des instruments financiers correspondent approximativement � leur juste valeur en raison de leur �ch�ance imminente.
17. �v�nement subs�quent
En mai 2007, le CNRC et l'Association des employ�s du Conseil de recherches (AECR) ont conclu une entente collective avec les groupes suivants: Soutien administratif (AD), Services administratifs (AS) et Gestion des syst�mes d'ordinateurs (CS) pour la p�riode du 1er mai 2005 au 30 avril 2008 pour les groupes AD et AS et la p�riode du 22 d�cembre 2005 au 21 d�cembre 2007 pour le groupe
CS. Tous les salaires et avantages sociaux r�troactifs payables selon ces ententes, lesquels seront financ�s par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, seront pay�s en 2008. Un passif et une charge pour les salaires et avantages sociaux r�troactifs � payer au 31 mars 2007 ont �t� inscrits au montant de 4 millions de dollars en 2007.
18. Chiffres correspondants
Les chiffres de l'exercice pr�c�dent ont �t� reclass�s afin de les rendre conformes � la pr�sentation adopt�e pour l'exercice en cours.
|
R�ponse aux comit�s parlementaires |
|
En 2005-2006, le CNRC n'a pas particip� � des travaux de comit�s parlementaires n�cessitant une r�ponse. |
|
R�ponse � la v�rificatrice g�n�rale |
|
Les progr�s � l'�gard de la mise en œuvre des recommandations de la V�rification interne du CNRC et du Bureau du v�rificateur g�n�ral (BVG) sont communiqu�s trimestriellement au Comit� sur la v�rification, l'�valuation et la gestion des risques. En 2006-2007, le BVG a analys� les progr�s r�alis�s par le CNRC relativement aux recommandations formul�es dans le rapport de v�rification de 2004 du BVG sur la gestion de la recherche de pointe du CNRC. Le BVG a remarqu� que le CRNC a, en g�n�ral, fait des progr�s satisfaisants depuis 2004 en r�action aux recommandations pr�c�dentes du BVG. Le CNRC a pris des mesures relatives aux recommandations portant sur la gouvernance minist�rielle, l'orientation strat�gique minist�rielle et la gestion des ressources humaines. Toutefois, il lui reste des progr�s � faire dans la documentation des d�cisions cruciales � l'�chelle institutionnelle et dans la d�claration et l'�valuation du rendement. Le BVG a admis que le processus de consultation et d'�laboration de nouvelles strat�gies du CNRC ne permet pas des progr�s optimaux dans certains domaines. Gr�ce � la nouvelle strat�gie du CNRC maintenant en place et � l'�laboration du plan d'activit�s minist�riel r�cemment approuv�, le CNRC devrait �tre mieux � m�me d'aborder les questions non r�solues de fa�on plus directe et efficace. Le suivi de v�rification interne du CNRC relatif aux recommandations subs�quentes qu'a faites le BVG dans son rapport de 2007 indique que ces recommandations sont g�n�ralement en bonne voie d'avancement. Lien vers la v�rification de suivi de f�vrier 2007 effectu�e par le BVG : http://www.oag-bvg.gc.ca/domino/rapports.nsf/html/20070203cf.html |
|
V�rifications internes effectu�es en 2006-2007 |
|
V�rifications internes
|
|
�valuations internes effectu�es en 2006-2007 |
|
�valuations internes
|
|
Recommandation |
R�ponse de la direction |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
L'�valuation recommande que le PARI-CNRC augmente le niveau de financement par client pour les projets de recherche et de d�veloppement. Afin d'y arriver, on devrait envisager de demander une augmentation du budget des contributions non remboursables du afin de rejoindre un plus grand nombre de clients et d'augmenter le montant des contributions vers�es � chacun. On devrait aussi envisager la possibilit� de cr�er des programmes � compl�mentaires � pour accro�tre le financement offert aux clients. Sans augmentation du budget des contributions du PARI-CNRC, celui-ci devra faire des compromis, le principal �tant de r�duire le nombre de clients desservis (afin de maximiser les contributions vers�es � chaque client) de mani�re � maximiser la valeur du PARI-CNRC pour les PME et le Canada. |
Le PARI-CNRC reconna�t d'embl�e la n�cessit� d'accro�tre le financement accord� � chaque client pour les projets de recherche- d�veloppement. En fait, le PARI-CNRC a d�j� commenc� � mettre cette strat�gie en œuvre avec comme corollaire in�vitable qu'il dessert un nombre inf�rieur de clients. En vertu de son nouveau plan strat�gique et sous r�serve qu'il obtienne des fonds additionnels, le PARI-CNRC doublera sa client�le au cours des cinq prochaines ann�es (de 12 000 � 24 000 clients en 2007). Le CNRC s'efforce actuellement d'obtenir du gouvernement f�d�ral des fonds additionnels pour le PARI-CNRC afin de s'assurer que le programme puisse aider un nombre sup�rieur de PME � accro�tre leur capacit� d'innovation au cours des ann�es � venir et envisage des d�marches novatrices pour accro�tre le niveau de financement disponible par client. Le PARI-CNRC sollicite �galement d'autres sources de financement et notamment des soci�t�s de capital de risque, la BDC et des organismes r�gionaux afin de permettre aux PME d'avoir acc�s plus facilement au financement n�cessaire � leurs activit�s d'innovation. |
Le r�seau de prestation du PARI-CNRC, constitu� de 230 professionnels exp�riment�s dans la prestation de programmes (conseillers en technologie industrielle, analystes en innovation et r�seau, analystes des syst�mes de gestion), offre trois programmes directement aux PME : le programme phare PARI-CNRC, le Programme jeunesse (au nom de RHDSC) et le programme temporaris� PARI-PTC. En g�n�ral, ces professionnels de la prestation ne se sp�cialisent pas dans la prestation d'un seul programme, mais choisissent plut�t le programme le plus adapt� aux besoins du client. Le financement par cr�dits vot�s du PARI-CNRC pour les subventions et contributions en g�n�ral a diminu� au cours de l'exercice financier 2006-2007. Par exemple, en 1997-1998, le PARI-CNRC a vers� 65,4 millions de dollars aux PME canadiennes. Le budget du PARI-CNRC pour son programme r�gulier en 2006-2007 �tait de 55,6 millions avant qu'une entente de financement unique conclue avec Industrie Canada (6,3 millions; DEC 2,6 millions; 1,2 million aux PME) ne porte le total actuel pour 2006-2007 � environ 63 millions. Le fait que la demande se soit maintenue a eu pour cons�quence que le PARI-CNRC est venu � manquer de financement au d�but de l'exercice et on s'attend � ce que la demande se maintienne � ce niveau dans le futur. En plus de la r�duction progressive des op�rations de la phase de financement du PARI-PTC, la plupart des organismes r�gionaux sont incapables de continuer � accorder la m�me part de leurs contributions financi�res au PARI-CNRC que c'�tait le cas depuis le d�but des ann�es 1990. La stagnation de l'allocation budg�taire et les pressions inflationnistes ont graduellement min� la capacit� du PARI-CNRC � aider les PME. Suite � l'examen des d�penses de 2006, et compte tenu des r�ductions financi�res auxquelles le CNRC a d� proc�der en 2006-2007, les allocations internes pour le PARI-CNRC ont �t� r�duites. Compte tenu de ce qui pr�c�de, les variations du niveau budg�taire du PARI-CNRC (acc�s aux sources de financement en cours d'exercice, par ex.) et l'affectation de fonds � une r�gion particuli�re ou � un domaine de technologie donn� ont �prouv� la flexibilit� de ce programme, dont la force est habituellement de r�pondre � la demande des clients. Par cons�quent, l'acc�s � un budget stable et pr�visible est d'une importance primordiale pour la gestion future du PARI-CNRC. Le PARI-CNRC a r�ussi � r�cup�rer certains des ajustements budg�taires auxquels il a d� proc�der suite � la perte des relations r�gionales et continue de chercher de nouvelles possibilit�s laiss�es par cette perte. Par exemple, en avril 2007, le PARI-CNRC a r�cup�r� sa contribution initiale de 15 millions de dollars � Partenariat technologique Canada (PTC) apr�s les n�gociations assidues men�es avec Industrie Canada dans les mois pr�c�dents. Ces fonds ont �t� r�int�gr�s dans le budget g�n�ral du PARI-CNRC (dont la majeure partie �tait destin�e � des contributions non remboursables) et ont permis aux clients d'acc�der � davantage de financement de projets. En raison de ces facteurs, le PARI-CNRC a accus� en 2006-2007une diminution de la port�e de ses clients financ�s, ceux-ci �tant pass�s de 2 677 en 2005-2006 � 1 906 en 2006-2007. Toutefois, le Programme a vers� une aide financi�re � davantage de nouveaux clients, passant de 340 clients en 2005-2006 � 732 en 2006-2007. De fa�on g�n�rale, les contributions vers�es aux soci�t�s (PARI-CNRC et Programme jeunesse) sont pass�es de 73,31 millions de dollars en 2005-2006 � 66,09 millions en 2006-2007. Le nouveau directeur ex�cutif du Bureau national qui s'est joint au PARI-CNRC en juin 2006 continue de s'efforcer � ouvrir l'acc�s aux fonds d�j� existants ou de chercher de nouvelles sources de contributions budg�taires. Une des priorit�s consiste � stabiliser le budget du PARI-CNRC et � cr�er de meilleurs outils de pr�vision pour que le Programme puisse administrer son aide financi�re de fa�on dynamique d�s le d�but de chaque exercice financier. Par cons�quent, le financement de projets accessible en 2006-2007 a �t� �troitement surveill� et r�parti entre les r�gions de fa�on plus ponctuelle, selon la demande des clients. Cette pratique a permis d'assurer l'utilisation optimale des fonds du Programme. |
|
Le PARI-CNRC devrait �tudier attentivement ses services consultatifs afin d'accro�tre leur valeur pour les clients ainsi que leur rapport co�ts-efficacit�. Pour y arriver, il devrait : envisager de r�duire l'�ventail des services consultatifs offerts, se concentrer sur les services de base et s'en remettre davantage aux partenariats pour compl�ter son offre de services; proc�der � des analyses afin d'�tablir si le genre et le niveau des conseils prodigu�s devraient �tre adapt�s en fonction du profil et des besoins de diff�rentes client�les (par exemple, besoins des petites entreprises par rapport aux plus grandes); d�finir clairement ce qui constitue un conseil du PARI-CNRC et accro�tre la sensibilisation des clients aux conseils du PARI-CNRC � titre de services et �tablir le niveau optimal de ressources qui devraient �tre allou�es au financement offert par le PARI-CNRC et � ses services consultatifs afin de maximiser le rapport co�ts-efficacit�. |
Le PARI-CNRC souscrit � l'importance de cette question et a planifi� de s'attaquer � cette t�che au cours des prochains exercices. Le PARI-CNRC croit fermement que ses conseils � valeur ajout�e font partie int�grante de l'�ventail des services offerts aux PME et qu'il est difficile de les s�parer du processus consistant � offrir une aide financi�re ou autre. La question pour le PARI-CNRC consiste � �tablir comment il peut consigner les conseils prodigu�s aux clients et mesurer leurs effets afin d'�valuer de mani�re satisfaisante les r�sultats obtenus par les PME qui sont directement imputables aux conseils qui leur sont dispens�s. Le cadre de mesure du rendement du PARI-CNRC jouera un r�le crucial � cet �gard. |
Le PARI-CNRC a continu� d'offrir ses comp�tences essentielles, � savoir une vari�t� de services techniques et consultatifs aux entreprises, de liaisons, de soumissions et de r�seaux, de m�me qu'une �ventuelle aide financi�re aux PME canadiennes en croissance. En 2006-2007, environ 8 000 entreprises ont profit� des services consultatifs du PARI-CNRC et sur ce nombre, 1 906 soci�t�s ont re�u de l'aide financi�re. En septembre 2005, le PARI-CNRC, se rendant compte qu'il ne poss�dait pas les ressources requises pour offrir de lui-m�me le vaste spectre de services d'aide � l'innovation, a ajust� son orientation strat�gique afin de se concentrer sur la prestation de ses comp�tences essentielles. Afin de s'assurer que les PME continuent d'avoir acc�s aux autres types de soutien voulu, le PARI-CNRC a �tabli diverses collaborations strat�giques avec d'autres organismes. Le PARI-CNRC a cr�� de nouveaux indicateurs du rendement technique et commercial des projets, qui feront l'objet d'un suivi de 2007 � 2012. Le PARI-CNRC a commenc� en 2006 � r�viser son cadre de rendement actuel et ses syst�mes d'appoint administratifs et de TI afin de s'assurer qu'ils sont adapt�s � son mod�le logique actuel. Par exemple, le PARI-CNRC contribue chaque ann�e � une initiative de l'Association canadienne des conseillers en management (ACCM) destin�e � offrir des conseils en gestion d'entreprise aux PME admissibles pendant une p�riode pouvant aller jusqu'� trois jours. Le programme, intitul� Management Advisory Services (MAS), compl�te le mandat du PARI-CNRC en offrant aux PME des services professionnels de gestion par une tierce partie, contribuant ainsi � ce que les innovations technologiques soient commercialis�es au profit des Canadiens. En 2006-2007, un total de 80 missions de consultation diff�rentes ont �t� men�es � bien par des conseillers certifi�s en gestion (CMC, pour Certified Management Consultants). Les PME clientes ont tr�s bien cot� ce programme. La totalit� des PME qui ont r�pondu au sondage ont dit qu'elles recommanderaient le MAS � d'autres PME. Ce programme permet principalement aux PME qui ont profit� de ce service d'�tre mieux pr�par�es pour commercialiser avec succ�s leurs innovations technologiques et surmonter les obstacles qui nuisent � leur croissance. |
|
Le RCT devrait se doter � l'�chelle nationale d'une vision, d'une mission et d'objectifs strat�giques et op�rationnels compris par tous et auxquels tous adh�rent. Il pourrait ainsi fonctionner comme un v�ritable r�seau national s'appuyant sur un mod�le commercial, �galement national, qui �noncerait clairement ce qu'est le RCT, quelles sont ses activit�s, qui sont ses clients et comment il est structur� en ce qui a trait � la communication de l'information et � la responsabilisation. On devrait envisager la mise en œuvre pour le RCT de pratiques r�gionales susceptibles de contribuer � son succ�s, et les attentes � l'endroit du RCT devraient �tre g�r�es efficacement (par exemple, les ressources dont dispose le RCT devraient �tre harmonis�es avec la vision, la mission, les objectifs et le mod�le commercial ayant fait l'objet d'un accord). |
Le PARI-CNRC reconna�t que l'�laboration d'une vision et d'une mission partag�es � l'�chelle nationale est essentielle au succ�s du RCT en sa qualit� de r�seau national et que cette vision et cette mission doivent s'appuyer sur un mod�le commercial, lui aussi national, qui �noncera de mani�re claire ce qu'est le RCT, quelles sont ses activit�s, ses ressources, sa port�e et les avantages qu'il g�n�re pour ses clients et pour le Canada. Avec les membres, les utilisateurs et les concepteurs du RCT, le PARI-CNRC s'attaquera � cette t�che d'ici d�cembre 2003. |
En 2006-2007, le PARI-CNRC de la r�gion de Qu�bec a d�termin� qu'en raison des fonds consid�rables fournis par DEC et des autres contributions non financi�res, il �tait opportun de prolonger son initiative de RCT en tant qu'organisme sans but lucratif appuy� et g�r� par ses membres. Le PARI-CNRC du Qu�bec demeure un membre important de ce r�seau, qui continuera de promouvoir la sensibilisation actuelle aux programmes et aux services de soutien � l'innovation permettant d'acc�l�rer la prestation et d'accro�tre l'efficacit� des services d'aiguillage entre les PME membres de la r�gion de Qu�bec. L'ensemble des r�gions participant au PARI-CNRC continuent d'offrir des contributions aux organismes, qui compl�tent les services de consultation technique essentiels du PARI-CNRC et offrent une vaste gamme de services aux PME. |
|
Le PARI-CNRC devrait envisager d'enrichir et d'intensifier les transferts de connaissances entre le PARI-CNRC et les PME par des partenariats cl�s avec l'Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST) et d'autres membres du RCT, de resserrer ses liens avec les laboratoires publics et les universit�s et d'�tablir au moyen de pratiques exemplaires des relations fructueuses entre le PARI-CNRC et les instituts du CNRC; d'�tudier les possibilit�s de resserrer les liens �tablis par l'entremise de r�seaux internationaux en analysant de mani�re �troite les pratiques de r�seautage international auxquelles ont recours certains programmes �trangers similaires et d'�tablir des r�seaux avec des grappes technologiques communautaires afin d'accro�tre les liens strat�giques entre ses clients et ses grappes. |
Le nouveau plan strat�gique du PARI-CNRC fait �tat d'importantes possibilit�s d'intensification des partenariats et des liens avec les intervenants cl�s afin d'aider les PME � acc�der aux technologies et � l'information technique, et � former des partenariats avec leurs fournisseurs, leurs clients et d'autres entreprises. Le PARI-CNRC travaille actuellement � l'�laboration d'un cadre de mise en œuvre afin de pouvoir profiter de ces possibilit�s en temps opportun et de stimuler l'innovation au sein des PME. |
En d�cembre 2004, le PARI-CNRC et l'ICIST-CNRC ont sign� un protocole d'accord (PA) sur la prestation par l'ICIST-CNRC de services d'information de base au PARI-CNRC dans l'ensemble du Canada au cours de l'exercice 2005-2006. En 2007, le PA a �t� renouvel� pour la p�riode allant de 2007 � 2010 et a entra�n� la mutation des conseillers techniques et commerciaux du PARI-CNRC � l'ICIST-CNRC. Ces deux unit�s du CNRC se partagent maintenant la coordination et la gestion des services connexes au PARI-CNRC. En plus de la prestation nationale uniforme des services d'information de base de l'ICIST-CNRC, ce dernier et le PARI-CNRC ont continu� de collaborer � l'�chelle r�gionale � la prestation de services de VTC dans la r�gion de l'Atlantique/Nunavut, au Manitoba et au Qu�bec. Cette collaboration comportait entre autres le lancement d'un service pilote de VTC � un nombre restreint de CTI au Qu�bec, l'�largissement des services de VTC dans la r�gion de l'Atlantique/Nunavut afin d'y inclure Terre-Neuve, le Labrador et le Nunavut, ainsi que l'embauche d'un analyste commercial technique de l'ICIST-CNRC qui travaillera pour le Centre � la commercialisation de la technologie biom�dicale du CNRC. Consolidation des relations entre le PARI-CNRC et les instituts Relations avec les autres minist�res f�d�raux Relations internationales |
|
Il est recommand� que le PARI-CNRC fixe ses priorit�s � l'�chelle nationale et les g�re efficacement en d�finissant de mani�re exacte et pr�cise quelles sont ses activit�s de base et en s'assurant que des ressources suffisantes sont affect�es � la mise en œuvre et � la gestion de ses activit�s; en �tablissant s'il est possible pour lui de lancer d'autres initiatives compte tenu des ressources dont il dispose et, le cas �ch�ant, en s�lectionnant ces initiatives conform�ment au nouveau plan strat�gique du PARI-CNRC et aux priorit�s du gouvernement f�d�ral et en s'appuyant sur une �valuation des risques; et en �tablissant un plan exhaustif de surveillance de ses activit�s de base et des autres initiatives mises en œuvre. |
Le PARI-CNRC souscrit au besoin d'identifier les priorit�s d'une fa�on claire et continuera � s'attaquer � cette t�che selon les ressources disponibles. Afin de s'assurer que ses ressources sont utilis�es de mani�re � g�n�rer le maximum d'avantages pour les PME, le PARI-CNRC proc�de actuellement � la confirmation de ses activit�s de base et � l'�valuation des ressources connexes ainsi que des r�sultats obtenus dans les cadres de mise en œuvre de son plan strat�gique. |
En septembre 2005, le PARI-CNRC a rajust� son orientation strat�gique en r�action aux besoins permanents de ses clients et de leurs march�s. En septembre 2006, l'�quipe des principaux leaders (�PL) du PARI-CNRC s'est r�unie pour discuter des priorit�s strat�giques du PARI-CNRC pour les exercices 2006-2007 et 2007-2008. L'�PL a formul� un plan d'activit�s continu de trois ans comportant sept priorit�s. En plus des engagements continus du PARI-CNRC en mati�re de prestation et d'�laboration de programmes (ex�cution du plan d'activit�s national et coordination des activit�s internationales), le programme portait avant tout sur ces sept priorit�s et continuera d'y travailler.
En 2006-2007, un document de travail a �t� r�dig� pour chacune de ces priorit�s du plan d'activit�s afin de d�finir la port�e du projet, les difficult�s et les possibilit�s qu'il pr�sente, les ressources humaines et financi�res requises et les prochaines �tapes � r�aliser. Ces documents de travail aideront les directeurs ex�cutifs responsables � r�diger les plans de travail correspondants et se trouveront � la base du plan d'activit�s int�gr� du PARI-CNRC pour 2008-2009. Le PARI-CNRC a termin� le premier plan d'activit�s du plan � horizon mobile de trois ans visant � s'attaquer � ces priorit�s. Au cours de 2006-2007, le PARI-CNRC a subi cinq v�rifications ou �valuations diff�rentes, � savoir la v�rification des activit�s des b�n�ficiaires, la v�rification interne du PARI-CNRC par le CNRC, l'�tude sur les programmes de subventions et de contributions et la v�rification sur la recherche et l'innovation du Bureau du v�rificateur g�n�ral, de m�me que l'�valuation du PARI-CNRC par le CNRC. Ces �tudes ont occasionn� un stress �norme au personnel de prestation du Programme, qui a d� r�pondre aux nombreuses demandes de documents et d'information des �valuateurs. Il est fort inhabituel de subir autant d'�tudes externes, chacune pr�sentant ses propres �ch�ances et exigences en information. Le PARI-CNRC a consacr� une somme consid�rable de temps et d'efforts pour faciliter la v�rification interne pr�liminaire du Programme (2006) par le CNRC et l'enqu�te compl�mentaire subs�quente, et a travaill� en �troite collaboration avec le groupe de v�rification interne du CNRC. Le PARI-CNRC attend les rapports pr�liminaires. En 2006, le CNRC a commenc� son �valuation du PARI-CNRC en pr�vision du renouvellement des conditions du Programme qui aura lieu en 2008. Le personnel r�gional et national du PARI-CNRC a consacr� beaucoup de temps et d'efforts pour fournir les donn�es demand�es et participer aux entrevues et aux groupes de discussion dans le cadre de cette initiative. En outre, le PARI-CNRC a collabor� avec le groupe de v�rification interne du CNRC et le BVG dans le cadre de la v�rification sur la recherche et l'innovation du BVG et de l'�tude f�d�rale sur les programmes de subventions et de contributions. Le personnel du Programme a aussi travaill� �troitement avec celui des Services corporatifs du CNRC afin de d�limiter et de mettre en œuvre l'�valuation du PARI-CNRC, qui se poursuit en 2007-2008. |
|
Le PARI-CNRC devrait envisager d'optimiser la composition de son portefeuille de clients en proc�dant r�guli�rement � l'�valuation des besoins des PME technologiques canadiennes et des d�bouch�s qui s'offrent � elles; des profils des clients du PARI-CNRC, des budgets et priorit�s du PARI-CNRC et des priorit�s du gouvernement f�d�ral. Le PARI-CNRC devrait s'efforcer de se constituer un portefeuille exer�ant une force d'attraction sur de nouveaux clients et s'assurer que toutes les r�gions et tous les CTI disposent de la capacit� et des pouvoirs n�cessaires pour s�lectionner une combinaison optimale de clients (qui disposent notamment de ressources financi�res suffisantes, et de certains outils comme des services de veille technologique et d'�laboration de cartes routi�res technologiques, la planification et l'examen du rendement (PER), etc.). |
Le PARI-CNRC souscrit � cette recommandation. Conform�ment � son plan strat�gique, le PARI-CNRC est progressivement en voie d'adopter une m�thode de gestion du portefeuille de clients. M�me si cette m�thode permettra au PARI-CNRC de faire preuve d'une plus grande proactivit� dans ses efforts pour comprendre les besoins d'aide � l'innovation des PME et y r�pondre, et particuli�rement les besoins de certains groupes de clients, il reste que l'action du PARI-CNRC est n�cessairement orient�e en fonction de la demande et que sa m�thode de gestion du portefeuille doit tenir compte de la r�alit� des PME. Le PARI-CNRC envisage aussi de se doter des outils n�cessaires pour aider les r�gions et ses employ�s � assurer une gestion plus efficace du programme et � le faire dans le cadre d'une m�thode de gestion du portefeuille. |
Les difficult�s administratives et les politiques financi�res complexes du Programme ont pris une importance particuli�re pour le personnel sur place et le personnel de soutien. En 2006-2007, un directeur g�n�ral et des directeurs ex�cutifs ont �t� engag�s dans trois r�gions et au Bureau national, ce qui assurera la stabilit� et une gestion plus uniforme du Programme. Le PARI-CNRC a r�ussi � r�cup�rer certains des ajustements budg�taires requis suite � la perte des relations r�gionales. En avril 2007, PARI-CNRC a r�cup�r� sa contribution initiale de 15 millions de dollars � Partenariat technologique Canada (PTC) apr�s des n�gociations assidues men�es avec Industrie Canada dans les mois pr�c�dents. Ces fonds ont �t� r�int�gr�s dans le budget g�n�ral de PARI-CNRC et ont permis � ses clients d'acc�der � davantage de financement de projets. En juillet 2006, le PARI-CNRC a lanc� une initiative de comparaison des clients du PARI-CNRC dans la r�gion du Pacifique. L'objectif de ce projet pilote consistait � formuler une m�thode comparative en utilisant les bases de donn�es existantes de Statique Canada afin de comparer le profil de croissance des PME qui b�n�ficient de l'aide financi�re du PARI-CNRC du Pacifique avec la population g�n�rale des soci�t�s dont le profil est semblable afin de mieux comprendre les caract�ristiques des clients du PARI-CNRC. Au total, 694 comparaisons ont �t� effectu�es � l'aide des bases de donn�es utilis�es. Ce nombre a �t� consid�r� suffisant pour constituer une � population � plut�t qu'un � �chantillon �. L'�tude indique que les PME clientes du PARI-CNRC dans la r�gion du Pacifique pr�sentent un taux de croissance (emploi, salaire et revenu) plus �lev� que les PME qui n'ont pas re�u l'aide du PARI-CNRC. En plus du taux plus �lev� dans les domaines de l'emploi, du salaire et du revenu, cette �tude a aussi montr� que les clients du PARI-CNRC pr�sentent un taux de rendement plus �lev� du capital-actions, des d�penses accrues en R-D et un effectif plus �lev� de travailleurs en R-D. Toutefois, le taux de rendement relatif aux exportations �tait l�g�rement plus faible pour les clients du PARI-CNRC que celui des PME en g�n�ral. L'�quipe des principaux leaders a jug� que cette analyse s'av�rait tr�s utile pour mieux comprendre le Programme et a accept� qu'une comparaison semblable soit entreprise � l'�chelle nationale en 2007-2008. En 2006-2007, le PARI-CNRC a plus que doubl� son portefeuille de nouveaux clients par rapport � l'exercice pr�c�dent. Le Programme a fourni de l'aide financi�re � 732 nouveaux clients en 2006-2007, comparativement � 340 en 2005-2006. En 2006, le Comit� de la haute direction a accueilli favorablement la proposition du PARI-CNRC d'obtenir 8,3 millions de dollars en trois ans dans la deuxi�me ronde de financement des grappes du CNRC. Suite � cet effort, le PARI-CNRC a d�termin� que le soutien et les efforts des grappes technologiques consacr�s � des groupes de soci�t�s constituent une part croissante des activit�s du Programme. Une strat�gie a �t� �labor�e, des syst�mes ont �t� modifi�s en cons�quence et la direction surveillera les activit�s de soutien des grappes au cours des trois prochaines ann�es afin de d�finir la taille optimale de cette composante des contributions du Programme. |
|
Le PARI-CNRC devrait songer � accro�tre sa compr�hension des m�thodes de gestion de ses clients et de leurs besoins en la mati�re et s'y sensibiliser en ayant davantage recours au RCT comme ressource compl�mentaire. Dans le cadre de cet effort, il faudrait notamment accro�tre l'acc�s qu'ont les CTI aux comp�tences commerciales du RCT et aux outils qu'il offre pour �valuer les perspectives socio�conomiques des projets ainsi que leur vitalit� financi�re et commerciale, et offrir aux clients du PARI-CNRC un acc�s aux comp�tences et aux services en gestion du RCT. |
Le PARI-CNRC est tr�s sensible � l'importance pour les PME d'acqu�rir des capacit�s dans le domaine de la commercialisation et de la gestion si elles d�sirent innover avec succ�s. Cet aspect de l'action du PARI-CNRC a �t� int�gr� � son cadre de rendement gr�ce � des indicateurs qui contribueront � l'�valuation des r�sultats obtenus. Conform�ment � son plan strat�gique, le PARI-CNRC �value actuellement comment il pourrait fournir aux PME une aide et des conseils de meilleure qualit� en mati�re de gestion et de commercialisation et notamment, comment le RCT pourrait devenir une ressource en ce domaine. Le PARI-CNRC a commenc� � offrir de la formation et du perfectionnement � ses employ�s dans les domaines li�s aux affaires, � la gestion financi�re et � la commercialisation et pr�voit continuer de le faire d'une mani�re plus syst�matique au cours des ann�es � venir. |
Le PARI-CNRC ne g�re plus le RCT. Par l'entremise de ses r�seaux et de ses contributions aux efforts des organisations, le PARI-CNRC continue de veiller � ce que les PME aient acc�s aux informations et aux services de soutien dont elles ont besoin. |
|
Il est recommand� que le PARI-CNRC consigne et tienne � jour de mani�re constante les coordonn�es des personnes-ressources chez ses clients; de l'information sur le genre de conseils fournis aux clients et sur les clients qui re�oivent des conseils, et qu'il dispose d'un profil de chaque client (par exemple, secteur d'activit�, taille de l'entreprise, etc.). Le PARI-CNRC devrait �galement mettre en place les outils n�cessaires pour que les CTI aient le temps et la motivation n�cessaires pour entrer l'information dans le syst�me de gestion des clients (SONAR) et sensibiliser de mani�re continue les CTI � l'importance du syst�me de mesure du rendement du PARI-CNRC. |
Le PARI-CNRC souscrit � cette recommandation et a d�velopp� un syst�me pour la gestion de relation aupr�s de ses clients. Il doit constamment respecter l'�quilibre entre la n�cessit� de consigner suffisamment d'information pour pouvoir s'acquitter de son obligation de rendre compte et la n�cessit� de fournir en temps opportun des conseils et des services aux PME. Ce probl�me est lui aussi li� aux ressources disponibles, comme cela est justement soulign� dans la recommandation. L'acc�s aux donn�es sur les clients est essentiel et le PARI-CNRC continuera de travailler avec ses employ�s et ses bureaux r�gionaux � am�liorer l'acc�s � une information de qualit� d'une mani�re efficace sur le plan des co�ts. |
Tout au long de l'ann�e, de nombreuses am�liorations consid�rables ont �t� apport�es � SONAR afin d'accro�tre la valeur des informations sur les clients du Programme. Ces changements traduisent les mesures prises en r�ponse � l'�tude et aux recommandations sur la diligence financi�re raisonnable de 2004. Le PARI-CNRC s'est lanc� dans un projet sur les exigences de l'utilisateur de SONAR afin d'examiner les besoins en donn�es du Programme. Le PARI-CNRC tente actuellement d'engager une personne pour une p�riode de trois ans afin de superviser ce projet � partir de la phase d'�laboration jusqu'� celle de mise en œuvre et d'�valuer l'incidence du r�cent achat par le CNRC de mySAP, un module de gestion de l'information sur les relations clients. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
Dans le cadre de l'exercice de planification strat�gique actuellement en cours, l'ITPCE-CNRC devrait s'efforcer d'�laborer une vision plus claire de son programme de recherche, une vision qui serait � la fois mieux cibl�e et plus facile � g�rer que l'actuelle. |
Dans le cadre de l'exercice de planification strat�gique, l'Institut se dotera d'une vision plus claire ainsi que d'objectifs et de strat�gies conformes au cadre de rendement. |
L'Institut en est rendu � perfectionner ses programmes afin de s'assurer qu'ils sont toujours harmonis�s avec les priorit�s du CNRC par un examen annuel et des processus de s�lection des projets. Le nombre de projets approuv�s pour 2007-2008 a �t� r�duit � 12. |
|
L'ITPCE-CNRC devrait s'efforcer d'accro�tre par diff�rents moyens l'int�gration de ses activit�s de recherche. |
L'int�gration sera en partie r�alis�e � mesure que de nouvelles activit�s de recherche seront d�velopp�es autour de th�mes s�lectionn�s d�finis dans le plan strat�gique. |
Le perfectionnement de l'approche matricielle se poursuit au moyen de s�ances de groupes de discussions et de la clarification des r�les et responsabilit�s, en particulier dans la gestion de la sant� et de la s�curit�. |
|
L'ITPCE-CNRC devrait chercher des moyens d'accro�tre ses interactions avec l'industrie et de resserrer ses liens avec elle. |
La sensibilisation de l'industrie aux travaux de l'ITPCE-CNRC sera accrue par plusieurs moyens. |
L'ITPCE-CNRC a nomm� des chefs dans trois domaines de base et participe de plus en plus � des consortiums de recherche et des activit�s de d�veloppement des grappes. Un certain nombre d'ententes de recherche collaborative ont �t� sign�es avec des entreprises dans les domaines cibl�s par l'Institut : piles � hydrog�ne et � combustible, �nergie durable et environnement. |
|
L'ITPCE-CNRC devrait intensifier ses interactions et sa collaboration avec les universit�s. |
L'ITPCE-CNRC continuera � multiplier les liens avec les universit�s, comme il l'a d'ailleurs indiqu� dans ses perspectives de planification de l'an dernier. |
Le premier colloque annuel sur les piles � combustible a �t� organis� avec le Fuel Cell Research Centre � Kingston (Universit� Queen's et Le Coll�ge militaire royal du Canada). L'Institut a organis� un atelier sur le stockage de l'hydrog�ne afin de cr�er un r�seau de chercheurs canadiens travaillant dans ce domaine. |
|
L'ITPCE-CNRC devrait accorder davantage d'importance au maintien, dans son portefeuille de programmes de recherche, d'un �quilibre appropri� entre la recherche strat�gique � long terme et la recherche concert�e � court terme, et la recherche appliqu�e. |
Dans son exercice de planification, qui se concentrera sur des th�mes pr�cis d'o� �mergeront des applications, l'ITPCE-CNRC a l'intention de cr�er un m�canisme efficace de gestion de son portefeuille de programmes de recherche. |
Un �quilibre a �t� atteint gr�ce aux ajustements constants r�alis�s par des examens annuels et un processus de s�lection des projets. |
|
L'ITPCE-CNRC devrait s'efforcer de trouver des moyens d'accro�tre sa visibilit� et de rehausser son profil, tant � l'int�rieur qu'� l'ext�rieur du CNRC. |
Comme nous le d�crivons dans notre r�ponse � la recommandation 1, le recentrage des activit�s de l'Institut facilitera le d�ploiement d'efforts en vue de rehausser son profil et d'accro�tre la reconnaissance dont il jouit. |
Il s'agit d'un processus continu, o� le personnel de l'Institut participe aux comit�s du CNRC, aux comit�s de S-T du gouvernement f�d�ral et aux conseils consultatifs d'organismes charg�s de promouvoir l'innovation et la R-D dans des secteurs donn�s. |
|
Dans ses activit�s de transfert et de commercialisation de technologies, l'ITPCE-CNRC devrait tendre vers un meilleur �quilibre entre les activit�s traditionnelles d'attribution de licences d'exploitation et la cr�ation d'entreprises d�riv�es. |
La cr�ation de nouvelles entreprises sera prise en compte comme initiative possible dans le cadre de rendement qui sera �labor� suite au prochain plan strat�gique de l'Institut. |
Des comptes rendus des r�unions sur l'invention sont effectu�s � l'interne et font l'objet d'un suivi afin de mesurer les progr�s r�alis�s. La possibilit� de commercialisation constitue l'un des crit�res pour l'�valuation annuelle des projets de recherche. |
|
Le Bureau des technologies viables (BTV) devrait � l'avenir se concentrer sur le d�veloppement de ses capacit�s dans le domaine des analyses de viabilit�. En outre, un examen des fonctions du BTV devrait �tre entrepris. |
Selon les pr�visions, les technologies et les syst�mes viables seront au cœur des activit�s futures de l'Institut. Le d�veloppement d'outils permettant d'�valuer le caract�re viable des technologies sera donc int�gr� au processus de planification strat�gique de l'ITPCE-CNRC. L'�largissement du r�le du BTV, notamment dans le domaine de la facilitation, du soutien et de la promotion des technologies viables � l'ext�rieur de l'ITPCE-CNRC exigera l'obtention d'un mandat clair du CNRC et de nouvelles ressources. |
Suite au d�mant�lement du Bureau des technologies viables, il n'y a plus rien � communiquer � ce chapitre. |
|
Recommandation – Le Comit� d'examen par les pairs : |
Progr�s accomplis en 2005-2006 |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
Souligne le r�le important des nominations conjointes de scientifiques par TRIUMF et par les universit�s et encourage la direction � faire participer davantage les universit�s canadiennes � l'�laboration de ses strat�gies et � ses activit�s. |
TRIUMF maintient son fort engagement aupr�s des universit�s canadiennes. Au cours de l'exercice financier 2005-2006, TRIUMF a proc�d� � une nomination conjointe avec l'Universit� de Guelph et a admis l'Universit� St Mary's en tant que membre associ� de la coentreprise. |
Au cours de l'exercice qui s'est termin� le 31 mars 2007, TRIUMF a re�u la demande d'admission de l'Universit� de Montr�al au consortium de TRIUMF ainsi que des lettres de demande de renseignements de l'Universit� du Manitoba concernant la possibilit� de se joindre au consortium. |
|
Appuie des priorit�s strat�giques claires mises de l'avant dans le plan en vue :
|
Le succ�s d�montr� des installations ISAC de TRIUMF et de son programme exp�rimental fait indubitablement de TRIUMF un chef de file mondial dans la physique des faisceaux d'ions radioactifs. Avec l'inauguration r�cente de l'acc�l�rateur lin�aire supraconducteur ISAC-II, TRIUMF est devenu une installation unique au monde dans cette discipline scientifique et le restera dans un avenir pr�visible. Actuellement, le nombre de demandes de temps d'utilisation des faisceaux qui sont valid�es par un examen international par les pairs est sup�rieur � ce que l'installation ISAC de TRIUMF peut accommoder. En 2005, TRIUMF a re�u un minimum de 19 demandes (TRIUMF ne peut accepter que de 8 � 10 exp�riences par ann�e). TRIUMF cherche activement des fonds pour mettre en place son centre de donn�es ATLAS Tier-1, la prochaine �tape du processus de mise en place d'une infrastructure pour les scientifiques canadiens qui d�sirent participer au projet ATLAS au CERN. Comme le plan quinquennal actuel de TRIUMF ne pr�voit pas ce financement, TRIUMF cherche � l'ext�rieur du CNRC une contribution pour financer la construction de cette installation de transfert de donn�es et d'informatique unique. Au nom de TRIUMF, l'Universit� Simon Fraser a pr�sent� une demande au Fonds des occasions exceptionnelles de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) afin d'obtenir une partie du financement n�cessaire � la construction de ce centre de traitement des donn�es. En mars 2006, la FCI a rendu une d�cision finale et d�cid� d'octroyer 8,178 millions de dollars � ce projet. TRIUMF a fait une demande au gouvernement de la Colombie-Britannique pour obtenir le reste des fonds n�cessaires. |
TRIUMF demeure la seule installation consacr�e � ce domaine scientifique, et le nombre de demandes de temps d'utilisation des faisceaux qui sont valid�es par un examen international par les pairs demeure sup�rieur � ce que l'installation ISAC de TRIUMF peut accommoder. Les scientifiques du Canada et de la communaut� internationale qui souhaitent utiliser les installations ISAC de TRIUMF trouvent que le temps d'attente requis pour l'utilisation des faisceaux exp�rimentaux est p�niblement long. TRIUMF ne poss�de qu'un seul faisceau aux installations ISAC, qui doivent desservir la communaut� scientifique tout en assurant le d�veloppement de nouveaux faisceaux ioniques rares et sp�ciaux, essentiels au maintien de la position de chef de file mondial du laboratoire dans ce domaine scientifique. La demande de financement quinquennal tient toujours compte de ce besoin parce que les fonds allou�s ne permettent pas la construction du deuxi�me faisceau propos� ni du centre de d�veloppement sp�cialis�. Un groupe de travail poursuit activement le d�veloppement de faisceaux sp�ciaux � partir de cibles d'actinides. TRIUMF d�veloppe aussi �nergiquement de nouveaux faisceaux avec un laser r�sonnant � source ionique et une source d'ions nomm�e FEBIAD. Des tests sur une source d'ions pour la r�sonance cyclotronique ont �t� entam�s. L'installation pr�liminaire d'un booster de charge pour acc�l�rer les masses sp�ciales a commenc�. La demande de financement du plan quinquennal de TRIUMF pour son centre de donn�es ATLAS Tier-1 a �t� refus�e. Toutefois, la communaut� universitaire canadienne, dirig�e par l'Universit� Simon Fraser et le directeur de TRIUMF, a r�ussi � obtenir du financement pour le centre aupr�s de la FCI ainsi que des fonds de contrepartie aupr�s de la province de la Colombie-Britannique. La communaut� des physiciens canadiens peut maintenant tirer le plein avantage de la contribution du Canada au grand collisionneur de hadrons du CERN. |
|
Soutient les moyens que la direction entend prendre pour solliciter des avis r�guliers sur les d�veloppements scientifiques et techniques du laboratoire aupr�s du Conseil consultatif de TRIUMF, du conseil de gestion et d'un nouvel organisme d�riv� du groupe de travail qui a pr�par� le plan quinquennal. |
En 2005-2006, la direction de TRIUMF a rencontr� deux fois le Comit� consultatif de TRIUMF (CCT), deux fois le Comit� interorganisations de TRIUMF (CIT) et cinq fois les comit�s d'�valuation des exp�riences. La communaut� internationale est fortement repr�sent�e au sein de ces trois comit�s. Au nombre de trois par ann�e, les rencontres entre les groupes d'utilisateurs et le Conseil d'administration de TRIUMF garantissent que le directeur de TRIUMF re�oit les meilleurs conseils et les meilleures donn�es scientifiques possibles pour assurer le d�veloppement du laboratoire. Trois comit�s ont �t� cr��s pour faciliter la planification et la coordination des activit�s de l'installation ISAC : le forum scientifique de ISAC, le groupe d'utilisation strat�gique des faisceaux de ISAC et le groupe d'examen des activit�s de ISAC. |
La direction de TRIUMF continue de rencontrer deux fois par ann�e le Comit� consultatif de TRIUMF (CCT), deux fois par ann�e le Comit� interorganisations de TRIUMF (CIT), ainsi que les comit�s d'�valuation des exp�riences (CEE). Le CEE des mat�riaux et de la science mol�culaire et le CEE de la science subatomique se r�unissent deux fois par ann�e et le CEE des sciences
de la vie se r�unit une fois par ann�e. Ces trois comit�s se composent en grande partie de membres internationaux de m�me que de repr�sentants canadiens. |
|
Note que la liaison et les communications avec les utilisateurs pourraient �tre am�lior�es et recommande que le laboratoire examine ad�quatement cet aspect. |
Un bulletin publi� deux fois par an est distribu� partout dans le monde � tous les utilisateurs potentiels depuis octobre 2002. Le forum scientifique de ISAC compos� d'exp�rimentateurs, de porte-parole des exp�riences approuv�es et de certains employ�s charg�s du fonctionnement de ISAC se r�unit toutes les deux semaines afin d'examiner les progr�s accomplis et de maintenir la collectivit� des utilisateurs au courant des d�veloppements survenus au laboratoire. Les proc�s-verbaux de ces r�unions sont affich�s sur un site Web public et distribu�s � 86 porte-parole responsables d'exp�riences. Le forum des installations exp�rimentales ISAC, auquel participent les coordonnateurs des installations, certains exp�rimentateurs locaux et des employ�s techniques, se r�unit toutes les deux semaines pour discuter des plans avec les utilisateurs. Un programme de s�minaires scientifiques sur ISAC a �t� lanc� en juin 2003. Depuis 2003-2004, TRIUMF compte aussi sur les services d'un groupe du d�veloppement strat�gique des faisceaux ISAC qui comprend des repr�sentants des groupes d'utilisateurs. |
TRIUMF continue de distribuer un bulletin semestriel dans le monde entier � tous les utilisateurs �ventuels. Le forum scientifique de ISAC, de m�me que le forum des installations exp�rimentales ISAC, continue de se r�unir toutes les deux semaines afin que l'ensemble du personnel et des utilisateurs concern�s par le programme demeurent pleinement inform�s. On peut consulter les comptes rendus des rencontres sur le site Web de TRIUMF. Le groupe du d�veloppement strat�gique des faisceaux ISAC continue de se r�unir chaque semaine. Le programme de s�minaires scientifiques sur ISAC organise jusqu'� 12 s�minaires par mois. TRIUMF a cr�� et mis en œuvre une base de donn�es des exp�rimentateurs qui permet � ceux-ci de g�rer leurs documents d'exp�rimentation. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
L'Institut devrait s'employer � att�nuer les clivages � l'interne en se donnant un processus d'�tablissement des projets de recherche multidisciplinaires ou interdisciplinaires et en constituant des �quipes de chercheurs plus solides et anim�es par une vision commune, � savoir mener des travaux de longue haleine en vue de r�soudre des probl�mes scientifiques importants. |
Nous sommes d'accord. L'Institut s'engage � �laborer des processus qui lui permettront de mieux identifier les projets multidisciplinaires et interdisciplinaires rassemblant de plus fortes �quipes de chercheurs et davantage de ressources afin de produire d'importants r�sultats � long terme, pour la science et la technologie. Ceci se trouve d'ailleurs au cœur de notre processus de planification qui sera termin� en juin 2005. |
L'Institut a pouss� plus avant son travail dans les secteurs th�matiques (diagnostic mol�culaire; mat�riaux utiles � l'assainissement de l'environnement et autres sources d'�nergie; plateformes de technologies quantiques) dans son plan d'activit�s formul� en 2006-2007 en fonction de la strat�gie du CNRC. Les possibilit�s de collaboration entre instituts ont �t� rep�r�es dans ces domaines afin de favoriser davantage la participation aux projets pluri-institutionnels d'envergure. |
|
L'Institut devrait se donner des structures et des m�thodes appropri�es de sorte que les projets de recherche multidisciplinaires ou interdisciplinaires puissent �tre men�s � bien. |
Nous sommes d'accord. L'ISSM-CNRC reconna�t que la mise en place de projets interdisciplinaires et inter-instituts exigera de nouvelles structures organisationnelles. On a d�j� proc�d� � une restructuration de l'�quipe de gestion de l'Institut. On est � explorer divers mod�les qui permettraient le maintien de comp�tences de classe mondiale tout en appuyant une culture d'entreprise de projets de recherche interdisciplinaires de grande envergure. Les nouveaux processus devront contenir des crit�res de base clairs pour la gestion des projets. |
On a continu� � utiliser l'approche fond�e sur les projets pour l'allocation des ressources con�ue en 2005-2006. Le portefeuille a continu� de s'accro�tre. On a mis fin aux projets de faible priorit� et les ressources ont �t� r�allou�es � des projets de plus grande priorit�. |
|
L'ISSM-CNRC devrait mieux coordonner ses activit�s de transfert de technologies afin de pouvoir expliquer plus clairement les retomb�es de ses inventions et de ses innovations sur des technologies commerciales existantes ou futures. |
Nous sommes d'accord. L'ISSM-CNRC reconna�t le besoin d'un changement de culture qui ferait que les chercheurs reconna�traient et formuleraient l'importance scientifique de leur travail et son impact possible ou r�el. L'ISSM-CNRC se penchera sur des probl�mes d'importance pour le Canada et �tablira l'�quilibre n�cessaire entre la science fondamentale qu'il faut acqu�rir et la science appliqu�e dont on peut mesurer l'impact plus facilement. Il lui faut b�tir un milieu plus ouvert � la communication, un environnement qui favorisera la discussion et le transfert des r�sultats de la recherche. De plus, le Bureau d'affaires de l'ISSM-CNRC �laborera un plan d'affaires en 2004-2005 et ce plan couvrira les meilleures pratiques de gestion de propri�t� intellectuelle, l'utilisation strat�gique de l'Installation de Sussex de partenariat avec l'Industrie et la fa�on de travailler plus efficacement avec le Programme d'aide � la recherche industrielle du CNRC (PARI). |
On a termin� l'�valuation du portefeuille de la propri�t� intellectuelle. On a d�cid� de laisser tomber les brevets qui avaient peu de chance d'obtenir une licence. Un nouveau processus d'�valuation des divulgations permettant de prendre des d�cisions initiales plus �clair�es a �t� mis en œuvre. |
|
L'Institut devrait examiner la possibilit� de se doter d'un processus plus strat�gique d'affectation de ses fonds tout en pr�voyant une r�serve � hauteur convenue et appropri�e de fonds internes pour des projets concurrentiels au sein de l'ISSM-CNRC et en mettant, � cet �gard, l'accent sur l'obtention de fonds de contrepartie de sources externes. |
Nous sommes d'accord. L'ISSM-CNRC est pr�t � relever le d�fi de trouver des sources additionnelles de financement externe et d'introduire un �l�ment de comp�tition pour l'allocation de ressources internes, tout en s'assurant que les fonds seront allou�s de fa�on strat�gique. Le personnel de l'Institut s'activera � trouver et faire conna�tre les occasions de financement externe et fournira l'appui n�cessaire aux chercheurs, au moment de faire les demandes de mani�re � ce que ceux-ci ne soient pas inutilement accabl�s par la logistique associ�e aux demandes de subventions. La direction doit concilier la n�cessit� de maintenir � la fine pointe les comp�tences de base de l'institut, de profiter des occasions en mati�re de technologie en partenariat avec les entreprises �mergentes ou de mettre en place des programmes ax�s sur la d�couverte dont l'�ch�ance des retomb�es est impr�cise. Pour y parvenir, l'ISSM-CNRC a l'intention d'introduire, pour l'exercice de 2005-2006, un �l�ment de gestion de ressources et de rendement, par projet. |
Le processus de r�allocation de 15 % des fonds d'exploitation a �t� mis en œuvre. On a introduit une �valuation officielle du risque pr�sent� par les projets. On a pris des d�cisions relatives aux projets en fonction de l'�quilibre entre le risque et l'incidence. Des ressources ont �t� allou�es en fonction de ces priorit�s. |
|
L'Institut devrait se doter de proc�dures internes de contr�le des projets scientifiques en faisant appel � des �l�ments efficaces de la concurrence interne et externe. |
Nous sommes d'accord. Alors que l'Institut adoptera la m�thode de gestion par projet, on pr�sentera un ensemble de mesures de suivi de projet, d'�valuation et de communication de rapports. Les projets devront contenir une description claire et une justification solide. On en �valuera les progr�s afin de justifier l'avancement des fonds et les projets seront g�r�s en fonction de produits � fournir dans des d�lais fixes. Le processus de gestion des projets deviendra le cadre qui permettra l'application des autres recommandations du comit� d'examen par les pairs, nomm�ment : 1) l'�tablissement de projets multidisciplinaires et d'�quipes interorganisationnelles; 2) la communication au personnel des objectifs poursuivis, des progr�s accomplis et des r�sultats obtenus dans le cadre des projets, afin de jeter les bases du transfert des connaissances et d'autres retomb�es; 3) la mise en place d'une culture privil�giant le travail d'�quipe en ce qui a trait � l'obtention de fonds de sources diverses (affectations internes au niveau de l'institut ou partenaires externes). La direction de l'ISSM-CNRC reconna�t que la recherche interdisciplinaire de pointe ne peut �tre faite que par des �quipes dont les membres sont en mesure de demeurer � la fine pointe de leur sp�cialit�. Il faudra conserver un �quilibre entre les projets au sein d'une sp�cialit� et les projets interdisciplinaires. On �valuera l'excellence au moyen d'examens p�riodiques par des pairs, de groupes et de projets. La direction de l'ISSM-CNRC œuvrera � convaincre les chercheurs que la bonne gestion de projets n'est pas incompatible avec l'excellence en recherche fondamentale. |
Les projets ont �t� �valu�s, en partie, en fonction de la capacit� de tirer parti des ressources et du financement concurrentiel externe (�valuation par les pairs). Une plus grande partie de l'allocation budg�taire de l'Institut a �t� utilis�e pour �galer les contributions des partenaires et d'autres sources de financement. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
Le CNRC devrait demander le renouvellement du financement des projets de cr�ation de grappes technologiques au Canada atlantique. Les projets en cours en sciences de la vie, en affaires �lectroniques/technologie de l'information et en technologies oc�aniques devraient se poursuivre jusqu'� ce qu'ils soient en mesure de r�pondre efficacement aux besoins changeants des collectivit�s h�tes. En s'appuyant sur la r��valuation en cours, l'Institut de technologie de l'information devrait par ailleurs continuer d'apporter des ajustements au positionnement et � la formule de l'initiative des syst�mes sans fil (technologie cibl�e, ressources, etc.) afin de trouver de quelle mani�re le CNRC pourrait participer le plus efficacement possible au d�veloppement des capacit�s de cette r�gion. Des repr�sentants du gouvernement, d'associations, d'universit�s et d'autres organismes participent activement aux travaux des grappes naissantes et appuient le concept qui a men� � leur cr�ation. Selon la perception g�n�rale actuelle, les activit�s des grappes technologiques seraient surtout le fait d'associations industrielles et d'organismes publics. Le degr� de participation des entreprises aux activit�s des grappes varie. Il semble que les entreprises ne s'engagent que timidement dans le processus, une lacune qui devra �tre combl�e � mesure que les grappes progresseront. |
La demande de renouvellement du financement des projets pour les initiatives Sciences de la vie, Affaires �lectroniques et technologies de l'information, et Technologies oc�aniques est en cours de r�daction. Dans le cadre de l'initiative du Cap-Breton, l'Institut de technologie de l'information du CNRC r��valuera l'initiative des syst�mes sans fil et continuera d'en ajuster tant le positionnement que la formule, en cons�quence. |
Termin�. Renouvellement du financement pour les projets des initiatives Sciences de la vie, Affaires �lectroniques et technologies de l'information et Technologies oc�aniques en 2005-2006. L'initiative des syst�mes sans fil du Cap-Breton dans sa formule actuelle n'a pas re�u de financement au-del� de 2004-2005. |
|
Apr�s le renouvellement des Initiatives de l'Atlantique du CNRC, il faudra s'efforcer plus particuli�rement d'accro�tre la participation de l'entreprise priv�e aux activit�s des grappes. L'engagement de l'industrie, confirm� par une participation dynamique aux activit�s des grappes, devrait �tre le principal facteur qui guidera leur d�veloppement futur (en fixant notamment leurs objectifs, en �laborant les plans et en les appuyant concr�tement). |
La participation de l'industrie aux activit�s des grappes est cruciale au progr�s de ces derni�res, et il s'agit d'une progression naturelle de tenter d'obtenir une participation accrue de la part de l'industrie. Cette participation sera mobilis�e au moyen de plusieurs m�canismes comme des ateliers, des d�monstrations technologiques, des conf�rences sur les technologies �mergentes, la cr�ation de groupe d'int�r�ts dans des domaines pr�cis, ainsi que des initiatives de formation sur les technologies plateformes. |
Sciences de la vie. Pour combler les postes de recherche des Initiatives de l'Atlantique dans le cadre de l'initiative Sciences de la vie, la DGI du CNRC a entrepris des consultations jusqu'alors in�gal�es avec ses partenaires de l'industrie. Cinq descriptions de travail ont �t� r�dig�es en fonction des commentaires des partenaires. Ces descriptions leur ont �t� envoy�es afin de d�terminer quels sont les trois plus importants postes � combler actuellement. De plus, la DGI, en collaboration avec l'association industrielle et un partenaire provincial, Nova Scotia Business Inc., a permis � plusieurs entreprises locales de participer � BIO, la premi�re conf�rence de biotechnologie du monde. Pendant trois jours, des partenaires du secteur et des organismes gouvernementaux se sont partag� le pavillon de l'Atlantique et ont d�peint la r�gion comme le meilleur endroit pour faire de la biotechnologie. L'exercice de cartographie est pass� � un degr� sup�rieur, l'industrie locale et les dirigeants communautaires s'�tant appropri� le processus. Une carte des atouts a d�j� �t� �tablie gr�ce � l'aide et � la contribution de l'industrie. L'association industrielle apporte un soutien suppl�mentaire au succ�s de BioPort Atlantic, un �v�nement annuel regroupant les membres de l'initiative Sciences de la vie et les communaut�s commerciales de la r�gion. Affaires �lectroniques et technologies de l'information. L'ITI-CNRC participe � un certain nombre d'activit�s ayant pour objectif le transfert des connaissances, l'accroissement de l'aide et de la collaboration en mati�re de R-D et l'aide � l'harmonisation des objectifs et de la planification en R-D. Voici quelques exemples d'organisations avec lesquelles l'ITI-CNRC collabore : l'�quipe d'innovation du Nouveau-Brunswick; le R�seau de recherche de l'Universit� du Nouveau-Brunswick; le Groupe de travail sur l'industrie du savoir; le Conseil d'administration d'Entreprise Fredericton; Services Nouveau-Brunswick; le conseil des gens d'affaires du Nouveau-Brunswick. Par ailleurs, il accueille les �v�nements d'apprentissage sur le capital de risque de la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunwick et Cybersocial chaque ann�e, participe aux r�unions du Atlantic Angel Network, au conseil consultatif industriel de l'�cole des sciences informatiques de l'Acadia University, aux comit�s d'examen des projets de l'Agence de promotion �conomique du Canada atlantique et h�berge l'International Conference on Electronic Commerce (2006).
|
|
Les liens entre les IPI et les instituts qui les accueillent devraient �tre harmonis�s en fonction des besoins, de mani�re � ce que les objectifs soient atteints. La contribution des IPI au succ�s de la grappe devrait faire l'objet d'un suivi � mesure que ces installations arriveront � maturit�. |
L'existence de liens et de relations solides entre les IPI et les instituts h�tes est cruciale pour que les objectifs strat�giques soient atteints de fa�on optimale. Les IPI joueront un r�le essentiel � mesure que les grappes �volueront et que les activit�s de commercialisation se multiplieront. Si la fonction de coordination mentionn�e � la recommandation 7 plus bas est mise en œuvre, l'�change des pratiques exemplaires sur les IPI et le d�veloppement des grappes feront partie int�grante des activit�s de coordination. |
Sciences de la vie. Un des grands probl�mes de positionnement de l'Installation de partenariat industriel (IPI) de l'IBM-CNRC dans le contexte des p�pini�res d'entreprises provinciales appartenant � InNOVAcorp a �t� r�solu par la cr�ation d'une initiative de synergie entre les deux organismes. L'IPI assume un r�le de soutien dans les activit�s technologiques (soutien des relations entre les entreprises et les scientifiques du CNRC), tandis qu'InNOVAcorp agit comme propri�taire bailleur. L'am�nagement final des laboratoires de l'IPI a permis de lib�rer 278 m2 suppl�mentaires que pourront utiliser les partenaires de l'industrie. De plus :
Affaires �lectroniques et technologies de l'information. Les objectifs op�rationnels de l'IPI du Nouveau-Brunswick de l'ITI-CNRC sont ajust�s de fa�on � favoriser les objectifs strat�giques � long terme de l'Institut tout en pourvoyant aux exigences op�rationnelles � court et � moyen terme. Par exemple, l'ITI-CNRC continue de rechercher des locataires selon les m�thodes conventionnelles d'incubation d'entreprises technologiques, mais il est aussi int�ress� � travailler avec des intervenants � d'autres aspects du d�veloppement de la grappe afin de stimuler ce d�veloppement. Dix locataires ont maintenu l'IPI � pleine capacit�, huit �tant des entreprises en devenir, un �tant un collaborateur de recherche (Populomix, Institut de recherche sur le cancer) et la derni�re �tant Industrie Canada (Commerce international). Un locataire de l'IPI, Virtual Expert Clinics, a gagn� le prix KIRA pour la jeune entreprise la plus prometteuse. Technologies oc�aniques. L'� Installation de partenariat de la grappe � (IPG) utilise des crit�res de pr�s�lection pour s'assurer que les candidats ont contribu� � la grappe technologique oc�anique avant d'�tre accept�s � l'IPI. Voici les points saillants de certaines activit�s de l'IPI :
Les efforts de planification strat�gique de l'ITO-CNRC entam�s au cours de l'�t� 2006 portent sur les activit�s, les mesures et les liens de la grappe. Les CTI du PARI-CNRC travaillent directement avec les clients du CETO sur des projets particuliers financ�s ou non. La co-occupation facilite les interactions et permet l'intervention rapide du PARI-CNRC et l'encadrement par celui-ci. |
|
Dans chaque collectivit�, il faut continuer de surveiller les retomb�es des Initiatives de l'Atlantique (IA) afin d'ajuster les programmes au besoin. Pour faciliter la surveillance des retomb�es, des �tudes de base devraient �tre entreprises. |
L'auto�valuation de la gestion des IA est un outil de diagnostic con�u pour aider les instituts, le PARI-CNRC et l'ICIST-CNRC � rep�rer les domaines � am�liorer pour soutenir les grappes technologiques dans leurs collectivit�s respectives. L'outil d'auto�valuation porte sur la surveillance et la gestion. Le processus d'auto�valuation aura pour r�sultat un plan d'action �labor� par les instituts, le PARI-CNRC et l'ICIST-CNRC afin de s'attaquer aux domaines � am�liorer et de r�pondre aux recommandations formul�es dans les �valuations. Lorsque les instituts amorceront la deuxi�me phase du d�veloppement des grappes, ils recueilleront des renseignements de base sur la grappe et l'institut afin de cr�er une base de comparaison future. Les renseignements de base sur la grappe devront �tre recueillis dans la collectivit� par les membres de la grappe. |
Technologies oc�aniques. Un rapport command� par OceansAdvance et Industrie Canada (A Good Investment – Public Sector Financial Support for Growing the Ocean Technology Sector in NL) a conclu que � l'industrie des technologies oc�aniques � Terre-Neuve-et-Labrador repr�sente l'un des volets de l'�conomie provinciale � la croissance la plus rapide et est consid�r�e comme un chef de file au Canada. De fa�on g�n�rale, de nombreuses entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador se font conna�tre pour leur technologie novatrice et ont �tabli de solides march�s � cr�neaux. �
Dans les cinq derni�res ann�es :
|
|
Pour chaque projet lanc� sous le parapluie des IA, le CNRC devrait �laborer un plan d'action qui encadrera ses activit�s. Ces plans d'action devraient d�crire les objectifs vis�s, les activit�s pr�conis�es, les �ch�anciers �tablis et les m�thodes de mesure du rendement retenues de mani�re � pouvoir fixer la port�e de la participation du CNRC dans le d�veloppement de ces grappes. Ces plans d'action devraient �tre �labor�s conjointement par les instituts, le PARI-CNRC et l'ICIST-CNRC ainsi que par tous les autres groupes du CNRC susceptibles de participer ou d'�tre m�l�s au d�veloppement des grappes technologiques. |
L'outil d'auto�valuation porte sur la strat�gie, la planification et la gouvernance (planification des activit�s/plan d'action). Les plans d'action du CNRC seront �labor�s lorsque le nouveau financement aura �t� obtenu et allou� aux IA puis pr�sent� au Comit� de la haute direction. Le plan d'action du CNRC d�finira les objectifs, les activit�s, les �ch�anciers et les mesures du rendement relatifs � la port�e de la participation du CNRC au d�veloppement de la grappe. |
Sciences de la vie. En consid�rant les activit�s de cartographie comme un effort permanent au sein de la communaut� (aucune participation aux r�alisations ant�rieures de la part de la collectivit�), l'utilisation des plans d'activit�s et des outils de gestion du rendement �labor�s � l'interne ont �t� �largis afin de garantir une incidence maximale des IA sur la croissance de la grappe.
Un plan de travail mettant en relation les finances et la programmation a �t� cr�� pour assurer l'�quilibre entre la reddition de comptes et la prestation du mandat. Affaires �lectroniques et technologies de l'information. Suivant l'analyse de rentabilisation et la planification des dossiers op�rationnels : le plan de dotation (entr�e acc�l�r�e) a en grande partie �t� termin� avant mars 2007; les fonctions de soutien essentielles (r�seautage, communications, administration) ont �t� centralis�es; les groupes et les projets de recherche ont �t� remani�s et regroup�s autour d'un �l�ment central; le plan de recherche a �t� mis en œuvre. Suivant le plan de recherche : les recherches ont �t� regroup�es autour d'un �l�ment central afin de cr�er une masse critique au moyen de deux initiatives strat�giques, de deux projets prioritaires et de quelques projets d'envergure; des collaborations de recherche strat�giques ont �t� form�es avec les PME sur des projets strat�giques; les PME et les universit�s ont tir� profit des subventions de recherche au moyen de partenariats avec l'ITI-CNRC; 21 �tudiants ont �t� embauch�s au cours de l'exercice afin de favoriser la recherche et les objectifs en mati�re de personnel hautement qualifi�. L'ITI-CNRC a r�dig� un plan strat�gique provisoire en 2006 mais le convertira en plan d'activit�s en 2007 afin de se conformer au plan de renouvellement des activit�s du CNRC maintenant requis de la part de tous les instituts. L'ITI a cr�� un outil d'auto�valuation de la gestion des activit�s de recherche et a mis en œuvre des mesures � partir de celui-ci (voir ci-dessous les exigences selon le CGRR). Technologies oc�aniques. Des plans d'action pour la grappe des technologies oc�aniques de Terre-Neuve-et-Labrador ont �t� r�dig�s en 2005. Voici quelques r�alisations courantes :
|
|
En tant qu'acteur du d�veloppement des grappes au sein des collectivit�s h�tes du Canada atlantique, le CNRC devrait inciter les parties prenantes au niveau de la collectivit� � se doter de strat�gies collectives de d�veloppement. |
Les instituts du CNRC ne peuvent formuler par eux-m�mes un plan de d�veloppement des grappes. Ils peuvent toutefois faciliter, favoriser et pr�coniser l'�laboration d'une strat�gie pour chaque grappe. La formulation de ces strat�gies constitue la prochaine �tape logique, maintenant que les instituts entament la deuxi�me phase de d�veloppement des grappes. |
Sciences de la vie
Affaires �lectroniques et technologies de l'information. L'ITI-CNRC poursuit son r�le et soutient toujours les membres de la collectivit�. Il a conserv� son r�le aupr�s d'Innovation Fredericton. L'Institut contribue aussi �troitement, en tant que partenaire ou collaborateur, aux programmes de recherche des grappes des universit�s du Nouveau-Brunswick et de Moncton, de divers minist�res provinciaux (SNB et S�curit� publique, par ex.) et d'autres grands organismes de recherche (Atlantic Canada Research Institute, Institut de recherche sur le cancer Populomix, Centre international de d�veloppement de l'inforoute en fran�ais). L'ITI-CNRC a �t� int�gr� aux plans de recherche des grappes de ces organismes.
|
|
Le CNRC devrait cr�er un nouveau groupe fonctionnel charg� d'assurer la coordination des Initiatives de l'Atlantique. Ce groupe chapeauterait tous les projets individuels lanc�s dans le cadre des IA afin d'en assurer la coordination. Son r�le pourrait comprendre, sans toutefois s'y restreindre, la coordination, le cas �ch�ant, entre les diff�rents projets; l'�tablissement de m�thodes communes (de mesure et de gestion du rendement, de suivi financier et autres); la d�finition, la documentation et le partage des pratiques exemplaires; et le d�veloppement et le partage d'outils communs. |
Il s'agirait de la prochaine �tape logique du d�veloppement des grappes. Le CNRC �tudiera la possibilit� de cr�er une fonction de coordination dans le cadre de la prochaine �tape des initiatives de grappes technologiques du Canada atlantique. |
Termin�. En 2005-2006, le CNRC a cr�� le Secr�tariat national des grappes technologiques (SNGT) afin d'offrir un soutien strat�gique continu � de nombreuses initiatives d'innovation communautaire du CNRC. Le SNGT a pour responsabilit� de surveiller les tendances et les affaires relatives aux grappes technologiques et d'assurer l'�change et la coordination de l'information dans l'ensemble du CNRC et, de concert avec les intervenants externes, de maximiser le d�veloppement des grappes. La structure de rapport du SNGT a �t� modifi�e : le Secr�tariat rend compte au directeur g�n�ral de la Direction de la strat�gie et du d�veloppement , par l'interm�diaire du directeur de la planification et de la gestion du rendement. En mars 2007, le SNGT a convoqu� la premi�re r�union de son r�seau d'initiatives des grappes. Ce r�seau compos� de praticiens internes des grappes de l'ensemble du CNRC se r�unit deux ou trois fois par ann�e pour discuter des projets communs, des buts, des difficult�s, des pratiques exemplaires et des le�ons tir�es. |
|
Le plan d'action du CNRC pour chaque grappe technologique devrait exposer en d�tail le r�le et la contribution du groupe des communications � l'appui du projet. |
L'outil d'auto�valuation porte sur les communications et les relations avec les intervenants. Le plan d'action du CNRC relatif � chaque grappe (recommandation 5 plus haut) expliquera en d�tail le r�le et la contribution des communications pour ce qui est du soutien � l'initiative de la grappe. |
Sciences de la vie. Un adjoint administratif de la grappe a �t� embauch� et assume une partie du r�le de coordination et de liaison, notamment la liaison entre les communications de l'IBM-CNRC et le secteur des communications de l'association industrielle, qui a pour mandat de diriger la collectivit�. Le personnel de la grappe du CNRC a travaill� en �troite collaboration avec l'association industrielle afin de formuler des outils communs de communication et de commercialisation pour des �v�nements tels que BIO. L'association industrielle a r�alis� une �valuation de la strat�gie de communication de l'IBM-CNRC afin de veiller � ce que celle-ci soit harmonis�e avec les objectifs de la grappe et la vision et les strat�gies de la collectivit�. Technologies oc�aniques. Il n'existe pas de plan de communication d�taill� pour l'ITO-CNRC, les communications de la grappe (avantages et strat�gies) �tant plut�t efficacement transmises par OceansAdvance au moyen d'une s�rie de consultations approfondies aupr�s des repr�sentants de tous les ordres de gouvernement, de m�me que des repr�sentants de l'industrie. |
|
Le cadre de responsabilisation applicable aux fonds octroy�s aux IA devrait �tre r�vis� et renforc�. Les activit�s financ�es au moyen de ces cr�dits et les r�sultats qui leur sont imputables devraient faire l'objet d'un suivi distinct et les donn�es de suivi �tre rapport�es s�par�ment. Il conviendrait aussi d'amorcer une r�flexion sur la pertinence de rendre obligatoire l'affectation des cr�dits des IA � des projets de recherche pr�cis men�s en plus des projets de recherche g�n�raux financ�s au moyen des services vot�s. Ces projets devraient avoir comme objectif exclusif de r�pondre aux besoins des collectivit�s h�tes des grappes technologiques. |
Lorsque les niveaux de financement des IA renouvel�es seront en place et que le plan de chaque initiative aura �t� r�dig�, un cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats (CGRR) sera mis en œuvre et la responsabilisation fera l'objet d'un suivi, d'une r�vision et d'une consolidation en cons�quence. Le CGRR mis � jour s'appuiera sur un effort de coop�ration de la part des directeurs g�n�raux des IA et sera g�r� par les Services corporatifs ou une fonction de coordination des grappes s'il est mis en œuvre. Lorsque les niveaux de financement des IA renouvel�es seront en place, les instituts, le PARI-CNRC et l'ICIST-CNRC effectueront le suivi de leur financement des IA s�par�ment de mani�re � rendre des comptes sur les activit�s des grappes et les progr�s effectu�s par rapport aux objectifs d�finis dans le plan d'action du CNRC. |
Sciences de la vie. Toutes les ressources fournies par l'entremise des IA, y compris les ressources humaines et financi�res, sont maintenant r�pertori�es au sein de l'Institut. Toutes les d�penses des IA font l'objet d'un suivi au moyen d'un syst�me transparent d'ordonnances internes allou�es en fonction d'un centre de co�ts �tabli � cette fin. Le processus de
prise de d�cisions relatives � l'allocation des ressources est transparent et repose sur un plan d'action fond� sur le budget formul� annuellement. Les crit�res d�cisionnels ont �t� d�finis et sont utilis�s pour s'assurer que tant le mandat des IA que les exigences redditionnelles sont respect�s. Des mesures particuli�res ont �t� mises en œuvre dans le processus de
s�lection des projets pour veiller � ce que les besoins de la communaut� soient pris en consid�ration.
|
|
L'attribution des ressources devrait �tre fond�e sur un exercice collectif d'examen. Dans certains cas, le suivi effectu� sur les cr�dits des IA n'est pas satisfaisant et cet aspect du programme doit donc �tre am�lior�. |
Le CNRC continuera de tenir r�guli�rement des r�unions sur les probl�mes internes, comme il l'a fait au cours du pr�sent exercice. |
Sciences de la vie. Les ressources sont attribu�es en fonction des besoins de la communaut�, des priorit�s du CNRC et de l'IBM-CNRC et du mandat des IA. Ces besoins et priorit�s sont continuellement r��valu�s comme d�crit ci-dessus. |
|
Les cr�dits affect�s aux IA devraient faire l'objet d'un suivi distinct de celui exerc� sur les services vot�s. |
Le financement des IA fera l'objet d'un suivi distinct de celui exerc� sur les services vot�s tel que d�crit en r�ponse � la recommandation 9 ci-dessus. |
Sciences de la vie. Trait� ci-dessus.
L'ITI-CNRC a �labor� une m�thode de ventilation des co�ts comportant un syst�me de codage particulier pour ses activit�s et projets au Nouveau-Brunswick, � Ottawa et � Gatineau. Cette initiative a �t� mise sur pied de concert avec la Direction des finances du CNRC. Technologies oc�aniques. Trait� ci-dessus. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
Le CNRC devrait continuer � financer l'Initiative en g�nomique et en sant� (IGS) et solliciter le renouvellement de l'Initiative de R‑D en g�nomique pour une quatri�me phase. |
Des discussions sur la conception des programmes et du concours pour la Phase IV de l'IGS seront amorc�es avec le Comit� des directeurs g�n�raux de l'IGS, en consultation avec le Comit� de coordination des programmes de l'IGS. Les recommandations de l'�valuation de l'IGS et les le�ons tir�es de l'IGS‑3 seront int�gr�es � la conception des programmes de la phase IV. |
Le cadre des programmes et la structure du concours pour la phase IV de l'IGS (IGS-4) ont �t� �labor�s en consultation avec le Comit� des directeurs g�n�raux et le Comit� de coordination des programmes de l'IGS. Les recommandations provenant de l'�valuation de l'IGS et les le�ons tir�es de l'IGS-3 ont �t� int�gr�es au cadre de l'IGS-4. Un appel d'offres avec concours pour l'IGS-4 a �t� lanc� � la mi-d�cembre 2006 et un processus d'�valuation par les pairs avec concours et un processus de s�lection sont en cours. Les cadres sup�rieurs du CNRC prendront les d�cisions relatives au financement des programmes (2008-2011) � l'automne 2007 afin que les nouveaux programmes de recherche de l'IGS-4 puissent commencer en avril 2008. Un groupe de travail interminist�riel pr�sid� par le CNRC travaille au renouvellement de l'Initiative de R-D en g�nomique. |
|
Le CNRC devrait s'assurer qu'une fois que les priorit�s strat�giques sont articul�es dans le cadre de l'Initiative de renouvellement, les objectifs de l'IGS sont clairement align�s sur ces priorit�s. |
Les objectifs de l'IGS seront revus une fois que les priorit�s strat�giques du CNRC auront �t� articul�es dans le cadre de l'Initiative de renouvellement. Les r�visions viseront � assurer que les objectifs sont clairement align�s sur les priorit�s strat�giques du CNRC. Le VP (Sciences de la vie) �laborera les objectifs r�vis�s en consultation avec le Comit� des directeurs g�n�raux de l'IGS. |
Termin�. Les objectifs de l'IGS ont �t� r�vis�s afin de s'aligner sur la nouvelle strat�gie du CNRC (2006-2011). Les objectifs de l'IGS-4 ont �t� approuv�s par le vice-pr�sident, Sciences de la vie, le 19 d�cembre 2006. Les objectifs r�vis�s sont les suivants :
|
|
Les phases futures de l'IGS devraient privil�gier l'approche par portefeuilles et rechercher un �quilibre dans le financement des nouveaux programmes de recherche fondamentale et des programmes de recherche appliqu�e. Pour les programmes qui proposent des applications � plus proches du march� �, une �tude portant sur l'�valuation de ces march�s devrait �tre r�alis�e dans le cadre du processus d'appel de propositions pour examiner les retomb�es potentielles des travaux propos�s. |
Dans la phase IV de l'IGS, une approche par portefeuilles sera d�finie de mani�re plus formelle et int�gr�e aux crit�res d'�valuation des programmes qui seront utilis�s par le Comit� d'experts de l'IGS, et elle guidera la haute direction du CNRC dans ses d�cisions de financement des programmes. L'approche par portefeuilles visera le financement d'un �ventail �quilibr� de programmes ayant un potentiel commercial � court terme et de programmes de recherche poursuivant des objectifs � long terme. On tirera les le�ons des �tudes d'analyse de march� r�alis�es par les instituts du CNRC (par ex., IRB-CNRC) et de l'�tude pilote men�e par les Services corporatifs du CNRC pour �laborer des exigences pr�cises pour les �tudes d'analyse de march� qui seront int�gr�es aux crit�res d'�valuation de la phase IV de l'IGS. Le Comit� d'experts de l'IGS sera aussi renforc� par l'inclusion de membres qui ont des comp�tences en affaires et en commercialisation. |
Conform�ment au cadre d�cisionnel relatif au financement des programmes de l'IGS-4, les cadres sup�rieurs du CNRC utiliseront une approche officielle ax�e sur le portefeuille dans la s�lection des propositions de programme afin de cr�er un portefeuille �quilibr� de programmes comportant des possibilit�s commerciales � court terme de m�me que des objectifs de recherche � long terme. Le processus d'�valuation des propositions de l'IGS-4 a �t� renforc� par la r�alisation obligatoire d'�tudes ind�pendantes de positionnement strat�gique et sur les march�s pour chaque proposition. Le Comit� d'experts de l'IGS-4 a �t� cr�� et de nouveaux membres poss�dant des comp�tences en affaires et en commercialisation y ont �t� int�gr�s |
|
Les efforts devraient tirer parti des progr�s r�alis�s lors de l'IGS‑2 en int�grant des activit�s � la grandeur du CNRC. De plus, la compl�mentarit� entre les programmes de l'IGS et les autres activit�s de recherche en g�nomique et en sant� au Canada devrait �tre renforc�e par une collaboration accrue avec des organismes ext�rieurs au CNRC. |
L'int�gration et l'effet de levier sont des crit�res importants dans l'�valuation des propositions pour l'IGS-3. Les auteurs de propositions sont encourag�s � former des �quipes de recherche int�gr�es et multidisciplinaires qui touchent plus qu'un institut du CNRC et qui pr�voient la coordination de la recherche et la collaboration avec d'autres minist�res et organismes gouvernementaux, des universit�s et/ou l'industrie. Un comit� interminist�riel de coordination de la R‑D en g�nomique supervise la gestion collective et la coordination du programme f�d�ral de R‑D en g�nomique, et veille � ce que l'on favorise les collaborations entre les minist�res f�d�raux lorsque cela est possible et pertinent. On insistera sur la n�cessit� d'�tablir une collaboration inter-instituts dans les programmes de recherche de la phase IV de l'IGS, et la collaboration avec des organismes ext�rieurs au CNRC continuera d'�tre un important crit�re dans l'�valuation des propositions. |
La collaboration interinstitutionnelle et la collaboration avec des organismes externes aux CNRC a �t� d�finie comme un crit�re d'�valuation crucial dans le cadre des programmes de l'IGS-4. Les lettres d'intention d'�laboration de la proposition compl�te de l'IGS-4 qui ont �t� approuv�es d�montrent clairement que cette exigence est prise en consid�ration. Le groupe de travail interminist�riel de R-D en g�nomique (qui soutient le comit� de coordination des sous-ministres adjoints) se r�unit r�guli�rement et �change de l'information sur les processus de s�lection des programmes de recherche minist�riels afin de s'assurer que les collaborations entre les minist�res f�d�raux sont rep�r�es et poursuivies. Citons en exemple les efforts de collaboration entre le CNRC et le minist�re de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire se rattachant aux semences de Brassica (canola). Dans le cadre du renouvellement de l'Initiative de R-D en g�nomique, ce groupe travaille en �troite collaboration avec G�nome Canada � la d�finition des priorit�s strat�giques de la R-D en g�nomique. |
|
Un mod�le logique propre � l'IGS, qui d�finit les r�sultats attendus � court, moyen et long terme, devrait �tre mis en œuvre pour faciliter une mesure effective du rendement. Les objectifs devraient �tre �nonc�s clairement et le rendement devrait �tre mesur� par rapport aux objectifs d�finis, tant au niveau de l'initiative que des programmes individuels. Des indicateurs li�s � des objectifs clairs ou aux plans strat�giques devraient �tre identifi�s, accept�s (c.-�‑d. par la direction, les chercheurs, les VP, etc.), et faire l'objet d'un suivi et de rapports pr�cis. La n�cessit� d'assurer un suivi du rendement et de l'affectation des ressources devrait �tre contrebalanc�e par le danger d'alourdir le fardeau administratif connexe. |
Le CNRC m�ne pr�sentement une �valuation de l'Initiative de R‑D en g�nomique interminist�rielle. Dans le cadre de cette �valuation, un Cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats (CGRR) r�vis� sera pr�par� pour l'Initiative de R‑D en g�nomique. Le consultant charg� de r�viser le CGRR sera aussi charg� d'�laborer le mod�le logique propre � l'IGS qui d�finira les r�sultats attendus � court, moyen et long terme. Des mesures ont d�j� �t� prises dans les chartes des programmes de l'IGS‑3 pour mieux d�finir les objectifs et les produits livrables/jalons cl�s des programmes, et les programmes de recherche doivent produire des rapports trimestriels faisant �tat des progr�s r�alis�s dans l'atteinte des objectifs et des jalons. Dans les chartes des programmes de la phase IV de l'IGS, on s'efforcera d'am�liorer la d�finition des objectifs de la recherche et leur lien avec le plan strat�gique de l'Initiative, et de mieux les articuler et de pr�ciser leur lien avec les jalons cl�s des programmes. |
L'�valuation de l'Initiative de R-D en g�nomique interminist�rielle est termin�e et un cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats (CGRR) a �t� r�dig� pour l'Initiative. Des discussions sont men�es avec la Direction de la strat�gie et du d�veloppement du CNRC (groupe Planification et gestion du rendement) afin de d�terminer si ce CGRR et le mod�le logique qui s'y rattache peuvent �tre utilis�s dans l'IGS, ou si un mod�le logique particulier � l'IGS devra �tre �labor�. La reddition de compte sur les objectifs et les jalons de recherche constitue une des exigences essentielles des rapports trimestriels de l'IGS-3. Des efforts ont �t� mis en œuvre afin de veiller � ce que le Bureau de coordination de l'IGS offre le soutien administratif n�cessaire pour minimiser la charge que repr�sente le suivi des ressources. Le cadre des programmes de l'IGS-4 stipule que les mandats de programme doivent pr�senter des objectifs de recherche mieux d�finis ainsi que leurs liens avec les priorit�s strat�giques. Les mandats de l'IGS-4 sont �galement tenus de pr�senter les principaux jalons des programmes qui serviront � effectuer le suivi des progr�s r�alis�s. |
|
Des efforts devraient �tre d�ploy�s pour clarifier les r�les et les responsabilit�s de la fonction de d�veloppement commercial et pour mieux la communiquer aux chercheurs et aux agents de d�veloppement commercial pour qu'ils aient une compr�hension commune des activit�s qui font partie de cette fonction. |
Le CNRC lance un vaste examen de ses activit�s de d�veloppement commercial pour s'assurer qu'il est engag� dans les bonnes activit�s commerciales et que le soutien pour ces activit�s sera ad�quat dans l'avenir. Plus pr�cis�ment, cet examen vise � examiner ces activit�s dans le but de reconduire le soutien pour atteindre les objectifs de l'Initiative de renouvellement, de tirer parti des possibilit�s de la gestion par portefeuille, et de mieux travailler � horizontalement �. Cet examen assurera que les enjeux et les possibilit�s de l'IGS mis au jour lors de l'�valuation seront trait�s de fa�on appropri�e. On devrait aussi clarifier les r�les en mati�re de d�veloppement commercial et de commercialisation et les communiquer � l'ensemble du Programme et du Conseil. |
Le besoin de clarifier les r�les et les responsabilit�s des � activit�s commerciales � faisait partie des recommandations cons�cutives au projet d'examen des activit�s. Cette conclusion est revenue constamment lors des entrevues effectu�es aupr�s du personnel du BEA, du personnel minist�riel et des directeurs de recherche. Par la suite, ce besoin est devenu l'une des priorit�s d'action de cet exercice financier dans le cadre des activit�s du nouveau groupe central de soutien des activit�s techniques. Plus particuli�rement, un nouveau projet de soutien des activit�s techniques qui vise � simplifier les pratiques op�rationnelles du CNRC a �t� approuv�. La fonction premi�re de ce projet est d'aborder le besoin de clarifier les r�les, les responsabilit�s et les pouvoirs entourant l'analyse et la n�gociation d'ententes. D'autres domaines de clarification suivront. |
|
Dans le cadre de la prochaine �valuation de l'Initiative de R‑D en g�nomique, on devrait proc�der � un examen en profondeur des orientations scientifiques et des axes de recherche des minist�res participant � la R‑D en g�nomique, de m�me que des autres organismes f�d�raux, dont les IRSC, G�nome Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation et la Strat�gie canadienne en mati�re de biotechnologie, pour d�terminer dans quelle mesure les diff�rents programmes sont compl�mentaires ou s'ils font double emploi. � cet �gard, on doit tenir compte de l'�tat et/ou des r�sultats de l'examen en cours par le ministre de l'Industrie sur la participation et les investissements du gouvernement f�d�ral dans la R‑D en g�nomique. |
L'�valuation de l'Initiative de R‑D en g�nomique interminist�rielle comprendra un examen en profondeur des orientations scientifiques et des axes de recherche des minist�res f�d�raux participant � la R‑D en g�nomique. Un examen semblable (en l'occurrence, l'Examen de la g�nomique) a �t� amorc�, sur une plus large �chelle, pour les autres organismes f�d�raux, dont les Instituts de recherche en sant� du Canada, G�nome Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation et la Strat�gie canadienne en mati�re de biotechnologie, et est dirig� par Industrie Canada. Ces �valuations/examens fourniront une excellente occasion de d�terminer comment rendre les diff�rents programmes plus efficaces. Le Bureau de coordination de l'IGS, en consultation avec le Comit� des directeurs g�n�raux de l'IGS, prendra des mesures pour r�pondre aux questions ou pr�occupations particuli�res qui sont soulev�es dans les recommandations et dans les r�ponses connexes de la direction � ces �valuations et examens. |
Termin�. Une �valuation de l'Initiative de R-D en g�nomique a �t� r�alis�e en 2006. La principale conclusion de cette �valuation �tait que l'Initiative est pertinente et repr�sente un �l�ment crucial des activit�s canadiennes g�n�rales en biotechnologie et qu'elle compl�te les autres initiatives relatives aux activit�s de r�glementation associ�es aux investissements en biotechnologie et aux autres investissements f�d�raux dans la R-D en g�nomique (G�nome Canada, par ex.). Industrie Canada a r�cemment termin� la r�vision d'une vaste gamme de participations et d'investissements du gouvernement f�d�ral en recherche en g�nomique, comme G�nome Canada, les conseils subventionnaires (Instituts de recherche en sant� du Canada, Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada, Conseil de recherches en sciences humaines du Canada), la Fondation canadienne pour l'innovation, le Programme des chaires de recherche du Canada, les R�seaux de centres d'excellence, et l'Initiative de R-D en g�nomique intramurale. Cette r�vision concluait que les r�les de ces organismes de recherche financ�s par le gouvernement f�d�ral sont compl�mentaires et int�gr�s et bien adapt�s pour soutenir le mandat des minist�res et des diff�rentes �chelles de programmes de recherche. En outre, tout en soulignant qu'il y avait place � am�lioration dans le domaine de la coordination et de la planification strat�gique, elle concluait que les investissements f�d�raux ont bien positionn� le Canada, consid�rant les progr�s scientifiques r�alis�s dans la g�nomique, l'augmentation de l'ampleur des collaborations et les investissements continus par des gouvernements et institutions de R-D en g�nomique �trangers. |
|
Le Bureau de coordination de l'IGS devrait continuer � soutenir les chefs scientifiques au niveau de la gestion de projet (par ex., formation, documents de r�f�rence, s�ances d'information, ateliers), en accordant une attention particuli�re � ceux qui ont moins d'exp�rience. Le Bureau de coordination devrait aider � faciliter le partage des bonnes pratiques de gestion entre les responsables des programmes ou chefs scientifiques exp�riment�s et les d�butants. |
Un des r�les cl�s du Comit� de coordination de l'IGS est d'encourager le partage des meilleures pratiques de gestion parmi les chefs scientifiques. Cette approche sera renforc�e dans la phase IV de l'IGS par l'introduction d'un atelier sur la gestion des projets qui se tiendra durant le lancement de l'IGS-4. Le Bureau de coordination de l'IGS, en consultation avec les instituts participants et les Services corporatifs, �laborera cet atelier. L'objectif de l'atelier sera de fournir des conseils sur les exigences relatives � la gestion de l'IGS et des programmes des instituts et � la gestion du rendement, et il inclura des pr�sentations sur les meilleures pratiques des chefs scientifiques d'exp�rience. On envisage aussi d'inclure des pr�sentations faites par des gestionnaires de projet professionnels du secteur priv�. En ce qui a trait � la formation en gestion de projet des chefs scientifiques, le Bureau de coordination de l'IGS peut fournir une aide financi�re et faciliter la formation pour aider � la prestation des programmes de recherche horizontaux. Toutefois, la formation et le perfectionnement des chefs scientifiques sont la responsabilit� des instituts, et tout effort dans ce domaine devra �tre coordonn� et approuv� par la direction des instituts. |
Le cadre des programmes de l'IGS-4 pr�voit la tenue d'un atelier sur la gestion de projet pendant le lancement de l'IGS-4 en 2008. L'objectif de l'atelier sera de fournir des conseils sur les exigences relatives � la gestion de l'IGS et des programmes des instituts ainsi qu'� la gestion du rendement, et il inclura des pr�sentations sur les pratiques exemplaires des chefs scientifiques d'exp�rience. On envisage aussi d'inclure des pr�sentations faites par des gestionnaires de projet professionnels du secteur priv�. |
|
La mise en œuvre de la nouvelle structure de gouvernance et de responsabilisation d�finie pour l'IGS-3 devrait faire l'objet d'une �valuation continue pour d�terminer son efficacit� � mesure que progresse la phase 3. |
Le Comit� des directeurs g�n�raux de l'IGS de m�me que le Comit� de coordination de l'IGS �valueront de fa�on continue l'efficacit� de la nouvelle structure de gouvernance et de responsabilisation de l'IGS. Ces questions seront � l'ordre du jour annuel des deux comit�s, et les recommandations faites par les comit�s seront utilis�es pour guider la r�vision du mod�le de gouvernance. L'efficacit� de la structure et du fonctionnement des divers comit�s sera un �l�ment cl� des discussions. Toute modification majeure au cadre de gouvernance et de responsabilisation devra �tre accept�e par le Comit� des directeurs g�n�raux de l'IGS et soumise au Comit� de la haute direction du CNRC pour son approbation. |
Cette exigence a �t� d�battue avec le vice-pr�sident de Sciences de la vie (pr�sident du Comit� des directeurs g�n�raux de l'IGS) et il a �t� convenu que le cadre de gouvernance de l'IGS sera r�vis� lors de l'exercice 2007-2008 de fa�on � ce que le cadre r�vis� puisse �tre approuv� au d�but de l'IGS-4 (avril 2008). |
|
Les propositions pour les phases futures devraient �tre simplifi�es, et elles devraient porter sur l'articulation d'objectifs et de jalons clairs et r�alistes. Il devrait y avoir plus de transparence dans le processus de s�lection finale des programmes, ainsi qu'une meilleure articulation et une meilleure communication avec les chefs scientifiques des raisons justifiant les d�cisions finales de financement. On devrait envisager de faire un suivi du temps consacr� � l'�laboration des propositions pour toute phase future. |
Des modifications pour simplifier et axer les propositions sur l'articulation d'objectifs et de jalons r�alistes ont �t� incluses dans l'IGS‑3 et seront int�gr�es et renforc�es dans la phase IV de l'IGS. Des efforts pour accro�tre la transparence du processus de s�lection finale des programmes ont aussi �t� amorc�s dans l'IGS-3, et des mesures additionnelles seront incluses dans la phase IV. Par exemple, un syst�me d'�valuation des propositions plus formel sera �labor� pour fournir une r�troaction sur chaque crit�re d'�valuation. Cette information sera ensuite utilis�e pour cr�er des documents sommaires d'�valuation qui seront communiqu�s � chaque proposant. L'objectif global de ces modifications sera de mieux articuler les raisons utilis�es dans le processus de prise de d�cisions. |
Le cadre des programmes de l'IGS-4 introduit des modifications ayant pour but de simplifier les propositions et de les axer sur des objectifs et des jalons r�alistes. Des modifications visant � am�liorer la transparence du processus de s�lection finale des programmes ont �t� apport�es dans l'IGS-4, et un syst�me d'�valuation des propositions plus formel est utilis�. Ce syst�me permet de fournir aux proposants une r�troaction bien plus d�taill�e (et pr�cise) sur chaque crit�re d'�valuation relativement aux �l�ments consid�r�s comme des forces ou des faiblesses, de m�me que des observations justifiant les modifications propos�es. Cette m�thode a d�j� �t� mise en œuvre dans le cadre du processus d'�valuation des lettres d'intention de l'IGS-4. |
|
Les chartes des programmes devraient inclure des plans pr�cis sur la fa�on dont le projet se terminera, dans l'�ventualit� o� le financement serait discontinu� apr�s trois ans. |
En se fondant sur les t�moignages pr�sent�s lors de l'�valuation, on constate clairement que certains des participants aux programmes de recherche de l'IGS supposent que le financement va probablement continuer au-del� de la p�riode nominale de trois ans suivant l'approbation de leur programme. Dans le cadre de l'IGS‑2 et de l'IGS‑3, les lignes directrices pour les concours indiquaient que la planification et le financement des programmes devaient porter sur une dur�e limit�e (g�n�ralement trois ans), et que les objectifs et les jalons de la recherche devaient �tre d�finis en cons�quence. Dans la phase IV de l'IGS, la dur�e des programmes et le processus de renouvellement du financement seront d�finis de fa�on plus explicite dans la documentation des programmes. De plus, on introduira, dans le cadre de l'�laboration des chartes des programmes de la Phase IV de l'IGS, une nouvelle exigence pour que chaque programme pr�pare une strat�gie de fermeture dans l'�ventualit� o� le financement serait discontinu�. Dans le cadre de la strat�gie de fermeture des programmes de l'IGS-3, des propositions pourront �tre mises de l'avant pour demander la poursuite du financement pour une courte p�riode afin de permettre l'ach�vement des travaux essentiels. On s'efforcera d'annoncer les d�cisions de financement de la Phase IV six mois avant la fin de l'IGS‑3 afin de laisser un d�lai suffisant pour mettre en œuvre la strat�gie de fermeture. |
Le cadre des programmes de l'IGS-4 et les pr�sentations connexes sur le mode de fonctionnement de l'IGS exposent explicitement la dur�e des programmes et le processus de renouvellement du financement. Lors de l'�laboration des chartes des programmes de l'IGS-4, on a introduit une nouvelle exigence voulant que chaque programme dispose d'une strat�gie de fermeture dans l'�ventualit� o� le financement serait discontinu�. On prendra les d�cisions relatives au financement de l'IGS‑4 � la mi-novembre, soit quatre ou cinq mois avant la fin de l'IGS-3, afin de laisser aux programmes de l'IGS-3 qui ne se poursuivent pas � la phase 4 un d�lai suffisant pour mettre en œuvre les plans strat�giques de fermeture. |
|
Pour optimiser le recours � des �valuateurs externes, une �valuation ind�pendante du rendement pass� par des experts de l'ext�rieur devrait �tre int�gr�e au processus de s�lection des programmes pour toutes les nouvelles phases de l'IGS. On devrait demander aux pairs �valuateurs non seulement d'�valuer les travaux propos�s, mais aussi de fournir une opinion sur le rendement ant�rieur des programmes. Des questions portant sur la recherche r�alis�e � la phase pr�c�dente (par ex., atteinte des objectifs, qualit� et pertinence des extrants/r�sultats) devraient �tre int�gr�es � l'�valuation des propositions. |
Les propositions soumises dans le cadre des programmes de l'IGS doivent inclure une section qui fait �tat des progr�s r�alis�s dans des domaines li�s directement � la proposition, ainsi qu'une liste des extrants (par ex., publications, brevets, accords de licence, etc.) associ�s � la recherche. Pour les programmes existants, les pairs �valuateurs et les membres du Comit� d'experts de l'IGS ont utilis� cette section pour �valuer le rendement ant�rieur. Dans le concours de la Phase IV de l'IGS, cette section du mod�le de proposition sera renforc�e et on exigera de faire �tat de fa�on explicite des progr�s r�alis�s dans l'atteinte des objectifs et des jalons de la recherche dans des domaines directement associ�s � la proposition. De plus, les rapports de rendement de l'IGS-3 seront mis � la disposition des �valuateurs des propositions de l'IGS-4. Les programmes de recherche de l'IGS-3 doivent soumettre des rapports de rendement trimestriels qui sont examin�s par les comit�s directeurs et par le Comit� des directeurs g�n�raux de l'IGS. De plus, il est pr�vu que le Comit� d'experts de l'IGS proc�de � des �valuations formelles des programmes de recherche de l'IGS � mi-mandat, et qu'il formule des recommandations au vice-pr�sident, Sciences de la vie, qui d�terminera si le financement d'un programme doit �tre maintenu, r�duit ou r�affect�. Les m�canismes d'�valuation du rendement existants sont vus comme �tant assez complets, et l'int�gration d'�valuations additionnelles et ind�pendantes du rendement pass� dans le cadre du processus de s�lection des programmes de l'IGS est per�ue comme non n�cessaire. |
On a consolid� le mod�le de proposition compl�te de l'IGS-4 afin d'y inclure l'obligation de faire �tat de fa�on explicite des progr�s r�alis�s dans l'atteinte des objectifs et des jalons de recherche dans des domaines directement li�s � la proposition. De plus, les rapports de rendement de l'IGS-3 seront mis � la disposition des �valuateurs des propositions de l'IGS-4. Le Comit� d'experts de l'IGS a r�alis� une �valuation formelle des programmes de recherche de l'IGS � mi-mandat en d�cembre 2006 et a formul� des recommandations � l'intention du vice-pr�sident, Sciences de la vie. Bien que le renouvellement du financement de chaque programme ait �t� accept�, les recommandations du Comit� ont entra�n� des modifications aux objectifs et � l'orientation des recherches lors de l'�laboration des plans des programmes pour la derni�re ann�e de l'IGS-3 (2007-2008). |
|
Avant de reproduire le mod�le de l'IGS pour d'autres initiatives horizontales du CNRC, les questions suivantes devraient �tre prises en consid�ration :
|
Le Comit� de la haute direction du CNRC est d'accord pour prendre en consid�ration ces questions avant de mettre en place toute autre initiative horizontale au CNRC. |
Le CNRC examine actuellement les questions relatives � la gouvernance et au financement des initiatives horizontales. Une rencontre des responsables des plans sectoriels est pr�vue pour juin 2007 afin de trouver des solutions � ces questions. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction et mesures propos�es |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
L'IIPC-CNRC doit �noncer une proposition de valeur en vue d'amener ses activit�s de R-D � compl�ter celles de l'industrie et non � les concurrencer. |
Accept�e. Nous allons examiner r�guli�rement, avec nos partenaires, l'orientation de nos recherches en fonction des besoins � court, � moyen et � long terme de la grappe du secteur des piles � combustible et apporter les correctifs n�cessaires pour am�liorer notre r�ponse aux besoins de l'industrie en lui permettant d'acc�der � une expertise et � des avanc�es
et technologiques uniques, ainsi qu'aux comp�tences essentielles.
|
|
|
L'IIPC-CNRC doit trouver comment accro�tre l'utilisation de la SACTH, notamment par des efforts de commercialisation. |
Accept�e.
|
|
|
L'IIPC-CNRC doit continuer de se concentrer sur le d�veloppement des capacit�s de recherche internes. |
Accept�e. Le d�veloppement des comp�tences essentielles et du leadership dans le domaine de la recherche est absolument n�cessaire � la viabilit� de l'Institut, donc prioritaire. Outre la formation de meneurs pour la recherche, nous pr�voyons augmenter le nombre de postes par l'accroissement des recettes.
|
|
|
L'IIPC-CNRC doit veiller � ce que son plan de recherche soit cibl� et tienne compte de ses ressources, et bien en informer les intervenants. |
Accept�e.
|
|
|
Le CNRC devra envisager toutes les possibilit�s, y compris des r�am�nagements de l'effectif, lorsqu'il modifiera en profondeur l'orientation de sa recherche. |
Accept�e
|
|
|
L'IIPC-CNRC doit s'attacher � la gestion des ressources et � la mise en œuvre des plans et poursuivre l'adoption des m�thodes et des processus de gestion n�cessaires � l'atteinte des objectifs. |
Accept�e
|
|
|
Le CNRC doit bien d�finir le sens de � figure de proue � ainsi que les r�les et les responsabilit�s que cela sous-entend. |
L'industrie demande au CNRC de cr�er un portail pour coordonner et regrouper les ressources du CNRC. � notre avis, l'IIPC-CNRC, en tant qu'institut de recherche appliqu�e, au cœur de la plus importante grappe d'entreprises qui s'int�ressent aux piles � combustibles et des activit�s de l'ensemble du secteur, peut servir de portail � la R-D dans ce domaine. Disposant du plus important groupe de recherche sur les piles � combustible au Canada, il collabore de pr�s avec ses partenaires universitaires pour r�pondre aux besoins de l'industrie. L'IIPC-CNRC coordonne l'ensemble de la R-D sur les piles � combustibles au Canada et assure les rapports avec l'Industrie. Piles � combustibles Canada, une association industrielle nationale qui a son si�ge social � l'Institut d'innovation en piles � combustible (IIPC-CNRC), donne r�guli�rement des informations sur les besoins des entreprises. L'IIPC-CNRC entretient d'excellents rapports avec les entreprises et les universit�s de m�me qu'avec les organisations de recherche � l'�tranger. Gr�ce � son Installation de partenariat industriel (IPI), � ses centres d'essai et de d�monstration, � son conseil consultatif ax� sur l'industrie et � ses bons rapports avec les conseillers en technologie industrielle (CTI) du PARI-CNRC, l'IIPC-CNRC est bien au fait des besoins du march� et des entreprises. Aussi, en qualit� de portail, il est en mesure d'informer des besoins le programme horizontal de recherche sur les piles � combustibles du CNRC. Le programme utilisera les renseignements obtenus pour instaurer des crit�res de s�lection de projet en vue de l'�laboration de plateformes de connaissances essentielles et nouvelles n�cessaires aux instituts de recherche appliqu�e pour aider les partenaires industriels. D'autre part, l'IIPC-CNRC peut r�pondre aux nombreux besoins et demandes de renseignements des entreprises en acheminant celles-ci, ainsi que leurs projets ou consortiums, aux employ�s du CNRC ayant les comp�tences et l'expertise voulues. |
Les cadres sup�rieurs du CNRC ont d�battu du r�le �ventuel de figure de proue de l'IIPC-CNRC dans la recherche sur les piles � combustible au Canada. Les discussions se poursuivent afin de clarifier la d�finition des r�les et des responsabilit�s relatives � la cr�ation de la fonction de � portail �. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction et mesures propos�es |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
Doter l'INN d'une vision strat�gique et de m�canismes permettant de la r�aliser. |
Cette recommandation sera mise en œuvre au cours de l'ann�e civile. L'INN dispose d'un plan pour les cinq premi�res ann�es : b�tir et �quiper l'INN selon le cadre de recherche particulier articul� par Dan Wayner en 2002. De plus, le Conseil a accept� le cadre strat�gique de fonctionnement lors de sa premi�re r�union, en juin 2005. Toutefois, par le pass�, l'approbation d'un plan strat�gique formel a �t� entrav�e parce que les parties ne savaient pas trop ce que le plan devait contenir. La direction a l'intention de formuler un plan strat�gique qui tiendra compte de l'initiative conjointe et qui pourra �tre approuv� par le Conseil de l'INN et les partenaires financiers de l'Institut le 3 octobre 2006. Le plan strat�gique offrira plus de pr�cisions sur le plan et l'accent des recherches. |
Le plan strat�gique provisoire a �t� pr�sent� par le Conseil d'administration en octobre 2006. Suivant les conseils de ses membres, le plan a �t� peaufin� par la direction de l'INN pour la r�union du Conseil d'administration en avril 2007. Le Conseil a alors not� des progr�s dans le plan et a demand� qu'il soit davantage cibl� strat�giquement, � son usage, comparativement � un document connexe pr�sent� au CNRC. La prochaine version du plan sera distribu�e �lectroniquement et fera l'objet de d�bats lors d'une conf�rence �lectronique avant d'obtenir l'approbation finale du Conseil au moyen d'un vote par courriel. Le plan de l'initiative de cr�ation d'une grappe en nanotechnologie, formul� principalement par l'INN et pr�sent� par le CNRC (au Conseil du Tr�sor dans le cadre de la proposition du CNRC de renouveler son portefeuille d'initiatives des grappes de la phase II), portait principalement sur l'INN et pr�sentait le plan strat�gique de l'Institut en fonction de ses liens et de sa synergie avec le cadre et les priorit�s des autres partenaires fondateurs de l'INN. La strat�gie de l'INN a fortement influ� sur la strat�gie de nanotechnologie de l'Alberta (voirci-dessous). |
|
Faire des questions de ressources humaines non r�solues la priorit� de la direction. |
Cette recommandation sera appliqu�e imm�diatement. Le poste de directeur de la recherche constitue une priorit� absolue pour la direction, et bien que le premier concours n'ait pas donn� de r�sultats, des solutions novatrices sont mises en œuvre. Le processus de recrutement externe pourrait �tre �largi conform�ment au cadre de dotation du gouvernement f�d�ral, qui exige que les concours internes soient suivis de concours externes. D'autres questions relatives aux RH, comme les possibilit�s de carri�re � long terme, seront soulev�es devant les directeurs des deux organisations, mais il faut admettre qu'il pourrait ne pas y avoir de solution � toutes les questions relatives � la carri�re. |
Le poste de directeur de la recherche a �t� combl� avec une grande comp�tence � titre int�rimaire par un cadre sup�rieur exp�riment� du CNRC, ancien DG int�rimaire de l'INN, qui coordonne �galement l'initiative de nanotechnologie transorganisationnelle. |
|
Pr�ciser le r�le et les responsabilit�s du Conseil d'administration. |
Le r�le du Conseil d'administration est d�fini dans l'entente sur la gouvernance de l'INN. � mesure que le Conseil se r�unira et que l'INN sera �tabli, les responsabilit�s du Conseil seront mieux d�finies. Pour garantir que le r�le du Conseil tient compte des attentes des partenaires, des entrevues individuelles avec les partenaires et les membres du Conseil seront organis�es et les r�sultats seront communiqu�s lors de la r�union suivante du Conseil. |
Lors de la r�union commune du Conseil d'administration de l'INN et du Comit� de surveillance de l'INN d'octobre 2006, le Conseil d'administration a recommand� aux membres fondateurs de l'Institut de former au sein du Conseil un sous-comit� ex�cutif responsable des questions d'ordre op�rationnel de l'INN. Ce sous-comit� a �t� cr�� et a depuis mis � jour le document de gouvernance de l'INN selon les recommandations du Comit� de surveillance et du Conseil d'administration. La formation de ce nouveau sous-comit� permettra au Conseil d'administration de se concentrer sur l'orientation strat�gique de l'INN, ce qui all�gera son ordre du jour d�j� charg� par l'int�gration des cadres de fonctionnement des partenaires. Le Comit� de surveillance de l'INN s'est r�uni avec le Conseil d'administration en avril et a formul� des recommandations sur le r�le de ce dernier. |
|
Am�liorer les syst�mes administratifs. |
Cette recommandation sera mise en œuvre dans la mesure du possible. Le personnel du CNRC � l'INN et le personnel de l'Universit� de l'Alberta s'efforcent continuellement de trouver les moyens les plus efficaces de travailler ensemble. Un certain nombre d'ententes ont �t� sign�es mais il en reste davantage � mettre en œuvre. Des efforts particuliers de communication seront d�ploy�s afin de rendre ces processus plus transparents pour tous. |
Le sous-comit� ex�cutif nouvellement form� au sein du Conseil d'administration travaille avec le directeur g�n�ral de l'INN pour assurer la collaboration efficace des membres fondateurs. Le DG et le vice-pr�sident, Recherche, de l'Universit� de l'Alberta se rencontrent r�guli�rement afin de faciliter l'int�gration de leurs priorit�s et de leurs cadres organisationnels. Un r�gime d'approbation commun au CNRC et � l'Universit� est en cours d'�laboration. Un groupe de travail sp�cial sur les questions administratives a �t� form� parmi les membres de l'INN et leurs homologues de l'Universit�. On envisage la cr�ation d'autres �quipes d'interconnectivit� form�es de membres du CNRC et de l'Universit� de l'Alberta, en mati�re de mise sur pied des activit�s, d'exploration des processus de recrutement des travailleurs, de nomination conjointe en science, de commercialisation commune et de prestation partag�e de services, par exemple. |
|
Conclure un protocole de communication et �laborer un plan de communication. |
Cette recommandation est cruciale et on veillera � ce que le protocole de communication soit accept� et sign�. Les grands principes du protocole sont en place et une version pr�liminaire �t� �labor�e et accept�e en principe. Il reste � formuler la strat�gie de communication, qui rev�t une certaine importance, �tant donn� que l'INN passe d'une phase de r�action � une phase de proaction. |
Le directeur g�n�ral de l'INN a r�dig� un protocole de communication aux fins d'approbation par le comit� ex�cutif. Le protocole constitue un document �volutif, et des am�liorations sont apport�es � sa philosophie de base sur le plan du travail � mesure que les relations se consolident. |
|
Assurer un niveau durable de financement continu. |
Cette recommandation sera appliqu�e imm�diatement. Le r�sultat du processus d'�valuation sera introduit dans le plan d'activit�s relatif � la demande de renouvellement qu'a pr�sent� le CNRC au gouvernement du Canada. En parall�le, le gouvernement de l'Alberta est en train de formuler une strat�gie de nanotechnologie qui reconna�t le r�le essentiel de l'INN pour l'Alberta. |
Le CNRC a pr�sent� sa demande au gouvernement f�d�ral, dans sa proposition de renouvellement du financement de la phase II de la grappe. La strat�gie de nanotechnologie du gouvernement de l'Alberta a �t� annonc�e en mai 2007. L'investissement de 130 millions de dollars �chelonn� sur cinq ans comporte 16 �l�ments de financement destin�s � favoriser la commercialisation, � attirer et � conserver les travailleurs talentueux ainsi qu'� cr�er et � pr�server l'infrastructure. De nombreux �l�ments pr�sentent des possibilit�s de financement pour l'INN. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction et mesures propos�es |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
L'initiative ASSH devrait renforcer ses liens avec la collectivit� de la recherche en m�decine et en nutrition œuvrant dans le domaine des nutraceutiques et aliments fonctionnels (NAF). |
Accept�e. |
En 2006-2007, l'IBP-CNRC a parrain� un atelier conjoint sur la m�decine, la nutrition et la recherche avec l'industrie et des universit�s canadiennes. De plus, les chercheurs de l'IBP-CNRC �tablissent des relations officielles avec des chercheurs de l'Universit� du Manitoba et examinent la possibilit� de mener des activit�s de coop�ration avec l'Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels de l'Universit� Laval, le R�seau des aliments et des mat�riaux d'avant garde (AFMNet) et le Centre canadien de recherche agroalimentaire en sant� et m�decine. De m�me, l'IBP-CNRC tente d'�tablir des relations plus formelles avec l'INS-CNRC. Il existe actuellement deux projets conjoints en cours entre ces deux instituts. L'IBP-CNRC �tudie la possibilit� d'un arrangement plus formel et plus large en recherche et d'une expansion de BioAccess dans le Canada atlantique. En novembre 2006, le Centre de commercialisation BioAccess a ouvert ses portes � Saskatoon. Le CNRC a cr�� le Centre afin d'aider les soci�t�s novatrices de produits neutraceutiques, d'aliments fonctionnels et de produits de sant� naturels de l'Ouest canadien � mettre leurs produits sur le march�. Le CNRC offrira entre autres des travaux de recherche, des programmes de soutien au d�veloppement des affaires, des connaissances d'experts, des ressources et des conseils en mati�re d'activit�s commerciales. |
|
L'initiative ASSH devrait �laborer un plan d'activit�s ou op�rationnel pr�cisant clairement les engagements et les �ch�anciers relatifs � toute activit� future, au cas o� l'initiative de grappe technologique recevrait des fonds additionnels. |
Accept�e. |
Le plan est en cours d'�laboration et devrait �tre termin� d'ici d�cembre 2007. De plus, l'IBP-CNRC �labore actuellement des syst�mes de gestion et de gestion de projets. |
|
L'initiative ASSH devrait �laborer un plan de communications pour guider les futurs efforts en diffusion d'information avec les participants de la grappe NAF. Le plan devrait comprendre des strat�gies pour communiquer avec les intervenants de la grappe dans la collectivit� de la recherche/universitaire, ainsi qu'avec d'autres intervenants et l'industrie. |
Dans le cadre de sa planification des activit�s, l'IBP-CNRC a d�termin� que la planification de la diffusion d'information et les communications �taient des �l�ments critiques pour encourager le d�veloppement de la grappe dans la collectivit�. |
L'agent d'information de l'IBP-CNRC a formul� un plan de communications, mais sa mise en œuvre est en attente parce que la personne qui occupe ce poste a d�missionn� et qu'on n'a encore trouv� personne pour la remplacer. Un rempla�ant provisoire devrait �tre engag� d'ici ao�t 2007 et un employ� permanent officiel sera embauch� d'ici d�cembre 2007. Les activit�s de communications de BioAccess vont bon train. La r�daction des documents promotionnels est termin�e, un exercice de cartographie a d�but� et un atelier de BioMap a �t� pr�sent� en novembre 2006 � diverses PME de l'ensemble de l'Ouest canadien. De plus, BioAccess pr�pare un bulletin �lectronique qui sera termin� en septembre 2007. Celui-ci mettra les entreprises de l'Ouest canadien au courant des grandes r�alisations en mati�re de technologie et de produits et offrira de l'information sur des questions de commercialisation et d'affaires. L'IBP-CNRC a organis� deux ateliers � l'intention de l'industrie et des participants � la recherche d'int�r�t public de l'ensemble du Canada afin d'accro�tre les connaissances et les partenariats de la grappe. Un autre �v�nement semblable est pr�vu en d�cembre 2007. |
|
Recommandation |
R�ponse de la direction et mesures propos�es |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
L'IBD-CNRC devrait �tablir un cadre de responsabilisation entre l'IBD-CNRC et BCC afin de pr�ciser les r�les et les responsabilit�s des deux organismes, particuli�rement en ce qui concerne les modalit�s de location du CCTB-CNRC. |
En cours. Les locaux � louer au CCTB-CNRC sont d�j� occup�s � 48 % , seulement neuf mois apr�s la fin de la construction. Pour les locaux qui restent, conform�ment � l'accord de collaboration entre l'IBD et BCC qui �tablit les responsabilit�s des parties, l'IBD-CNRC consultera BCC pour d�terminer les besoins en espace dans les 12 prochains mois. Pour les locaux non requis par BCC, l'IBD-CNRC cherchera des locataires et des organismes qui ne feront pas partie du programme de BCC, afin de ne pas faire obstacle aux objectifs du programme de BCC. |
En date du 1er avril 2007, les locaux � louer au CCTB-CNRC �taient occup�s � 61 %. Le nombre total d'occupants du CCTB en date du 1er avril 2007 s'�levait � neuf, tous se rattachant � la grappe biom�dicale, dont quatre participent au programme de BCC. Lors des r�unions du comit� directeur, BCC a inform� le CNRC que quatre autres clients pourraient se rajouter au programme de BCC. |
|
Compte tenu du grand nombre de locaux au sein du CCTB-CNRC allou�s au BCC, l'IBD-CNRC devrait s'assurer que BCC a un plan d'activit�s en place indiquant les �ch�anciers, des jalons et des plans d'urgence pour trouver et conserver des clients appropri�s � l'espace allou� et pour participer aux programmes de BCC. |
Termin�e. BCC a un plan d'activit�s et un plan de travail, qui ont �t� pr�sent�s au conseil d'administration en mars 2006. BCC fait �galement �tat des progr�s r�alis�s au PARI-CNRC tous les mois. |
BCC poss�de un plan d'activit�s en place et rend compte de ses progr�s au PARI-CNRC chaque mois. |
|
Conform�ment � l'accord de collaboration entre l'IBD-CNRC et BCC, l'IBD-CNRC devrait assurer la tenue de r�unions officielles du comit� directeur mixte et l'�tablissement de m�canismes appropri�s en vue de surveiller les progr�s � l'�gard des engagements indiqu�s dans l'accord et de satisfaire aux exigences de reddition de comptes du gouvernement f�d�ral. |
Accept�e. Des r�unions de planification ont eu lieu de fa�on continue depuis octobre 2005 et selon les besoins du moment. Les r�unions du comit� directeur mixte commenceront au quatri�me trimestre de 2006. Au cours de ces r�unions, on aura recours � des programmes et des mesures connexes pour surveiller les progr�s � l'�gard des engagements. |
En plus des r�unions ponctuelles, plusieurs r�unions officielles du comit� directeur ont eu lieu aux dates suivantes au cours de l'exercice 2006-2007 :
|
|
Recommandation |
R�ponse de la direction et mesures propos�es |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
Proc�der rapidement � l'analyse pr�vue des besoins des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean afin de cerner les possibilit�s qu'offrent les plates-formes technologiques que le CTA-CNRC est � �tablir. |
Accept�e. La Carte routi�re technologique canadienne de la transformation de l'aluminium, dont le CNRC est un intervenant, privil�giera les besoins industriels nationaux et locaux. Des ateliers permettront aux entreprises d'exprimer leurs vues sur les priorit�s du secteur et leur difficult� � les respecter. |
L'�dition de 2006 de la Carte routi�re technologique canadienne de la transformation de l'aluminium a �t� publi�e le 31 mars 2007 au Saguenay. On peut obtenir gratuitement ce document en fran�ais et en anglais sur Internet � l'adresse suivante : http://www.trans-al.com/ . Plusieurs pr�sentations ont suivi le lancement officiel du document au Qu�bec. Ce document a �galement �t� distribu� en Ontario lors de la foire de l'Automotive Parts Manufacturers' Association qui a eu lieu � Hamilton en mai 2007. |
|
De concert avec les intervenants, selon une approche int�gr�e visant � offrir des programmes et des services soucieux des besoins des PME :
|
La phase initiale a eu lieu l'an dernier Des efforts ont �t� consacr�s � l'�valuation des besoins r�els du CTA-CNRC et de la grappe des technologies de l'aluminium. La plupart des activit�s ont eu lieu apr�s janvier 2007. Ces activit�s visaient � mieux faire conna�tre au nouveau chef du Centre d'information du CNRC (CIC) du Saguenay les activit�s et les intervenants de la grappe afin d'�valuer leurs besoins. Le coordonnateur r�gional de l'ICIST-CNRC et le chef du CIC du Saguenay ont travaill� en �troite collaboration avec la direction du CTA-CNRC afin d'harmoniser les services �ventuellement offerts avec ces besoins.
|
|
|
Examiner la gestion de la propri�t� intellectuelle avec les collaborateurs afin d'offrir aux membres des grappes technologiques l'acc�s aux nouvelles connaissances. |
Accept�e (avec des pr�cisions). L'approche utilis�e � ce jour avec nos collaborateurs repose sur l'accroissement de la vitesse de commercialisation, le d�veloppement des connaissances pour le CTA-CNRC, l'acc�s aux installations et le transfert de comp�tences en ce qui concerne les autres utilisateurs, tant � l'int�rieur de la grappe qu'au Canada. Les ententes sign�es par le CTA-CNRC continueront d'optimiser l'atteinte des objectifs strat�giques du CNRC en permettant le transfert de connaissances aux autres utilisateurs des grappes technologiques, afin de cr�er la richesse, des emplois et des avantages pour les Canadiens. |
Un accent particulier a �t� mis en 2006-2007 sur la d�finition des questions relatives � la PI et des ententes de PI pertinentes pour tous les nouveaux projets. La section des march�s relative � la PI est d�finie par l'agent de d�veloppement des entreprises du CTA-CNRC en consultation avec l'avocat sp�cialis� en PI du CNRC. L'entente de PI est �tudi�e par le comit� d'�tude des projets de l'IMI-CNRC avant la signature du march�. Cette d�marche a pour r�sultat des ententes de PI particuli�res, m�me si des projets multiples sont men�s avec le m�me partenaire industriel.
|
|
Recommandation |
R�ponse de la direction et mesures propos�es |
Progr�s accomplis en 2006-2007 |
|
Chercher de nouvelles occasions pour informer, �duquer et b�tir des liens avec les CTI du PARI-CNRC. |
Accept�e. Le CCFDP-CNRC consid�re le PARI-CNRC comme un partenaire essentiel pour diffuser ses services dans l'ensemble du secteur industriel canadien – un prolongement � ses professionnels de la vente et du marketing. La direction de l'ISM-CNRC rencontrera le directeur g�n�ral du PARI-CNRC en vue de d�terminer la meilleure fa�on d'informer les CTI des programmes et services commerciaux propos�s par le CCFDP-CNRC. |
La direction du CCFDP-CNRC a assist� � trois r�unions diff�rentes avec la direction (directeur g�n�ral et directeur de l'Ontario) du PARI-CNRC afin de concevoir une strat�gie pour la pleine int�gration du CCFDP-CNRC au PARI-CNRC. Il a �t� convenu que le directeur du CCFDP sera invit� aux futures r�unions r�gionales des CTI afin d'offrir un survol de cette initiative de la grappe et de ce qu'il pourrait faire pour leurs clients. Le PARI-CNRC a donn� une pr�sentation � la direction et aux chefs de groupe de l'ISM-CNRC sur le positionnement du PARI-CNRC afin de favoriser la commercialisation des capacit�s de l'ISM-CNRC. En retour, cet institut a accueilli une d�l�gation de plusieurs CTI du PARI-CNRC o� il a donn� des pr�sentations sur ses programmes de R‑D, sur le CCFDP-CNRC et sur la mani�re dont il collabore avec ses clients. Cet �v�nement a mis en lumi�re bon nombre d'activit�s que l'on juge pr�tes � l'exploitation commerciale. Deux clients ont d�j� �t� rep�r�s par le PARI-CNRC et des possibilit�s d'affaires avec le CCFDP-CNRC sont � l'�tude. |
|
Continuer de prendre de l'expansion dans le secteur priv� et de tisser des liens afin de faire conna�tre les services propos�s par le CCFDP-CNRC. |
Accept�e. C'est essentiel pour ce que le CCFDP-CNRC doit faire – assurer la diffusion des services du CCFDP-CNRC offerts au secteur industriel. Pour ce faire, le CCFDP-CNRC s'assurera que ses membres du personnel du bureau d'affaires connaissent bien les pratiques commerciales du CCFDP-CNRC. Le CCFDP-CNRC continuera �galement de participer aux salons professionnels tels que Photonics North et West ainsi qu'� si�ger aux comit�s d'associations de l'industrie photonique afin d'informer les clients industriels �ventuels. |
Un CTI du PARI-CNRC sp�cialis� en photonique a �t� d�sign� en tant que principale personne-ressource pour le personnel du PARI-CNRC qui souhaite acc�der � l'expertise du CCFDP-CNRC. Il a �galement �t� convenu que le Centre fera l'objet d'une attention sp�ciale lors d'un certain nombre de r�unions r�gionales du PARI-CNRC en Ontario, au Qu�bec, dans la r�gion de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien au cours des douze prochains mois. Les CTI du PARI-CNRC apporteront leur soutien au Bureau des affaires commerciales de l'ISM-CNRC et au CCFDP-CNRC lors du prochain �v�nement de Photonics North et du Symposium ex�cutif sur la commercialisation de la photonique. |
|
R�soudre la question de l'attribution des imp�ts fonciers et des co�ts d'�lectricit�. |
Accept�e. La direction de l'ISM-CNRC rencontrera le directeur g�n�ral des SAGI afin d'�valuer le co�t r�el des services publics et les taxes du complexe du CCFDP-CNRC. � noter qu'une seule journ�e d'interruption de service au CCFDP-CNRC se solde par un arr�t des activit�s durant au moins deux jours, ce qui entra�ne des co�ts de 50 000 $ en perte d'occasion pour le CCFDP-CNRC. Les SAGI doivent tenir compte de telles pressions. |
On a estim� le co�t moyen des services publics et des taxes pour les activit�s des deux derni�res ann�es et on a int�gr� cette estimation au plan d'activit�s du CCFDP-CNRC. On pr�voit que ces co�ts seront pleinement couverts par la demande de cr�dits budg�taires pr�sent�e au Conseil du Tr�sor. La direction de l'ISM-CNRC continue de travailler en �troite collaboration avec les SAGI afin de minimiser les interruptions de services. Les coupures de courant sur l'ensemble du site (aux fins de l'entretien p�riodique d'Hydro Ottawa) entra�nent toujours un arr�t complet des installations, comme ce fut le cas derni�rement. Malgr� la planification � long terme, le Centre a perdu presque deux jours d'activit�s. |
|
Examiner le potentiel du march� et �tablir des attentes de recouvrement des co�ts par le CCFDP-CNRC. |
Accept�e. Le CCFDP-CNRC continuera de mettre � jour son plan de commercialisation de fa�on r�guli�re et d'obtenir des conseils d'autres organismes internationaux (tels que OIDA) � cet �gard. Comme il a �t� �tabli dans la demande initiale aupr�s du Conseil du Tr�sor, la politique de recouvrement des co�ts du CCFDP-CNRC vise � r�cup�rer une partie seulement et non l'ensemble des co�ts d'exploitation du Centre. L'incidence du CCFDP-CNRC sera mesur�e en fonction de son efficacit� � stimuler l'�conomie canadienne (croissance de l'emploi, attrait des PME, placement de capital de risque, produit commercial sur le march�, etc.). Le CCFDP-CNRC continuera � tenir des r�unions d'affaires et de commercialisation toutes les deux semaines afin de surveiller les recettes pr�vues du Centre. |
Le CCFDP-CNRC a continu� de chercher de nouvelles occasions d'affaires tant au Canada qu'� l'�chelle internationale. Les prix factur�s pour les services de fabrication ont �t� pleinement �valu�s selon le principe comptable uniformis� du CNRC et semblent concurrentiels. Certains des principaux param�tres �tablis pour ce secteur sont li�s aux retomb�es industrielles du CCFDP-CNRC. Celles-ci peuvent �tre mesur�es selon la croissance des entreprises clientes (attraction d'investissements, augmentation des revenus, hausse des emplois). La direction du CCFDP-CNRC conna�t le d�licat �quilibre � pr�server pour maximiser le rendement du capital investi. Le CCFDP-CNRC continuera de surveiller la fixation des prix par le march� pour des services semblables afin de s'assurer qu'il offre � ses clients le meilleur rapport qualit�-prix. Le suivi de ces param�tres fera partie des attributions du nouveau responsable du soutien technique � la commercialisation du CCFDP-CNRC. |
|
�tablir un cadre de gestion et de responsabilisation ax� sur les r�sultats (CGRR) qui prend en compte le financement sous forme de contributions ou l'ex�cution des programmes des collaborateurs. |
Cette recommandation n'est pas accept�e. L'Universit� Carleton est responsable du programme de formation et a re�u des fonds de la province pour exercer cette fonction. Le CNRC n'a aucun pouvoir ni aucune autorit� dans ce domaine, bien que le CCFDP-CNRC soit d�sign� dans le programme de formation th�orique de l'Universit� Carleton. |
Cette recommandation n'est pas accept�e. |
|
Poursuivre l'�laboration des strat�gies de commercialisation et de communication, particuli�rement celles visant directement les entreprises, y compris celles d'Ottawa. |
Accept�e. Comme il a d�j� �t� mentionn�, la commercialisation et la communication jouent un r�le essentiel dans une entreprise telle que le CCFDP-CNRC et sont des outils qui doivent �tre exploit�s. Le CCFDP-CNRC continuera d'obtenir des donn�es relatives � la commercialisation et � la concurrence � l'aide de ses SF internes et tentera de mieux s'int�grer aux ressources de l'ICIST. Ainsi, dans son plan d'activit� propos� (2007-2012), le CCFDP-CNRC pr�voit des partenariats avec l'ICIST-CNRC pour obtenir des donn�es de veille technologique concurrentielle qui seront distill�es et analys�es afin d'aider � cerner les menaces et les possibilit�s pour le Centre – les r�sultats seront int�gr�s dans le processus de d�cision de gestion. Sur le plan des communications, le CCFDP-CNRC continuera de mettre � jour son site Web et de diffuser ses services aupr�s des parties int�ress�es. Un agent sup�rieur en communication sera embauch� par le Centre pour s'acquitter de ces fonctions. |
Quatre r�unions ont eu lieu entre l'ISM-CNRC et l'ICIST-CNRC afin de d�finir le profil du poste d'analyste des entreprises technologiques au sein de l'ICIST-CNRC. Un examen �crit destin� � la pr�s�lection des candidats est en cours d'�laboration. Une annonce pour le poste d'agent de d�veloppement des entreprises en soutien technique � la commercialisation pour le CCFDP-CNRC est en cours de finalisation et sera affich�e sous peu. On met � jour des brochures sur le CCFDP-CNRC, dont le contenu sera aussi utilis� pour compl�ter le site Web du Centre. Le CCFDP-CNRC a �galement travaill� activement � consolider les relations existantes avec les grappes photoniques dirig�es par l'industrie (Ottawa, Montr�al, Qu�bec, Colombie-Britannique, sud de l'Ontario, Rochester, Tucson, Phoenix, San Jose, Pittsburgh et Boston) et tente de nouer de nouvelles relations avec d'autres grappes photoniques � l'�chelle internationale (France, Italie, Espagne, Chine, Floride, Caroline du Nord, Colorado). � cette fin, le CCFDP-CNRC a obtenu un projet financ� de l'initiative de repr�sentation accrue aux �tats-Unis afin d'accro�tre sa pr�sence et celle de ses clients sur les march�s am�ricains. |
|
Mener une �tude comparative dans environ cinq ans pour mesurer la position et la force du service du CCFDP-CNRC par rapport aux autres centres. |
Accept�e avec des changements. Bien que le CCFDP-CNRC convienne qu'il serait n�cessaire de proc�der � une analyse comparative pour �valuer les forces et les faiblesses du Centre en regard des autres centres, cette analyse doit �tre men�e avant l'�ch�ance de cinq ans. En fait, cet exercice devrait �tre effectu� de fa�on continue dans le cadre d'un plan de marketing et en m�me temps que la mise � jour de la carte routi�re technologique du CCFDP-CNRC – les deux ensembles de donn�es sont n�cessaires pour mener une analyse globale du service concurrentiel du Centre. |
Le CCFDP-CNRC a assum� un r�le de leader en rassemblant les Centres d'excellence de l'Ontario, RDDC, Commerce international, le R�seau photonique du Qu�bec, l'Institut national en optique photonique, CMC Microsystems et les gouvernements de la Colombie-Britannique et de l'Alberta afin de mener une �tude nationale d'�talonnage en photonique qui comprend des soci�t�s de photonique de l'ensemble du Canada. Cette �tude est r�alis�e sous la banni�re du Comit� du Consortium photonique du Canada, qui est pr�sid� par le directeur du CCFDP-CNRC. Le rapport doit �tre remis en mai 2008. |
|
Examiner les politiques de communication en fonction du partenariat CNRC-gouvernement de l'Ontario/Universit� Carleton. |
Accept�e. Cela d�pendra bien entendu de l'appui continu assur� de l'Ontario et de l'Universit� Carleton. � ce jour, aucun probl�me de communication important n'a eu lieu entre les trois parties int�ress�es. L'Universit� Carleton et la province de l'Ontario semblent souscrire � la d�signation du Centre comme �tant le � CCFDP-CNRC �. |
Des cadres sup�rieurs de l'Universit� Carleton et du CNRC ont rencontr� leurs homologues du gouvernement de l'Ontario afin de d�terminer le positionnement du CCFDP-CNRC pour le prochain cycle de financement du gouvernement provincial. L'Universit� Carleton et le CNRC travaillent ensemble � cette prochaine proposition. L'Universit� Carleton et le CNRC ont �galement travaill� ensemble � une demande de subvention au CRSNG concernant l'acc�s aux grandes installations qui aurait permis au CCFDP-CNRC d'acc�der davantage (une journ�e par semaine) aux projets de chercheurs des universit�s canadiennes. Bien que cette demande n'ait pas �t� accept�e, le soutien de la communaut� des utilisateurs universitaires et les r�troactions du comit� d'examen ont tous deux �t� tr�s positifs. |
|
Le CNRC assure la direction du volet de l’initiative en R-D en g�nomique men�e. Des renseignements suppl�mentaires sur les initiatives horizontales se trouvent � l'adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr3/06-07/index_f.asp. |
|
Le CNRC suit les politiques et les param�tres fix�s par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor concernant les voyages. Le CNRC ne dispose d'aucune autorisation sp�ciale en mati�re de voyage. |
|
Une lettre concernant le statut des r�servoirs de stockage sur des terrains appartenant au CNRC a �t� achemin�e au ministre de l'Environnement le 3 avril 2007. |
Section IV — Autres sujets d'int�r�t
Prix et r�alisations
- Aitken, J. IRA-CNRC
Troph�e Trans-Canada (McKee) de l'Institut a�ronautique et spatial du Canada, Institut a�ronautique et spatial du Canada - Arsenault, C., Duval, C., Newsham, G., Tosco, A., Veitch, J. IRC-CNRC
Prix Taylor Technical Talent 2006, pour l'article � Task Lighting Effects on Office Worker Satisfaction and Performance, and Energy Efficiency �, Illuminating Engineering Society of North America - Atif, M. IRC-CNRC
R��lu pr�sident de l'International Energy Agency Executive Committee de l' Energy Conservation for Buildings and Community Systems Programme (ECBCS), ECBCS - Baker, H. IRC-CNRC
R�cipiendaire d'une bourse de l'ICI, mis en nomination par la Soci�t� canadienne de g�otechnique pour l'excellence de ses services aux communaut�s g�otechnique et g�oscientifique, Institut canadien des ing�nieurs - Beaulieu, D., Brothers, M., Campbell, R., Chen, J., Chouinard, G., Delannoy, M. l., Dicaire, P., Djokic, D., Ferguson, P., Fisher, K., Harrison, M., Hojjati, M., Kay, T., Kratz, J., Lalibert�, J., Lalonde, J., Luteyn, A., Moyes, B., Octeau, M-A., Rogers, J., Shane, D., Tanguay, M., Yousefpour, A. IRA-CNRC
Prix Partenariat 2006 avec leurs partenaires de projet, Delastek, Bell Helicopter, Universit� Concordia et Pratt & Whitney Canada, Association de la recherche industrielle du Qu�bec (ADRIQ) - Black, R. PARI-CNRC
Membre de la Soci�t� canadienne de g�nie biom�dical, Soci�t� canadienne de g�nie biom�dical - Blanchet, C., Newsham, G., Richardson, C., Veitch, J. IRC-CNRC
Prix Walsh-Weston 2006, pour l'article � Lighting Quality Research Using Rendered Images of Offices �, Society of Light and Lighting - Borgeat, L., Poirier, G., Taylor, J., Blais, F., Cournoyer, L., Picard, M., Godin, G., Beraldin, J.-A., Lahanier, C., Rioux, M. ITI-CNRC
Deuxi�me prix du Scientific and Engineering Visualization Challenge 2006, National Science Foundation, �.-U. - Boyd, R. IBM-CNRC/IENM-CNRC
Le document � Rapid Communications in Mass Spectrometry �, 30 mai 2006, lui a �t� d�di�. - Buriak, J. INN
Bourse du E. W. R. Steacie Memorial, CRSNG - Caikang, K.F., Gu, E., Henry, S., Hernandez, M., Hesser, R., Hu, C., Jankovic, J., Martin, J. J., V�zquez, O. H., Veljkovic, M., Wang, H. IIPC-CNRC
Prix d'excellence de la fonction publique, Commission de la fonction publique - Charbonneau, S. ISM-CNRC
Prix des partenariats en technologie, Centre de recherche et d'innovation d'Ottawa (OCRI) - Corkum, P. ISSM-CNRC
Prix Killam, Conseil des Arts du Canada - Corkum, P. ISSM-CNRC
Prix Arthur L. Schwalow en science des lasers, American Physical Society - Corkum, P. ISSM-CNRC
Docteur honoraire, Universit� Acadia - Crampton, G., Cunningham, H., Kim, A. IRC-CNRC
Prix 2006 des Partenaires f�d�raux en transfert de technologie (PFT) pour � le succ�s du transfert et de la commercialisation de la technologie d'extinction par mousse � air comprim�, Partenaires f�d�raux en transfert de technologie - D'Iorio, M. ISM-CNRC
Membre de la Soci�t� royale du Canada, Soci�t� royale du Canada - Erdogmus, H. ITI-CNRC
R�dacteur en chef de la revue Software Magazine de l'IEEE, Institute for Electrical and Electronics Engineers - Ferrie, A. IBP-CNRC
Correspondant national � l'International Association for Plant Biotechnology (IAPB) - Gosselin, G. IRC-CNRC
Bourses de l'Institut canadien des ing�nieurs et de la Soci�t� canadienne de g�nie civil, Institut canadien des ing�nieurs, Soci�t� canadienne de g�nie civil - Gupta, J. ISM-CNRC
Prix de l'Institut des t�l�communications de la Capitale nationale (ITCN) pour les moins de 40 ans pour, ses recherches en photonique, Centre de recherche et d'innovation d'Ottawa (OCRI) - Hawrylak, P. ISM-CNRC
Membre de la Soci�t� royale du Canada, Soci�t� royale du Canada - Jahazzi, M. IRA-CNRC
Prix Morris Cohen 2006 en hommage � sa contribution remarquable � l'analyse des d�faillances des composants a�rospatiaux, Section sur l'int�grit� et le rendement des mat�riaux, Soci�t� de la m�tallurgie de l'ICM - Jennings, H. J. ISB-CNRC
Prix Galien Canada (Recherche) 2006, Prix Galien Canada - Johnston, A. IRA-CNRC, Hubert, M. P. Universit� McGill
Prix de r�alisation pour leur contribution � la technologie de s�chage par faisceau d'�lectrons des structures en mat�riau composite, The Technical Collaboration Program (TTCP) Panel MAT TP6/TP7 - Ledoux, J.-J. ISM-CNRC
Prix du pr�sident de la CABI, Canadian Association of Business Incubators - Liu, H.C. ISM-CNRC
Membre de l'IEEE, Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) - Liu, F., Smallwood, G., Snelling, D. ITPCE-CNRC
Fast Breaking Paper, distinction accord�e pour avoir obtenu la plus grande hausse de citations dans le premier 1 % de l'ensemble des documents d'ing�nierie index�s par ESI, Thomson Scientific – Essential Science Indicators - Luong, J. IRB-CNRC
Bourse de s�jour Walton, Science Foundation Ireland, Irlande, mars 2007 - MacDougall, B. ITPCE-CNRC
Membre �lu de l'Electrochemical Society - Madej, A. IENM-CNRC
Subvention � la d�couverte du CRSNG pour son document intitul� � High Resolution Studies of a Single Trapped Ion and its Environment and Quantum State Manipulation �, Conseil de recherches en sciences naturelles et en g�nie du Canada - Magee, B. IRC-CNRC
Prix d'appr�ciation de l'ASTM soulignant l'excellence de son service au Committee D22 on Air Quality et au Subcommittee D22.05 on Indoor Air de l'ASTM, pour avoir organis� et pr�sid� la conf�rence de 2004 sur l'essai de contr�le des �missions int�rieures intitul�e � Methods and Interpretation �, et pour son service actuel au Subcommittee D22.05 on Indoor Air, ASTM - McCreery, R. INN
Prix Ernest Yeager, section de Cleveland de l'Electrochemical Society - McCreery, R. INN
Chercheur-boursier de l'Alberta Ingenuity, Alberta Ingenuity - Moreau, C. IMI-CNRC
Membre �lu de ASM International, ASM International - Moreau, C. IMI-CNRC
Prix G. MacDonald Young, American Society for Metals Canada Council (ASMCC) - Nowark, A. IBD-CNRC
M�daille d'argent du Gouverneur g�n�ral, Gouverneur g�n�ral, mai 2006 - Paroli, R. IRC-CNRC
Prix de reconnaissance pour services exceptionnels de la CSASS, Canadian Society for Analytical Sciences and Spectroscopy - Proulx, G. IRC-CNRC
Choisi pour si�ger au conseil d'administration de la Society of Fire Protection Engineers (SFPE), Society of Fire Protection Engineers - Rogge, R. ISSM-CNRC
Prix � Thirty From the Past Thirty Years �, association des dipl�m�s de l'Universit� Brock - Rowell, N., Baribeau, J.-M. IENM-CNRC, Lockwood, D. ISM-CNRC
Meilleurs articles 2006 du Journal of Physics: Condensed Matter, � Ge dots and nanostructures grown epitaxially on Si �, Journal of Physics: Condensed Matter (JPCM) - Sabsabi, M. IMI-CNRC
Certificat d'appr�ciation pour l'excellence scientifique du programme 2006 de LIBS. Remis par l'ancien pr�sident des conf�rences de LIBS, LIBS 2006 - Smallwood, G. ITPCE-CNRC
Prix Forest R. McFarland pour s'�tre distingu� comme collaborateur d'importance, Society for Automotive Engineers - Smith, I. IBD-CNRC
Nomm� membre Paul Harris, club Rotary de Winnipeg-Assiniboine - Smith, I. IBD-CNRC
Professeur honoraire, Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, juin 2006 - Stetson, P. IHA-CNRC
Membre de la Soci�t� royale du Canada, Soci�t� royale du Canada - Sturgeon, R. IENM-CNRC
Prix Maxxam pour son � �minente contribution dans le domaine de la chimie analytique lorsqu'il travaillait au Canada �, Soci�t� canadienne de chimie - Timco, G. CHC-CNRC
Prix � Thirty from the Past Thirty �, association des dipl�m�s de l'Universit� Brock - Valzano, V., Beraldin, J.-A. ITI-CNRC
Premier prix dans la cat�gorie eScience du eContent Award Italy, Fondazione Politechnico di Milano, dans le cadre du Sommet mondial des Nations Unies sur la soci�t� de l'information - Veitch, J. IRC-CNRC
Bourse de la SCP, Soci�t� canadienne de psychologie (SCP) - Viktor, H. L., Paquet, E. ITI-CNRC
Prix � PKDD Innovative Application � pour la communication intitul�e � Mesurage par ajustage : Fa�onnage virtuel par l'analyse et la classification des masses �, ECML PKDD, 17e European Conference on Machine Learning et 10e European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Berlin, Allemagne - Villeneuve, D. ISSM-CNRC
Bourse de l'American Physical Society, American Physical Society - Wickramasinghe, V., Zimcik, D. G. IRA-CNRC
Prix de r�alisation pour leur contribution � l'affectation d'ex�cution du TTCP-TP4 � Next Generation Active Buffeting Induced Stress Suppression System �, The Technical Collaboration Program (TTCP) - Wood, B. IENM-CNRC
Membre �lu de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE - Wood, B. IENM-CNRC
Prix Astin 2006, � meilleur document de la conf�rence de 2006 � (premier Canadien � remporter le prix), conf�rence de 2006 du National Conference of Standards Laboratories International - Wood, B. IENM-CNRC
Pr�sidence du CODATA Task Group on Fundamental Constants (premier Canadien � occuper ce poste), comit� scientifique du Conseil international pour la science (CIUS) - Wu, L. IENM-CNRC
Vice-pr�sidence, CSC/IEC/TC 29 �lectroacoustique, Conseil canadien des normes - Yousefi, A. M. IMI-CNRC
Mention remarquable par la compagnie YAPP pour la formation en Chine, Compagnie YAPP
Pour nous joindre
Renseignements sur la haute direction et les directions centrales
|
Pr�sident |
Secr�taire g�n�rale |
|
Vice-pr�sident, Sciences de la vie |
Vice-pr�sidente, Soutien technologique et industriel |
|
Vice-pr�sident, Sciences physiques |
Vice-pr�sident, Services corporatifs |
|
Vice-pr�sident, G�nie |
Renseignements g�n�raux |
|
Administration centrale |
Responsable du RMR |
|
Acc�s � l'information et protection des renseignements personnels |
|
Recherche-d�veloppement
Sous la direction du vice-pr�sident, Sciences de la vie
Institut de recherche en biotechnologie (IRB-CNRC) – Montr�al (Qc)
Directeur g�n�ral : Michel Desrochers
Renseignements g�n�raux : 514-496-6100 http://www.bri-irb.nrc-cnrc.gc.ca
Institut du biodiagnostic (IBD-CNRC) – Winnipeg (Man.)
Directeur g�n�ral : Ian Smith
Renseignements g�n�raux : 204-983-7692 http://www.ibd.nrc-cnrc.gc.ca
Institut des sciences biologiques (ISB-CNRC) – Ottawa (Ont.)
Directeur g�n�ral : Jim Richards (par int�rim)
Renseignements g�n�raux : 613-993-5812 http://ibs-isb.nrc-cnrc.gc.ca
Institut des biosciences marines (IBM-CNRC) – Halifax (N.-�.)
Directrice g�n�rale : Joan Kean-Howie
Renseignements g�n�raux : 902-426-8332 http://imb-ibm.nrc-cnrc.gc.ca
Institut de biotechnologie des plantes (IBP-CNRC) – Saskatoon (Sask.)
Directeur g�n�ral : Kutty Kartha
Renseignements g�n�raux : 306-975-5248 http://pbi-ibp.nrc-cnrc.gc.ca/
Sous la direction du vice-pr�sident, Sciences physiques
Institut Herzberg d'astrophysique (IHA-CNRC) – Victoria et Penticton (C.-B.)
Directeur g�n�ral : Gregory G. Fahlman
Renseignements g�n�raux : 250-363-0001 http://hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca
Institut de technologie des proc�d�s chimiques et de l'environnement (ITPCE-CNRC) – Ottawa (Ont.)
Directeur g�n�ral : Don Singleton
Renseignements g�n�raux : 613-993-4041 http://icpet-itpce.nrc-cnrc.gc.ca
Institut de technologie de l'information (ITI-CNRC) –Ottawa (Ont.), Gatineau (Qu�bec), Fredericton (N.‑B.), Moncton (N.‑B.) et Saint John (N.‑B.)
Directeur g�n�ral : Christian Couturier
Renseignements g�n�raux : 506-444-6132 http://iit-iti.nrc-cnrc.gc.ca
Institut des sciences des microstructures (ISM-CNRC) – Ottawa (Ont.)
Directrice g�n�rale : Marie D'Iorio
Renseignements g�n�raux : 613-993-4583 http://ims-ism.nrc-cnrc.gc.ca
Institut des �talons nationaux de mesure (IENM-CNRC) – Ottawa (Ont.)
Directeur g�n�ral : Jim McLaren
Renseignements g�n�raux : 613-998-7018 http://inms-ienm.nrc-cnrc.gc.ca
Institut national de nanotechnologie (INN) – Edmonton (Alb.)
Directeur g�n�ral : Nils Petersen
Renseignements g�n�raux : 780-492-8888 http://nint-innt.nrc-cnrc.gc.ca
Institut Steacie des sciences mol�culaires (ISSM-CNRC) – Ottawa et Chalk River (Ont.)
Directeur g�n�ral : Danial Wayner
Renseignements g�n�raux : 613-991-5419 http://steacie.nrc-cnrc.gc.ca
Sous la direction du vice-pr�sident, G�nie
Institut de recherche a�rospatiale (IRA-CNRC) – Ottawa (Ont.) et Montr�al (Qc)
Directeur g�n�ral : Jerzy Komorowski
Renseignements g�n�raux : 613-993-5738 http://iar-ira.nrc-cnrc.gc.ca
Institut d'innovation en piles � combustible (IIPC-CNRC) – Vancouver (C.-B.)
Directrice g�n�rale : Maja Veljkovic
Renseignements g�n�raux : 604-221-3099 http://ifci-iipac.nrc-cnrc.gc.ca
Institut des mat�riaux industriels (IMI-CNRC) –Boucherville et Saguenay (Qc)
Directeur g�n�ral : Blaise Champagne
Renseignements g�n�raux : 450-641-5000 http://www.imi.nrc-cnrc.gc.ca
Institut des technologies de fabrication int�gr�e (ITFI-CNRC) – London (Ont.)
Directeur g�n�ral : Georges Salloum
Renseignements g�n�raux : 519-430-7092 http://imti-itfi.nrc-cnrc.gc.ca
Institut des technologies oc�aniques (ITO-CNRC) – St. John's (T.-N.-L.)
Directrice g�n�rale : Mary Williams
Renseignements g�n�raux : 709-772-6001 http://iot-ito.nrc-cnrc.gc.ca
Institut de recherche en construction (IRC-CNRC) – Ottawa (Ont.) et Regina (Sask.)
Directeur g�n�ral : Bob Bowen
Renseignements g�n�raux : 613-993-2607 http://irc.nrc-cnrc.gc.ca
Centre d'hydraulique canadien (CHC-CNRC)
Directeur ex�cutif : Etienne Mansard
Renseignements g�n�raux : 613-993-9381 http://chc.nrc-cnrc.gc.ca
Centre de technologie des transports de surface (CTTS-CNRC) – Ottawa (Ont.)
Directeur g�n�ral : John Coleman
Renseignements g�n�raux : 613-998-9638 http://cstt-ctts.nrc-cnrc.gc.ca
Soutien technologique et industriel
Sous la direction du vice-pr�sident, Soutien technologique et industriel
Institut canadien de l'information scientifique et technique (ICIST-CNRC) – Ottawa (Ont.) ainsi que des bureaux r�partis un peu partout au Canada
Director General: Pam Bjornson
Renseignements g�n�raux : 1-800-668-1222 http://cisti-icist.nrc-cnrc.gc.ca
Programme d'aide � la recherche industrielle (PARI-CNRC) – Ottawa (Ont.) ainsi que des bureaux un peu partout au Canada
Directeur g�n�ral : Tony Rahilly
Renseignements g�n�raux : 1-877-994-4727 http://irap-pari.nrc-cnrc.gc.ca
Services corporatifs
Sous la direction du vice-pr�sident, Services corporatifs
Direction des services administratifs et de la gestion de l'immobilier (DSAGI-CNRC)
Directeur g�n�ral : Jerry Rogers
Renseignements g�n�raux : 613-993-2440 jerry.rogers@nrc-cnrc.gc.ca
Direction de la strat�gie et du d�veloppement (DSD-CNRC)
Directeur g�n�ral (int�rimaire) : Rob James
Renseignements g�n�raux : 613-990-7381 rob.james@nrc-cnrc.gc.ca
Direction des services de gestion de l'information (DSGI-CNRC)
Directeur g�n�ral : Andy Savary
Renseignements g�n�raux : 613-991-3773 andy.savary@nrc-cnrc.gc.ca
Directions centrales
Sous la direction du pr�sident
Bureau de la direction et du secr�taire g�n�ral du CNRC
Secr�taire g�n�rale: Marielle Pich�
Renseignements g�n�raux : 613-998-4579 marielle.piche@nrc-cnrc.gc.ca
Direction des finances (DF-CNRC)
Directeur g�n�ral : Daniel Gosselin
Renseignements g�n�raux : 613-990-7471 daniel.gosselin@nrc-cnrc.gc.ca
Direction des ressources humaines (DRH-CNRC)
Directrice g�n�rale : Mary McLaren
Renseignements g�n�raux : 613-993-9391 mary.mclaren@nrc-cnrc.gc.ca
V�rification interne
Directrice: Jayne Hinchliff-Milne
Renseignements g�n�raux : 613-949-7689 jayne.hinchliff-milne@nrc-cnrc.gc.ca
Services juridiques du CNRC
Directeur: Louis Robayo
Renseignements g�n�raux : 613-993-0035 louis.robayo@nrc-cnrc.gc.ca
Membres du Conseil du CNRC
|
Pierre Coulombe |
Margaret Lefebvre |
|
Patricia B�retta |
Gilles Patry |
|
Louis Brunel |
Alan Pelman |
|
Paul Clark |
Katherine Schultz |
|
Delwyn Fredlund |
Barbara Stanley |
|
Peter Frise |
Howard Tennant |
|
James Hatton |
|
Tableau 3-7B : Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation
|
En novembre 2004, les ministres du Conseil du Tr�sor ont approuv� la Politique sur les normes de service pour les frais d'utilisation. Cette politique exige des minist�res qu'ils produisent un rapport sur les normes qui encadrent la prestation des services rendus moyennant certains frais sur une base autre que contractuelle. Dans le cas du CNRC, cette politique s'applique aux programmes suivants :
|
|
A. Frais ext�rieurs |
Normes de service |
Rendement en 2006-2007 |
Consultation des intervenants |
|
|
Frais exig�s pour la livraison de documents par l'ICIST-CNRC |
Direct – Command� par des moyens �lectroniques et livr� par Ariel ou par t�l�copieur |
Traitement des commandes dans un d�lai de 24 heures* |
89 % de toutes les commandes directes ont �t� livr�es dans un d�lai de 24 heures. |
L'ICIST-CNRC a effectu� un sondage aupr�s de ses clients sur l'acc�s � l'information et sur la livraison de l'information � l'ext�rieur en novembre 2006. L'ICIST-CNRC a proc�d� � 20 entrevues avec des chercheurs qui ont eu acc�s � de l'information scientifique, technique ou m�dicale en mars 2007. |
|
Direct – Command� et livr� par des moyens autres qu'�lectroniques |
||||
|
Direct – Command� par des moyens �lectroniques et achemin� par livraison �lectronique s�curis�e |
||||
|
Global – Copies et pr�ts |
Ont re�u l'article recherch�. |
95 % des commandes ont �t� ex�cut�es. |
||
|
Urgent |
R�ponse re�ue aux commandes dans un d�lai de 2 heures |
99 % des clients ont re�u une r�ponse dans un d�lai de 2 jours. |
||
|
Prise de contact du client |
Satisfaction du client : Dans moins de 3 % des commandes trait�es, il y a eu une prise de contact avec le service d'aide � la client�le |
2,75 % des commandes ont entra�n� une prise de contact avec le service d'aide � la client�le. |
||
|
Vente de publications de l'IRC-CNRC |
Traitement des commandes |
Toutes les commandes ont �t� trait�es dans un d�lai de 2 semaines suivant la r�ception de toute l'information requise. |
De 1 � 14 jours : 88,5 % |
|
|
Commentaires ou plaintes des clients |
R�pondu aux plaintes et commentaires dans un d�lai de 2 jours ouvrables. |
62,5 % dans 1 ou 2 jours ouvrables |
|
|
|
Demande d'information |
Accus� de r�ception dans un d�lai de 2 jours ouvrables. |
98 % dans un d�lai de 2 jours ouvrables |
|
|
|
Programme des mat�riaux de r�f�rence certifi�s (IBM CNRC) |
Commandes |
Commande trait�e et exp�di�e dans un d�lai de 3 jours ouvrables suivant la r�ception de toute l'information requise |
99 % |
Taux de r�ponse 13 % 73,5 % des r�pondants sont tr�s satisfaits 24,5 % sont satisfaits 2 % sont plus ou moins satisfaits 0 % sont insatisfaits |
|
D�lai de livraison |
Livraison dans les 5 jours ouvrables |
92 % |
||
|
Programme de mat�riaux de r�f�rence certifi�s de l'IENM-CNRC |
D�lai de livraison entre la r�ception de la commande et son exp�dition |
3 jours ouvrables |
Il y a eu 678 commandes. 91,15 % des commandes livr�es r�pondaient � la norme. Il y a eu des probl�mes de livraison imputables � des p�nuries de personnel pendant une courte p�riode � l'�t� 2006, ce qui a allong� le d�lai moyen de livraison. On estime que ce chiffre aurait �t� d'environ 96 % si on avait dispos� d'un effectif complet. |
Taux de r�ponse 9,4 % |
Tableau 3-8 : Renseignements sur les d�penses de projets (en millions de dollars)
|
|
2006-2007 |
||||||
|
Activit� de programme |
Co�t total estimatif courant |
D�penses r�elles 2004-2005 |
D�penses r�elles 2005-2006 |
Total du Budget principal des d�penses |
Total des d�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
|
Recherche et d�veloppement |
|
|
|
|
|
|
|
|
Centre des technologies de fabrication en a�rospatiale, phase de cl�ture du projet, (S-APE) |
34,1 |
4,9 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
|
Centre des technologies de l'aluminium, phase de cl�ture du projet, (S-APE) |
34,4 |
5,0 |
2,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
Construction du Centre canadien de fabrication de dispositifs photoniques, phase de cl�ture du projet, (S‑APE) |
19,0 |
2,2 |
1,1 |
- |
- |
0,6 |
0,6 |
|
Construction d'une installation de partenariat industriel (IPI) adjacente � l'IBD-CNRC, phase de cl�ture du projet, (S-APE) |
8,5 |
6,7 |
1,7 |
- |
- |
- |
- |
|
D�m�nagement du Centre d'innovation du CNRC, phase de cl�ture du projet, (S-APE) |
18,7 |
3,1 |
13,1 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Construction d'une installation de partenariat industriel (IPI) � l'IBM‑CNRC, phase de cl�ture du projet, (PD) |
7,2 |
0,9 |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
|
Approbation d'un projet de bail pour l'Institut national de nanotechnologie, phase de mise en œuvre du projet (F-APL) |
87,2 |
- |
5,4 |
3,4 |
3,4 |
2,4 |
2,4 |
|
Approbation d'un projet de bail pour l'Institut des sciences nutritionnelles et de la sant�, phase de mise en œuvre du projet (I-APL) |
20,9 |
- |
- |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
Tableau 3-9 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert
|
Le CNRC g�re les programmes de paiements de transfert suivants :
|
||||||||
|
1) Nom du programme de paiements de transfert : Programme d’aide � la recherche industrielle (PARI-CNRC) |
||||||||
|
2) Date de cr�ation : 1962-1963 |
3) Date de cl�ture : programme continu |
|||||||
|
4) Description : |
||||||||
|
5) R�sultats strat�giques :
R�sultats imm�diats et interm�diaires
R�sultats finaux
|
||||||||
|
6) R�sultats obtenus : R�sultats de l’aide financi�re et des services consultatifs Accroissement de la capacit� technique de R-D des PME
A r�uni les acteurs cl�s du syst�me d’innovation du Canada :
A favoris� et maintenu des relations de travail avec les instituts de recherche du CNRC :
Accroissement de la capacit� de gestion, de commercialisation et de gestion financi�re des PME
A encourag� et favoris� la diffusion de pratiques exemplaires et de m�thodes de fabrication gr�ce � des visites d’entreprise � entreprise :
Croissance des entreprises R�sultats des efforts de r�seautage
Augmentation du nombre de services d’innovation offerts aux PME
Augmentation du nombre et de la force des acteurs du syst�me d’innovation gr�ce � un nombre accru de consortiums au sein de la collectivit�
Meilleure compr�hension des d�bouch�s internationaux
Efforts accrus d’adoption, de commercialisation et de collaboration dans le cadre d’entreprises internationales
|
||||||||
|
|
En millions de dollars |
|||||||
|
|
7) D�penses r�elles 2004-2005 |
8) D�penses r�elles 2005-2006 |
9) D�penses pr�vues 2006-2007 |
10) Autorisations totales 2006‑2007 |
11) D�penses r�elles 2006-2007 |
12) �cart(s) entre les colonnes 9) et 11) |
||
|
Soutien � l’innovation et infrastructure nationale de science et de technologie |
||||||||
|
13) Activit� de programme (AP) |
|
|
|
|
|
|
||
|
14) Total des subventions |
|
|
|
|
|
|
||
|
14) Contributions |
83,6 |
79,0 |
71,2 |
80,1 |
76,6 |
(5,4) |
||
|
14) Total autres genres de PT |
|
|
|
|
|
|
||
|
15) Total pour l’AP |
83,6 |
79,0 |
71,2 |
80,1 |
76,6 |
(5,4) |
||
|
16) Commentaire(s) sur les �carts : L’�cart de (5,4 M$) est surtout imputable aux fonds additionnels re�us d’Industrie Canada pour les PME et qui n’avaient pas �t� pr�vus au moment o� le RPP a �t� produit. |
||||||||
|
17) Conclusions importantes de l’�valuation :
Le PARI-CNRC a �galement g�n�r� de la valeur et cr�� de la richesse pour le Canada.
|
||||||||
|
1 - Les donn�es sur le nombre d’innovations ont �t� �tablies par extrapolation en fonction des 14 564 projets men�s par le PARI. Les donn�es sur les chiffres d’affaires et les emplois sont fond�es sur une enqu�te effectu�e aupr�s de 684 clients du PARI et ont �t� �tablies par extrapolation en fonction
du nombre de clients du PARI qui s’�l�ve � 9 158. La dur�e moyenne des innovations des clients est estim�e � dix ans. L’attribution au PARI est fond�e sur l’augmentation de 37 % du financement du PARI. Les contributions totales du PARI aux projets des clients au cours de la p�riode de 1996 � 2001 se sont �lev�es � 386 millions de
dollars. |
||||||||
|
URL vers le rapport d’�valuation de 2001-2002 : http://www.nrc-cnrc.gc.ca/aboutUs/audit_irap_f.html |
||||||||
|
1) Nom du programme de paiements de transfert : Tri-University Meson Facility (TRIUMF) |
||||||||
|
2) Date de cr�ation : 1976 |
3) Date de fin : 31 mars 2010 |
|||||||
|
4) Description : TRIUMF, le laboratoire national canadien de recherche en physique subatomique est situ� sur le campus de l’Universit� de la Colombie-Britannique � Vancouver. Son fonctionnement est assur� depuis 1968 par un consortium de quatre universit�s de l’Ouest canadien – l’Universit� de l’Alberta, l’Universit� Simon Fraser, l’Universit� de Victoria et l’Universit� de Colombie-Britannique – dans le cadre d’une convention de coentreprise. Une cinqui�me universit�, l’Universit� Carleton, s’est jointe au consortium le 1er avril 2000 et l’Universit� de Toronto est devenue le sixi�me membre en avril 2005. Sept autres universit�s (Regina, Manitoba, Guelph, McMaster, Queen's, St. Mary’s et Montr�al) sont membres associ�s. L’Universit� de Montr�al a demand� � se joindre au consortium en tant que membre � part enti�re d�s le 1er avril 2007. Le laboratoire TRIUMF loge un acc�l�rateur de particules qui produit des faisceaux de m�sons et d’autres particules subatomiques servant � la recherche fondamentale en physique nucl�aire et en physique des particules au Canada et � l’�tranger. Ces recherches jettent les bases de nouvelles technologies en physique et en sciences de la vie, et l’installation contribue aussi fortement � la recherche sur les mat�riaux de pointe au Canada et � l’�tranger. TRIUMF est g�r� comme un laboratoire national et comme la passerelle du Canada vers les laboratoires internationaux de physique subatomique. Ce laboratoire est la contribution canadienne au r�seau mondial d’installations de physique des hautes �nergies pr�sent dans la plupart des grands pays industrialis�s. |
||||||||
|
5) R�sultats strat�giques :
|
||||||||
|
6) R�sultats obtenus :
R�sultats techniques et r�sultats des appareils exp�rimentaux
|
||||||||
|
|
En millions de dollars |
|||||||
|
|
7) D�penses r�elles 2004-2005 |
8) D�penses r�elles 2005-2006 |
9) D�penses pr�vues 2006-2007 |
10) Autorisations totales 2006‑2007 |
11) D�penses r�elles 2006-2007 |
12) �cart(s) entre les colonnes 9) et 11) |
||
|
Recherche et innovation technologique |
||||||||
|
13) Activit� de programme (AP) |
|
|
|
|
|
|
||
|
14) Total des subventions |
|
|
|
|
|
|
||
|
14) Contributions |
40,0 |
44,0 |
51,8 |
51,8 |
45,5 |
6,3 |
||
|
14) Total des autres genres de PT |
|
|
|
|
|
|
||
|
15) Total pour l’AP |
40,0 |
44,0 |
51,8 |
51,8 |
45,5 |
6,3 |
||
|
16) Commentaire(s) sur les �carts : L’�cart de 6,3 M$ est surtout imputable au blocage d’une allocation de 6,2 M$ de TRIUMF. |
||||||||
|
17) Conclusions importantes de l’�valuation : Le Comit� n’a que des louanges � faire sur le processus au moyen duquel le plan quinquennal a �t� �labor�, et plus particuli�rement � l’�gard de la participation importante et continue de la communaut� scientifique canadienne. Au cours de la derni�re d�cennie, TRIUMF a fait l’objet d’une r�orientation importante, passant du statut d’installation de hadrons en physique nucl�aire � �nergie moyenne � un laboratoire ayant une mission de recherche double : i) un programme interne fond� sur le cyclotron de 500 MeV, principalement l’installation ISAC, qui fournit des faisceaux intenses de noyaux � vie courte aux chercheurs en astrophysique et en physique nucl�aires des noyaux instables, en plus de mener d’importants programmes en science mol�culaire, en science des mat�riaux et en sciences de la vie; ii) un programme ext�rieur orient� vers les grands d�bouch�s de la physique des particules que l’on s’attend � cr�er au moyen des futures installations et plus particuli�rement du LHC du CERN. En outre, TRIUMF a d�velopp� un dynamique programme de transferts des technologies, d’�ducation et de sensibilisation du public qui a connu de nombreux succ�s. De l’avis du Comit�, le laboratoire est arriv� � ma�triser les nombreux enjeux critiques sous-jacents � cette difficile transition et il est maintenant bien positionn� pour assumer son double r�le gr�ce � ses programmes internes et externes. Certains d�veloppements techniques, et plus particuli�rement la construction r�ussie d’ISAC ainsi que les structures des programmes, sont maintenant bien harmonis�s et devraient permettre des perc�es majeures dans leur domaine respectif de recherche. Le plan quinquennal propos� traduit de mani�re efficace les objectifs scientifiques g�n�raux dans un programme d�taill� et bien planifi�. Le Comit� estime que sur la foi de ces d�veloppements, TRIUMF g�n�re des possibilit�s nouvelles et importantes tout en jouant son r�le traditionnel d’appui � la recherche universitaire canadienne et tout en continuant � attirer un nombre croissant de scientifiques de partout dans le monde. La structure de direction, la structure technique et la structure de gestion en place au laboratoire conviennent particuli�rement bien � l’ex�cution du programme quinquennal propos�. Le Comit� consid�re que le financement demand� est appropri� et n�cessaire. Si les cr�dits accord�s sont inf�rieurs aux demandes, cela entra�nera in�vitablement la perte d’�l�ments scientifiques importants pour TRIUMF et pour le milieu scientifique canadien tout entier. |
||||||||
|
URL vers le rapport d’examen par les pairs 2003-2004 : http://www.nrc-cnrc.gc.ca/aboutUs/audit_irap_f.html |
||||||||
|
1) Nom du programme de paiements de transfert : T�lescope Canada-France-Hawaii (TCFH), T�lescope James Clerk Maxwell (TJCM), t�lescopes Gemini |
||||||||
|
2) Date de cr�ation : 1978 (TCFH) |
3) Date de fin : d�cembre 2012 (aide de la National Science Foundation des �tats-Unis aux t�lescopes Gemini) |
|||||||
|
4) Description : Le CNRC, en partenariat avec d'autres organismes internationaux, verse des contributions financi�res � l'appui de la gestion et du fonctionnement de ces t�lescopes et des installations connexes, et il participe � la supervision et � l'orientation de ces installations et de leurs activit�s de recherche. Les activit�s de recherche-d�veloppement en astrophysique exigent la construction de grands t�lescopes tr�s pr�cis et tr�s on�reux, ainsi que de nombreux instruments connexes, dans les emplacements o� r�gnent des conditions d'observation id�ales. Les co�ts de construction et d'entretien de ces installations sont si �lev�s qu'ils d�passent la capacit� financi�re d'entreprises seules, voire de bien des �tats. Les organismes de recherche publics s'efforcent donc d'appuyer ces activit�s de R-D dans le cadre de partenariats internationaux. |
||||||||
|
5) R�sultats strat�giques : Objectifs :
R�sultats imm�diats :
R�sultats interm�diaires :
R�sultats finaux :
|
||||||||
|
6) R�sultats obtenus : Les scientifiques de l’IHA-CNRC jouent un r�le pr�pond�rant afin de s’assurer que les installations appuy�es par le Canada demeurent concurrentielles sur la sc�ne mondiale. Les spectrographes GMOS, construits par l’IHA-CNRC pour les t�lescopes Gemini, produisent les retomb�es scientifiques les plus importantes du projet Gemini. En 2006, l’IHA-CNRC, en collaboration avec des laboratoires partenaires, a obtenu un important contrat (6,3 millions de dollars am�ricains) pour participer � la construction de l’imageur plan�taire Gemini (GPI). Cet imageur, le premier des instruments con�us dans le cadre du programme Aspen de Gemini � �tre financ� a �t� formellement lanc� en juin. Lorsque la construction du GPI sera termin�e en 2010, il s’agira de l’instrument le plus puissant au monde pour d�tecter directement les images de plan�tes autour des �toiles environnantes. L’IHA-CNRC participe au d�veloppement du syst�me d’optique adaptative de Gemini (Altair, �galement construit � l’IHA-CNRC) qui doit �tre utilis� avec le guide laser des �toiles, et les scientifiques de l’Institut sont parmi les tout premiers utilisateurs de cette capacit�. Le syst�me permettra, au moyen des t�lescopes Gemini, de prendre des images environ trois fois plus pr�cises que celles prises avec le t�lescope spatial Hubble. Le succ�s de ces projets aura des retomb�es non seulement pour les scientifiques canadiens, mais aussi pour tous ceux du partenariat Gemini. Le savoir-faire �tabli de l’IHA-CNRC dans les technologies d’optique adaptative, d�velopp�es initialement pour le TCFH et maintenant pour Gemini, repr�sente le fondement de travaux plus pouss�s pour la conception du syst�me d’optique adaptative du T�lescope de trente m�tres. Les articles scientifiques s’appuyant sur les donn�es extraites du GMOS et du dispositif Altair repr�sentent pr�s de 50 % de tous les articles publi�s sur Gemini � ce jour. Centre canadien de donn�es astronomiques (CCDA)
Sensibilisation Collaboration avec l’industrie
|
||||||||
|
|
En millions de dollars |
|||||||
|
|
7) D�penses r�elles 2004-2005 |
8) D�penses r�elles 2005-2006 |
9) D�penses pr�vues 2006-2007 |
10) Autorisations totales 2006‑2007 |
11) D�penses r�elles 2006-2007 |
12) �cart(s) entre les colonnes 9) et 11) |
||
|
Recherche et innovation technologique |
||||||||
|
13) Activit� de programme (AP) |
|
|
|
|
|
|
||
|
14) Total des subventions |
|
|
|
|
|
|
||
|
14) Total des contributions |
10,8 |
9,4 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
- |
||
|
14) Total des autres genres de PT |
|
|
|
|
|
|
||
|
15) Total de l’AP |
10,8 |
9,4 |
12,6 |
12,6 |
12,6 |
- |
||
|
16) Commentaire(s) sur les �carts : Aucune explication requise. |
||||||||
|
17) R�sultats d’�valuation importants : Au cours des exercices financiers 2005-2006 et 2006-2007, les �l�ments du PLT appuy�s par l’IHA-CNRC au cours des cinq premi�res ann�es de mise en œuvre ont �t� �valu�s. Les recommandations qui suivent sont fond�es sur les conclusions du rapport d’�valuation. Recommandation 1 : L’IHA-CNRC devrait se doter d’un plan de rel�ve afin de s’assurer que la capacit� de recherche de l’Institut n’est pas amoindrie par le d�part � la retraite potentiel d’employ�s. Recommandation 2 : Une insistance et des efforts accrus devraient �tre d�ploy�s par l’IHA-CNRC pour r�pertorier de mani�re syst�matique les entreprises canadiennes � inclure � ses travaux dans le cadre des grands projets internationaux de t�lescopes financ�s par l’entremise du PLT. Recommandation 3 : L’IHA-CNRC devrait tenir compte du probl�me de l’affaiblissement per�u de la recherche en astronomie � l’Institut et, si ces pr�occupations sont jug�es valides, il devrait prendre des mesures pour rem�dier � la situation. Recommandation 4 : Le CNRC devrait obtenir des fonds pour financer le reste des travaux attribu�s � l’IHA-CNRC dans le cadre du PLT et des documents d’examen � mi-mandat afin de s’assurer que les retomb�es positives se maintiennent. Recommandation 5 : La prochaine enveloppe budg�taire re�ue afin de mettre en œuvre le PLT devrait faire l’objet d’un suivi distinct dans le syst�me financier de l’IHA-CNRC. Recommandation 6 : Les difficult�s li�es � la gestion financi�re des � grands projets scientifiques � � long terme pr�vus dans le PLT � l’int�rieur d’un cycle de planification quinquennal devraient �tre analys�es en tenant compte du cadre recommand� par le Bureau du conseiller national des sciences (BCNS). Recommandation 7 : Si une deuxi�me enveloppe de financement est accord�e pour le PLT, le CNRC devrait envisager de proc�der � une analyse de rendement de l’investissement et � une analyse co�ts-avantages, en coordination avec les autres organisations f�d�rales financ�es par l’entremise du PLT. Si elles sont entreprises, ces �tudes devraient �tre termin�es avant la prochaine �valuation. |
||||||||
Tableau 3-12: Initiatives horizontales
|
Le CNRC assure la direction du volet de l’initiative en R-D en g�nomique men�e. Des renseignements suppl�mentaires sur cette initiative horizontale se trouvent � l'adresse http://www.tbs-sct.gc.ca/rma/eppi-ibdrp/hrdb-rhbd/cbs-scb/2006-2007_f.asp#s4. |