ARCHIVÉ - Tribunal de la dotation de la fonction publique
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
2006-2007
Rapport sur le rendement
Tribunal de la dotation de la fonction publique
L'honorable Jos�e Verner, C.P., d�put�e
Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition f�minine et des Langues officielles
Table des mati�res
Chapitre 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique
Chapitre 3 : Renseignements suppl�mentaires
Chapitre 4 : Autre points d’int�r�t
Chapitre 1 : Aper�u
Message du pr�sident
 L’exercice 2006-2007 a marqu� la premi�re ann�e compl�te de fonctionnement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, une ann�e au cours de laquelle le nombre de plaintes a fortement augment� et le processus et les proc�dures li�s aux plaintes ont continu� de
s’am�liorer.
L’exercice 2006-2007 a marqu� la premi�re ann�e compl�te de fonctionnement du Tribunal de la dotation de la fonction publique, une ann�e au cours de laquelle le nombre de plaintes a fortement augment� et le processus et les proc�dures li�s aux plaintes ont continu� de
s’am�liorer.
D�s le d�part, le Tribunal a adopt� une ligne de conduite favorisant le r�glement de la plainte par les parties concern�es, sans formalisme et avec c�l�rit�, dans la mesure du possible. Cette strat�gie est conforme � l’un des grands objectifs de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP) adopt�e en 2003, soit cultiver de bonnes relations patronales-syndicales dans la fonction publique f�d�rale � l’aide de la communication et d’un dialogue constant.
De m�me, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), un �l�ment cl� de la LMFP, pr�conise une fonction publique � qui se distingue par ses pratiques d’emploi �quitables et transparentes, le respect de ses employ�s, sa volont� r�elle de dialogue et ses m�canismes de recours destin�s � r�soudre les question touchant les nominations. �
Aussi, le Tribunal, dans le R�glement le concernant et son Guide de proc�dures, a-t-il choisi de donner aux parties plusieurs occasions de r�gler la plainte avant d’�tre entendues.
D’abord, le R�glement oblige les parties � se communiquer toute l’information pertinente, afin que ces derni�res tentent d’en arriver � une solution gr�ce � une meilleure compr�hension du processus et des pr�occupations de leur vis-�-vis.
Une fois cet �change effectu�, le dossier est confi� � la m�diation, � moins que l’une des parties refuse d’y prendre part.
Si la plainte n’est pas retir�e apr�s l’�tape de la m�diation ou de la communication des renseignements, une conf�rence pr�paratoire est organis�e, non seulement pour aborder la proc�dure elle-m�me, mais �galement pour cerner les enjeux et, dans certains cas, envisager la possibilit� de trancher l’affaire en se fondant sur les observations �crites des parties.
Les �tapes de recherche du consensus par le Tribunal ont �t� tr�s fructueuses. En effet, des 273 dossiers r�gl�s en 2006-2007, 86 % l’ont �t� avant l’�tape de l’audience, soit gr�ce � la m�diation ou � une autre �tape du processus.
Bien que le Tribunal soit conscient que toutes les plaintes ne peuvent �tre trait�es de mani�re informelle, il croit tout de m�me qu’une entente � l’amiable offre une meilleure solution � un conflit ou � un diff�rend en milieu de travail qu’une d�cision prise par un tiers.
Dans les mois qui ont suivi la cr�ation du Tribunal, nous avons entrepris d’instituer des pratiques qui permettraient aux cadres et aux employ�s de r�soudre leurs diff�rends gr�ce � un dialogue constructif. Je suis fier d’annoncer que ces pratiques sont en place et se r�v�lent profitables. Le Tribunal a la ferme volont� de favoriser de bonnes relations patronales-syndicales dans la fonction publique f�d�rale, contribuant ainsi � bonifier la capacit� de cette derni�re � servir et � prot�ger l’int�r�t public.
Le pr�sident et premier dirigeant du Tribunal,
Guy Gigu�re
D�claration de la direction
Je soumets, en vue de son d�p�t au Parlement, le Rapport sur le rendement de 2006-2007 du Tribunal de la dotation de la fonction publique.
Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�sentation des rapports �nonc�s dans le Guide pour la pr�paration de la Partie III du budget des d�penses 2006-2007 : rapports sur les plans et les priorit�s et rapports minist�riels sur le rendement.
- Il respecte les exigences sp�ciales relatives � la pr�sentation de rapports, �nonc�es dans les directives du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor;
- Il repose sur l’architecture des activit�s de programme et le r�sultat strat�gique approuv� du Tribunal ;
- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable;
- Il sert de fondement � la responsabilisation � l’�gard des r�sultats obtenus au moyen des ressources et des pouvoirs qui lui sont confi�s;
Le pr�sident et premier dirigeant du Tribunal,
Guy Gigu�re
Renseignements sommaires
Raison d’�tre
Le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) est un tribunal administratif quasi judiciaire ind�pendant qui est officiellement entr� en fonction au moment de l’entr�e en vigueur de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) le 31 d�cembre 2005. Cette loi vise � moderniser la dotation dans la fonction publique en donnant une nouvelle signification au m�rite et en mettant en place de nouveaux m�canismes de recours.
Mandat
Selon le paragraphe 88(2) de la LEFP, le TDFP a pour mandat d’instruire les plaintes relatives aux nominations internes, � l’application de mesures correctives ordonn�es par le Tribunal, � la r�vocation d’une nomination et � la mise en disponibilit�.
De plus, le TDFP peut, en tout �tat de cause, offrir des services de m�diation en vue de r�gler une plainte et, lorsqu’il d�cide si une plainte relative � une nomination interne ou � une mise en disponibilit� est fond�e, il peut interpr�ter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Mission
Le TDFP a pour mission de contribuer � une fonction publique comp�tente, impartiale et repr�sentative par le traitement impartial et dans les meilleurs d�lais de diff�rends relativement au processus interne de dotation et de mise en disponibilit� du gouvernement du Canada.
Ressources financi�res (en milliers de dollars)
|
2006–2007 |
||
|
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
|
5 244,0 $ |
5 022,8 $ |
3 215,9 $ |
Ressources humaines
|
2006–2007 |
||
|
Pr�vues |
R�elles |
�cart |
Priorit�s du Tribunal de la dotation de la fonction publique
|
2006-2007 |
|
|
R�sultat strat�gique |
Traitement impartial et dans les meilleurs d�lais de conflits relativement aux processus internes de dotation et de mise en disponibilit� du gouvernement du Canada. |
|
Harmonisation avec les r�sultats du gouvernement du Canada |
Contribuer � une fonction publique comp�tente, impartiale et repr�sentative. |
|
Activit� de programme |
Traitement des plaintes survenant dans le cadre des nominations, des r�vocations et des mises en disponibilit� conform�ment � la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. |
|
R�sultats pr�vus |
|
|
Priorit�s |
�tat |
Pr�vues |
R�elles |
|
|
No 1 |
�tre pr�t � entendre les plaintes. |
R�alis�e |
654 |
433 |
|
No 2 |
�tre pr�t � offrir la m�diation. |
R�alis�e |
825 |
311 |
|
No 3 |
Cr�ation d’un greffe et de syst�mes de gestion de l’information. |
R�alis�e |
245 |
101 |
|
No 4 |
�tablir des communications internes et externes. |
R�alis�e |
398 |
270 |
|
No 5 |
S’assurer que les outils sont en plans pour la gestion des RH. |
En cours |
256 |
143 |
|
No 6 |
�tablir des pratiques minist�rielles et des pratiques de gestion. |
En cours |
431 |
220 |
Cadre op�rationnel
Bien que le Tribunal de la dotation de la fonction publique est officiellement entr� en fonction le 31 d�cembre 2005, il n’a re�u sa premi�re plainte que le 6 f�vrier 2006 et le nombre de plaintes est rest� plut�t faible jusqu’au d�but de l’exercice 2006-2007. Par contre, pour l’ensemble de ce dernier exercice, leur nombre a �t� de loin sup�rieur au total pour l’exercice pr�c�dent, passant de 15 � 438 dossiers.
Il n’est donc pas surprenant que l’un des grands d�fis qu’a d� et que doit toujours relever le Tribunal soit la nature impr�visible de sa charge de travail.
L’obtention d’un financement � long terme a constitu� le deuxi�me d�fi important auquel le Tribunal a �t� confront� lors de sa premi�re ann�e d’existence. Les subsides n’ont �t� accord�s que sur une base annuelle, suite � la pr�sentation d’une demande au Conseil du Tr�sor (CT). Les pourparlers en vue d’un financement permanent se poursuivent avec les agents responsables du CT.
La situation financi�re combin�e � la difficult� de pr�voir le nombre de plaintes a amen� le Tribunal � faire preuve de prudence dans ses d�cisions, en particulier en mati�re de dotation de son propre personnel. Le Tribunal pr�voit doter 33 postes d’�quivalents temps plein (ETP) lorsque le nombre de dossiers se stabilisera, mais il garde pour le moment le nombre de ses employ�s � un minimum (22) pour �viter d’avoir � assumer des d�penses inutiles et � mettre des employ�s � pied si la charge de travail s’av�rait moins importante que pr�vu. De plus, nous avons d�lib�r�ment cherch� des personnes ayant de l’exp�rience, des connaissances et des habilet�s dans plusieurs domaines, nous assurant ainsi des ressources humaines les plus performantes possibles.
Le fait que les intervenants s’attendaient � ce que les plaintes soient trait�es � dans la mesure du possible sans formalisme et avec c�l�rit� �, pour reprendre les termes de la nouvelle LEFP, un d�fi d’autant plus important que l’organisme �tait nouveau et que, par cons�quent, le nouveau processus de plainte �tait mal connu, est �galement entr� en jeu dans les pr�paratifs pour la premi�re ann�e compl�te de fonctionnement du Tribunal.
D�s le d�part, le Tribunal a d�cid� de mettre de l’avant la m�diation en tant que processus le plus efficace de r�gler vite et sans formalisme les plaintes dans le secteur de la dotation en personnel. En convaincre les parties s’est cependant r�v�l� difficile pendant les premiers mois d’existence du Tribunal. Le milieu semblait nourrir un doute s�rieux quant � la valeur d’une m�diation dans un cadre d’une plainte en mati�re de dotation.
Les activit�s du Tribunal pendant l’ann�e ont vis� en grande partie � mettre � la disposition du milieu, de l’information sur le r�le du Tribunal, le processus de traitement des plaintes, y compris la m�diation, et les proc�dures connexes. L’�tablissement et le maintien de communications avec les intervenants demeure essentiel au bon fonctionnement du Tribunal.
Malgr� les nombreux d�fis affront�s cette ann�e, le Tribunal a obtenu des r�sultats de taille dans le traitement des plaintes et la m�diation :
- Plus de moiti� des 438 plaintes re�ues en 2006-2007 ont �t� r�gl�es.
- L’audition officielle des plaintes n’a pas �t� n�cessaire dans 86 % des dossiers ferm�s.
- Plus du quart des plaintes ont �t� dirig�es vers la m�diation en accord avec les parties.*
- Le pourcentage de plaintes r�gl�es gr�ce � la m�diation en 2006-2007 a atteint 71 % (sur un total de 49).
�tant donn� le nombre de plaintes trait�es au cours de sa premi�re ann�e compl�te d’activit�, le Tribunal consid�re avoir atteint son principal objectif pour cette p�riode, soit �tre pr�t � entendre les plaintes et � offrir des services de m�diation.
Harmonisation avec les r�sultats strat�giques du gouvernement du Canada
Gr�ce au processus d�cisionnel transparent, impartial et rigoureux mis en place et � l’appui offert pour aider les parties � r�gler les conflits li�s � la dotation, le Tribunal sera accessible et attentif au milieu et il contribuera aussi � la gestion efficace des ressources humaines, et ce, dans l’int�r�t des minist�res et organismes f�d�raux, des gestionnaires, des employ�s ainsi que de la population canadienne dans son ensemble.
Avantages pour les Canadiens
Le Tribunal rend service aux Canadiens en assurant une fonction publique comp�tente, impartiale et repr�sentative gr�ce au traitement impartial et dans les meilleurs d�lais des plaintes en mati�re de dotation au sein du gouvernement du Canada.
Description g�n�rale du rendement du Tribunal
Le Tribunal de la dotation de la fonction publique a officiellement commenc� ses activit�s le 31 d�cembre 2005, date d’entr�e en vigueur de la nouvelle LEFP. Tribunal administratif quasi judiciaire ind�pendant, il a �t� cr�� pour instruire les plaintes port�es par les employ�s du gouvernement f�d�ral relativement aux nominations internes, aux mises en disponibilit�, � l’application de mesures correctives ordonn�es par le Tribunal ou � la r�vocation d’une nomination.
Le Tribunal vise un seul r�sultat strat�gique : le traitement impartial et dans les meilleurs d�lais de diff�rends relativement au processus interne de dotation et de mise en disponibilit� du gouvernement du Canada.
De m�me, le Tribunal n’a qu’une seule activit� de programme, soit le traitement des plaintes survenant dans le cadre des nominations, des r�vocations et des mises en disponibilit� conform�ment � la LEFP.
En 2006-2007, le Tribunal en �tait encore � l’�tape de l’organisation. Il a donc mis l’accent sur la mise en place des personnes et des processus n�cessaires � l’audition des plaintes et � la m�diation entre les parties. Des proc�dures ont donc �t� �labor�es, mises en œuvre et am�lior�es et les membres et le personnel du Tribunal ont re�u une formation sur le r�le de ce dernier, les modalit�s pour rendre une d�cision, la m�diation dans un contexte de dotation, les questions juridiques et les pr�c�dents jurisprudentiels et autres sujets, selon les besoins.
Pour �tre pr�t � traiter les plaintes, le Tribunal avait aussi besoin d’�laborer et de mettre en place une structure de soutien, soit greffe et un syst�me de gestion de l’information, des outils de gestion des ressources humaines, des communications internes et externes et des r�gles g�n�rales et m�thodes de gestion.
Le Tribunal consid�re avoir grandement progress� dans ces domaines au cours de la derni�re ann�e. Un syst�me de gestion des dossiers (WebCims) a �t� implant� et continue d’�tre adapt� � mesure que s’accro�t le besoin d’une information d�taill�e et exacte pour suivre l’�volution et le r�sultat des plaintes.
Les postes essentiels au traitement des plaintes ont �t� combl�s et diverses politiques et proc�dures de gestion des ressources humaines (par exemple, une politique en mati�re de relations de travail, laquelle comporte une proc�dure de grief, et un Syst�me de gestion informelle des conflits) ont �t� d�velopp�es afin de cr�er un milieu de travail harmonieux et productif.
L’�l�ment cl� de la strat�gie de communication du Tribunal a �t� l’�laboration d’un programme de communication � court terme comportant la construction et le lancement du site Internet de l’organisme et d’autres produits de communication, afin que le milieu ait acc�s � de l’information sur le r�le du Tribunal et son processus de traitement des plaintes.
Comme la priorit� est de faire en sorte que le Tribunal soit pr�t � traiter les plaintes, l’�laboration de proc�dures et de politiques minist�rielles, notamment en ce qui concerne les mesures de rendement, a �t� limit�e � ce qui �tait essentiel � ses op�rations quotidiennes. Comme pr�vu, on travaille toutefois � �tablir un cadre de mesure du rendement et � mettre sur pied d’autres projets connexes.
Chapitre 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique
Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique
|
Tribunal de la dotation de la fonction publique |
|
|
Traitement impartial et dans les meilleurs d�lais de conflits relativement au processus interne de dotation et de mise en disponibilit� du gouvernement du Canada. |
|
|
Harmonisation avec les r�sultats du gouvernement du Canada |
Contribuer � une fonction publique comp�tente, impartiale et repr�sentative. |
|
Activit� de programme |
Traitement des plaintes survenant dans le cadre des nominations, des r�vocations et des mises en disponibilit� conform�ment � la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. |
|
R�sultats pr�vus |
|
Ressources financi�res (en milliers de dollars)
|
2006–2007 |
||
|
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
|
5 244,0 $ |
5 022,8 $ |
3 215,9 $ |
Human Resources
|
2006–2007 |
||
|
Pr�vues |
R�elles |
�cart |
Description des activit�s de programme
Le Tribunal de la dotation de la fonction publique est un organe administratif quasi judiciaire ind�pendant institu� en d�cembre 2005 par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique pour instruire les plaintes relatives aux nominations internes, aux mises en disponibilit�, � l’application de mesures correctives ordonn�es par le Tribunal et � la r�vocation d’une nomination. Sa seule activit� de programme consiste � traiter les plaintes relatives aux dispositions de la LEFP en mati�re de nomination, de r�vocation et de mise en disponibilit�.
Dans le cadre de son mandat, le Tribunal peut, en tout �tat de cause, offrir des services de m�diation en vue de r�gler une plainte. Lorsqu’il d�cide si une plainte relative � une nomination interne ou � une mise en disponibilit� est fond�e, il peut interpr�ter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
Dans son Rapport sur les plans et les priorit�s 2006-2007, le Tribunal s’�tait fix� des priorit�s pour r�aliser sa principale activit� de programme. Voici l’�tat d’avancement des travaux et t�ches associ�s � ces priorit�s.
|
Priorit� no 1 : �tre pr�t � entendre les plaintes |
|
|
Description |
T�ches
|
|
�tat d’avancement et r�sultats
|
|
|
Priorit� no 2 : �tre pr�t � offrir la m�diation |
|
|
Description |
T�ches
|
|
�tat d’avancement et r�sultats
|
|
|
Priorit� no 3 : �tablir un greffe et des syst�mes de gestion de l’information |
|
|
Description |
T�ches
|
|
�tat d’avancement et r�sultats
|
|
|
Priorit� no 4 : �tablir des communications internes et externes |
|
|
Description |
T�ches
|
|
�tat d’avancement et r�sultats
|
|
|
Priorit� no 5 : S’assurer que les outils sont en place pour la gestion des RH |
|
|
Description |
T�ches
|
|
�tat d’avancement et r�sultats
|
|
|
Priorit� no 6 : �tablir des services g�n�raux et des pratiques de gestion |
|
|
Description |
T�ches
|
|
�tat d’avancement et r�sultats
|
|
Le�ons tir�es
Le Tribunal s’est donn� un programme ambitieux en 2006-2007 en retenant six grandes priorit�s par rapport � son unique activit� de programme, laquelle consistait � traiter les plaintes relatives aux dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique en mati�re de nomination, de r�vocation et de mise en disponibilit�.
� la suite d’une hausse soudaine et vertigineuse du nombre de plaintes pendant l’ann�e, le Tribunal a �t� forc� de porter son attention sur les priorit�s particuli�rement indispensables � son fonctionnement : am�liorer le mode de traitement des plaintes et les proc�dures connexes, implanter graduellement un syst�me de gestion des cas totalement int�gr�, poursuivre le d�veloppement et la mise en place d’un programme de m�diation comportant un volet formation du personnel et du milieu, et d�finir une strat�gie de communication compl�te. L’�ch�ancier des travaux d’�laboration des politiques et des proc�dures internes, bien que ces derni�res soient essentielles au fonctionnement de l’organisme, a d� �tre prolong� pour permettre aux ressources du Tribunal de se consacrer aux travaux plus urgents.
La hausse du nombre de plaintes et la charge de travail ainsi entra�n�e ont fait ressortir la n�cessit� d’un bon syst�me de gestion des cas, afin d’�tre en mesure de retracer les dossiers, de suivre leur progression et d’assurer un suivi, le cas �ch�ant.
La pr�paration de divers outils de communication et activit�s de sensibilisation s’est r�v�l�e une initiative d�terminante du Tribunal, car elle a favoris� une compr�hension du mandat de ce dernier et ainsi � un fonctionnement plus efficace et efficient.
Gr�ce une solide infrastructure et � une �quipe aux habilet�s multiples et d’une grande souplesse, le Tribunal est bien plac� pour mettre la touche finale � ses services g�n�raux et � ses politiques et proc�dures administratives internes tout en continuant de peaufiner sa proc�dure de traitement des plaintes et ses services de r�solution des conflits.
Chapitre 3 : Renseignements suppl�mentaires
Structure de l’organisation
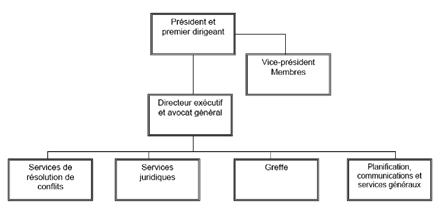
Rendement financier
La pr�sente section r�sume le rendement financier du Tribunal. Les tableaux de cette section comparent quatre cat�gories de donn�es : le budget principal, les d�penses pr�vues, le total des autorisations et les d�penses r�elles. La colonne du Budget principal contient des donn�es incluses dans le budget principal des d�penses 2006-2007 du gouvernement. La colonne des d�penses pr�vues contient des donn�es incluses dans le Rapport sur les plans et les priorit�s 2006-2007 du Tribunal, c'est-�-dire les montants pr�vus au d�but de l'exercice. La colonne des autorisations totales inclut les montants figurant dans le budget principal et suppl�mentaires des d�penses ainsi que d'autres montants approuv�s par le Parlement et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor. Enfin, la colonne des d�penses r�elles indique les montants r�els d�pens�s.
Les tableaux financiers suivants s'appliquent au Tribunal de la dotation de la fonction publique:
- Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles
- Postes vot�s et l�gislatifs
- Services re�us � titre gracieux
- Politiques en mati�re de voyages
Tableau 1: Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles (en milliers de dollars)
Ce tableau compare les donn�es du Budget principal des dispenses r�elles du plus r�cent exercice termin�, de m�me que les dispenses r�elles des deux exercices pr�c�dents.
|
(en milliers de dollars) |
|
|
2006-2007 |
|||
|
2004-05 |
2005-06 |
Budget |
D�penses |
Total des autorisations |
D�penses |
|
|
Tribunal de la dotation de la fonction publique |
- |
1 949,6 |
5 244,0 |
5 244,0 |
5 022,8 |
3 245,1 |
|
Moins : revenus non disponibles |
- |
- |
- |
- |
- |
(29,2) |
|
Plus : co�t des services re�us � titre gracieux |
- |
175,9 |
- |
447,0 |
392,3 |
392,3 |
|
Co�t net pour le Tribunal |
- |
2 125,5 |
5 244,0 |
5 691,0 |
5 415,1 |
3 608,2 |
|
�quivalents temps plein |
- |
10 |
33 |
33 |
33 |
22 |
Tableau 2: Postes votes et l�gislatifs
Ce tableau explique comment le Parlement attribue les ressources au Tribunal, y compris les cr�dits vot�s et les autorisations l�gislatives.
|
(en milliers de dollars) |
2006-2007 |
||||
|
Poste vote ou l�gislatif |
Budget principal |
D�penses pr�vues |
Total des autorisations |
D�penses r�elles |
|
|
105 |
D�penses de programme |
4 710,0 |
4 710,0 |
4 710,0 |
2 903,1 |
|
(L) |
Contribution aux avantages sociaux des employ�s |
534,0 |
534,0 |
312,8 |
312,8 |
|
(L) |
Biens exc�dentaires de l’�tat |
- |
- |
- |
- |
|
Total pour le Tribunal |
5 244,0 |
5 244,0 |
5 022,8 |
3 215,9 |
|
Note: D�penses pr�vues s'entend du montant inclus dans le Rapport sur les plans et priorit�s 2006-2007 du Tribunal et indique les montants planifi�s au d�but de l'ann�e.
Tableau 3: Services re�us � titre gracieux
Ce tableau pr�sente les services re�us � titre gracieux par le Tribunal.
|
(en milliers de dollars) |
2006-2007 |
|
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
249,3 |
|
Contribution de l’employeur aux primes du r�gime d’assurance des employ�s et d�penses pay�es par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada |
143,0 |
|
Total des services re�us � titre gracieux en 2006-2007 |
392,3 |
Tableau 4: Politiques en mati�re de voyages
Les �tats financiers sont pr�par�s conform�ment aux principes comptables de la comptabilit� d’exercice. Les renseignements suppl�mentaires non v�rifi�s pr�sent�s dans les tableaux financiers du RMR sont pr�par�s selon la comptabilit� de caisse modifi�e afin d’�tre consistent avec la comptabilit� bas� sur les cr�dits vot�s. Le rapprochement entre ces deux m�thodes est pr�sent� � la note 3 des �tats financiers.
�tats financiers
These Financial Statements are prepared in accordance with accrual accounting principles. The unaudited supplementary information presented in the financial tables of this report is prepared on a modified cash basis of accounting in order to be consistent with appropriations-based reporting. Note 3 of the financial statements reconcile these two accounting methods.
D�claration de responsabilit� de la direction
La responsabilit� de l’int�grit� et de l’objectivit� des �tats financiers ci-joints pour l’exercice financier termin� le 31 mars 2007 et de toute l’information figurant dans le pr�sent rapport incombe � la direction du Tribunal. Ces �tats financiers ont �t� pr�par�s par la direction conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public.
La direction est responsable de l’int�grit� et de l’objectivit� de l’information pr�sent�e dans les �tats financiers. Certaines informations pr�sent�es dans les �tats financiers sont fond�es sur les meilleures estimations et le jugement de la direction et tiennent compte de l’importance relative. Pour s’acquitter de ses obligations au chapitre de la comptabilit� et de la pr�sentation des rapports, la direction tient des comptes qui permettent l’enregistrement centralis� des op�rations financi�res du Tribunal. L’information financi�re soumise pour la pr�paration des Comptes publics du Canada concorde avec les �tats financiers ci-joints.
La direction poss�de un syst�me de gestion financi�re et de contr�le interne con�u pour fournir une assurance raisonnable que l’information financi�re est fiable, que les actifs sont prot�g�s et que les op�rations sont conformes � la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’elles sont ex�cut�es en conformit� avec les r�glements, qu’elles respectent les autorisations du Parlement et qu’elles sont comptabilis�es de mani�re � rendre compte de l’utilisation des fonds du gouvernement. La direction veille �galement � l’objectivit� et � l’int�grit� des donn�es de ses �tats financiers par la s�lection appropri�e, la formation et le perfectionnement d’employ�s qualifi�s, par une organisation assurant une s�paration appropri�e des responsabilit�s et par des programmes de communication visant � assurer la compr�hension des r�glements, des politiques, des normes et des responsabilit�s de gestion dans tout le Tribunal.
Les �tats financiers du Tribunal n'ont pas fait l’objet d’une v�rification.
Guy Gigu�re, Pr�sident
Jos�e Dubois, Agent financier sup�rieur
�tat des r�sultats (non v�rifi�)
pour l'exercice termin� le 31 mars 2007
(en dollars)
|
CHARGES DE FONCTIONNEMENT |
2007 |
2006 |
|
Salaires et avantages sociaux |
2 658 069 |
1 514 358 |
|
Services professionnels et sp�ciaux |
387 113 |
400 917 |
|
Installations |
249 312 |
95 767 |
|
Transports et t�l�communications |
166 552 |
101 479 |
|
Locations |
103 360 |
22 905 |
|
Acquisition de machinerie et d’�quipement |
57 344 |
191 777 |
|
Autres charges de fonctionnement |
43 904 |
34 703 |
|
Services publics, fournitures et approvisionnements |
40 672 |
22 399 |
|
Communications |
29 014 |
30 816 |
|
Entretien et r�paration d'�quipement |
12 621 |
3 400 |
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
6 393 |
870 |
|
Total des charges |
3 754 355 |
2 419 391 |
|
PRODUITS |
||
|
Revenus divers |
29 210 |
- |
|
Total des produits |
29 210 |
- |
|
Co�t de fonctionnement net |
3 725 145 |
2 419 391 |
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers |
||
�tat de la situation financi�re (non v�rifi�)
au 31 mars 2007
(en dollars)
|
|
2007 |
2006 |
|
ACTIFS |
|
|
|
Actifs financiers |
|
|
|
D�biteurs d'autres minist�res et organismes f�d�raux |
|
|
|
Avances permanentes |
500 |
500 |
|
Total des actifs financiers |
|
212 615 |
|
Actifs non financiers |
|
|
|
Immobilisations corporelles (Note 4) |
|
|
|
Total des actifs non financiers |
21 444 |
|
|
TOTAL |
|
|
|
PASSIFS |
|
|
|
Cr�diteurs et charges � payer |
|
|
|
Autres minist�res et organismes f�d�raux |
|
|
|
Autres |
238 506 |
|
|
Indemnit�s de vacance et cong�s compensatoires |
88 443 |
63,865 |
|
Indemnit�s de d�part (Note 5) |
363 919 |
232,850 |
|
|
723 412 |
636 822 |
|
AVOIR DU CANADA |
(471 971) |
(412 249) |
|
TOTAL |
251 441 |
224 573 |
|
Passif �ventuel (note 2 (h)) |
|
|
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers. |
||
�tat de l'avoir du Canada (non v�rifi�)
pour l'exercice termin� le 31 mars 2007
(en dollars)
|
2007
|
2006
|
|
| Avoir du Canada, d�but de l'exercice |
(412 249)
|
-
|
| Co�t de fonctionnement net |
(3 725 145)
|
(2 419 391)
|
| Cr�dits de l'exercice utilis�s (note 3) |
3 215 894
|
1 949 647
|
| Variation de la situation nette du Tr�sor (note 3) |
86 438
|
(127 492)
|
| Revenu non disponible pour d�penser |
(29 210)
|
|
| Contre-passation des d�penses li�es � Justice Canada |
-
|
9 074
|
| Services fournis gratuitement par d'autres minist�res (note 6) |
392 301
|
175 913
|
| Avoir du Canada, fin de l'exercice |
(471 971)
|
(412 249)
|
| Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers. | ||
�tat des flux de tr�sorerie (non v�rifi�)
pour l'exercice termin� le 31 mars 2007
(en dollars)
|
Activit�s de fonctionnement |
2007 |
2006 |
|
R�sultats nets |
3 725 145 |
2 419 391 |
|
�l�ments sans effet sur l’encaisse inclus dans les r�sultats nets |
|
|
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
(6 393) |
(870) |
|
Services fournis gratuitement par d’autres minist�res |
(392 301) |
(175 913) |
|
Variations de rapport de la position financi�re |
|
|
|
Augmentation (diminution) des d�biteurs et avances |
17 382 |
212 615 |
|
Augmentation (diminution) des passifs |
(86 590) |
(636 822) |
|
Encaisse utilis�e par les activit�s de fonctionnement |
3 257 243 |
1 818 401 |
|
Activit�s d'investissement en immobilisations |
|
|
|
Acquisition d’immobilisations corporelles |
15 879 |
12 828 |
|
Encaisse utilis�e par les activit�s d'investissement en immobilisations |
15 879 |
12 828 |
|
Activit�s de financement |
|
|
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada |
(3 273 122) |
(1 831 229) |
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers. |
||
TRIBUNAL DE LA DOTATION DE LA FONCTION PUBLIQUE
Notes compl�mentaires aux �tats financiers (non v�rifi�es)
Pour l'exercice termin� le 31 mars 2007
|
1. |
Autorisations et objectifs Cr�� par la nouvelle Loi sur l’emploi dans la fonction publique et promulgu� par le d�cret du Conseil 2003-1808, le Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) a comme mission d’instruire et de statuer sur les plaintes log�es � l’encontre de nominations internes, sur les plaintes concernant les r�vocations de nominations internes faites par l’administrateur g�n�ral ou la Commission de la fonction publique (CFP) � la suite d’une enqu�te minist�rielle ou d’une enqu�te men�e par la CFP � la demande d’un minist�re ou d’un organisme, et sur les plaintes pr�sent�es par des employ�s qui ont �t� inform�s qu’ils seront mis en disponibilit�. Le TDFP favorisera un r�glement � l’amiable des diff�rends en offrant des services de m�diation. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
Sommaire des principales conventions comptables Les �tats financiers ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public. Les principales conventions comptables sont les suivantes : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(a) |
Cr�dits parlementaires – le Tribunal est financ�e par le biais de cr�dits parlementaires du gouvernement du Canada. Les cr�dits consentis au Tribunal ne correspondent pas � la pr�sentation des rapports financiers pr�vus dans les principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada, �tant fond�s dans une large mesure sur les besoins de tr�sorerie. Ainsi, les postes consign�s dans l'�tat des r�sultats et dans l'�tat de la situation financi�re ne sont pas n�cessairement les m�mes que ceux auxquels il est pourvu par les cr�dits parlementaires. La note 3 pr�sente un rapprochement g�n�ral entre les deux m�thodes de rapports financiers. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (b) |
Encaisse nette fournie par le gouvernement - Le Tribunal fonctionne au moyen du Tr�sor, qui est administr� par le receveur g�n�ral du Canada. Toutes les rentr�es de fonds sont d�pos�es au Tr�sor et toutes les sorties de fonds sont pay�es � m�me le Tr�sor. L’encaisse nette fournie par le gouvernement correspond � la diff�rence entre toutes les rentr�es et les sorties de fonds, y compris les op�rations interminist�rielles. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(c) |
La variation de la situation nette du Tr�sor correspond � la diff�rence entre l’encaisse nette fournie par le gouvernement et les cr�dits utilis�s au cours d’un exercice, � l’exclusion du montant des revenus non disponibles comptabilis�s par le Tribunal. Il d�coule d’�carts temporaires entre le moment o� une op�ration touche un cr�dit et le moment o� elle est trait�e par le Tr�sor. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(d) |
Produits – Les produits sont comptabilis�s dans l’exercice o� les op�rations ou les faits sous-jacents surviennent. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(e) |
Charges – Les charges sont comptabilis�es selon la m�thode de la comptabilit� d’exercice :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(f) |
Avantages sociaux futurs (i) Prestations de retraite : Les employ�s admissibles participent au R�gime de retraite de la fonction publique, un r�gime multi employeurs administr� par le gouvernement du Canada. Les cotisations du Tribunal au r�gime sont pass�es en charges dans l’exercice au cours duquel elles sont engag�es et elles repr�sentent l’obligation totale d�coulant du r�gime. En vertu des dispositions l�gislatives en vigueur, le Tribunal n’est pas tenu de verser des cotisations au titre de l’insuffisance actuarielle du r�gime. (ii) Indemnit�s de d�part : Les employ�s ont droit � des indemnit�s de d�part, pr�vues dans leurs conventions collectives ou les conditions d’emploi. Le co�t de ces indemnit�s s’accumule � mesure que les employ�s effectuent les services n�cessaires pour les gagner. Le co�t des avantages sociaux gagn�s par les employ�s est calcul� � l’aide de l’information provenant des r�sultats du passif d�termin� sur une base actuarielle pour les prestations de d�part pour l’ensemble du gouvernement. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(g) |
Les d�biteurs enregistr�s par le Tribunal sont imputables � d'autres minist�res du gouvernement. Le recouvrement est consid�r� comme certain donc aucune provision n'a �t� �tablie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(h)
|
Passif �ventuel - Dans le cours normal de ses activit�s, le Tribunal pourrait �tre vis�e par diverses actions en justice. Certaines obligations �ventuelles peuvent devenir des obligations r�elles, selon que certains �v�nements se r�aliseront ou non. Dans la mesure o� l'�v�nement futur risque fort de se produire ou de ne pas se produire, et que l’on peut �tablir une estimation raisonnable de la perte, un passif estimatif est constat� et une charge enregistr�e dans les �tats financiers consolid�s du gouvernement. Le passif estimatif n’est pas port� aux �tats financiers du Tribunal jusqu’� ce que son montant soit �tabli avec certitude. Au 31 mars 2007, le Tribunal n'avait pas de passifs �ventuels. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(i)
|
Immobilisations corporelles - toutes les immobilisations corporelles et les am�liorations locatives dont le co�t initial est d'au moins 3 000 $, sont comptabilis�s � leur co�t d’achat. Les immobilisations corporelles n’incluent pas les biens incorporels, les œuvres d'art, les tr�sors historiques ayant une valeur culturelle, esth�tique ou historique, les biens situ�s dans les r�serves indiennes, ni les collections dans les mus�es. Les immobilisations corporelles sont amorties selon une m�thode lin�aire sur la dur�e de vie utile estimative de l'immobilisation, comme suit :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(j)
|
Op�rations en devises �trang�res - les op�rations en devises �trang�res sont converties en dollars canadiens aux taux de change en vigueur � la date de la transaction. Les actifs et les passifs en devises �trang�res sont convertis en dollars canadiens selon les taux en vigueur le 31 mars. Les gains et les pertes r�sultant de la conversion de devises sont present�s � l’�tat des r�sultats. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(k)
|
Incertitude relative � la mesure - La pr�paration de ces �tats financiers conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor du Canada, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypoth�ses qui influent sur les montants d�clar�s des actifs, des passifs, des revenus et des charges pr�sent�s dans les �tats financiers. Au moment de la pr�paration des pr�sents �tats financiers, la direction consid�re que les estimations et les hypoth�ses sont raisonnables. Les principaux �l�ments pour lesquels des estimations sont faites sont le passif �ventuel, le passif pour les indemnit�s de d�part et la dur�e de vie utile des immobilisations corporelles. Les r�sultats r�els pourraient diff�rer des estimations de mani�re significative. Les estimations de la direction sont examin�es p�riodiquement et, � mesure que les rajustements deviennent n�cessaires, ils sont constat�s dans les �tats financiers de l’exercice o� ils sont connus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.
|
Cr�dits parlementaires Le Tribunal re�oit la plus grande partie de son financement au moyen de cr�dits parlementaires annuels. Les �l�ments comptabilis�s dans l’�tat des r�sultats et l’�tat de la situation financi�re d’un exercice peuvent �tre financ�s au moyen de cr�dits parlementaires qui ont �t� autoris�s dans des exercices pr�c�dents, pendant l’exercice en cours ou qui le seront dans des exercices futurs. En cons�quence, les r�sultats de fonctionnement nets du Tribunal diff�rent selon qu’ils sont pr�sent�s selon le financement octroy� par le gouvernement ou selon la m�thode de la comptabilit� d’exercice. Les diff�rences sont rapproch�es dans les tableaux suivants : |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)
|
Rapprochement du co�t de fonctionnement net et des cr�dits parlementaires de l'exercice en cours :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)
|
Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c)
|
Rapprochement de l'encaisse nette fournie par le gouvernement et des cr�dits de l'exercice en cours utilis�s
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.
|
Immobilisations corporelles
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.
|
Employee benefits Tant les employ�s que le Tribunal versent des cotisations couvrant le co�t du r�gime. En 2006-2007 les charges s’�l�vent � 131 068 $ (232 850 $ en 2005-2006), soit environ 2,2 fois (2,6 fois en 2005-2006) les cotisations des employ�s. La responsabilit� du Tribunal relative au r�gime de retraite se limite aux cotisations vers�es. Les exc�dents ou les d�ficits actuariels sont constat�s dans les �tats financiers du gouvernement du Canada, en sa qualit� de r�pondant du r�gime. (b) Indemnit�s de d�part : Le Tribunal verse des indemnit�s de d�part aux employ�s en fonction de l’admissibilit�, des ann�es de service et du salaire final. Ces indemnit�s ne sont pas capitalis�es d’avance. Les prestations seront pr�lev�es sur les cr�dits futurs. Voici quelles �taient les indemnit�s de d�part au 31 mars :
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.
|
Op�rations entre entit�s apparent�es En vertu du principe de propri�t� commune, le Tribunal est apparent� � tous les minist�res, organismes et soci�t�s d’�tat du gouvernement du Canada. Le Tribunal conclut des op�rations avec ces entit�s dans le cours normal des ses activit�s et selon des modalit�s commerciales normales. De plus, au cours de l’exercice, le Tribunal re�oit gratuitement des services d’autres minist�res, comme il est indiqu� � la partie a). (a) Services fournis gratuitement : Au cours de l’exercice, le minist�re re�oit gratuitement des services d’autres minist�res (installations et cotisations de l’employeur au r�gime de soins de sant� et au r�gime de soins dentaires). Ces services gratuits ont �t� constat�s comme suit dans l’�tat des r�sultats du minist�re :
Le gouvernement a structur� certaines de ses activit�s administratives de mani�re � optimiser l’efficience et l’efficacit� de sorte qu’un seul minist�re m�ne sans frais certaines activit�s au nom de tous. Le co�t de ses services, qui comprennent les services de paye et d’�mission des ch�ques offerts par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ne sont pas inclus � titre de charge dans l’�tat des r�sultats du Tribunal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapitre 4 : Autre points d’int�r�t
Renseignements sur les personnes-ressources et site Web
Renseignements g�n�raux
Vos observations et questions sont importantes � nos yeux et nous vous prions de ne pas h�siter � communiquer avec nous par l’un des moyens suivants :
T�l�phone
613-949-6516
1-866-637-4491 (sans frais)
ATS (appareil de t�l�communication pour sourds)
866-389-6901
T�l�copieur
613-949-6551
Courriel
Info@psst-tdfp.gc.ca
Poste
Tribunal de la dotation de la fonction publique
240, rue Sparks, tour Ouest
6e �tage
Ottawa (Ontario)
K1A 0A5
Site Web
http://www.psst-tdfp.gc.ca
Information reli�e aux plaintes
Courriel :
Director.directeur@psst-tdfp.gc.ca
Envoi postal :
Directeur ex�cutif
Tribunal de la dotation de la fonction publique
240, rue Sparks, tour Ouest
6e �tage
Ottawa, ON K1A 0A5
Envoi par t�l�copieur : 613-949-6551
* Au moment de la r�daction de ce rapport, on ne conna�t pas le nombre de dossiers ouverts en 2006-2007 qui ont �t� dirig�s vers la m�diation en 2007-2008.