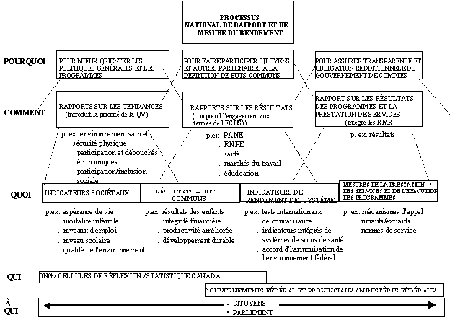Liens de la barre de menu commune
Fil d'Ariane
ARCHIVÉ - Qualité de vie - rapport conceptuel : les moyens de définir et de mesurer la qualité de vie et de présenter aux Canadiens des rapports à ce sujet
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Message de la pr�sidente
Lors de son discours du Tr�ne en 1999, le gouvernement actuel a d�crit d'ambitieux projets pour l'avenir. Il entend investir dans des secteurs comme la jeunesse, l'emploi, la sant�, l'environnement et la technologie - les secteurs qui importent le plus pour les Canadiens et les Canadiennes. Cette intention correspond au ferme engagement pris par le gouvernement vis-�-vis de la population canadienne de prendre des mesures qui am�lioreront et prot�geront la qualit� de vie dans notre pays.
La ��qualit� de vie�� est un concept vaste que l'on peut d�finir de nombreuses fa�ons et qui ne se limite pas simplement au revenu. Il est le produit de l'interaction d'un certain nombre de facteurs sociaux, �conomiques, environnementaux et li�s � la sant�. Il est important pour les d�cideurs � tous les paliers gouvernementaux de chercher � comprendre davantage quelles sont les choses auxquelles les Canadiens et Canadiennes attachent de la valeur dans le contexte de leur qualit� de vie. Cette compr�hension est essentielle � la cr�ation, � la mise en oeuvre et � l'�valuation de programmes et de services ax�s sur les citoyens et les citoyennes de notre pays.
En Octobre 1999, j'ai d�pos� au Parlement le rapport intitul� Une gestion ax�e sur les r�sultats 1999. Dans le chapitre 3 de ce document, on aborde des questions ayant trait � la mesure des indicateurs sociaux et on propose des approches que l'on pourrait adopter pour produire des rapports complets tenant compte de la qualit� de vie. Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor s'est engag� � consulter de nombreux partenaires diff�rents � propos de ce sujet important et complexe. Le pr�sent document, Qualit� de vie, s'inscrit dans ce processus. Il vise � encourager la discussion et la communication d'id�es sur la mani�re de d�finir et de mesurer la qualit� de vie pour les Canadiens et Canadiennes et d'en rendre compte.
Je vous encourage donc � lire ce document, � r�fl�chir aux questions qu'il soul�ve et � nous faire part des commentaires qu'il suscite. C'est � partir de cette r�flexion que tous ensemble, nous pourrons mieux d�finir nos politiques publiques, aujourd'hui et pour l'avenir.
�
Lucienne Robillard
Pr�sidente du Conseil du Tr�sor
R�sum�
Le pr�sent rapport conceptuel examine trois �l�ments�: les moyens de d�finir et de mesurer la qualit� de vie (QV) ainsi que les moyens de pr�senter des rapports � son sujet. Il propose ensuite un cadre pour l'�tablissement d'un processus f�d�ral de mesures du rendement et de rapports qui pourrait int�grer des rapports sur la QV.
L'int�r�t que suscite la pr�sentation de rapports sur la QV trouve son origine dans trois tendances qui se sont dessin�es r�cemment dans le domaine de la gestion publique moderne. En premier lieu, on assiste � un regain d'int�r�t pour les indicateurs soci�taux, apr�s un d�clin, dans les ann�es 80, qu'avaient pr�c�d� quelque quinze ann�es de d�veloppement. Les gouvernements de tous ordres ainsi que des organisations internationales publient des rapports sur les indicateurs soci�taux. L'OCDE commencera en l'an�2000 � rendre publiques des donn�es sur les indicateurs soci�taux, mais le rapport le plus connu est l'Indice du d�veloppement humain des Nations�Unies, qui a maintes fois class� le Canada au premier rang d'un indice que les m�dias ont popularis� comme �tant un outil de classement des pays au chapitre de la qualit� de vie.
En deuxi�me lieu, on observe une tendance croissante des administrations publiques � faire rapport aux citoyens sur le rendement. Cette pr�sentation de rapports lib�re l'imputabilit�, ou obligation de rendre compte, de la formule simpliste qui consiste � pointer du doigt, pour la faire tendre vers une approche nouvelle dans laquelle les gouvernements sont responsables de dire quels sont les r�sultats d�sir�s des programmes et comment ces r�sultats seront mesur�s de fa�on transparente, puis de tirer des le�ons des �checs pour atteindre les r�sultats escompt�s et modifier les programmes en cons�quence.
En troisi�me lieu, on remarque que, de plus en plus, les citoyens veulent avoir leur mot � dire dans la d�finition des questions et dossiers � l'ordre du jour et dans le processus d'�laboration des politiques. La pr�sentation de rapports sur la QV peut faciliter la mise en oeuvre de processus visant � faire participer les citoyens � l'�laboration des politiques.
Il existe divers liens entre la fonction propos�e de rapports sur la QV et des initiatives f�d�rales connexes d�j� en cours, notamment les rapports minist�riels sur le rendement (RMR) et le rapport de la pr�sidente du Conseil du Tr�sor intitul� Une gestion ax�e sur les r�sultats, qui sont d�pos�s chaque ann�e au Parlement, ainsi que les engagements que le gouvernement f�d�ral a pris, dans l'Entente-cadre sur l'union sociale (ECUS), en mati�re d'obligation redditionnelle et de pr�sentation de rapports.
Le pr�sent rapport propose un processus f�d�ral exhaustif de mesure du rendement et de transmission de donn�es aux citoyens qui int�gre trois volets de pr�sentation de rapports�: la fonction de rapport sur les tendances soci�tales, comme la QV; la fonction de rapport sur les r�sultats atteints quant aux buts soci�taux communs, comme ceux que pr�voit l'ECUS; la fonction de rapport sur les r�sultats de programmes et sur le rendement des programmes f�d�raux au chapitre de la prestation de services, dimensions qui sont la raison d'�tre des RMR. Chacun de ces volets r�pond � des objectifs diff�rents et chacun en est � une �tape diff�rente d'�laboration. Un rapport int�gr� ne remplacerait aucune de ces initiatives existantes, ni n'en modifierait l'�volution, mais s'en inspirerait plut�t pour atteindre un objectif plus fondamental.
Un rapport exhaustif mentionnerait que le but de chaque type de rapport est diff�rent. Les rapports de QV sur les donn�es conjoncturelles (tendances) visent � renseigner les citoyens sur la fa�on dont ils peuvent influer sur l'orientation des politiques g�n�rales et sur la s�lection des questions et dossiers � l'ordre du jour. Compte tenu de la difficult�, dans ces types d'indicateurs, d'attribuer des changements � des mesures gouvernementales particuli�res, ce type de rapports ne peut �tre assimil� � un instrument pour tenir les gouvernements responsables, quoique certains puissent vouloir les utiliser � cette fin. La fonction de rapport sur les r�sultats atteints � l'�gard de buts soci�taux communs vise � renseigner les citoyens pour les amener � participer, de concert avec d'autres intervenants tels que les organisations gouvernementales et non gouvernementales, � la d�finition et � la r�alisation de buts communs. La fonction de rapport sur les r�sultats de programmes et la prestation de services des minist�res a pour objet de permettre aux citoyens de tenir les gouvernements responsables, id�alement dans une perspective de transparence et d'apprentissage, plut�t que de se contenter de bl�mer ou de critiquer.
La s�rie de rapports sur la gestion ax�e sur les r�sultats, publi�s au cours des quatre derni�res ann�es, commandait un processus de rapport sur les indicateurs soci�taux, et les parlementaires ont fait remarquer qu'un tel processus de rapport fournirait la mati�re de leur examen des RMR.
Comme point de d�part du d�bat et de la discussion, le chapitre�3 du rapport Une gestion ax�e sur les r�sultats 1999 propose, en mati�re de pr�sentation de rapports, une approche exhaustive qui comporterait un volet centr� sur la qualit� de vie; le rapport pr�voit �galement une s�rie d'exemples d'indicateurs soci�taux, que Statistique�Canada a �labor�s de fa�on assez d�taill�e.
Tout processus du genre de celui qui est discut� ici devrait �tre ax� sur les citoyens. Les indicateurs d�finitifs de QV sur lesquels on s'est entendu doivent �tre pertinents aux citoyens et rendre compte de leurs valeurs quant � ce qui contribue � la QV. Il conviendrait donc de faire participer les citoyens � la d�finition des indicateurs et des mesures r�elles utilis�s pour �valuer le rendement. Il faudrait �galement faire appel � des experts pour veiller � ce que la m�thodologie qui sous-tend les rapports soit cr�dible. Il y aurait �galement lieu de consulter d'autres gouvernements qui publient d�j� des rapports sur les indicateurs soci�taux, comme le gouvernement de l'Alberta, qui a inclus des indicateurs soci�taux dans son rapport annuel de mesure du rendement, afin de partager les meilleures pratiques.
Pour mettre en place un cadre de rapport exhaustif, il conviendrait de recourir � une approche �volutive et graduelle qui susciterait l'adh�sion des intervenants � l'�gard d'un tel rapport. Parall�lement, il existe d�j� une solide expertise dans certains minist�res, en particulier Statistique Canada. Des relations avec les experts et les membres du Parlement ont d�j� �t� tiss�es avec la publication des rapports sur la gestion ax�e sur les r�sultats, et des discussions sur la mesure du rendement sont toujours en cours avec les provinces en vue d'initiatives conjointes, comme le R�gime national de prestations pour enfants (RNPE) et le Programme d'action national pour les enfants (PANE). La possibilit� de tirer parti de ce travail et l'appui qui existe d�j� pour de tels rapports contribueraient � faire avancer le concept et la mise en oeuvre d'un cadre de rapport exhaustif.
1. D�finir la QV
Il ne semble pas y avoir de d�finition unique g�n�ralement accept�e de la QV dans les tr�s nombreux documents qui ont �t� produits sur le sujet au cours des trente derni�res ann�es. Qui plus est, d'autres expressions, telles que ��bien-�tre social��, ��s�curit� sociale�� et ��d�veloppement humain��, sont souvent utilis�es comme des expressions �quivalentes ou analogues. Par exemple, comme on l'a d�j� vu, l'Indice du d�veloppement humain des Nations�Unies est souvent qualifi� d'instrument de mesure de la QV. G�n�ralement, toutefois, la QV est consid�r�e comme le produit de l'interaction de plusieurs facteurs (sociaux, de sant�, �conomiques, environnementaux) qui, collectivement et par des moyens souvent inconnus, entrent en interaction pour finalement avoir une incidence sur le d�veloppement humain et social, au niveau des particuliers comme � celui des soci�t�s.
Dans les �tudes et ouvrages parus sur la question, on reconna�t qu'une telle notion comporte une dimension � la fois subjective et objective. ��En ce qui a trait � la qualit� de vie subjective, il est question de se sentir bien et d'�tre satisfait des choses en g�n�ral. Quant � la qualit� de vie objective, il s'agit de satisfaire aux exigences culturelles et soci�tales en mati�re de richesse mat�rielle, de statut social et de bien-�tre physique.�� (Centre de recherches sur la QV, Danemark).�i Cela repr�sente un d�fi pour ce qui est de mesurer la QV et de faire rapport � cet �gard. Par exemple, les r�sultats d'un indicateur subjectif tel qu'un sondage d'opinion pourraient faire appara�tre qu'un groupe en particulier se dit tr�s satisfait de sa QV, alors que des indicateurs objectifs comme la sant�, le logement, le revenu et l'�ducation, appliqu�s au m�me �chantillon, pourraient d�noter un niveau moins �lev� de QV, peut-�tre, par rapport � d'autres personnes. Lequel de ces indicateurs repr�sente la mesure la plus pertinente de la QV et lequel devrait guider la d�finition des programmes et l'�laboration des politiques?
Il importe de tenir compte de la fa�on dont les Canadiens per�oivent actuellement la notion de QV et de ce que cette expression signifie vraiment pour eux. Fait int�ressant � noter, l'expression ne semble pas �tre confondue avec le ��niveau de vie��, puisque tant les travaux et documents publi�s sur la question que le public en g�n�ral font une nette distinction entre la QV et le ��niveau de vie��. La International Society for Quality of Life Studies d�finit le niveau de vie comme une mesure de la quantit� et de la qualit� des biens et services mis � la disposition des gens, comme le PIB par habitant, le nombre de m�decins par millier d'habitants, le pourcentage du PIB consacr� � la sant� et � l'�ducation, ou le nombre de t�l�viseurs et de t�l�phones par m�nage. Elle donne de la QV une d�finition tr�s diff�rente�: ��le produit de l'interaction entre les facteurs sociaux, �conomiques, environnementaux et de la sant� qui touchent le d�veloppement humain et social��.ii En fait, la notion de QV a vu le jour au milieu des ann�es�1960, comme solution de rechange au concept de la ��soci�t� d'abondance��, dont on doutait de plus en plus qu'il puisse �tre une mesure de la richesse d'une soci�t�. Y fait �cho cette r�flexion du pr�sident am�ricain Johnson qui, en 1964, caract�risait la ��grande soci�t頻 comme ��ne se pr�occupant pas tant de la quantit� de produits que de la qualit� de la vie.��
Un r�cent sondage d'opinion EKOS sur la notion de productivit� a fait ressortir ��un profond �cart d'opinion�entre la fa�on dont on per�oit le 'niveau de vie' et la r�sonance de la 'qualit� de vie'��, et que les Canadiens n'accordaient pas la m�me valeur aux deux expressions. Par exemple, en r�ponse � une question sur le but national que le Canada devrait atteindre d'ici�2010, les r�pondants ont d�clar� que s'ils se trouvaient pendant une journ�e � la place du premier ministre, ils mettraient (dans une proportion de 66�%) ��la meilleure qualit� de vie au monde�� au premier rang des priorit�s de la nation, comparativement au ��niveau de vie le plus �lev� des pays industrialis�s��, qui a constitu� la deuxi�me r�ponse la moins populaire, avec une proportion de 30�% des r�pondants. iii
Le sondage EKOS a �galement r�v�l� que, pour le grand public, l'expression ��qualit� de vie�� semblait clairement li�e aux politiques et objectifs �conomiques et sociaux, ce qui correspond � la fa�on dont la politique publique devrait �tre �labor�e aux yeux de la majorit�. Il semble que les Canadiens soient de plus en plus nombreux � reconna�tre que ��la croissance �conomique et un meilleur niveau de vie passent obligatoirement par de bons programmes sociaux et de bonnes politiques sociales��. iv Le rapport EKOS conclut que les r�pondants qui ont massivement rejet� l'id�e du ��niveau de vie le plus �lev頻 comme objectif d�terminant pour le Canada ne se per�oivent pas ni ne per�oivent leur soci�t� en simples termes p�cuniaires, mais se pr�occupent de ce qu'on appelle souvent ��l'investissement humain��, c'est-�-dire la sant�, l'�ducation, l'acquisition de comp�tences et les r�sultats des enfants.
Pour les Canadiens, la ��qualit� de vie�� pourrait aussi repr�senter cette qu�te constante d'un �quilibre entre les objectifs sociaux et �conomiques qui diff�rencie le Canada de bien d'autres pays, en particulier les �tats-Unis. Nombreux sont ceux qui estiment que l'identit� canadienne r�side en fait dans cette diff�renciation explicite du Canada et des �tats-Unis, en particulier au chapitre des programmes sociaux, tels que les soins de sant�. D'aucuns ont �mis l'hypoth�se que cette approche pourrait �tre d�finie comme ��la fa�on canadienne��, et d'autres ont fait valoir qu'une politique de la qualit� de vie pouvait �tre caract�ris�e comme une version canadienne de la ��troisi�me mani�re�� mise de l'avant par le premier ministre de Grande-Bretagne, Tony�Blair.
Lors d'une r�union de participants du gouvernement, du milieu des affaires et du secteur b�n�vole, qui s'est tenue � l'occasion du Forum des politiques publiques (FPP), en juin�1999, a �merg� un autre sens de l'expression ��qualit� de vie��. L'objectif de cette r�union �tait d'�tudier des fa�on d'am�liorer le partenariat � trois entre ces secteurs afin d'���difier une saine soci�t頻. Les participants ont d�cid� de mettre en oeuvre un grand projet pour aider les trois secteurs � travailler de concert et � cr�er une vision commune de cette soci�t�. Le projet qu'ils ont choisi a �t� celui de l'�laboration d'indices de la qualit� de vie, notamment parce qu'ils voyaient la ��qualit� de vie�� comme un possible point de ralliement sur lequel tous les secteurs pourraient s'entendre, malgr� des divergences sur des dossiers particuliers tels que l'exode des cerveaux et la productivit�. Ils ont isol� ce terrain d'entente car ils convenaient tous de l'importance de lier les objectifs �conomiques aux objectifs sociaux, ce que l'expression ��qualit� de vie�� semble l� encore incarner.
Les significations vari�es mais compatibles entre elles que semble rev�tir l'expression ��qualit� de vie�� pour les Canadiens militent grandement en faveur de son utilisation comme th�me directeur de l'action gouvernementale. On ne saurait toutefois r�duire la qualit� de vie � un simple slogan si l'on veut qu'elle oriente la politique publique et, en particulier, si elle repr�sente un moyen de d�finir et de formuler l'identit� canadienne en r�ponse aux pressions de la mondialisation et de l'int�gration �conomique accrue avec les �tats-Unis. L'approche retenue pour mesurer la QV et faire rapport � cet �gard sera d�terminante pour la formulation et l'�volution de la QV au-del� du simple slogan.
Il est plus important encore que le gouvernement soit clair sur l'objet de la fonction gouvernementale de rapport sur la QV et qu'il soit en mesure de satisfaire les attentes de citoyens. En particulier, il faudra que le gouvernement fasse la distinction entre le recours � cette fonction de rapport pour op�rer des choix �clair�s en mati�re de processus d'�laboration des politiques et l'�tablissement d'un lien explicite entre la pr�sentation de rapports sur la QV et la d�finition des priorit�s.
2. Mesurer la QV
Il y a un certain nombre de difficult�s d'ordre m�thodologique associ�es � la mesure de la QV. En fait, les probl�mes de mesure ont �t� les moteurs de l'�laboration du concept m�me de la QV. Les critiques sur le plan m�thodologique faites au domaine des indicateurs sociaux, qui mettaient l'accent sur son incapacit� de d�montrer comment diff�rentes variables entrent en interaction pour produire une QV donn�e et le fait que ce domaine n'ait pu int�grer des donn�es subjectives, ont entra�n� son d�clin au d�but des ann�es�1980, apr�s quelque quinze ann�es de d�veloppement. Peut-�tre ce d�clin �tait-il in�vitable �tant donn� cette hypoth�se initiale, non d�nu�e d'une certaine pr�tention, qui voulait que l'exp�rience et les processus soci�taux puissent �tre quantitativement model�s et rapport�s d'une fa�on qui pouvait se traduire directement par une action gouvernementale. Avec un tel objectif en point de mire, les recherches sur les indicateurs sociaux n'ont pu r�pondre aux attentes.
Depuis le milieu des ann�es 1980, les objectifs de la recherche et des travaux appliqu�s en mati�re d'indicateurs sociaux sont plus modestes. En m�me temps, la technologie de l'information, avec l'arriv�e des bases de donn�es et de l'infrastructure de traitement des donn�es, a rendu ces objectifs plus faciles � atteindre. Les tenants de ce mouvement ne pr�tendent pas que des mod�les quantitatifs d'indicateurs sociaux peuvent �tre utilis�s pour simplifier les processus de planification ou fixer des priorit�s. Ils d�fendent plut�t les indicateurs sociaux � titre de donn�es pouvant �clairer les processus strat�giques et �tre int�gr�es dans ces processus, et que l'on peut utiliser pour mesurer les progr�s accomplis � l'�gard de la r�alisation de buts convenus. En particulier, on a affirm� que l'une des plus importantes fonctions des indicateurs sociaux a �t� de relever le profil des questions sociales dans le d�bat sur la politique publique domin� par les indicateurs �conomiques plus facilement accessibles, tels que le produit int�rieur brut (PIB). Un chercheur scandinave dans le domaine, Joachim�Vagel, soutient que ��les rapports sur la soci�t� s'inscrivent dans le cadre de l'infrastructure d�mocratique et qu'ils exercent une fonction politique particuli�re. Pour simplifier, les rapports sur la soci�t� inscrivent la question du bien-�tre au programme politique.��v
Divers mod�les de QV sont d�j� utilis�s. Plusieurs de ces indicateurs, par exemple l'esp�rance de vie, la qualit� de l'environnement physique, les taux de criminalit�, les taux de pauvret� et des statistiques �conomiques telles que le PIB par habitant, ont tendance � se retrouver dans la plupart des mod�les de QV. Parall�lement, au terme de trois d�cennies de travaux accomplis dans le domaine, il ne s'est toujours pas d�gag� de consensus th�orique ou m�thodologique sur la mesure de la QV. � ce chapitre, mentionnons par exemple le d�bat entourant la question des indices sommaires, un aspect de la mesure de la QV qui conna�t actuellement un regain d'int�r�t. Un certain nombre de mod�les de QV tentent de fournir un index sommaire, bien que l'une des questions cl�s, sur le plan strat�gique, soit de d�terminer dans quelle mesure pareille agr�gation (r�union) de donn�es peut �tre utile pour �clairer le d�bat politique, d'autant plus que, ainsi que l'affirme Lars�Osberg, un index unique a tendance � rendre plus floues les questions de fait, les analyses et les valeurs. Une solution, que l'on retrouve dans l'indice de bien-�tre �conomique mis au point par Lars�Osberg et Andrew�Sharpe vi, consiste � fournir des donn�es pour d�clencher explicitement un d�bat sur le poids qui se rattache � chaque composante de l'indice.
La s�lection d'indicateurs proc�de � la fois de la science et de l'art, puisqu'elle fait fondamentalement appel � des d�cisions sur des questions statistiques et � des jugements sur des valeurs. Le d�fi qui consiste � trouver des solutions aux probl�mes statistiques peut �tre relev� en engageant des experts dans un d�bat sur les questions m�thodologiques, mais la n�cessit� de porter des jugements de valeur sur la pr�sentation de rapports sur la QV commande la participation des citoyens � un certain nombre d'aspects du processus, notamment le choix et la d�finition des indicateurs ainsi que l'attribution de valeurs aux indicateurs, la r�ception et l'interpr�tation des r�sultats, de m�me que la surveillance et l'affinement des indicateurs au fil du temps. Un syst�me de mesure de la QV et de pr�sentation de rapports sur la QV cr�dible et pertinent, et qui vise � influer sur la d�finition des questions et dossiers � l'ordre du jour, doit absolument faire intervenir experts et citoyens dans son �laboration et son �volution.
Un examen plus pouss� de ces probl�mes m�thodologiques pourrait reposer sur un mod�le de rapport sur la QV. Pour produire un tel rapport, il faudrait d�finir les indicateurs les plus pertinents dans chaque domaine, notamment des donn�es suggestives et des donn�es objectives. Il faudrait faire une analyse des tendances pour chaque indicateur, puisque la mesure la plus utile de la QV n'est pas un instantan� ponctuel, mais plut�t une analyse de l'�volution des donn�es pendant les p�riodes pertinentes. Cette analyse pourrait tabler sur des donn�es rep�res, au m�me titre que l'Indice du d�veloppement humain des Nations�Unies. Comme point de d�part, on pourrait inclure des donn�es comparables pour les indicateurs des �tats-Unis, lorsqu'elles existent.
La s�rie d'indicateurs possibles de la QV pr�sent�e dans le tableau ci-dessous, qui a �t� �labor�e par Statistique�Canada et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, est tir�e du rapport Une gestion ax�e sur les r�sultats 1999 d�pos� par la pr�sidente du Conseil du Tr�sor en octobre�1999. On peut trouver des renseignements suppl�mentaires sur ces indicateurs aux sites suivants�: http://www.statcan.ca/. On y trouvera des d�finitions des indicateurs, des analyses des tendances sous forme graphique, une interpr�tation des donn�es, et des comparaisons pertinentes avec d'autres pays, notamment � partir de donn�es comparables pour les �tats-Unis, lorsqu'elles existent.
| Sant�, environnement et
s�curit� du public |
Occasions et participation �conomiques |
Participation sociale |
|
|
|
Cet ensemble d'indicateurs �ventuels a pour objet d'alimenter la discussion sur des questions de fond et de forme, puisqu'il faudrait beaucoup plus de travail pour produire un rapport cr�dible sur la QV. En particulier, il faudrait prendre davantage en consid�ration les crit�res que l'on ferait intervenir pour recenser les indicateurs de QV � utiliser pour produire un rapport f�d�ral sur la QV, notamment la pertinence au programme strat�gique actuel, la pertinence par rapport aux citoyens et la disponibilit� de donn�es ou le co�t de la production de nouvelles donn�es.
Une autre question � examiner serait celle de d�terminer si seules des donn�es nationales doivent �tre pr�sent�es, ou si le rapport devrait comprendre des ventilations pertinentes par sous-groupe. Par exemple, la courbe des donn�es canadiennes sur l'esp�rance de vie est positive au niveau national, mais le tableau est bien diff�rent pour les donn�es d'esp�rance de vie des autochtones. En corollaire, il s'agirait de mesurer l'opportunit� de fournir des donn�es r�gionales qui seraient plus pertinentes pour les citoyens. Sur le plan technique, on pourrait concevoir un site Web consacr� aux grands indicateurs, qui permettrait � l'utilisateur d'acc�der, en mode descendant, � une information plus d�taill�e.
Il importe aussi de d�finir l'�quilibre � atteindre entre les donn�es quantitatives et l'analyse et l'interpr�tation qualitative des donn�es. Fondamentalement, il s'agit de d�terminer pourquoi certains indicateurs �voluent � la hausse et � la baisse dans le temps et si tous les Canadiens sont touch�s de la m�me fa�on par ces tendances. Quels r�sultats d'analyse devraient se retrouver dans un document gouvernemental et quelle proportion de l'analyse doit �tre laiss�e aux universitaires et aux organisations non gouvernementales int�ress�s? Dans quelle mesure cela aurait-il une incidence sur la cr�dibilit� du rapport?
3. Faire rapport sur la QV
Un rapport sur la QV devait �tre un rapport public plut�t qu'interne, qui pourrait �tre rendu public par le gouvernement f�d�ral, voire d�pos� au Parlement, sur le mod�le du rapport sur la gestion ax�e sur les r�sultats, qui est d�pos� annuellement � l'automne. Il faudrait formuler clairement l'objectif du rapport et clarifier les liens entre une nouvelle initiative de rapport sur la QV, les actuels RMR et d'autres engagements en mati�re de rapport que le gouvernement f�d�ral a pris.
Il y a, dans la gestion publique moderne, diverses tendances qui fournissent le contexte de la pr�sentation de rapports sur la QV par le gouvernement f�d�ral.
Tout d'abord, les organisations statistiques nationales et internationales compilent et publient davantage de donn�es statistiques sur un �ventail de sujets de plus en plus large. Cette tendance est induite par de nombreux facteurs, notamment les progr�s de la technologie de l'information, la complexit� croissante des questions de politique publique, qui n�cessite la compilation de donn�es plus nombreuses et de meilleure qualit�, et le besoin de fournir des donn�es au secteur priv� afin qu'il maintienne sa capacit� concurrentielle dans une �conomie de plus en plus mondialis�e. Au nombre des intervenants cl�s dans ce domaine, mentionnons les bureaux statistiques, tel Statistique�Canada, qui publie des donn�es nationales, mais aussi des organisations internationales comme les Nations�Unies et l'Organisation de Coop�ration et de D�veloppement �conomiques, qui publient des rapports renfermant des donn�es comparables sur un certain nombre de pays. De plus en plus, on per�oit ces derniers rapports comme �tablissant des donn�es de r�f�rence sur le rendement de chaque pays.
Un exemple classique de ce genre de rapport est celui de l'Indice du d�veloppement humain des Nations�Unies. Le Canada peut s'enorgueillir � juste titre du premier rang qu'il y occupe depuis quelques ann�es, mais on se demande si un rapport ��fait au Canada�� sur notre qualit� de vie ne rendrait pas mieux compte de nos priorit�s et valeurs propres et, par l� m�me, ne serait pas plus pertinent � notre programme politique.
En deuxi�me lieu, en gestion publique moderne, se dessine une tendance des gouvernements � faire rapport aux citoyens. Cela repr�sente une �volution notable de la traditionnelle fonction gouvernementale de communication de renseignements, puisque cela signifie que les administrations publiques font preuve d'une plus grande transparence � l'�gard des objectifs qu'elles essayent d'atteindre, des raisons qui leur font croire que des activit�s ou programmes gouvernementaux particuliers permettront d'atteindre ces objectifs et de la fa�on dont elles (les citoyens) mesureront le degr� de r�alisation de leurs objectifs. En faisant ainsi rapport, les gouvernements ont aussi l'occasion de montrer comment ils apprennent de ce processus de mesure des r�sultats et y modifient leurs activit�s en sorte d'atteindre les r�sultats d�sir�s. Ce genre de transparence �taye une nouvelle perspective sur la responsabilisation, dans laquelle les administrations publiques sont responsables, aux yeux de la population�:
- de comprendre et formuler clairement quels r�sultats sont escompt�s, comment les programmes et politiques sont con�us pour atteindre ces r�sultats et comment l'on mesurera le degr� de r�alisation de ces buts;
- d'atteindre ces r�sultats dans le respect des traditionnelles valeurs de la fonction publique, soit l'application r�guli�re de la loi, l'�quit� et la justice, en satisfaisant aux normes de service en mati�re de rapidit� de traitement, de qualit� et d'exactitude et, le cas �ch�ant, en pr�voyant des m�canismes d'appel et de recours ou de r�paration; de tirer les le�ons des �checs pour modifier les programmes en cons�quence et atteindre les r�sultats d�sir�s.
Ce genre de transparence et d'obligation redditionnelle est l'objectif du mouvement auquel on assiste en faveur d'une approche d'apprentissage bas�e sur les valeurs et les r�sultats, en gestion publique moderne, que l'on retrouve de plus en plus souvent dans les RMR. La pr�sentation de rapports sur la QV pourrait aussi �tre une composante de la gestion publique moderne, mais d'une fa�on qui tienne bien compte de la capacit� souvent limit�e des administrations publiques d'influer directement sur les indicateurs de QV choisis. Ainsi, la pr�sentation de rapports de QV ne doit pas �tre interpr�t�e comme un instrument d'imputabilit� du gouvernement (quoique certains voudront l'utiliser de cette fa�on), mais plut�t comme un outil servant � �clairer le programme politique. Mais si l'on veut une approche exhaustive en mati�re de communication de l'information, il conviendrait de compl�ter les rapports sur la QV par des rapports sur les r�sultats de programmes et la prestation de services que feraient les administrations publiques qui fournissent des renseignements aux citoyens sur les mesures particuli�res que prend le gouvernement pour influer, en bout de ligne, sur la qualit� de vie au Canada.
Le troisi�me aspect de la gestion publique moderne pertinent aux rapports sur la QV consiste � aller au-del� de la transparence et de la responsabilit� pour faire r�ellement participer les citoyens au processus de s�lection des questions et dossiers � l'ordre du jour et d'�laboration des politiques. Certains ont qualifi� cet aspect d'�volution selon laquelle les citoyens ne sont pas simplement consid�r�s comme des �lecteurs ou des consommateurs de services publics, mais comme des partenaires de la gouvernance. Les sondages d'opinion d�notent clairement une volont� des citoyens de participer aux discussions sur les questions de politiques publiques qui sont importantes � leurs yeux, en particulier celles qui portent sur des valeurs fondamentales et impliquent des compromis � faire entre les valeurs, et montrent qu'ils ne sont pas satisfaits des traditionnels v�hicules de communication des renseignements et de consultation que les gouvernements ont utilis�s pour les faire participer au processus d'�laboration des politiques.
Qui plus est, les citoyens estiment que la r�solution de nombreuses questions de politiques publiques exigera de plus en plus la participation d'un certain nombre d'intervenants, et pas seulement un seul ordre de gouvernement. L'accent sera mis sur la participation d'un certain nombre d'intervenants qui s'entendront sur des buts communs et des r�sultats escompt�s, en d�finissant la contribution que chacun d'eux fera � la r�alisation de ces buts ainsi qu'en mesurant et faisant rapport sur la contribution de chaque intervenant. Ce genre de processus transpara�t clairement dans de r�centes initiatives, comme le RNPE et le PANE, ainsi que dans les engagements redditionnels que les administrations f�d�rale, provinciales et territoriales ont pris dans l'ECUS. Les rapports sur la QV pourraient compl�ter les rapports sur des buts communs, comme le PANE, en fournissant des analyses de tendances sur les indicateurs cl�s des r�sultats touchant les enfants, par exemple la mortalit� infantile et le niveau scolaire.
Cette analyse de l'environnement de la gestion moderne dans lequel le gouvernement f�d�ral pourrait instaurer la pr�sentation de rapports sur la QV implique que l'objectif de tels rapports doit �tre clairement formul� et diff�renci� de celui des autres rapports du gouvernement, mais, id�alement, en �tant compl�mentaire des objectifs des autres rapports. Cette analyse fait �galement ressortir la n�cessit�, pour un gouvernement f�d�ral d�sireux d'instaurer un processus de pr�sentation de rapports sur la QV, de faire participer un certain nombre d'autres intervenants, par exemple des experts en m�thodologies associ�es � la QV, les citoyens (au sujet des valeurs qui pourraient �tayer un rapport sur la QV ��fait au Canada��), les gouvernements provinciaux (sur les implications d'un tel rapport sur leurs initiatives de rapport au public) et le Parlement (sur le r�le qu'il pourrait tenir dans ce processus).
En outre, il y aurait lieu de s'attaquer � d'autres questions essentielles li�es � la fonction de rapport sur la QV. L'une de ces questions est de savoir si le rapport doit �tre publi� par le gouvernement f�d�ral comme tel ou par un bureau comme Statistique Canada. S'agirait-il d'un rapport annuel renfermant des donn�es sur une m�me s�rie d'indicateurs ann�e apr�s ann�e, ou mettrait-on l'accent sur diff�rents domaines d'indicateurs chaque ann�e? Quels liens, le cas �ch�ant, y aurait-il avec les rapports sur la QV publi�s par d'autres groupes, comme le Conference Board du Canada, la F�d�ration canadienne des municipalit�s et les R�seaux canadiens de recherche en politiques publiques? Comment, quand et par qui les citoyens seraient-ils appel�s � participer au processus?
La section suivante du pr�sent document tente de r�pondre � certaines de ces questions par la pr�sentation graphique d'un cadre qui positionne la pr�sentation de rapports sur la QV comme l'un des trois grands axes de rapport qui pourraient former ensemble un processus national exhaustif de mesure du rendement et de rapport. Le cadre propos� distingue la pr�sentation de rapports sur la QV et son objet de ceux des deux autres axes, tout en montrant les liens qui s'�tablissent entre eux.
4. Cadre propos� pour mesurer la QV et faire rapport � cet �gard
Le diagramme qui suit illustre un cadre pour un processus national exhaustif de rapport et de mesure du rendement qui comprendrait la pr�sentation de rapports sur la QV.
Selon ce cadre, les rapports sur la QV devraient �tre consid�r�s comme faisant partie d'un rapport int�gr� et exhaustif sur la mesure du rendement qui brosserait, � l'intention des Canadiens, un tableau d�taill� du rendement atteint dans des domaines int�ressant les citoyens�: am�lioration de notre qualit� de vie, degr� de r�alisation des objectifs soci�taux communs et r�sultats particuliers atteints par les programmes et services nationaux.
Un rapport d�taill� et int�gr� sur le rendement de ce genre repr�sente une �volution naturelle de l'approche adopt�e au cours des quatre derni�res ann�es lors du d�p�t, � l'automne, du rapport annuel intitul� Une gestion ax�e sur les r�sultats. Le rapport int�grerait trois types de compte rendu�: les rapports sur les donn�es soci�tales; les rapports sur les r�sultats atteints � l'�gard de buts soci�taux communs; les rapports sur les r�sultats de programme et sur le rendement des programmes f�d�raux en mati�re de prestation de services. Chacun de ces axes de rapport comporterait des objectifs distincts mais compl�mentaires, pouvant m�me se chevaucher. Le rapport sur les tendances vise � mieux orienter l'�laboration des politiques g�n�rales et la d�finition des questions et dossiers � l'ordre du jour; le rapport sur les r�sultats atteints � l'�gard des objectifs communs vise � faire appel au concours des citoyens et d'autres intervenants pour recenser et atteindre les buts soci�taux communs; la communication de donn�es sur les r�sultats des programmes et la prestation de services vise � accro�tre la transparence et l'obligation redditionnelle du gouvernement. Les liens entre ces trois types de transmission de donn�es seraient aussi clairement d�finis. Par exemple, les r�sultats atteints par un programme f�d�ral donn�, comme les soins pr�natals, contribuent � la r�alisation d'un objectif commun formul� dans le PANE et visent � r�duire les taux de mortalit� infantile, qui sont un indicateur de la QV.
Rapport sur les tendances
Dans le cadre propos�, l'objectif de la pr�sentation de rapports sur la QV est de transmettre des donn�es conjoncturelles (tendances) sur les indicateurs cl�s de la qualit� de vie afin de guider l'�laboration des politiques g�n�rales et la s�lection des questions et dossiers � l'ordre du jour des gouvernements. Forts de cette analyse des tendances, les citoyens seraient en mesure de d�terminer s'il y a eu am�lioration ou non du rendement quant aux indicateurs qui rev�tent de l'importance � leurs yeux. Le compte rendu comprendrait une analyse des raisons pour lesquelles le rendement, pour certains indicateurs, a chang� et, dans le cas d'une diminution du rendement, signalerait assur�ment le besoin d'y pr�ter attention. Les donn�es sur la QV seraient fournies � l'�chelle nationale, mais pourraient aussi �tre ventil�es par r�gion, par sexe, par tout un �ventail de sous-groupes comme les cohortes d'�ge, ou par population particuli�re, par exemple les autochtones.
Un rapport sur la QV pourrait pr�senter une analyse des tendances pour les indicateurs cl�s que les Canadiens auront recens�s comme �tant les plus pertinents pour d�finir et mesurer leur qualit� de vie. Les indicateurs devraient �galement tenir compte des politiques publiques et des domaines sur lesquels pourrait influer l'action du gouvernement. Les indicateurs fictifs de QV pr�sent�s dans le rapport Une gestion ax�e sur les r�sultats 1999 donnent une premi�re id�e de l'identification des indicateurs pertinents, mais il faudrait les mettre � l'essai aupr�s des citoyens pour en mesurer la pertinence. Cependant, ce que les citoyens consid�rent comme pertinent devra aussi �tre pond�r� par d'autres variables, comme la disponibilit� des donn�es ou le co�t de production de nouvelles donn�es. Il faudra aussi se pencher sur des questions de forme, par exemple la quantit� d'interpr�tations � inclure dans un rapport gouvernemental et la pertinence d'y inclure des donn�es comparatives internationales.
Une approche � privil�gier serait de permettre au processus de pr�sentation de rapports sur la QV d'�voluer � mesure que les citoyens et les administrations publiques se familiarisent avec le processus. Un premier rapport pourrait d�crire le processus propos� et fournir quelques indicateurs � titre d'exemples pour nourrir le d�bat entre les citoyens et les experts. Les premiers rapports pourraient se contenter de suivre l'�volution des indicateurs sur lesquels on se sera entendu, de tenir compte des tendances et de modifier les indicateurs en cons�quence. Une fois que l'on estimera qu'un ensemble acceptable d'indicateurs a �t� r�uni, le rapport pourrait introduire la notion d'analyse comparative avec d'autres pays. Le besoin de r�pondre aux pr�occupations des citoyens en ce qui concerne les tendances dans les indicateurs et la r�action des citoyens aux r�sultats des analyses comparatives pourraient fort bien amener les gouvernements � d�finir des orientations strat�giques particuli�res pour combler les lacunes observ�es dans le rendement du Canada, particuli�rement par comparaison avec le rendement d'autres pays. La transmission de donn�es sur la QV pourrait aussi influer sur des d�bats publics plus g�n�raux portant sur les niveaux d'imposition ou la taille du gouvernement.
Rapport sur les r�sultats
L'objectif du volet des comptes rendus sur les r�sultats, dans un rapport int�gr� de mesures du rendement, serait de transmettre des informations aux citoyens pour les faire participer � la d�finition de buts communs et � la surveillance des progr�s dans la r�alisation de ces buts. Cette participation viendrait �tayer les efforts d�ploy�s pour d�finir des buts communs, exercice qui exige le concours de nombreux intervenants, pour d�finir la contribution potentielle de chacun d'eux � la r�alisation de l'objectif commun, puis pour mesurer les progr�s � cet �gard. Ce volet constituerait donc un v�hicule particuli�rement utile et opportun de transmission de donn�es sur les buts communs recens�s par les administrations f�d�rales, provinciales et territoriales dans le cadre de leurs discussions sur l'union sociale.
Par exemple, ces ordres de gouvernement collaborent d�j� � des initiatives de rapport et de mesure du rendement pour le PANE et le RNPE, en plus de travailler de fa�on continue sur d'autres secteurs, comme la sant� et les programmes pour personnes handicap�es. Comme ces initiatives pr�voient d�j� la publication conjointe de rapports annuels, ces rapports seraient simplement synth�tis�s dans le programme national propos� de mesure du rendement, et l'on indiquerait aux lecteurs la fa�on d'acc�der aux rapports complets. Cette forme faciliterait la communication aux citoyens de renseignements sur les r�sultats atteints dans les nombreux secteurs de l'union sociale. Le rapport f�d�ral ne doit pas �tre n�cessairement le seul � synth�tiser cette information, puisque les gouvernements provinciaux pourraient �galement opter pour l'inclusion de ce genre de donn�es dans leurs propres rapports de mesure du rendement. La communication de donn�es sur les r�sultats ne se limiterait toutefois pas � la pr�sentation de rapports sur les buts sociaux, mais comprendrait aussi des comptes rendus sur la r�alisation de buts �conomiques, comme celui de la productivit� am�lior�e, et d'objectifs environnementaux, comme celui du d�veloppement durable.
Outre le travail d�j� en cours pour faire rapport sur les buts particuliers, comme le PANE, on s'attache aussi � permettre aux gouvernements de faire rapport aux citoyens sur le rendement des syst�mes cl�s au Canada, dans des domaines tels que les soins de sant� et l'�ducation. Le budget f�d�ral de 1999 engageait le gouvernement � pr�senter un rapport annuel sur les soins de sant� au Canada, et le Conseil des ministres de l'�ducation (Canada) travaille � l'�laboration d'un cadre de rapport sur le rendement des syst�mes d'�ducation au Canada. L� encore, ces activit�s de pr�sentation de rapports pourraient �tre synth�tis�es dans un rapport national sur le rendement, en sorte que les citoyens obtiennent une vue d'ensemble d�taill�e du rendement de ces deux syst�mes cl�s ainsi que des progr�s accomplis dans l'atteinte des r�sultats d�sir�s � l'�gard des buts communs.
La n�cessit� d'�laborer des indicateurs comparables entre les diff�rents ordres du gouvernement, qui a �t� discut�e dans l'Entente-cadre sur l'union sociale (ECUS), s'applique sp�cifiquement � une activit� de rapport de ce type sur les syst�mes, puisque l'on s'emploie d�j� � d�finir des indicateurs comparables � l'�gard de buts communs tels que le Plan d'action national pour les enfants et la Prestation nationale pour enfants. L'�laboration d'indicateurs comparables et de rapports sur les syst�mes exige que l'on d�ploie des efforts importants pour �laborer des syst�mes d'information. Par exemple, le gouvernement f�d�ral consent un investissement important � la conception de syst�mes d'information pour �tayer la pr�sentation de rapports sur les soins de sant�. De tels efforts de la part de tous les ordres de gouvernement doivent �tre �tendus � d'autres domaines, comme l'�ducation, l'aide sociale et les services sociaux, ainsi que l'environnement.
Rapport sur la prestation de services et les r�sultats de programmes
L'activit� f�d�rale de rapport sur les r�sultats de programmes a consid�rablement �volu�, au cours des derni�res ann�es, pour faire en sorte que les minist�res f�d�raux se concentrent sur les r�sultats de leurs activit�s (pourquoi ils font quelque chose) et pas seulement sur leurs intrants et extrants (ce qu'ils font) ou sur les normes de service (comment ils le font). Ce changement op�r� dans la fa�on de transmettre les donn�es est d�terminant pour la mise en oeuvre de la gestion ax�e sur les r�sultats au gouvernement.
Cependant, comme nous l'avons mentionn� plus haut, la fonction gouvernementale de pr�sentation de rapports ax�s sur les r�sultats �volue en soi de mani�re que, dans l'accent qu'elle met sur les r�sultats, elle ne perde pas de vue pour autant ces valeurs de la fonction publique que sont l'application r�guli�re de la loi et le principe d'�quit�, la gestion responsable des d�penses et l'objectif d'am�liorer la prestation de services aux Canadiens. Une approche int�gr�e de ce genre permet aux gouvernements d'utiliser les rapports ax�s sur les r�sultats de mani�re � tirer les le�ons des r�sultats atteints par les programmes et � modifier les programmes en cons�quence. Elle permet aussi aux minist�res de formuler clairement une ��th�orie�� sur les raisons pour lesquelles leurs activit�s visent � atteindre des r�sultats donn�s et sur la fa�on dont ils mesureront les r�sultats atteints, puis de faire rapport sur le besoin �ventuel et la fa�on de modifier leur th�orie pour tirer les le�ons des �checs et atteindre les r�sultats escompt�s. Ce type d'activit� de rapport au Parlement et aux citoyens am�nerait les d�put�s, par leur participation � des comit�s permanents, et les citoyens � discuter en profondeur des d�penses gouvernementales, augmentant ainsi de fa�on appr�ciable la transparence du gouvernement.
En faisant rapport sur la prestation de services et les r�sultats de programmes, les minist�res auraient recours � un large �ventail d'indicateurs de rendement, y compris des mesures des intrants/extrants, des normes de service et des mesures des r�sultats pour d�montrer l'atteinte de leurs r�sultats. Le cas �ch�ant, ils feraient aussi rapport sur l'utilisation de m�canismes d'appel et de recours par les citoyens ainsi que sur les r�sultats � cet �gard.
5. Conclusion
Nous avons vu dans ce document certaines des questions que soul�ve la qualit� de vie, et propos� une approche qui pourrait �tre retenue pour la mise sur pied d'un processus f�d�ral exhaustif de mesures du rendement et de pr�sentation de rapports � ce sujet. Nous esp�rons que les id�es pr�sent�es ici ainsi que dans le rapport Une gestion ax�e sur les r�sultats 1999 inciteront les Canadiens � discuter de ces enjeux importants. En fin de compte, les le�ons que nous tirerons de telles discussions viendront appuyer les initiatives du gouvernement visant � am�liorer la qualit� de nos processus d�cisionnels, la pertinence de nos politiques et de nos programmes, ainsi que les rapports que nous pr�sentons au Parlement et aux Canadiens.
R�f�rences�:
| i | Noll, Heinz-Herbert. 1998. Societal Indicators and Social reporting: The International Experience, Centre de recherche sur la QV, Danemark [ Retour ] |
| ii | International Society for the Quality of Life Studies, University of Virginia, Blacksburg, Virginia. Voir �galement le site Web http://www.isqols.org/index.htm. � [ Retour ] |
| iii | Les Associ�s de recherche Ekos inc. 1999. Economic Opportunity, Productivity and Social Policy.� [ Retour ] |
| iv | Avrim, Lazar, sous-ministre adjoint, Politique strat�gique, D�veloppement des ressources humaines Canada, avril�1999, Horizons.� [ Retour ] |
| v | Noll, ibid.� [ Retour ] |
| vi | Osberg, Lars, D�partement d'�conomie, Universit� Dalhousie, et Andrew�Sharpe, Centre d'�tude des niveaux de vie, 1998. An Index of Well-being for Canada, communication � l'occasion d'une conf�rence sur les niveaux de vie et la qualit� de vie au Canada, les 30 et 31�octobre�1998, H�tel Ch�teau Laurier, Ottawa (Ontario).� [ Retour ] |