ARCHIVÉ - Office national du film
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
2006-2007
Rapport sur le rendement
Office national du film du Canada
L'honorable Jos�e Verner, C.P., d�put�e
Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition f�minine et des Langues officielles
Table des mati�res
SECTION I - Survol
Raison d'�tre de l'Office national du film
SECTION II - ANALYSE DES ACTIVIT�S DE PROGRAMME PAR R�SULTAT STRAT�GIQUE
Activit� de Programme 1. Production d'œuvres audiovisuelles
Activit� de Programme 2. Distribution d'œuvres audiovisuelles
Activit� de programme 3. Acc�s aux œuvres audiovisuelles et d�veloppement des r�seaux
Activit� de programme 4 : Services de recherche et de conseil
SECTION III - RENSEIGNEMENTS SUPPL�MENTAIRES
Renseignements sur l'organisation
Gestion, administration et imputabilit�
SECTION I - SURVOL

La r�colte du 12e Oscar de l'histoire de l'Office national du film du Canada (ONF) pour le court m�trage d'animation Le po�te danois, en f�vrier dernier, a non seulement permis � l'ONF de conclure l'ann�e 2006-2007 sur une note positive, mais a �galement confirm� l'excellence artistique du milieu cin�matographique et culturel canadien � l'�chelle internationale. Au fil de l'ann�e, de nombreux artistes et artisans des quatre coins du pays ont �t� prim�s pour la qualit� exceptionnelle de leurs œuvres, et ce, au Canada et � l'�tranger.
Organisme audiovisuel canadien d'importance, l'ONF a jou� un r�le tout aussi essentiel en 2006-2007 qu'� l'�poque de sa cr�ation, en 1939. En tant que producteur et distributeur public au Canada, l'ONF refl�te les valeurs et les points de vue qui sont chers aux Canadiens en leur offrant des productions audiovisuelles novatrices et originales. De plus, l'ONF tire parti des nouvelles m�thodes de productions et des nouvelles plateformes de diffusion pour rejoindre les multiples communaut�s r�gionales, culturelles et linguistiques situ�es partout au pays.
� titre de ministre du Patrimoine canadien, de la Condition f�minine et des Langues officielles, je suis heureuse de pr�senter le Rapport minist�riel sur le rendement de l'Office national du film du Canada, qui fait le bilan de ses multiples r�alisations au cours de l'ann�e 2006-2007. Ce rapport met en valeur le r�le particulier et important que joue cet organisme au sein du portefeuille du Patrimoine canadien en vue de d�finir ce que nous sommes et de renforcer notre sentiment d'appartenance � la soci�t� canadienne.
L'honorable Jos�e Verner, C.P., d�put�e
MESSAGE DU COMMISSAIRE
Si l'on demandait � la population canadienne de r�capituler bri�vement les performances de l'Office national du film du Canada pour l'ann�e 2006-2007, plusieurs r�pondraient que le plus grand accomplissement de l'ONF au cours de la derni�re ann�e fut l'obtention de l'Oscar� du meilleur court m�trage d'animation pour Le Po�te danois. Pour plusieurs en effet, obtenir une mise en nomination aux Academy Awards� et repartir avec la statuette dor�e repr�sente le summum du succ�s dans le milieu cin�matographique. Bien que la 69i�me nomination de l'ONF � la c�r�monie des Oscars, un sommet in�gal� par une institution en dehors d'Hollywood, fut couronn�e par un douzi�me Oscar� de l'histoire de l'Office, ce n'est pas tellement les honneurs r�colt�s par les films de l'ONF qui sont garants d'une ann�e r�ussie mais plut�t l'impact que nos œuvres audiovisuelles, nos initiatives et nos programmes ont eu sur la vie quotidienne des Canadiens et Canadiennes, sur le milieu cin�matographique du pays et m�me sur la communaut� internationale.
En effet c'est lorsque plus de 750 000 jeunes �tudiants, apr�s avoir visionn� le film Le poids du monde rel�vent le D�fi du Poids du monde et posent des gestes concrets pour lutter contre le surpoids ou que des jeunes m�res de Toronto ayant v�cu dans la rue pr�sentent au maire de Toronto un plan d'action pour aider les jeunes parents sans adresse fixe suite au projet I WAS HERE de Cin�aste en R�sidence que l'Office est � son meilleur. En combinant engagement social et engagement cr�atif, l'ONF rel�ve avec succ�s le d�fi de mieux faire conna�tre et comprendre les r�alit�s sociales et culturelles du Canada et de contribuer au rayonnement de ses valeurs. Comme me l'a si bien fait remarquer l'un des auditeurs d'une pr�sentation sur les diff�rents projets novateurs � vocation communautaire de l'Office donn�e aux membres de l'industrie de l'audiovisuelle canadienne lors du dernier Festival de la t�l�vision de Banff : Voil� exactement ce que l'ONF doit faire !
Par le truchement du cin�ma, l'Office national du film du Canada a toujours eu comme pr�occupation de permettre autant aux Canadiens et Canadiennes d'intervenir directement sur les enjeux de leur communaut� respective. Le cin�ma socialement engag� est inscrit dans les g�nes de l'ONF depuis ses premi�res ann�es. Beaucoup d'initiatives des derni�res ann�es se situent dans la parfaite lign�e de la vision cr�atrice des d�buts de l'ONF. En effet, l'institution a toujours eu pour but de pr�senter non seulement des œuvres audiovisuelles innovatrices, pertinentes et audacieuses, mais �galement que ses films soient des outils favorisant la participation active des citoyens et citoyennes d'un oc�an � l'autre. Des sites comme Parole citoyenne / Citizen shift, plateformes de l'ONF vou�es � la production m�diatique engag�e sur le plan communautaire, et le programme Cin�aste en r�sidence (Filmmakers in residence), le plus r�cent effort de l'ONF pour rejoindre les diverses communaut�s et remettre dans les mains des citoyens le processus de cr�ation, s'inspirent all�grement du programme Soci�t� Nouvelle /Challenge for change des ann�es 70 et 80. Et les diff�rents programmes destin�s sp�cifiquement aux personnes handicap�es, aux autochtones et aux membres de diverses communaut�s culturelles refl�tent la m�me volont� d'offrir � chacun, peu importe son arri�re-plan, l'opportunit� de faire entendre sa voix tout comme plusieurs films de l'ONF ont contribu� largement � donner aux Canadiens et Canadiennes (cin�astes et auditoires) l'occasion de cr�er, de partager et de voir leurs histoires � l'�cran.
De nos jours, les nouvelles technologies permettent � l'ONF de se r�approprier l'espace public et d'offrir de nouvelles avenues afin de mieux desservir les multiples collectivit�s qui composent la soci�t� canadienne. En posant d�s maintenant les assises qui lui permettront d'utiliser les nouvelles technologies de productions et les nouvelles plateformes de diffusions pour faire avancer des projets avant-gardistes et novateurs, l'ONF s'assure que ses productions audiovisuelles demeureront pertinentes et accessibles � tous les publics, dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens. L'ONF entend demeurer un acteur aussi essentiel � l'�re num�rique qu'il ne l'�tait du temps o� ses projectionnistes ambulants allaient de village en village pour organiser des visionnements publics.
En terminant, j'aimerais chaleureusement remercier M. Jacques Bensimon qui fut le 14i�me Commissaire du gouvernement � la cin�matographie et pr�sident de l'ONF entre 2001 et 2006. La vision et le leadership exceptionnel de Jacques ont donn� � l'Office un nouvel essor et un nouveau dynamisme � l'innovation et � la cr�ation d'œuvres audiovisuelles innovatrices de qualit� au sein de l'institution. Je voudrais �galement souligner l'excellent travail de M. Claude Joli-Cœur alors qu'il assurait le poste de commissaire par int�rim de d�cembre 2006 � juin 2007. Son d�vouement pour l'Office et sa passion du milieu cin�matographique canadien ont contribu� au bon d�roulement des activit�s de l'institution entre le d�part de M. Bensimon et mon arriv�e � la barre de l'ONF. Depuis plus de soixante-cinq ans, la passion, la cr�ativit� et le professionnalisme des employ�s et des partenaires de l'ONF ont permis que celui-ci devienne une institution-phare dans le milieu cin�matographique canadien jouissant d'une r�putation enviable � l'�chelle internationale. Le m�me esprit d'innovation et d'avant-gardisme des pionniers de l'ONF se retrouve toujours au sein de l'organisation et permettra � l'Office de demeurer un lieu de cr�ation unique au service de tous les Canadiens et Canadiennes.
Tom Perlmutter
Commissaire du gouvernement � la cin�matographie
et pr�sident de l'Office national du film du Canada
D�claration de la direction
Je soumets, aux fins de d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement (RMR) de 2006-2007 de l'Office national du film du Canada.
Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�sentation des rapports �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006-2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement:
- Il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor;
- Il repose sur le r�sultat(s) strat�gique(s) et sur l'architecture des activit�s de programme du minist�re approuv�s par le Conseil du Tr�sor;
- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable;
- Il fournit une base pour la reddition de comptes � l'�gard des r�sultats obtenus avec les ressources et les autorisations qui lui sont confi�es.
- Il rend compte de la situation financi�re en fonction des montants approuv�s des budgets des d�penses et des Comptes publics du Canada.
Nom : Luisa Frate, c.a.
Titre : Directrice, Administration
Renseignements sommaires
Raison d'�tre de l'Office national du film
Mandat - L'Office national du film du Canada a pour mandat de � susciter et promouvoir la production et la distribution de films dans l'int�r�t national, et notamment de :
- produire et distribuer des films destin�s � faire conna�tre et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations, et de promouvoir la production et la distribution de tels films;
- faire des recherches sur les activit�s filmiques et en mettre les r�sultats � la disposition des producteurs et productrices de films;
- conseiller le gouverneur en conseil en mati�re d'activit�s filmiques;
- remplir, en mati�re d'activit�s filmiques, les autres fonctions que le gouverneur en conseil peut lui assigner �.
Mission - La mission de l'ONF consiste � produire et distribuer des œuvres audiovisuelles distinctives, audacieuses et pertinentes qui refl�tent la diversit� culturelle et qui pr�sentent au Canada et au monde un point de vue authentiquement canadien.
L'ONF est un organisme int�gr� de production et de distribution qui d�tient une imposante collection de films, un laboratoire de conservation, ainsi que des installations de postproduction et de recherche et d�veloppement � son bureau central, � Montr�al. Le service des relations gouvernementales exerce ses activit�s � partir d'Ottawa, tandis que les directions Marketing et Communications, Distribution, Relations d'affaires et Services juridiques, Planification strat�gique et relations gouvernementales, Ressources humaines et Administration sont majoritairement situ�es � Montr�al.
L'ONF est un centre de cr�ation d'œuvres audiovisuelles unique en son genre. Ses œuvres sont produites dans les deux langues officielles. L'Office national du film du Canada poss�de des centres de production � Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto, Montr�al, Moncton et Halifax, un bureau de production � Qu�bec et deux centres de consultation, dont un � Montr�al et l'autre � Toronto.
Avantages pour la population canadienne et pour le monde
Dans son rapport Rendement Canada 20061, le gouvernement du Canada rapportait que � Les Canadiens affirment que pour eux, une culture canadienne vigoureuse est importante et ils demandent donc au gouvernement de faire en sorte, en d�pit d'un march� culturel de petite taille, que les conditions propices � l'enracinement de la culture canadienne soient d�velopp�es. Ils veulent des choix canadiens qui refl�tent la cr�ativit� et le talent canadiens, la dualit� linguistique, la diversit� multiculturelle et la place sp�ciale que les peuples autochtones occupent au sein de leur soci�t�. � L'ONF est un instrument de choix du gouvernement canadien pour r�pondre aux attentes des Canadiens et Canadiennes. L'Office est un lieu exceptionnel de cr�ation, dont le mandat est de produire et de distribuer des films et d'autres documents audiovisuels pour des auditoires canadiens et les march�s �trangers, dans le but de mieux faire conna�tre et comprendre les r�alit�s sociales et culturelles du Canada et de contribuer au rayonnement de ses valeurs. L'ONF offre aux Canadiennes et aux Canadiens des œuvres au pouvoir transformateur, qui parlent des r�alit�s de la vie quotidienne avec �loquence. Qu'il s'agisse d'examiner des situations contemporaines ou d'effectuer un retour sur des pages de l'histoire du pays, l'ONF a continu� � favoriser l'expression de valeurs qui d�finissent les citoyens d'un oc�an � l'autre et fondent les fa�ons dont les Canadiens choisissent de vivre ensemble. Les efforts constants de l'Office en vue de soutenir la rel�ve, particuli�rement au sein des diverses communaut�s ethnoculturelles, et de donner aux jeunes cin�astes les moyens d'articuler leur vision des r�alit�s canadiennes ont �t� r�compens�s par des œuvres marquantes qui n'ont de cesse d'�largir et de renouveler les perspectives de chacun.
Gr�ce � l'application de nouvelles technologies dans le domaine de l'audiovisuel, l'ONF a su d�velopper divers r�seaux de distribution traditionnels et virtuels qui rendent sa production cin�matographique et sa collection, v�ritable m�moire de la collectivit� canadienne, encore plus accessible aux Canadiens et Canadiennes de toutes les provinces.
Total des ressources financi�res du minist�re (en milliers de $)
| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |
| 64 839 | 71 221 | 68 436 |
Total des ressources humaines du minist�re
| Pr�vues | Total des autorisations | R�elles |
| 500 | 500 | 486 |
Lien aux secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada
L'Office national du film du Canada est une agence culturelle relevant du minist�re du Patrimoine canadien. Il soutient le minist�re dans sa mission de faire de notre pays un lieu stimulant o� r�gne la coh�sion et un lieu o� tous les Canadiens peuvent participer � la vie culturelle et sociale. L'agence culturelle contribue directement � la r�alisation des deux r�sultats strat�giques du minist�re2 :
- les Canadiens et Canadiennes r�alisent des exp�riences culturelles vari�es et les partagent entre eux et avec le monde;
- les Canadiens et Canadiennes vivent dans une soci�t� ouverte � tous, fond�e sur la compr�hension interculturelle et la participation des citoyens.
Ces deux r�sultats strat�giques sont � leur tour intrins�quement reli�s aux objectifs du gouvernement du Canada ayant trait � la consolidation des fondements sociaux du Canada. Il est question ici d'une soci�t� inclusive qui favorise la dualit� linguistique et la diversit� ainsi qu'une culture et un patrimoine canadiens dynamiques.
Alignement avec les priorit�s du gouvernement
Par l'entremise du minist�re du Patrimoine canadien, l'ONF contribue directement � la r�alisation des priorit�s du gouvernement f�d�ral. Par diff�rentes initiatives concr�tes au sein de l'organisation et de l'industrie priv�e ainsi que par ses productions cin�matographiques originales refl�tant les grandes pr�occupations des Canadiens et Canadiennes, l'ONF assiste le gouvernement f�d�ral dans la r�alisation des priorit�s suivantes :
-
La protection environnementale
Le gouvernement s'est engag� � prendre des mesures pratiques pour am�liorer l'environnement et adopter des normes environnementales strictes, notamment pour am�liorer la qualit� de l'air, r�duire la pollution et s'attaquer aux �missions de gaz � effet de serre. La sensibilisation aux questions environnementales n'est pas �trang�re � l'ONF qui a produit, au fil des ans, de nombreux films sur le sujet.Initiatives
-
L'ONF a support� financi�rement et activement le projet Green Code, une initiative d'un groupe de plus en plus important de cin�astes canadiens et �trangers, de partenaires de l'industrie des m�dias, de chercheurs et d'environnementalistes qui ont uni leurs efforts pour chercher, �laborer, lancer et �tablir un code vert pour l'industrie cin�matographique.
Dans sa forme la plus simple, le projet Green Code est un ensemble de mesures - lignes directrices, normes, principes et pratiques - prises volontairement par l'industrie du cin�ma pour favoriser la durabilit� de l'environnement.
-
L'ONF a �galement mis sur pied un comit� vert ayant pour but de sensibiliser les employ�s de l'ONF aux questions environnementales.
Films sur le sujet produits en 2006-2007 par l'ONF
Manufactured Landscapes, Les r�fugi�s de la plan�te bleue, La Plan�te blanche;
-
-
La s�curit� :
Le gouvernement s'est engag� � mieux prot�ger les Canadiens et les Canadiennes en faisant de la pr�vention contre le comportement criminel et en aidant les collectivit�s � offrir des perspectives d'avenir aux jeunes et � mettre fin au cycle de violence qui d�truit tant de vies et de collectivit�s.L'ONF produit, dans les deux langues officielles, un contenu audiovisuel canadien sur des enjeux sociaux qui pr�occupent les collectivit�s � l'�chelle du pays, qui s'int�ressent, entre autres, aux sources de la violence dans nos soci�t�s. De plus, des initiatives comme Vid�o Paradiso et Racisme au travail encouragent avec succ�s la participation des jeunes et des moins jeunes et leur fournissent un moyen d'expression original pour partager leurs r�alit�s.
Initiatives
-
Le programme Vid�o Paradiso, auquel l'ONF a collabor� entre 2004 et 2007, est un studio ambulant de formation et de cr�ation audiovisuelle pour les jeunes marginaux des centres urbains de Montr�al et de Qu�bec. Tout en apprivoisant la cam�ra, les jeunes cin�astes documentent leur r�alit� de l'int�rieur : une fa�on de faire entendre leurs voix, de briser le silence.
-
Le projet Racisme au travail s'attaque � la question du racisme en milieu de travail. Ce projet comprend trois �l�ments principaux, soit la r�alisation par des cin�astes de la diversit� issus de toutes les r�gions du Canada, de cinq courts m�trages traitant de la question du racisme en milieu de travail, une compilation DVD (en anglais et en fran�ais) des films produits et de suppl�ments et la cr�ation de deux sites Internet � Racisme au travail/Racism at work �
Films sur le sujet produits en 2006-2007 par l'ONF
R�cit d'une m�diation, Finding Dawn
-
-
Un Canada uni chez lui et respect� � l'�tranger :
Le gouvernement s'est engag� � promouvoir les valeurs et les int�r�ts que partagent les Canadiens et Canadiennes. De mani�re plus g�n�rale, le gouvernement s'est engag� � promouvoir et � d�fendre � l'�tranger les valeurs qui sont fondamentales pour le Canada : la libert�, la d�mocratie, la primaut� du droit et les droits de la personne.L'ONF produit des œuvres cin�matographiques novatrices et percutantes qui v�hiculent les valeurs canadiennes ici et dans le monde. Par le biais de ses documentaires ou films d'animation, l'ONF est un instrument de choix pour transmettre les valeurs fondamentales de notre pays.
Initiatives
-
�laboration d'une entente avec le gouvernement ha�tien en vue d'offrir une collection de films documentaires, de fiction et d'animation qui enrichiront la programmation de la t�l�vision nationale et des autres t�l�visions en Ha�ti. La mission de l'ONF aura �galement comme objectif d'�valuer la mise en place des projets structurants de formation en cin�ma, qui utilisent le cin�ma comme outil social.
Films sur le sujet produits en 2006-2007 par l'ONF
Souvenirs of Canada, Chroniques afghanes, The Bicycle: Fighting AIDS with Community Medicine
-
-
Les immigrants et les Autochtones
Le gouvernement canadien s'est engag� � am�liorer les possibilit�s pour tous les Canadiens, notamment les Autochtones et les nouveaux arrivants.L'ONF joue un r�le unique dans la production et la distribution d'œuvres audiovisuelles r�alis�es par les membres de ces communaut�s ethnoculturelles et autochtones. De plus, plusieurs initiatives de l'agence f�d�rale ont �t� cr��es sp�cifiquement pour rejoindre les membres de diverses communaut�s autochtones et ethnoculturelles.
Initiatives
- First Stories est un programme de formation destin� aux cin�astes autochtones de la rel�ve. Cette initiative permet � des jeunes cin�astes autochtones du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nord de suivre une s�rie de s�minaires intensifs au terme desquels ils sont invit�s � d�poser des propositions de court m�trage portant sur des enjeux sociaux.
- Wapikoni Mobile est un studio de production cin�matographique ambulant imagin� par la cin�aste Manon Barbeau, et appuy� par l'ONF, qui va � la rencontre des jeunes Autochtones. Ces derniers sont initi�s aux techniques de production et signent leurs premiers films ou clips sonores.
Films sur le sujet produits en 2006-2007 par l'ONF
Wabanaki, Qallunaat! Why White People Are Funny, Apples and Indians, Wapos Bay, Series.
-
Les soins de la sant�
Le gouvernement canadien s'est engag� � offrir des soins de sant� de qualit� en temps opportun. Au cours des ann�es, l'ONF a produit de nombreux films abordant la th�matique du syst�me de sant� au Canada et soulevant les r�percussions de maladies autant mentales que physiques sur les Canadiens et Canadiennes. De plus, l'ONF a �t� l'instigateur de plusieurs initiatives visant � d�celer et � encourager le talent de personnes handicap�es.Initiatives
-
Lanc� en 2006, le projet Cin�aste en r�sidence (Filmmaker in Residence - FiR), un partenariat sans pr�c�dent entre l'ONF et l'h�pital St-Michael, situ� dans un quartier d�favoris� de Toronto, donne la parole aux intervenants sociaux et aux professionnels de la sant�.
-
Le programme de stages en cr�ation m�diatique de l'ONF et de l'ACPFT est le tout premier programme national de formation visant � faciliter l'int�gration des personnes handicap�es dans l'industrie du cin�ma et de la t�l�vision. Il offre � des Canadiennes et Canadiens handicap�s - cin�astes, producteurs et autres - une formation en cours d'emploi dans les secteurs du cin�ma et de la t�l�vision. Jusqu'� cinq stagiaires seront encadr�s par des maisons de production ind�pendantes membres de l'ACPFT et ayant une entente de d�veloppement ou de coproduction avec l'ONF.
Films sur le sujet produits en 2006-2007 par l'ONF
La peau et les os, apr�s..., The Interventionists: Chronicles of a Mental Health Crisis Team, Flight from Darkness, Unspeakable.
-
Priorit�s de l'Office national du film du Canada
| R�sultat strat�gique Produire et rendre accessibles des œuvres audiovisuelles pertinentes, ambitieuses et innovatrices qui offrent aux Canadiens et aux Canadiennes une meilleure compr�hension du Canada et du monde. |
||||
| Lien aux secteurs de r�sultats du gouvernement du Canada : Une soci�t� diversifi�e qui favorise la dualit� linguistique et l'inclusion sociale. |
||||
| Activit� de programme : production d'œuvres audiovisuelles | 2006-2007 | |||
| Priorit�s | R�sultats pr�vus | Sommaire du rendement | D�penses pr�vues (en milliers de $) |
D�penses r�elles (en milliers de $) |
| 1. Maintenir une programmation globale d'œuvres audiovisuelles distinctives, audacieuses et pertinentes. |
|
Satisfait � toutes les attentes | 47 103$ | 45 847$ |
| 2. Renforcer la production de longs m�trages documentaires et d�velopper une approche coh�rente des productions courts m�trages |
|
Satisfait � toutes les attentes | ||
| 3. Consolider la capacit� de l'ONF � rep�rer et encourager les talents les plus prometteurs et travailler avec eux - assurant ainsi la promotion des cin�astes de la rel�ve et des talents issus des milieux autochtones ou de milieux culturels divers. |
|
Continu | ||
| 4. Favoriser les partenariats par les coproductions. |
|
Satisfait � toutes les attentes | ||
| 5. Renforcer l'innovation sur les plans du contenu, de la forme et de la technologie. |
|
Satisfait � toutes les attentes | ||
| 6. Maintenir le d�veloppement de coproductions internationales. |
|
Satisfait � toutes les attentes | ||
| Activit� de programme : distribution d'œuvres audiovisuelles | 2006-2007 | |||
| Priorit�s | R�sultats pr�vus | Sommaire du rendement | D�penses pr�vues (en milliers de $) |
D�penses r�elles (en milliers de $) |
| 7. Accro�tre les revenus tir�s de la collection de l'ONF et optimiser les ventes et les pr�ventes. |
|
Satisfait � toutes les attentes | 2 370$ | 3 134$ |
| 8. Offrir les comp�tences sp�cialis�es et les r�seaux de distribution de l'ONF aux secteurs priv� et public |
|
Satisfait � toutes les attentes | ||
|
Continu | |||
| Activit� de programme : acc�s aux œuvres audiovisuelles et au d�veloppement des r�seaux | 2006-2007 | |||
| Priorit�s | R�sultats pr�vus | Sommaire du rendement | D�penses pr�vues (en milliers de $) |
D�penses r�elles (en milliers de $) |
| 9. Maintenir, favoriser et accro�tre la conservation et l'acc�s �quitable � la collection de l'ONF - dans les nouveaux formats num�riques �mergents. |
|
Satisfait � toutes les attentes | 11 726$ | 12 608$ |
| 10. Rejoindre davantage les communaut�s par tout le Canada. |
|
Satisfait � toutes les attentes | ||
| 11. Intensifier la pr�sence de l'ONF dans les communaut�s, � la t�l�vision et dans les r�seaux d'apprentissage. |
|
Continu | ||
| 12. Multiplier les occasions de faire rayonner l'image de marque de l'ONF au Canada et � l'�tranger. |
|
Continu | ||
|
Continu | |||
|
Continu | |||
| Activit� de programme : services de recherche et de conseil | 2006-2007 | |||
| Priorit�s | R�sultats pr�vus | Sommaire du rendement | D�penses pr�vues (en milliers de $) |
D�penses r�elles (en milliers de $) |
| 13. Maintenir, favoriser et accro�tre les initiatives de recherche et d�veloppement afin de repositionner l'ONF comme chef de file, avec ses partenaires et dans le milieu cin�matographique canadien. |
|
Satisfait � toutes les attentes | 3 640$ | 6 847$ |
| 14. Mener des projets de recherche et participer � d'autres projets. |
|
Continu | ||
| 15. Collaborer davantage avec le gouvernement et d'autres organismes. | ||||
Contexte de l'Office national du film du Canada
L'Office national du film du Canada est un lieu exceptionnel de cr�ation, dont le mandat est de produire et de distribuer des films et d'autres documents audiovisuels pour des auditoires canadiens et les march�s �trangers, dans le but de mieux faire conna�tre et comprendre les r�alit�s sociales et culturelles du Canada et de contribuer au rayonnement de ses valeurs.
Environnement d'affaires internes
Fin du terme du commissaire et pr�sident
Le 18 d�cembre 2006 marquait la fin du mandat de cinq ans de M. Jacques Bensimon � la t�te de l'ONF. Pendant le processus de s�lection d'un nouveau commissaire du gouvernement � la cin�matographie et pr�sident de l'Office national du film du Canada (ONF), M. Claude Joli-Cœur, directeur des Relations d'affaires et services juridiques de l'Office national du film, a agit comme commissaire int�rimaire du 19 d�cembre 2006 au 11 juin 2007, date � laquelle le 15e commissaire du gouvernement � la cin�matographie et pr�sident de l'Office national du film du Canada (ONF), M. Tom Perlmutter, est entr� en fonction.
Fin du Plan strat�gique 2002-2006
L'ann�e 2006-2007 marquait non seulement la fin du terme du pr�c�dent commissaire, mais �galement la derni�re ann�e du plan strat�gique quinquennal de 2002-2006. Au cours des cinq derni�res ann�es, l'ensemble des activit�s de l'ONF visait � le repositionner en tant que partenaire essentiel dans un environnement cin�matographique national et international en constant changement. Le nouveau commissaire en consultation avec le conseil d'administration, les employ�s de l'ONF et les principaux partenaires strat�giques de l'institution devrait entreprendre la production du prochain plan strat�gique de l'ONF d�s l'automne 2007.
Restructuration
Parmi les changements apport�s au sein de ses diff�rentes directions, deux r�am�nagements auront eu un impact particulier sur les fa�ons dont l'organisme r�alise ses activit�s.
Le Programme fran�ais a men� � bien une importante refonte. Sa structure organisationnelle a �t� adapt�e de fa�on � mieux refl�ter ses responsabilit�s. Ses activit�s sont d�sormais regroup�es au sein de trois grands secteurs de production, chacun plac� sous la responsabilit� d'un producteur ex�cutif : Animation, Qu�bec et R�gions (studios Acadie et Ontario et Ouest), ce qui a notamment permis de renforcer la structure de programmation francophone hors Qu�bec. En leur sein, les responsabilit�s ont �t� partag�es de fa�on � favoriser le d�veloppement et le partage d'expertises : un poste de producteur, multiplateforme, a notamment �t� cr�� afin de tirer parti des occasions offertes par ce domaine en �mergence.
L'ann�e 2006-2007 a aussi �t� marqu�e par le regroupement des activit�s de mise en march� et de communications au sein d'une seule direction, Marketing et communications, et par l'implantation d'une nouvelle structure de gestion. L'int�gration de ces deux services a entra�n� une r�organisation majeure et de nouveaux processus de travail ont �t� mis en place. Par ce biais, l'ONF a grandement am�lior� sa capacit� � rejoindre ses diff�rents publics, avec une plus grande coh�rence, et s'est dot� d'outils pour consolider sa pr�sence dans plusieurs secteurs cl�s de la soci�t�, contribuant ainsi � l'atteinte des objectifs de visibilit� fix�s dans le Plan strat�gique 2002-2006. Ces nouvelles fa�ons de proc�der permettent �galement d'optimiser les ententes pass�es avec diff�rents partenaires institutionnels, dans le cadre desquelles il est d�sormais plus facile d'inclure divers produits et activit�s.
Environnement d'affaires externes
Attentes du gouvernement
L'ONF rend des comptes au minist�re du Patrimoine canadien, charg� d'administrer la Loi sur le cin�ma qui r�git ce dernier. Cet organisme canadien � vocation culturelle est financ� principalement par des cr�dits parlementaires, par les revenus tir�s de la vente de ses produits et par des redevances.
Le gouvernement du Canada a fait de la saine gouvernance des institutions gouvernementales et du r�tablissement de l'imputabilit� une priorit� de son mandat �lectoral. La Loi f�d�rale sur la responsabilit� propose des mesures pr�cises qui visent � accro�tre la responsabilisation, la transparence et la surveillance des activit�s gouvernementales. De plus, le cadre de responsabilisation de gestion �nonce la liste des attentes concernant la gestion moderne de la fonction publique afin d'assurer un rendement organisationnel sup�rieur.
L'analyse et la conformit� aux exigences gouvernementales en mati�re de bonne gestion est un processus continuel chez cet organisme � vocation culturelle, de m�me qu'une priorit� organisationnelle. L'ONF maintient des pratiques d'affaires qui favorisent la bonne gouvernance, l'imputabilit� et assure le lien de confiance avec la population canadienne. Il s'est assur� que toutes ses activit�s respectent ou exc�dent les plus hauts standards dans ces domaines.
Profil de la production cin�matographique et t�l�visuelle au Canada
Le plus r�cent rapport �conomique sur la production cin�matographique et t�l�visuelle au Canada, Profil 2007, rapportait que la production cin�matographique et t�l�visuelle dans son ensemble avait augment� de 5,8% pour se chiffrer � 4,8 milliards de dollars. La production cin�matographique canadienne, compos�e des longs et courts m�trages d'abord pr�sent�s au public dans les salles de cin�ma, a grimp� de 75,6% en 2005-2006 par rapport � l'ann�e pr�c�dente, ce qui en a port� la valeur � 323 millions de dollars. Cette hausse survient apr�s avoir exp�riment� une forte r�gression en 2003-2004 et 2004-2005. En tout, 80 films destin�s aux salles de cin�ma ont �t� r�alis�s au Canada, soit 76 longs m�trages et 4 courts m�trages.3 La hausse du volume de production cin�matographique s'explique principalement par l'augmentation du nombre de productions � budget plus �lev� dans le long m�trage de fiction ainsi que par la reprise des activit�s de production �trang�re. Cependant, le nombre de coproductions officielles avec l'�tranger a continu� sa chute avec une r�duction de 177 millions de dollars en 2005-2006. Le march� des pr�ventes � l'�tranger est �galement � la baisse apr�s avoir connu des ann�es exceptionnelles dans les ann�es 1990. La valeur d'exportation de la production cin�matographique canadienne4 a tripl� pour se chiffrer � 88 millions de dollars.
La production cin�matographique et t�l�visuelle a �t� la source de 124 300 emplois �quivalents temps plein dont plus de 8 600 emplois directs et indirects gr�ce au secteur de la production cin�matographique seulement. Le PIB r�el attribuable au groupe des industries du film et de la vid�o a augment� de 1,5% en 2005-2006.
Un des principaux risques auquel fait face l'industrie canadienne de la production cin�matographique et t�l�visuelle au Canada est la hausse constante des co�ts de production combin�e � la stagnation du financement public et priv�. En effet, la haute d�finition, l'interactivit� et la mise en forme que n�cessitent les nouvelles plateformes de distribution font monter les co�ts alors que les nouveaux apports financiers sont tr�s minimes. Ces deux facteurs entra�nent donc une baisse de production. Avec la fragmentation des march�s, l'investissement �tranger dans le domaine cin�matographique et audiovisuel au Canada ainsi que les pr�ventes internationales sont � la baisse. Ces facteurs privent les producteurs d'importantes sources de revenus et rehaussent l'importance des divers programmes gouvernementaux pour le financement de productions audiovisuelles.
Tous ces �l�ments affectent non seulement les producteurs priv�s, mais ont �galement une incidence sur les op�rations de l'Office national du film.
Le genre documentaire
La r�putation d'excellence du Canada dans le genre documentaire n'est plus � faire, ces derniers �tant souvent prim�s pour l'�loquence de leur caract�re social. Le volume total de production de documentaires a continuellement augment� depuis le d�but des ann�es 2000 et s'�tablissait � 383 millions de dollars � la fin du dernier exercice. La majorit� des documentaires produits l'�taient premi�rement pour le march� de la t�l�vision.
Bien que la vaste majorit� des œuvres cin�matographiques canadiennes tourn�es pour le cin�ma soient des œuvres de fiction, 3% de celles-ci �taient des documentaires totalisant 11 millions de dollars. Ces r�sultats expliquent que seulement 5 des 80 œuvres cin�matographiques destin�es aux salles �taient des documentaires. Depuis 2003-2004, il y a eu une r�gression constante du volume de production pour le documentaire canadien, passant de 24 millions en 2003-2004 � 11 millions en 2005-2006, ce qui explique la baisse de 50% du nombre de documentaires destin�s au cin�ma entre 03-04 et 05-06. � la lumi�re de l'augmentation de l'int�r�t � l'�chelle mondiale pour le genre documentaire depuis le succ�s de films tels que Bowling for Columbine ou the Inconvenient Truth, et des œuvres canadiennes comme Les voleurs d'enfance et Manufactured Landscapes ces chiffres semblent � premi�re vue surprenants. Cependant, le financement du long m�trage documentaire ne b�n�ficiait pas d'autant de ressources dans le pass� que celui des œuvres de fiction. T�l�film Canada a inscrit en 2006-2007, � titre exceptionnel, ce genre parmi ceux soutenus par le Fonds du long m�trage du Canada. L'industrie du documentaire estime qu'il faut un budget de plus d'un million de dollars pour r�aliser un long m�trage documentaire et assumer la publicit� n�cessaire pour accroitre l'auditoire pour ce type de film. Selon les conclusions de l'industrie du documentaire � si on veut en faire (le documentaire) un �l�ment permanent du cin�ma canadien -et perp�tuer ainsi la longue tradition d'excellence dont jouit le pays dans ce genre cin�matographique, il faut �tablir un programme (de financement) sp�cial qui pourra soutenir la production d'une liste de films chaque ann�e.5�
Dans un pareil contexte, l'ONF souligne l'importance du genre documentaire pour l'industrie cin�matographique canadienne et prend des mesures concr�tes pour soutenir la cr�ation d'œuvres canadienne. Il joue un r�le unique et essentiel dans la distribution de documentaires, entre autres, en distribuant les films qu'il produit, coproduit et distribue pour le compte des producteurs ind�pendants. L'ONF met � la disposition de l'industrie un savoir-faire unique qui allie cr�ativit� et innovation technologique. L'Office a fait des documentaires d'opinion une de ses priorit�s op�rationnelles, car la population veut voir des films qui l'aident � mieux comprendre les enjeux qui la touchent. Les documentaires de l'ONF sont un outil important pour favoriser la r�flexion au sein de la population canadienne et des divers intervenants des milieux politiques, �conomiques et sociaux.
La transition au num�rique
Le 17 mai dernier, le Conseil de la radiodiffusion et des t�l�communications canadiennes (CRTC) modifiait sa r�glementation � l'�gard des t�l�diffuseurs conventionnels et fixait au 31 ao�t 2011 la date � laquelle les t�l�diffuseurs canadiens devront diffuser uniquement des signaux en mode num�rique. Dans son avis public, le CRTC constatait que la transition � la t�l�diffusion num�rique/HD progressait lentement au Canada - surtout par rapport aux �tats-Unis qui a fix� au 17 f�vrier 2009 la fin de la transmission en mode analogique de tous les signaux de la t�l�vision en direct. Pour leur part, les �tats membres de l'Union europ�enne ont entre 2008 et 2012 pour passer de la transmission analogique � la transmission num�rique. Au Royaume-Uni, la suppression du service analogique commencera en 2008 et tout service analogique aura cess� avant 20126.
Le Conseil a aussi expliqu� qu'il craignait que les t�l�spectateurs canadiens ne puissent avoir acc�s qu'� une faible quantit� d'�missions canadiennes en HD. Ces derniers pourraient alors se tourner vers des services �trangers, avec pour corollaire la possibilit� qu'il soit difficile de les r�orienter vers des services canadiens m�me lorsque ceux-ci proposeront un plus grand nombre d'�missions canadiennes en HD7.
� titre de producteur public, l'ONF doit se pr�parer bien avant qu'une date d'arr�t ne soit fix�e au Canada. Pour �tre pr�t en 2009-2010, il doit produire tous ses documentaires et films d'animation en HD d'ici 2008-2009, puisque le cycle de production dure environ 18 mois.
De nouvelles plateformes de diffusion
Gr�ce � la num�risation, les Canadiens et Canadiennes peuvent, o� qu'ils se trouvent, regarder films et �missions de t�l�vision sur le support et sur la plateforme de leur choix : DVD, baladeur num�rique, lecteur de vid�o mobile, diffusion Web ou autre. M�me si la r�volution num�rique offre des possibilit�s extraordinaires aux maisons de production et aux distributeurs, elle pose aussi d'�normes difficult�s. L'ONF se pr�pare � cette r�volution depuis quelques ann�es d�j� en cr�ant des partenariats et en menant des recherches sur la qualit� de l'image, les modes de transfert innovateurs, l'accessibilit� et la diffusion en vue de la transition vers la technologie num�rique. Durant les prochaines ann�es, la multiplication des formats num�riques posera de nombreux d�fis � l'ONF. La HD deviendra le format de tournage, de t�l�diffusion et de distribution incontournable sur les march�s canadiens et �trangers. Sans capacit� de production HD et de distribution num�rique sur plateformes multiples, l'Office mettrait en p�ril son mandat et ses activit�s de distribution, et ses revenus pourraient accuser une forte baisse.
L'ONF doit rapidement adapter sa cha�ne de production, ses strat�gies de distribution et les m�thodes de gestion de sa collection pour s'assurer de satisfaire aux objectifs de son programme et conserver son r�le de chef de file aupr�s de ses partenaires et de la population canadienne. Toutefois, les co�ts sont importants pour l'industrie priv�e comme pour l'organisation. Cette transition repr�sente un d�fi de taille.
SECTION II - ANALYSE DES ACTIVIT�S DE PROGRAMME PAR R�SULTAT STRAT�GIQUE
R�sultat strat�gique
Le r�sultat strat�gique de l'ONF consiste � produire et � rendre accessibles des œuvres audiovisuelles pertinentes, ambitieuses et innovatrices, qui offrent aux Canadiens et aux Canadiennes une meilleure compr�hension de leur pays et du monde.
Activit� de Programme 1. Production d'œuvres audiovisuelles
L'Office national du film produit des œuvres audiovisuelles pertinentes sur les plans social et culturel qui abordent les grands sujets de pr�occupation des Canadiens et Canadiennes. Ces activit�s de production comprennent la conceptualisation, la recherche, l'�laboration, la production proprement dite et le marketing social de documentaires, films d'animation, contenu nouveaux m�dias ou autres nouvelles formes audiovisuelles.
De par ses activit�s de production, l'ONF joue un r�le important dans la d�couverte, le perfectionnement et l'encadrement des talents et des cr�ateurs. Il appuie ainsi les cin�astes, ce qui fait de lui un incubateur de nouveaux talents. De plus, il remplit son mandat national et international qui est de � produire, distribuer et promouvoir des films destin�s � faire conna�tre et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations. �
| RMR 2006-2007 (selon l'AAP) | |
| Activit�s | Priorit�s |
| Production : Une programmation d'œuvres audiovisuelles distinctives, audacieuses et pertinentes. |
|
Ressources financi�res en milliers de dollars
| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |
| 47 103 | 50 890 | 45 847 |
Ressources humaines
| Pr�vues | Autorisations | R�elles |
| 275 | 275 | 221 |
Les priorit�s
1. Maintenir une programmation globale d'œuvres audiovisuelles distinctives, audacieuses et pertinentes.
R�sultat pr�vu :
85 % de la programmation de l'ONF portera sur des enjeux sociaux;
Indicateurs :
- Diversit� des genres et des sujets trait�s dans les productions de l'ONF;
- Degr� d'atteinte des auditoires et niveau d'int�r�t pour les films (auditoire � la t�l�vision, auditoire autre qu'� la t�l�vision et rayonnement du site Internet);
- Participation de la population canadienne.
85 % de la programmation de l'ONF portera sur des enjeux sociaux;
Le mandat principal de l'ONF consiste � produire des œuvres audiovisuelles pertinentes et distinctives qui t�moignent des grands enjeux sociaux d'ici et d'ailleurs, de la diversit� et de la richesse des communaut�s du pays, et ce, pour le plus grand b�n�fice des Canadiens et des Canadiennes. Les œuvres documentaires, d'animation et de fiction produites par l'ONF utilisent des technologies innovatrices et des formats de production vari�s. Elles sont des outils d'accroissement de connaissance, d'�ducation, d'innovation sociale et de participation des diverses communaut�s qui composent le Canada. Plus de 85% de la programmation 2006-2007 portait sur de grands enjeux contemporains nationaux et internationaux.
Diversit� des genres et des sujets trait�s dans les productions de l'ONF
| Sujets trait�s en 2006-2007 |
|
Tout au long de son cycle de planification strat�gique, l'ONF s'est mobilis� afin de produire des œuvres audiovisuelles sur des grands enjeux qui sont au cœur des pr�occupations des citoyennes et des citoyens. L'ann�e 2006-2007 ne fait pas exception puisque divers sujets d'int�r�t public ont �t� abord�s dans les productions cin�matographiques r�alis�es au cours de cette p�riode. Les 127 productions originales et coproduites abordent autant de sujets diff�rents et de points de vue vari�s refl�tant les r�alit�s v�cues au Canada et � l'�tranger.
Que ce soit les nombreux obstacles rencontr�s par les personnes � mobilit� r�duite tels qu'illustr�s par la course � la mairie de Vancouver de Sam Sullivan dans Citizen Sam en passant par la d�marche de sensibilisation du r�alisateur Patricio Enríquez contre les tortures commises au Chili sur l'Esm�ralda, un bateau d'�tat, les films de l'ONF offrent une perspective saisissante du monde qui nous entoure. Le rapport annuel 2006-2007 de l'ONF offre une liste compl�te des œuvres produites par l'Office ainsi qu'une description d�taill�e des enjeux abord�s dans ces films.
| Genres utilis�s en 2006-2007 | nombre | pourcentage |
| Animation | 26 | 20% |
| Documentaire | 97 | 76% |
| Fiction | 4 | 4% |
| Total | 127 | 100% |
Les divers genres cin�matographiques privil�gi�s par l'ONF pour ses œuvres cin�matographiques permettent de pr�senter de diverses fa�ons aux cin�philes les multiples sujets propos�s. Ainsi la cuv�e de 26 œuvres des studios d'animation a permis de mettre � la port�e de tous, y compris les plus jeunes, les tribulations d'un jeune gar�on asthmatique, la difficult� d'avoir deux identit�s culturelles, la culture autochtone, etc. Bien qu'ayant pour but principal le divertissement, les quatre fictions produites par l'ONF transmettent des messages transformateurs � leur public et permettent de rejoindre un auditoire plus large et moins familier avec d'autres genres cin�matographiques. L'ONF jouit d'une r�putation internationale dans la production de documentaires d'opinion, aussi il va de soi que ses cin�astes privil�gient ce genre dans le but de mieux faire conna�tre et comprendre les r�alit�s sociales et culturelles du Canada et contribuer au rayonnement de ses valeurs comme le d�montre les 97 documentaires produits au sein de l'ONF.
Degr� d'atteinte des auditoires et niveau d'int�r�t pour les films (auditoire � la t�l�vision, auditoire autre qu'� la t�l�vision et rayonnement du site Internet)
| Auditoire | 2006-2007 | 2005-2006 |
| T�l�vision | 6 781 000 | 5 948 000 |
| Visionnement public | 145 941 | 154 563 |
| Internet | 3 693 571 | 4 733 366 |
L'ONF rejoint les Canadiens de tout �ge et de toute origine � travers divers canaux de distribution et diffusion. La t�l�vision demeure un moyen privil�gi� pour atteindre le public, mais Internet devient de plus en plus crucial, surtout en ce qui concerne les jeunes. Nos films sont �galement vus par le public dans les cin�mas, lors des festivals et de visionnages publics, mais aussi gr�ce � la vente de nos films par la vid�o sur demande aux consommateurs, aux �coles et aux divers organismes culturels et sociaux.
Auditoire � la t�l�vision
En 2006-2007, 6 781 000 t�l�spectateurs canadiens ont regard� des films de l'ONF � la t�l�vision, ce qui repr�sente une hausse de 14 % par rapport � l'ann�e pr�c�dente. Il faut noter que cette ann�e, l'ONF s'est dot� d'un nouveau logiciel qui lui permet de mieux prendre la mesure des auditoires de plus en plus importants des cha�nes sp�cialis�es.
D�veloppement et achalandage du site Internet
onf.ca
Cette ann�e encore l'achalandage du site Internet de l'ONF a fait bonne figure avec 3 693 571 de visiteurs. Le nombre des sessions d'utilisateurs a �galement l�g�rement augment� pour un total de 42 522 550 pages affich�es, soit 522 000 de plus que l'ann�e pr�c�dente.
Au total, 30 nouveaux microsites et productions Web ont �t� mis en ligne sur le site de l'ONF au cours de l'ann�e 2006-2007.
Parole Citoyenne / Citizenshift
L'ONF a �galement mis en œuvre des initiatives Web novatrices qui permettent aux jeunes et � la population en g�n�ral de d�battre d'enjeux sociaux et politiques. C'est notamment le cas de Parole citoyenne et CitizenShift qui sont les tout premiers forums de discussion qui explorent les multiples possibilit�s de l'outil Web pour d�battre de sujets sociaux. Ces sites sont avant tout des espaces publics et technologiques qui s'engagent � donner la parole aux citoyens.
Participation de la population canadienne
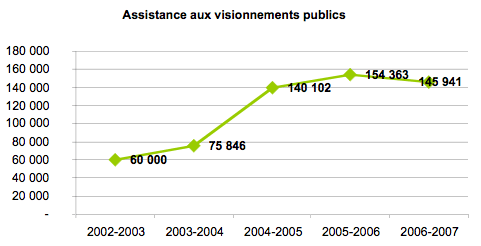
Rendre l'ONF pr�sent dans la vie des gens demeure un d�fi constant et demande des efforts renouvel�s. Afin de d�velopper des liens plus �troits avec la population, l'ONF a poursuivi sa tradition d'organiser des visionnements de ses films dans diverses communaut�s d'un oc�an � l'autre.
En plus de visiter des communaut�s ou groupes sp�cifiques qui sont directement concern�s par certains sujets discut�s dans ses films, l'ONF organise �galement des tourn�es de projections de ses films tournant autour d'une th�matique pr�cise. Au cours de la derni�re ann�e, la principale initiative de visionnement public organis�e par l'ONF pr�sentait les grands classiques de Norman McLaren dans plusieurs communaut�s partout au Canada, dont plusieurs �taient peu desservies par le r�seau de distribution commerciale traditionnelle, ainsi que dans les grandes villes des �tats-Unis et de l'Europe. Cette grande tourn�e fut �galement accompagn�e d'ateliers d'initiation � l'animation destin�s aux enfants qui suscit�rent un engouement certain dans les villes o� ils furent offerts.
2. Renforcer la production de longs m�trages documentaires et d�velopper une approche coh�rente des productions courts m�trages.
R�sultat pr�vu :
La programmation se caract�risera par la production de documentaires d'opinion, de films d'animation, de films de fiction innovateurs et de produits nouveaux m�dias;
R�sultat pr�vu :
La programmation se caract�risera par la production de documentaires d'opinion, de films d'animation, de films de fiction innovateurs et de produits nouveaux m�dias;
Depuis toujours, l'ONF contribue � cr�er un environnement cin�matographique au Canada dans lequel les divers genres et formats de films peuvent s'�panouir et donner la pleine mesure de leurs possibilit�s. Lors des discussions entourant l'�laboration du plan strat�gique pr�c�dent, il a �t� d�cid� que l'ONF concentrerait ses efforts et ses ressources sur le cin�ma d'animation d'auteur et les documentaires qui se d�marquent tout en faisant certaines incursions innovatrices dans les formes hybrides et la fiction alternative.
Indicateurs :
Long m�trage documentaire
| Format du documentaire | 2006-2007 | % |
| Long m�trage | 18 | 19% |
| Moyen m�trage | 20 | 20% |
| Court m�trage | 59 | 61% |
| Total | 97 | 100% |
Inspir� par la vision du premier commissaire de l'ONF, John Grierson, et par le d�veloppement du cin�ma direct dans les ann�es 60 par ses cr�ateurs, l'ONF est un chef de file mondial du documentaire social et engag�. La popularit� croissante du long m�trage documentaire destin� premi�rement au cin�ma a renforc� la d�termination de l'ONF � explorer le potentiel de ce genre. En 2006-2007, l'ONF a produit 18 longs m�trages documentaires (90 minutes ou plus), soit 19% de tous les documentaires produits au cours de l'ann�e.
En tant que producteur public du Canada et champion de longue date du documentaire destin� aux salles, l'ONF s'est joint au programme pilote pour le long m�trage documentaire destin� aux salles qui est assorti d'une enveloppe de plus de 2 millions de dollars pour la production et l'ach�vement de longs m�trages documentaires destin�s aux salles de cin�ma canadiennes. Le Programme pilote offert en partenariat avec T�l�film Canada, CBC et Rogers repr�sente pour l'ONF une belle occasion de travailler avec les secteurs public et priv� pour renforcer l'industrie canadienne du documentaire et porter davantage de documentaires � l'�cran. Le programme r�pondra aux besoins des deux march�s linguistiques. Mis sur pied en 2005-2006 � titre de projet pilote d'un an, le Programme pilote pour le long m�trage documentaire destin� aux salles a contribu� au d�veloppement et � la production de sept documentaires de langues anglaise et fran�aise, ainsi qu'� l'ach�vement de six projets de documentaires en anglais et en fran�ais provenant de l'ensemble du Canada.
Court m�trage
| Format des films de l'ONF (tous genres confondus) | 2006-2007 | % |
| Court m�trage | 88 | 69% |
| Moyen m�trage | 20 | 16% |
| Long m�trage | 19 | 15% |
| Total | 127 | 100% |
Au cours de la derni�re ann�e, l’ONF a entrepris de repenser l’ensemble de ses initiatives de production, de diffusion et de distribution du court m�trage. Ce faisant, il reconna�t l’importance de ce format de production, en particulier pour les cin�astes �mergents, et l’int�r�t croissant qu’il suscite, au Canada comme ailleurs dans le monde.
En outre, dans son d�sir de valoriser le court m�trage sur la sc�ne internationale, l'ONF a �tabli un partenariat avec le March� du film du Festival de Cannes, le Short Film Corner afin d’organiser un vaste concours international de courts m�trages. Pour la deuxi�me ann�e, l’ONF a remis au laur�at de la Palme d’or du court m�trage, le prix Norman-McLaren, dot� d’une bourse et assorti d’une offre optionnelle de distribution internationale ou de coproduction de la prochaine œuvre de l’artiste. La deuxi�me Comp�tition en ligne Cannes 2006 pr�sentait pour sa part dix courts m�trages en provenance de six pays, s�lectionn�s parmi pr�s de neuf cents films inscrits au Short Film Corner. Le film B is for Bomb, une production de la documentariste sud-africaine Carey McKenzie, a �t� choisi par vote du public : le concours a donn� lieu � pr�s de 44 000 visionnages, soit une augmentation de 308 % par rapport � l’�dition 2005. De plus, l’ONF a command� une �tude sur le court m�trage en 2006-2007 qui servira de fer de lance dans l’�laboration d’une strat�gie d�taill�e pour l’ann�e 2007-2008.
3. Consolider la capacit� de l'ONF � rep�rer et encourager les talents les plus prometteurs et travailler avec eux, assurant ainsi la promotion des cin�astes de la rel�ve et des talents issus des milieux autochtones et culturels divers.
R�sultat pr�vu :
Le d�veloppement et le perfectionnement continus de nouveaux talents;
Indicateur :
- Diversit� � l'�cran et en coulisses
R�sultat pr�vu :
Le d�veloppement et le perfectionnement continus de nouveaux talents;
L'ONF a toujours investi beaucoup d'�nergie � s'ouvrir davantage � la rel�ve, puisqu' il offre un lieu d'apprentissage unique caract�ris� par une tradition cin�matographique d'une grande richesse. L'Office a toujours aspir� � �tre un tremplin pour les jeunes talents qui veulent s'investir dans la production et la r�alisation de films documentaire et d'animation.
En mettant en œuvre de nombreux programmes et projets de perfectionnement, l'ONF d�couvre et encourage le talent, consolide le cin�ma canadien et favorise l'exp�rimentation. Son soutien aux cin�astes canadiens se traduit par tout un �ventail d'activit�s offertes � l'�chelle du pays. Ce faisant, l'ONF encourage des voix distinctives de partout au pays � se faire entendre.
Les diff�rents programmes et initiatives mis sur pied par l'organisme pour rallier les cin�astes de la rel�ve, dont nombre sont issus de cultures diverses, des minorit�s de langues officielles et des communaut�s autochtones, ont fait que pour la deuxi�me ann�e cons�cutive, plus de la moiti� des productions et coproductions de l'ONF sont aujourd'hui r�alis�es par des cin�astes de la rel�ve. L'ONF est fier de cet accomplissement et est bien r�solu � continuer dans cette voie. Voici quelques initiatives de l'ONF qui ont encourag� la diversit� � l'�cran et en coulisses.
Indicateur :
Diversit� � l'�cran et en coulisses
Initiatives pour la rel�ve :
Hothouse 3
Maintenant � sa troisi�me �dition, ce programme favorise l'�panouissement des nouveaux talents, offre une formation compl�te en cin�ma d'animation professionnel et r�invente ce moyen d'expression en concevant des m�thodes d'animation plus rapides et plus souples, qui exaltent les formes de m�trage les plus courtes tout en maintenant l'excellence sur les plans de la cr�ation et de la technologie. Cette ann�e, six cin�astes de la rel�ve ont relev� le d�fi de passer douze semaines cons�cutives au Studio d'animation de l'ONF de Montr�al pour cr�er un film de 30 secondes.
Momentum 2006
Il s'agit d'un programme pour la rel�ve qui donne la chance � des jeunes cin�astes d'am�liorer leur expertise en recherche, en �criture et en r�alisation � travers une s�rie d'ateliers et gr�ce au mentorat. Ainsi, ils peuvent explorer des m�thodes de production innovatrices pour r�aliser un film qui correspond aux standards de l'industrie. Ces films sont diffus�s sur CBC Newsworld. Pour la troisi�me ann�e cons�cutive, les ateliers de formation en documentaire Momentum ont eu lieu au mois de janvier. En f�vrier, chaque participant a �t� suivi par une conseill�re pour le d�veloppement de son projet. Le concours s'est termin� en mars par la s�lection d'un projet de court m�trage que l'ONF a produit.
Yukon V�rit�
Yukon V�rit� est un programme de mentorat destin� aux documentaristes qui en sont � leurs premi�res armes. Le programme, offert en partenariat avec la Yukon Film Society, consiste en une s�rie d'ateliers participatifs destin�s aux personnes int�ress�es � se lancer en production de film et vid�os, qui poss�dent de l'exp�rience et des aptitudes dans des domaines de cr�ativit� connexes.
Huit cin�astes ont �t� s�lectionn�s pour participer � des ateliers pratiques intensifs. Tous ont b�n�fici� de soutien et de mentorat tandis qu'ils produisaient leur premier court m�trage, � l'automne 2006.
Initiatives pour les Autochtones :
Wapikoni Mobile
Il s'agit d'un studio de production cin�matographique ambulant imagin� par la cin�aste Manon Barbeau, et appuy� par l'ONF, qui va � la rencontre des jeunes Autochtones. Ces derniers sont initi�s aux techniques de production et signent leur premier film ou clip sonore. En 2006-2007, 8 communaut�s autochtones ont �t� visit�es par l'�quipe des studios volants de Wapikoni. Depuis les d�buts de ce projet, 445 jeunes des communaut�s autochtones isol�es du Qu�bec ont �t� form�s en technologie num�rique, 76 courts m�trages furent r�alis�s par ces jeunes Autochtones et treize prix furent d�cern�s � ces films. Plus de 49 projections des œuvres r�alis�es furent pr�sent�es devant un public autochtone et non-autochtone et un total de 64 �v�nements de diffusion dans des festivals, colloques ou autres �v�nements sp�ciaux furent organis�s depuis 2004. En janvier 2006, un premier studio permanent � Wemotaci a �t� pris en charge par quatre jeunes autochtones form�s dans le studio Wapikoni et deux autres studios permanents dans les communaut�s de Kitcisakik et de Mashteuiatsh ont commenc� leurs op�rations en 2006-2007.
First Stories
Ce partenariat avec CBC vise � d�velopper les talents et l'expertise d'Autochtones en production cin�matographique et t�l�visuelle. Cette initiative permet � des cin�astes autochtones de la rel�ve du Manitoba, de la Saskatchewan et du Nord de suivre une s�rie de s�minaires intensifs au terme desquels ils sont invit�s � d�poser des propositions de court m�trage portant sur des enjeux sociaux. Lanc� en 2005, First Stories - Manitoba a donn� � quinze jeunes Autochtones l'opportunit� de partager des histoires qui sont importantes pour eux et leur communaut�.
Nunavut Animation Lab
Le Nunavut Animation Lab est le fruit d'une initiative conjointe de l'ONF, de l'Inuit Broadcasting Corporation, du Banff Centre, du r�seau de t�l�vision des peuples autochtones (APTN), du National Screen Institute, de Nunavut Film et du gouvernement du Nunavut. Ce projet a pour but de servir de porte-voix aux cin�astes du Nunavut par le biais d'ateliers, de partage de connaissances et de techniques de pointe et de la cr�ation de films d'animation. Les professionnels du cin�ma du Nunavut trouvent ainsi le moyen de se faire entendre dans le monde entier gr�ce aux m�dias �lectroniques.
Le premier volet du Nunavut Animation Lab s'est cl�tur� avec succ�s. Quatre jeunes animateurs d'Iqaluit et Pangnirtung ont �t� choisis pour poursuivre leur formation et tourner un court m�trage d'animation (moins de cinq minutes). Ils ont �t� retenus parmi les 38 r�sidents du Nunavut qui ont particip� aux ateliers intensifs donn�s en f�vrier � Cape Dorset, Iqaluit et Pangnirtung. Ces ateliers avaient pour but d'initier les artistes de la rel�ve et les cin�astes chevronn�s aux derni�res techniques d'animation faisant appel � du mat�riel hautement perfectionn�. Les quatre gagnants ont entam� � Winnipeg une semaine d'ateliers sur le r�cit, coordonn�s par le National Screen Institute, afin de d�velopper et peaufiner leur �bauche. Ils sont all�s ensuite au Banff Centre en faire la r�alisation et l'animation. Les films seront disponibles en inuktitut, en anglais et en fran�ais. � Banff, les jeunes cin�astes ont travaill� aupr�s de coll�gues exp�riment�s et de mentors qui les ont aid�s � mener � bien leur projet, et � r�fl�chir aux moyens de le commercialiser. Les films recevront une diffusion mondiale par le biais du site Web de l'ONF, des festivals et du r�seau national APTN.
Initiatives pour les communaut�s de langue officielle en situation minoritaire :
Programme de mentorat destin� aux cin�astes francophones de l'Ontario
Ce projet pilote en collaboration avec le Conseil des arts de l'Ontario fut offert pour la premi�re fois en 2006. Il a permis � quatre cin�astes francophones ontariens d'�tre suivis dans une d�marche de perfectionnement artistique sur le long terme par un mentor exp�riment� dans le domaine de la pr�production, production ou postproduction. Les quatre r�alisatrices s�lectionn�es cette ann�e ont �galement eu la chance d'�tre encadr�es personnellement en montage, structuration de l'histoire, sc�narisation et cam�ra HD.
AnimAcadie
Lors de la troisi�me �dition du concours AnimAcadie, des modifications importantes ont �t� apport�es � ce projet con�u sous l'�gide du Programme de partenariat interminist�riel pour les communaut�s de langue officielle (PICLO), dont l'objectif est de soutenir les communaut�s de langue officielle en situation minoritaire. En mettant cette ann�e l'accent sur la sc�narisation et en invitant les laur�ats � travailler avec les r�alisateurs gagnants des ann�es pr�c�dentes, l'ONF a voulu contribuer non seulement � l'�mergence d'œuvres profond�ment originales et d'une grande qualit�, mais aussi � renforcer les liens qui existent entre les diff�rents acteurs du milieu.
Concours PICLO 2006
Cette initiative vise � offrir aux auteurs, aux r�alisateurs et aux producteurs œuvrant en fran�ais � l'ext�rieur du Qu�bec la possibilit� de d�velopper leurs comp�tences en mati�re de production dramatique t�l�visuelle. Le concours a �galement pour objectif d'�largir le bassin des professionnels et des cr�ateurs francophones provenant de provinces autres que celle du Qu�bec.
Les huit sc�naristes dont le projet a �t� retenu en 2006 ont re�u une aide financi�re ainsi que l'appui d'un conseiller en sc�narisation de l'Institut national de l'image et du son (INIS). Par la suite, ils ont finalis� le mat�riel cr�atif et se sont associ�s avec un producteur œuvrant en fran�ais � l'ext�rieur du Qu�bec. Ce concours est organis� conjointement par l'ONF, T�l�film et Radio-Canada. L'Office national du film agit en tant que producteur associ� et T�l�film Canada en tant qu'investisseur alors que Radio-Canada est associ�e � la production et acquerra les droits de diffusion � ses antennes r�gionales et nationale.
Cin�aste recherch�(e)
Ouvert aux Canadiens francophones ayant d�j� r�alis� un film d'animation sonoris�, dans des conditions artisanales ou scolaires, le concours permet � un(e) laur�at(e) de r�aliser un premier court m�trage anim� professionnel dans les studios ONF de Montr�al. Cr�� en 1980, � l'initiative du Studio Animation et Jeunesse, le concours Cin�aste recherch�(e) a permis l'�mergence de nombreux cin�astes d'animation, tels que Mich�le Cournoyer (La Basse Cour, 1992), Pierre M. Trudeau (Enfantillage, 1990) et Nicolas Brault (Antagonia, 2002). Les premi�res œuvres r�alis�es dans le cadre du concours ont r�colt� plus d'une trentaine de prix internationaux.
Initiatives pour la diversit� culturelle :
72 Heures Chrono
Cette comp�tition organis�e par Taling Dialo, un groupe de cin�astes de la diversit� culturelle canadienne, permet � des jeunes Africains de cr�er un documentaire court m�trage tout en recevant de la formation de cin�astes canadiens de la diversit� culturelle. L'initiative en �tait � sa quatri�me �dition cette ann�e et a attir� une dizaine de jeunes du Qu�bec qui, en collaboration avec des Burkinab�s �g�s entre 18 et 25 ans, ont particip� � la quatri�me �dition de cette aventure dont le th�me �tait � Jeunesse et Cin�ma �. En 72 heures, six �quipes ont tourn� six courts m�trages de six minutes. Documentaire, fiction et docu-fiction en r�sult�rent. Cette exp�rience a non seulement permis aux jeunes Qu�b�cois et Burkinab�s de se d�couvrir, de s'exprimer par l'image, mais aussi de vivre une exp�rience interculturelle unique.
Reel Diversity
La cinqui�me �dition de cette comp�tition annuelle, qui se fait en partenariat avec CBC, CBC Newsworld et Vision TV, a offert la possibilit� � huit cin�astes de la rel�ve des minorit�s visibles de participer � une s�ance de formation intensive de trois jours et � trois d'entre eux de produire un documentaire avec l'ONF, qui a �t� t�l�diffus� nationalement par la suite. Ce programme d'envergure nationale donne � de nouveaux talents l'occasion de se faire conna�tre en proposant aux auditoires d'ici et d'ailleurs des sujets et des traitements originaux rarement vus dans les m�dias grand public. Jusqu'� maintenant, Reel Diversity a donn� naissance � 23 films qui, en plus d'�tre pr�sent�s dans 35 prestigieux festivals de film canadiens et �trangers, ont �t� prim�s � plusieurs reprises.
Projets pour les personnes handicap�es
Open i
Open-i est un programme de mentorat en vid�o num�rique et comp�tence m�diatique destin� aux jeunes handicap�s. Au cours des deux derni�res ann�es, des cin�astes du projet AccessNFB ainsi que des moniteurs de la Cin�math�que Pacifique et des conseillers jeunesse - certains handicap�s, d'autres pas - ont travaill� aupr�s de cinq groupes de jeunes dans tout le Lower Mainland pour les aider � concr�tiser leur vision cr�atrice, c'est-�-dire raconter leurs propres histoires au moyen de la vid�o num�rique. En 2006-2007, cinq courts m�trages de tr�s grande qualit�, aux genres et styles tr�s diff�rents et portant sur les sujets les plus divers ont �t� r�alis�s. Plusieurs des jeunes artistes qui ont particip� au programme cette ann�e ont annonc� qu'ils embrasseraient une carri�re dans les m�dias; trois d'entre eux suivront d'ailleurs la formation Summer Visions de la Cin�math�que pour continuer d'approfondir leurs connaissances en cin�ma.
4. Favoriser les partenariats par les coproductions.
R�sultat pr�vu :
Le maintien du nombre de coproductions nationales et internationales;
Indicateur :
- Nombre de coproductions nationales et internationales
R�sultat pr�vu :
Le maintien du nombre de coproductions nationales et internationales;
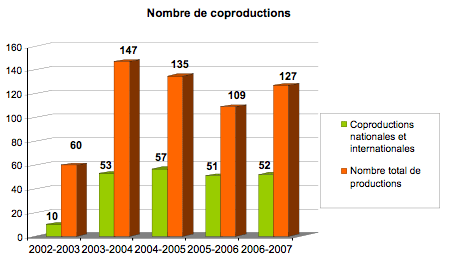
Par le biais de ses productions originales et de ses coproductions, l'ONF mise sur des contenus riches tant sur le plan artistique que social. L'accent des derni�res ann�es sur le d�veloppement de coproductions avec les secteurs priv�s et publics du Canada et de l'�tranger a permis d'optimiser les ressources financi�res, techniques et cr�atives de l'ONF et d'entreprendre des projets d'envergures nationale et internationale. Au cours des cinq ann�es du Plan strat�gique, le nombre de coproductions avec le secteur priv� a augment� de mani�re significative.
Indicateur :
Nombre de coproductions nationales et internationales
| Productions | 2006-2007 | % | 2005-2006 | % |
| Productions 100% ONF | 75 | 59% | 51 | 50% |
| Coproductions nationales et internationales | 52 | 41% | 51 | 50% |
| Total | 127 | 100% | 102 | 100% |
En 2006-2007, l'ONF a maintenu son nombre de coproductions avec des acteurs d'ici et d'ailleurs. Dans plusieurs cas, il est essentiel de mentionner que sans la participation de l'Office, ces coproductions n'auraient pas vu le jour. L'Office national du film est une maison de production et de distribution int�gr�e qui dispose de services techniques de postproduction, un laboratoire de conservation ainsi qu'une collection audiovisuelle et des archives d'une richesse exceptionnelle, accessibles aux coproducteurs � des tarifs tr�s avantageux. Selon les besoins sp�cifiques de chaque projet, l'ONF peut mettre � contribution toutes ses ressources financi�res, techniques et cr�atives. Les retomb�es pour les coproducteurs ind�pendants sont nombreuses.
La coproduction permet d'accro�tre les moyens de d�velopper une strat�gie de promotion et de mise en march� assurant une visibilit� optimale des œuvres aupr�s des publics cibl�s. Une �quipe sp�cialis�e collabore �troitement avec les producteurs partenaires pour que cette �tape cruciale soit couronn�e de succ�s.
Les coproductions peuvent b�n�ficier d'un r�seau de distribution tr�s bien implant� dans le secteur de l'�ducation, les march�s institutionnels et aupr�s des consommateurs. Un num�ro de t�l�phone sans frais et un service de vente en ligne permettent l'achat de vid�os en tout temps. Il est plut�t rare que des films d'auteur produits dans le secteur priv�, plus particuli�rement les documentaires et les films d'animation, œuvres uniques, profitent d'une distribution � l'�chelle du pays.
L'ONF est le plus important distributeur canadien et vend plusieurs milliers de cassettes par ann�e, sans interm�diaire. Dans le cadre d'une coproduction, un partage des droits de distribution peut �tre n�goci� dans le meilleur int�r�t du projet, selon les cr�neaux vis�s. L'ONF peut agir � titre d'agent de vente dans les territoires canadiens et dans le monde, notamment dans les march�s institutionnels et de vente directe, � des conditions �quivalentes � celles pratiqu�es dans l'industrie.
Finalement, des ententes-cadres et des partenariats d'envergure conclus avec des joueurs cl�s de l'industrie mondiale de l'audiovisuel, permettent aux productions de l'ONF et aux coproductions de se positionner avantageusement sur la sc�ne internationale.
5. Renforcer l'innovation sur les plans du contenu, de la forme et de la technologie.
R�sultat pr�vu :
Les nouveaux produits seront innovateurs par leur contenu, leur forme et leur diffusion; ils feront place � l'exp�rimentation
Indicateur :
- Plusieurs applications innovatrices
- Reconnaissance de prix dans les festivals
R�sultat pr�vu :
Les nouveaux produits seront innovateurs par leur contenu, leur forme et leur diffusion; ils feront place � l'exp�rimentation;
Depuis de nombreuses ann�es, l'ONF est reconnu pour sa contribution � la cin�matographie mondiale tant au plan de l'innovation technique que formelle. L'ONF est d�termin� � maintenir sa r�putation d'excellence et de chef de file sur les plans du contenu, de la forme et de la technologie en explorant de nouveaux cr�neaux pour la production d'œuvres audiovisuelles, telles que la production HD, la production pour nouvelles plateformes et l'utilisation de nouvelles techniques de production en animation. L'ONF tient �galement � explorer le potentiel de strat�gies novatrices de distribution et d'accessibilit� mettant � contribution les nouveaux m�dias, dont Internet et la distribution num�rique.
Cette derni�re ann�e a �t� riche en r�alisations : l'ONF est actif dans la production pour nouvelles plateformes et a r�ussi � diversifier ses revenus de distribution gr�ce aux nouvelles technologies. L'engagement de l'ONF vis-�-vis la production et la distribution de contenus novateurs destin�s aux nouvelles plateformes a confirm�, cette ann�e, sa capacit� � stimuler les cr�ateurs d'ici et � faire du Canada un leader dans ce domaine sur la sc�ne internationale.
Indicateurs :
Plusieurs applications innovatrices
Cin�aste en r�sidence
Lanc� en 2006, le projet Cin�aste en r�sidence (Filmmaker in Residence - FiR), un partenariat sans pr�c�dent entre l'ONF et l'h�pital St-Michael's, situ� dans un quartier d�favoris� de Toronto, a d�j� commenc� � donner ses premiers r�sultats concrets. Trente ans apr�s le programme Challenge for Change/Soci�t� nouvelle, qui l'inspire, et nourri par la r�volution num�rique, la collaboration unique entre les deux principaux partenaires donne � la cin�aste Katerina Cizek la possibilit� de travailler directement avec les intervenants de premi�re ligne et leurs clients pour cr�er des œuvres audiovisuelles et mettre les outils multim�dias dans les mains des acteurs sociaux concern�s.
Jusqu'� pr�sent deux films ont �t� r�alis�s. Le premier, The Bicycle, accompagne les m�decins de St-Michael's qui sont � l'origine du projet Dignitas International au Malawi, o� des travailleurs communautaires luttent sur la ligne de front contre la pand�mie du sida. The Interventionists : Chronicles of a Mental Health Crisis Team suit une �quipe form�e d'une infirmi�re et d'un policier torontois r�pondant aux appels d'urgence suscit�s par des personnes troubl�es sur le plan �motionnel.
Shorts in Motion
Unanimement salu�e lors de sa premi�re mondiale au MIPCOM 2006, la p�tillante anthologie de dix films de deux minutes Shorts in Motion - The Art of Seduction, pr�sent�e par Bravo!Fact de CHUM Television, coproduite par l'ONF et Marblemedia, a b�n�fici� au Canada d'un lancement en ligne au mois d'octobre. La qualit� intrins�que des œuvres qui la composent, sign�e par des personnalit�s, des cin�astes et des artistes connus, et l'avant-gardisme du projet lui ont valu le prix Best Made for Mobile Video Service, d�cern� par la prestigieuse Groupe Speciale Mobile Association (GSMA).
Contenus novateurs socialement engag�s
D�sireux de contribuer � �largir constamment le bassin des cr�ateurs et cr�atrices susceptibles de relever le d�fi li� � la production de contenus et d'applications interactives et innovatrices pour la technologie mobile et � haut d�bit, l'ONF, sur la sc�ne internationale, a accept� en 2006 de commanditer le volet � contenus novateurs socialement engag�s � du concours Content 360, organis� pour la premi�re fois dans le cadre du MIPTV. � la suite des d�lib�rations d'un jury international pr�sid� par le directeur g�n�ral du Programme anglais, il a offert au projet laur�at une entente de coproduction (d�veloppement) d'un film d'animation pour nouvelles plateformes sur l'art de la rue et les jeunes qui le cr�ent. Le succ�s de cette initiative a amen� l'ONF � poursuivre son engagement dans l'�dition 2007 du concours.
Reconnaissance de prix dans les festivals
| Festivals de films | 2006-2007 | 2005-2006 |
| Prix remport�s aux festivals canadiens | 56 | 48 |
| Prix remport�s aux festivals internationaux | 97 | 95 |
| Total | 153 | 143 |
Depuis sa cr�ation, l'ONF a remport� plus de 5 000 prix, dont plus de 90 prix G�nie et 6 Prix Jutra. La cuv�e de prix pour l'ann�e 2006-2007 confirme la tradition d'excellence cin�matographique de l'Office. Sur la sc�ne internationale, l'ONF a ainsi r�colt� plus de 97 r�compenses, dont son 12e Oscar� pour le film The Danish Poet. Plus pr�s de chez-nous, 56 productions de l'ONF ont �t� prim�es dans divers festivals et �v�nements � travers le Canada. Deux de ses coproductions, The Danish Poet et Manufactured Landscapes, ont �t� r�compens�es au gala des prix G�nie de l'Acad�mie canadienne du cin�ma et de la t�l�vision, respectivement pour le meilleur court m�trage et le meilleur documentaire. Le long m�trage documentaire � force de r�ves, une coproduction de l'ONF, a remport� le Jutra du meilleur documentaire. Au dernier gala annuel des prix Gemini, huit films et coproductions furent mis en nomination dans six cat�gories. Le film House Calls, de Ian McLeod, a enlev� le prestigieux prix Donald-Brittain du meilleur documentaire � caract�re social ou politique, alors que Being Caribou a gagn� le Gemini dans la cat�gorie Meilleure �mission documentaire - science, technologie, nature ou environnement et que Fran�ois Dagenais a re�u le Gemini de la Meilleure direction photo - �mission ou s�rie documentaire pour la coproduction de l'ONF No More Tears Sister. � l'occasion du 21e Gala des Prix G�meaux, le pendant fran�ais des prix Gemini, les films de l'ONF ont �t� nomm�s � neuf reprises dans huit cat�gories pour finalement remporter trois prestigieuses statuettes. L'ann�e 2006-2007 marquait �galement la troisi�me ann�e de suite qu'un film de l'ONF �tait honor� du prix Canada. C'est la production Wapos Bay: There's No "I" in Hockey qui a re�u la prestigieuse r�compense qui honore l'excellence en programmation t�l�visuelle refl�tant le mieux la diversit� raciale et culturelle du Canada.
Au cours de l'ann�e, l'ONF n'a pas �t� r�compens� seulement pour la qualit� de ses œuvres audiovisuelles les plus r�centes. En effet, la s�rie The Champions a �t� honor�e au gala des �’uvres magistrales du Trust pour la pr�servation de l'audiovisuel du Canada (Trust AV). Cette c�r�monie organis�e chaque ann�e par l'organisme rend hommage aux r�alisations des artistes et artisans des secteurs du cin�ma, de la t�l�vision, de la musique et de la radio, et souligne l'importance de pr�server les tr�sors audiovisuels du Canada.
6. Maintenir le d�veloppement de coproductions internationales.
R�sultat pr�vu :
Le maintien du nombre de coproductions internationales;
Indicateur :
- Nombre de coproductions internationales
- Accords de partenariats internationaux
R�sultat pr�vu :
Le maintien du nombre de coproductions internationales;
Par ses coproductions internationales, les partenariats qu'il noue avec les grands festivals et march�s, et les accords de coop�ration innovateurs qu'il signe avec des gouvernements et organismes du monde, l'ONF fait conna�tre l'excellence cin�matographique canadienne � l'�chelle internationale. Ces ententes-cadres et partenariats d'envergure conclus avec des joueurs cl�s de l'industrie mondiale de l'audiovisuel, permettent aux coproductions avec l'industrie priv�e canadienne de se positionner avantageusement sur la sc�ne internationale. Ainsi, au fil des ans, l'ONF a continu� � augmenter le nombre de ses partenariats internationaux. En 2006-2007, il a aussi cherch�, avec succ�s, � en �largir la port�e.
Indicateurs :
Nombre de coproductions internationales
Afin de tirer profit de la mondialisation des march�s et d'accro�tre sa notori�t� internationale, l'ONF a mis� sur le d�veloppement de coproductions internationales. Cinq des œuvres produites par l'ONF cette ann�e comprennent un ou des producteurs �trangers, publics ou priv�s. Ces relations fructueuses sont � l'origine d'œuvres comme Killer's Paradise et La plan�te blanche. Bien que le nombre de coproductions internationales ait l�g�rement diminu� par rapport � l'an dernier, passant de 7 � 5 films, cette diminution refl�te la r�alit� de l'industrie cin�matographique canadienne en g�n�ral qui a �galement exp�riment� une baisse de coproductions � l'�tranger. Cette diminution s'explique en grande partie par l'�volution de la politique et de la r�glementation en Europe et au Royaume-Uni qui a beaucoup nui aux coproductions officielles avec le Canada8.
Accords de partenariats internationaux
La mise en œuvre de l'entente entre l'Office national du film et le secr�tariat d'�tat � l'audiovisuel du minist�re br�silien de la Culture t�moigne du potentiel d'accords de coop�ration entre institutions partageant les m�mes objectifs. Cette ann�e, les repr�sentants des parties signataires se sont rencontr�s au Canada, � l'occasion du Festival international du film de Toronto. Un premier documentaire, coproduit par l'ONF, la soci�t� br�silienne GrifaMixer et Discovery Canada, est en cours de r�alisation. Par ailleurs, � la suite d'un appel de propositions lanc� par les responsables du Fonds de d�veloppement cr�� par les parties, quatre projets de coproduction ont �t� choisis et b�n�ficient d'une aide au d�veloppement du sc�nario. Enfin, dans le cadre du volet � d�veloppement technologique et formation � de l'entente, deux jeunes animateurs br�siliens sont venus participer au programme Hothouse 4 2007, donn� cette ann�e par la r�alisatrice de The Danish Poet, Torill Kove.
Dans le m�me esprit, l'ONF a aussi sign� cette ann�e un accord de coop�ration avec la Media Development Authority de Singapour et la Singapore Film Commission, qui couvre les secteurs de la coproduction, de la formation et du d�veloppement technologique.
Activit� de Programme 2. Distribution d'œuvres audiovisuelles
L'ONF a �galement pour mandat de distribuer ses produits aussi largement que possible au Canada et � l'�tranger. En mettant ses œuvres sur le march�, l'ONF maximise ses recettes. Sous cette activit� sont regroup�es les comp�tences et les capacit�s de l'ONF en mati�re de distribution commerciale. L'activit� � distribution � s'entend de la commercialisation des catalogues audiovisuels de l'ONF et de sa cin�math�que de plans d'archives bien �tablie; du d�veloppement et de la diversification des march�s sur lesquels il distribue ses produits, au Canada comme � l'ext�rieur; de la cr�ation de compilations pour des march�s sp�cifiques; de l'offre d'un service � la client�le de qualit�; de l'augmentation de son fonds d'œuvres audiovisuelles par des acquisitions ou des ententes de partenariat; des �tudes de march�.
Par ses activit�s de distribution, l'ONF d�veloppe des rapports de coop�ration strat�gique avec les secteurs public et priv� au Canada et � l'�tranger afin de mettre sa collection � la disposition de tous les Canadiens et Canadiennes ainsi que des cin�philes du monde entier.
| RMR 2006-2007 (selon l'AAP) | |
| Activit� de programme 2 | Priorit�s |
| Distribution d'œuvres audiovisuelles |
|
Ressources financi�res en milliers de dollars
| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |
| 2 370 | 2 391 | 3 134 |
Ressources humaines
| Pr�vues | Autorisations | R�elles |
| 45 | 45 | 49 |
Les priorit�s
1. Accro�tre les revenus tir�s de la collection de l'ONF et optimiser les ventes et les pr�ventes.
R�sultat pr�vu :
Augmenter notre chiffre d'affaires et nos revenus pour l'ensemble de nos march�s et territoires;
Indicateur :
- �valuation trimestrielle des ventes, pr�ventes et revenus de l'ONF
R�sultat pr�vu :
Augmenter notre chiffre d'affaires et nos revenus pour l'ensemble de nos march�s et territoires;
En 2006-2007 le chiffre d'affaires de l'ONF a totalis� 6 630 M$, une baisse significative par rapport au chiffre d'affaires de 8 882 M$ r�alis�s lors de l'exercice financier pr�c�dent. Bien que le chiffre d'affaires de cette ann�e, soit l�g�rement en de�� des pr�visions annuelles projet�es au d�but de l'ann�e fiscale, ces r�sultats sont plus en conformit� avec le bilan des cinq derni�res ann�es. L'ann�e 2005-2006 fut une ann�e exceptionnelle qui est le fruit de r�sultats excellents dans les march�s institutionnel et t�l�visuel. Plusieurs ventes uniques importantes et signatures d'ententes majeures avaient �t� conclues lors de cette p�riode.
Il est � noter que les activit�s de distribution ont permis de g�n�rer des revenus totaux de plus de 5 338 millions de dollars et que pr�s de 1 180 M$ ont �t� redistribu�s � ses partenaires commerciaux provenant en majorit� de l'industrie ind�pendante du cin�ma canadien.
Ventes, pr�ventes et revenus de distribution de l'ONF
| Revenus de distributions | 2006-2007 | 2005-2006 |
| T�l�vision | 1 315 280 $ | 2 005 950 $ |
| Distribution en salle | 61 796 $ | 292 636 $ |
| Institutionnel et �ducatif | 2 405 130 $ | 2 780 251 $ |
| Consommateur | 1 040 531 $ | 1 179 053 $ |
| Total | 5 338 342 $ | 6 939 836 $ |
March�s consommateur et institutionnel
Les efforts soutenus de l'�quipe de ventes sur le march� institutionnel canadien ont donn� d'excellents r�sultats, avec des revenus de 1 832 M$, un r�sultat sup�rieur aux pr�visions et, de loin, � la moyenne des ann�es pr�c�dentes. Le march� consommateur canadien a lui aussi connu une tr�s bonne ann�e, gr�ce notamment � la disponibilit� accrue des productions de l'ONF en format DVD et des campagnes promotionnelles bien cibl�es, qui se sont traduites par des revenus de 686 000 $. Des succ�s similaires ont �t� enregistr�s sur le march� consommateur europ�en, o� les revenus, qui ont totalis� 154 717 $, ont plus que doubl� par rapport � l'ann�e derni�re.
March� t�l�visuel
Partout en Am�rique, les turbulences sur les march�s de la t�l�vision, rendus incertains par l'arriv�e de la technologie haute d�finition et le morcellement constant des publics, ont eu un impact sur les revenus enregistr�s au Canada (421 000 $, soit 18 % de moins qu'en 2005-2006) ainsi que sur les march�s des �tats-Unis et de l'Am�rique latine (489 000 $, en baisse de 19 %). La baisse des revenus de l'ONF dans le march� de la t�l�vision est �galement attribuable � la diminution du nombre de nouveaux produits disponibles et � la composition de ces nouveaux produits (production ONF vs coproductions vs acquisitions).
Plans d'archives
Les revenus tir�s des ventes de plans d'archives de l'ONF s'�l�vent pour leur part � 515 605 $, en baisse de 32 % par rapport � l'ann�e pr�c�dente. Comme par le pass�, ces revenus proviennent majoritairement du Canada (89 %), o� des �v�nements comme le conflit de travail entre la Canadian Film and Television Producers Association (CFPTA) et l'Alliance of Canadian Cinema Television and Radio Artists (ACTRA) et la crise au Fonds de t�l�vision canadien � l'automne ont incit� de nombreux producteurs � la prudence : certains ont r�duit leurs budgets de production, d'autres ont tout simplement remis leurs projets � plus tard. Par contre, il convient de noter que la num�risation des plans d'archives de l'ONF pourrait se traduire par une augmentation des ventes d�s 2008-2009.
Distribution en salle
Les revenus provenant de la distribution en salle ont �galement diminu� en 2006-2007, passant de 293 000 � 63 000. Il faut cependant noter que cet �cart est largement d� � une correction au rapport d'un des coproducteurs de l'ONF qui a amen� une distorsion dans la comparaison des revenus r�alis�s au cour des deux ann�es. Des revenus de 92 000 $ comptabilis�s en 2005-2006 ont d� �tre corrig�s � la baisse. Cette correction est refl�t�e en 2006-2007.
2. Offrir les comp�tences sp�cialis�es et les r�seaux de distribution de l'ONF aux secteurs priv� et public.
R�sultat pr�vu :
Acqu�rir un plus grand nombre de productions compl�mentaires au catalogue de l'ONF;
Renforcer l'image de marque de la distribution de l'ONF
Indicateur :
- Attention particuli�re, chaque trimestre, au nombre d'acquisitions de productions audiovisuelles r�alis�es et � leurs retomb�es
- Suivi des progr�s faits en vue de d�velopper de nouveaux outils Internet pour nos clients du march� consommateur
R�sultat pr�vu :
Acqu�rir un plus grand nombre de productions compl�mentaires au catalogue de l'ONF;
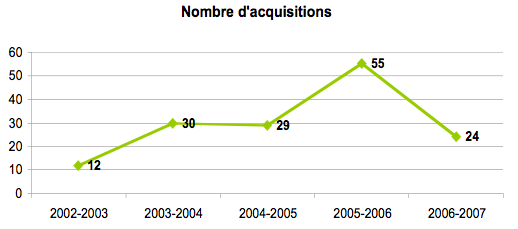
Avec sa politique d'acquisition, l'ONF cherche � acqu�rir les droits de distribution de documentaires et de films d'animation canadiens ou �trangers (productions uniques ou en s�rie). De cette mani�re, l'ONF met au service des producteurs du secteur priv� canadien et �tranger son savoir-faire en mati�re de diffusion de documentaires sociaux, d'œuvres exp�rimentales et de films d'animation. Depuis 2002, l'ONF a constamment augment� le nombre de titres qu'il s'est procur�.
Indicateur :
Attention particuli�re, chaque trimestre, au nombre d'acquisitions de productions audiovisuelles r�alis�es et � leurs retomb�es
| Acquisitions | 2006-2007 | 2005-2006 |
| Nombre | 24 | 55 |
| Revenus nets | 546 000$ | 556 000$ |
Apr�s une ann�e record pour le nombre de productions audiovisuelles acquises par l'ONF, les r�sultats de l'exercice financier qui vient de se terminer sont plus pr�s de la moyenne des cinq derni�res ann�es. La baisse de plus de cinquante pourcent exp�riment�e en 2006-2007 s'explique par une diminution importante du nombre de s�ries comportant plusieurs titres. Les titres acquis au cours de l'ann�e ont g�n�r� des revenus nets de 546 000$ apr�s avoir remis les royaut�s aux producteurs et d�duit les d�penses de distribution.
R�sultat pr�vu :
Renforcer l'image de marque de la distribution de l'ONF.
Le mandat de l'ONF indique que l'Office a non seulement la responsabilit� de produire mais �galement de distribuer des films destin�s � faire conna�tre et comprendre le Canada aux Canadiens et aux autres nations ainsi que de promouvoir la production et la distribution de telles œuvres. Afin de bien ex�cuter son r�le de distributeur public, il est important de rehausser aupr�s des membres de l'industrie cin�matographique l'image de marque du r�seau de distribution de l'ONF.
Dans le pass�, toutes les comp�tences en distribution commerciale ont �t� regroup�es dans le pass� sous une m�me direction. Cette entit� a pour objectif principal d'optimiser les ventes et les revenus de l'ONF et de ses partenaires. Depuis plusieurs mesures ont �t� entreprises pour renforcer les diff�rentes composantes du r�seau de distribution au pays et � l'�tranger de l'Office.
Indicateur :
Suivi des progr�s faits en vue de d�velopper de nouveaux outils Internet pour nos clients du march� consommateur
Le principal outil de ventes en ligne de l'ONF, la Boutique en ligne ONF, a subi une cure de rajeunissement en 2006-2007. En effet le site Internet de cette cin�math�que virtuelle a �t� totalement renouvel� afin de servir les consommateurs d'une mani�re efficace et efficiente tout en rencontrant du mieux possible leurs attentes. La collection de l'ONF est d�sormais accessible en quelques clics! De plus, avec l'ajout du CRM, les promotions en ligne de l'ONF sont d�sormais mieux cibl�es dans un souci constant d'am�liorer le service � la client�le.
Activit� de programme 3. Acc�s aux œuvres audiovisuelles et d�veloppement des r�seaux
Les activit�s � d'acc�s et de rayonnement � rendent accessibles aux Canadiens et Canadiennes des ressources m�diatiques pertinentes favorisant leur engagement citoyen et leur apprentissage continu. Ainsi, l'ONF accro�t la pr�sence et l'utilisation de documents primaires et secondaires tir�s de sa vaste collection dans diff�rents circuits d'apprentissage; cr�e de nouveaux r�seaux quand il n'en existe pas; favorise les connaissances m�diatiques dans l'ensemble de la population canadienne et l'encourage � utiliser int�gralement sa collection.
Certaines des activit�s d'acc�s et de rayonnement consistent � assurer en permanence l'acc�s � la collection de l'ONF en g�rant la collection - conservation, indexage, catalogage, et enfin, restauration - et � la rendre plus accessible aux g�n�rations futures gr�ce � une utilisation novatrice des nouvelles technologies et de partenariats, notamment les cin�math�ques et les centres d'apprentissage en ligne pour les �coles ainsi que les centres de consultation num�rique.
Les activit�s de rayonnement regroupent notamment les activit�s men�es dans les centres de consultation et les cin�mas ONF � Montr�al et Toronto, les collections dispos�es dans 49 biblioth�ques partenaires de toutes les r�gions du Canada, les projections publiques r�guli�res organis�es de l'Atlantique au Pacifique, le programme d'adh�sion, les cin�math�ques en ligne, les ateliers pour les publics de tous �ges, ainsi que les ateliers de ma�tre et un site Web complet qui renferme des productions interactives, des possibilit�s de dialoguer et de partager des connaissances. Ces activit�s servent � trouver, �tablir et maintenir des relations permanentes et profondes dans les collectivit�s canadiennes et, en second lieu, dans le monde. Elles servent en outre � consolider l'image de marque de l'ONF ainsi qu'� faire conna�tre et comprendre le Canada et sa place dans le monde aux Canadiens et Canadiennes.
| RMR 2006-2007 (selon L'AAP) | |
| Activit� de programme 3 | Priorit�s |
| Acc�s aux œuvres audiovisuelles et d�veloppement des r�seaux |
|
Ressources financi�res en milliers de dollars
| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |
| 11 726 | 14 284 | 12 608 |
Ressources humaines
| Pr�vues | Autorisations | R�elles |
| 110 | 110 | 122 |
Les priorit�s
1. Maintenir, favoriser et accro�tre la conservation et l'acc�s �quitable � la collection de l'ONF - dans les nouveaux formats num�riques �mergents.
R�sultat pr�vu :
Am�liorer l'acc�s � la collection de l'ONF par l'entremise de ses diff�rentes activit�s et outils, notamment ses m�diath�ques et ses autres ressources; continuer la num�risation de la collection de l'ONF;
Indicateurs :
- �valuation de l'utilisation des titres de l'ONF aupr�s de ses diff�rents partenaires, notamment le nombre de pr�ts de films par des biblioth�ques partenaires
R�sultat pr�vu :
Am�liorer l'acc�s � la collection de l'ONF par l'entremise de ses diff�rentes activit�s et outils, notamment ses m�diath�ques et ses autres ressources; continuer la num�risation de la collection de l'ONF;
Afin de rendre ses œuvres accessibles � tous les publics, dans l'ensemble des provinces et territoires canadiens, l'ONF a �tabli un vaste r�seau de distribution qui regroupe de nombreux partenaires des secteurs public (biblioth�ques publiques et scolaires) et priv� (entreprises de distribution, maisons de vente par catalogue, cha�nes de cin�ma, clubs vid�o, etc.). Ses productions sont diffus�es r�guli�rement par les r�seaux de t�l�vision traditionnels et sp�cialis�s et ses m�diath�ques modernes, � Montr�al et � Toronto, donnent acc�s � des milliers de titres de sa collection. Le public canadien peut �galement se procurer les œuvres de l'ONF sept jours sur sept, en furetant dans le catalogue virtuel de son site Internet ou par t�l�phone, en utilisant le num�ro sans frais 1-800-267-7710, du lundi au samedi.
�valuation de l'utilisation des titres de l'ONF aupr�s de ses diff�rents partenaires, notamment le nombre de pr�ts de films par des biblioth�ques partenaires
Vitrines ONF
V�ritables vitrines de l'ONF � Montr�al et � Toronto, la Cin�Roboth�que et la M�diath�que ont, ensemble, accueilli cette ann�e plus de 210 000 visiteurs en plus d'organiser et de participer � de nombreuses activit�s hors de leurs murs.
� Montr�al, o� 106 369 personnes ont franchi ses portes, la Cin�Roboth�que a r�affirm� son r�le dynamique au cœur de la vie culturelle en s'associant �troitement � des �v�nements d'envergure comme la F�te des enfants ou le Festival Montr�al en lumi�re. Parmi les 378 nouveaux titres de sa collection, qui compte d�sormais plus de 9 000 œuvres, The Danish Poet, demand� en visionnage individuel par 1587 personnes, a sans contredit �t� le plus populaire. Par ailleurs, les classes de ma�tre, les ateliers de fins de semaine et les projections organis�es � l'occasion des c�l�brations des 65 ans des studios d'animation de l'ONF ont tous fait salle comble. Ses responsables ont aussi ajout� quatre nouveaux ateliers sur le cin�ma au programme existant, qui a attir� un nombre record de 22 326 participants.
La M�diath�que, � Toronto, a elle aussi d�pass� ses objectifs et a accueilli 105 110 visiteurs. Sa r�putation en mati�re d'ateliers pour les enfants lui a valu de devenir partenaire de la Canadian Opera Company dans le cadre du projet Animate the Opera, une compilation vid�o des productions de plus de 150 �tudiants et professeurs de la r�gion torontoise qui a �t� pr�sent�e � la soir�e d'ouverture du Four Seasons Center for the Performing Arts devant plus de 1000 personnes. Ses collaborations avec la Fondation Historica, la Comp�tition nationale de vid�o Arr�tez le racisme! et le Festival international de films pour la jeunesse ViewFinder l'ont aussi amen� � donner une s�rie d'ateliers pour les enfants et les jeunes un peu partout au pays et m�me � Denver, aux �tats-Unis, � l'occasion de la pr�sentation des films de McLaren au Starz Denver Film Festival.
Les personnes � l'ext�rieur de Montr�al et de Toronto peuvent acc�der aux services de l'ONF via le site internet de l'Office au www.onf.ca ainsi que par la ligne sans frais au num�ro 1 800 267-7710.
Biblioth�ques partenaires
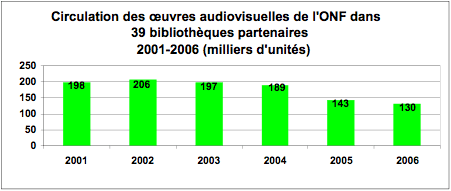
Afin de rendre ses films accessibles au plus grand nombre de citoyens et citoyennes canadiens, l'ONF a �tabli des relations contractuelles avec 49 biblioth�ques partenaires. La majorit� des biblioth�ques partenaires re�oivent des copies gratuites des nouvelles productions de l'ONF. Plusieurs des partenaires de l'ONF ach�tent �galement des titres de l'ONF pour augmenter leur collection. Certaines biblioth�ques, en plus de pr�ter les films de l'ONF � leurs usagers, organisent �galement des s�ances de visionnement des titres de l'ONF pour le public.
Une r�cente �tude a r�v�l� que les Canadiens empruntent de moins en moins d'œuvres audiovisuelles de l'ONF par le biais des biblioth�ques partenaires. En 2006, 34 des 49 biblioth�ques partenaires rapportaient un d�clin dans le nombre d'emprunts des films de l'ONF. De plus, toutes les biblioth�ques ont not� une tendance � la baisse des emprunts des titres de l'ONF au cours des derni�res ann�es. Cette baisse s'explique par le fait que l'ONF d�posait auparavant ses films en format VHS et qu'un grand nombre de films tenus en inventaire par les biblioth�ques sont disponibles dans un format d�suet. Les d�p�ts de films sont faits d�sormais en format DVD et une solution pour remplacer les copies VHS des biblioth�ques est pr�sentement � l'�tude.
Ceci dit, le d�clin de la circulation des titres de l'ONF doit �tre mis en contexte. Plusieurs biblioth�ques ont indiqu� que l'emprunt des films ne provenant pas de l'ONF ont �galement connu une forte diminution. Ce d�clin peut �tre attribu� � l'inventaire important de copies VHS de plusieurs biblioth�ques, le remplacement des lecteurs VHS par les lecteurs DVD et l'abandon des abonn�s des emprunts de copies VHS.
Num�risation de sa collection
| Vo�te num�rique (num�risation, traitement d'image et encodage audio, vid�o et Web) | 2006-2007 | 2005-2006 |
| Films num�ris�s en MPEG2 | 1 405 | 1 620 |
| Films num�ris�s en MPEG4 | 1 301 | 1 347 |
| Extraits num�ris�s pour le Web | 926 | 517 |
| Films num�ris�s pour le Web9 | 1 027 | 271 |
| Films num�ris�s pour le baladeur num�rique | 59 | 12 |
| Total des unit�s | 4 718 | 3 767 |
L'ONF a consid�rablement am�lior� l'accessibilit� � sa collection gr�ce � la num�risation de ses titres. Le Fonds M�moire canadienne, initiative du Contenu canadien en ligne, a aid� � la num�risation de la collection de m�me que le proc�d� de r�plication DVD a favoris� l'augmentation de l'offre de titres DVD pour la vente. � ce jour, plus de 4 718 films ou extraits de films ont �t� num�ris�s. Au cours de la derni�re ann�e, plusieurs coffrets DVD de prestige ont �t� d�velopp�s afin de rendre accessible le patrimoine cin�matographique canadien au grand public. Le plus populaire de la cuv�e 2006-2007 fut sans contredit le coffret intitul� Norman McLaren - L'int�grale.
2. Rejoindre davantage les communaut�s partout au Canada.
R�sultat pr�vu :
Favoriser la participation citoyenne par des projections publiques ou d'autres moyens jug�s appropri�s;
Am�liorer la qualit� de la pr�sence de l'ONF et de ses productions � la t�l�vision, dans les festivals, dans les �coles, au cours des activit�s de l'industrie et aupr�s du gouvernement f�d�ral.
Indicateurs :
- Analyser les mesures d'auditoires pour les productions de l'ONF
- �valuer par des �tudes de cas l'impact social de nos productions
R�sultat pr�vu :
Favoriser la participation citoyenne par des projections publiques ou d'autres moyens jug�s appropri�s;
Rendre l'ONF pr�sent dans la vie des gens demeure un d�fi constant et demande des efforts renouvel�s. Afin de renouer des liens plus �troits avec la population, l'ONF a mis� sur des projets qui permettaient de favoriser l'acc�s � sa collection et d'encourager le dialogue avec les citoyens. De plus, les nouvelles technologies de production et de distribution multim�dia permettront � l'ONF de mieux relever ce d�fi.
Indicateur :
Analyser les mesures d'auditoires pour les productions de l'ONF
Projections publiques
| Projections publiques | 2006-2007 | 2005-2006 |
| Projections (salles commerciales, de r�pertoire et communautaires) | 2 435 | 2 500 |
| Spectateurs aux projections publiques | 145 941 | 154 563 |
Des visionnements publics sont organis�s en fran�ais et en anglais dans diverses communaut�s � l'�chelle du pays et sont souvent accompagn�s de discussions avec des r�alisateurs ou des intervenants du milieu communautaire. Ces visionnements peuvent �tre propos�s dans le cadre d'une s�rie programm�e en partenariat avec un organisme (par exemple, avec les maisons de la culture de Montr�al) ou dans le cadre d'�v�nements communautaires particuliers. Cette ann�e plus de 145 941 personnes ont visionn� des films de l'ONF lors des 2 435 s�ances organis�es par l'ONF ou par ses partenaires. Entre 2002-2006, 5 769 visionnements publics ont eu lieu et 782 335 personnes y ont assist�.
Gr�ce � un partenariat avec la Qikigtani Inuit Association et le minist�re de la Culture, de la Langue, des A�n�s et de la Jeunesse du Nunavut, une s�rie de projections communautaires de films de l'ONF d�peignant la vie inuit fut organis�e � l'�t� et � l'automne 2006. Cette tourn�e avait non seulement pour but de faire conna�tre les films aux Inuits et leur en faciliter l'acc�s, mais �galement d'observer la r�action de la communaut� et d'identifier les personnages � l'�cran avec l'aide de l'auditoire. Beaucoup d'a�n�s pr�sents ont reconnu des parents et des amis d'enfance dans plusieurs de ces films qui n'avaient jamais �t� pr�sent�s dans la r�gion. Dans les communaut�s d'Iqaluit, de Cape Dorset et de Pond Inlet, les spectateurs de tous les groupes d'�ges ont particuli�rement appr�ci� les sc�nes de chasse ainsi que les images montrant les gens et illustrant le mode de vie sur la terre du Nunavut. Les s�ances de visionnage ont attir� un auditoire de plus de 300 personnes. Plus de 20 films, dont des classiques et des nouveaut�s, ont �t� pr�sent�s.
Apr�s une premi�re participation r�ussie aux Rendez-vous de la Francophonie avec 32 projections gratuites de ses films dans 19 villes du Canada, l'ONF r�cidivait encore cette ann�e avec 86 projections dans 33 villes, dans tous les territoires et provinces du Canada. Il est � noter que pr�s de 90% de ces projections (76) avaient lieu dans des communaut�s francophones hors Qu�bec.
T�l�vision
| Auditoire t�l� | 2006-2007 | 2005-2006 |
| Nombre de t�l�diffusions | 1 218 | 1 484 |
| Nombre de t�l�spectateurs | 6 781 000 | 5 948 000 |
En 2006-2007, 6 781 000 t�l�spectateurs canadiens ont regard� l'une des 1 218 t�l�diffusions des films de l'ONF � la t�l�vision, ce qui repr�sente une hausse de 14 % par rapport � l'ann�e pr�c�dente. Il faut noter que cette ann�e, l'ONF s'est dot� d'un nouveau logiciel qui lui permet de mieux prendre la mesure des auditoires de plus en plus importants des cha�nes sp�cialis�es.
Institutionnel
L'ONF d�veloppe pr�sentement une m�thodologie pour calculer le nombre de personnes qui visionnent les films de l'ONF, lorsque qu'une copie est vendue dans les milieux �ducatif, culturel, communautaire, hospitalier et des soins de la sant� ainsi qu'au march� consommateur. En 2006-2007, les ventes brutes du march� institutionnel au Canada ont augment� de 2,4% par rapport � l'ann�e pr�c�dente pour se chiffrer � 2 073 429$. Globalement, les ventes brutes dans le march� consommateur ont g�n�r� 747 765$, ce qui repr�sente une diminution de 2,5% par rapport � 2005-2006.
R�sultat pr�vu :
Am�liorer la qualit� de la pr�sence de l'ONF et de ses productions � la t�l�vision, dans les festivals, dans les �coles, au cours des activit�s de l'industrie et aupr�s du gouvernement f�d�ral;
Festival
| Festival de films | 2006-2007 | 2005-2006 |
| Participation � des festivals canadiens | 68 | 72 |
| Films pr�sent�s aux festivals canadiens | 380 | 336 |
| Participation � des festivals internationaux | 282 | 364 |
| Films pr�sent�s aux festivals internationaux | 463 | 519 |
L'ONF s'est illustr� dans plusieurs festivals tant au Canada qu'� l'�tranger. De 2002 � 2006, les productions de l'ONF ont re�u en moyenne 150 prix et particip� � 390 festivals par ann�e, soit en comp�tition officielle ou hors concours, lors d'�v�nements sp�ciaux. La pr�sentation des films de l'ONF lors de festivals permet de faire conna�tre les artistes d'ici � travers le Canada et sur la sc�ne internationale.
Secteur �ducatif
Gr�ce � des strat�gies de distribution et de d�veloppement des r�seaux, l'ONF s'est enracin� davantage dans le milieu �ducatif. L'ONF offre notamment ses productions aux �diteurs scolaires pour qu'ils puissent les ajouter � leurs catalogues. De plus, des ateliers th�matiques et des ateliers sp�cialis�s sont organis�s sp�cialement pour les �tudiants. Les premiers sont des activit�s programm�es � la M�diath�que et � la Cin�Roboth�que, dans le cadre desquelles les visiteurs des milieux scolaires ou du grand public explorent des aspects de l'expertise de l'Office, comme les techniques d'animation. Les seconds sont des activit�s offertes par l'Office dans le cadre d'�v�nements professionnels, notamment des conf�rences d'enseignants. De plus, dans la section Ressources �ducatives du site Web de l'ONF, �l�ves, enseignants, parents et internautes curieux d'explorer l'univers de l'ONF trouvent un v�ritable carrefour d'apprentissage et ont acc�s gratuitement � une foule d'outils et de ressources.
Suite � la coproduction ONF/CBC The Weight of the World / Le poids du monde, traitant du probl�me de l'ob�sit�, l'ONF et la CBC se sont associ�s de nouveau en organisant le D�fi des �coles/Le poids du monde. Cette initiative vise � encourager la discussion � l'�cole sur ce ph�nom�ne alarmant et � fournir aux jeunes de 9 � 14 ans des informations ludo-�ducatives sur la sant� et leur alimentation. Sous la forme d'un site Web et d'une trousse d'accompagnement, �l�ves et professeurs ont la possibilit� d'utiliser gratuitement le mat�riel �ducatif propos� et participer ainsi au D�fi. Plus de 4 500 enseignants et environ 500 000 �l�ves ont ainsi r�pondu � l'appel et d�j� pris part � cette activit�.
D'autres projets avec les milieux scolaires ont connu �galement beaucoup de succ�s. Fort de la popularit� du D�fi le Poids du monde, l'ONF, en collaboration avec CBC Montreal et les Services � la famille juive, a lanc� un nouveau projet pilote, intitul� Stand by Me, portant cette fois sur la violence et l'intimidation � l'�cole. Apr�s visionnage en classe de films comme Glasses de Brian Duchesherer et Bully Dance de Janet Perlman, et en utilisant les guides d'enseignement �labor�s par l'ONF, les professeurs de quelque 800 �tudiants de la fin du primaire et du d�but du secondaire, dans six �coles, ont anim� des discussions autour de ce probl�me.
�valuer par des �tudes de cas l'impact social de nos productions
Bien que l'ONF n'ait pas fait d'�tudes de cas sp�cifiques sur l'impact social de l'ensemble de ses productions en 2006-2007, plusieurs initiatives et œuvres audiovisuelles de l'ONF ont eu des r�percussions notables sur les communaut�s vis�es par ces projets ou films.
Tales from Bridgeview
L'ONF et l'Initiative de revitalisation des quartiers ont d�velopp� conjointement un projet communautaire de vid�o num�rique : Tales from Bridgeview. Ce projet pilote regroupait cinq courts m�trages num�riques cr��s par sept �l�ves de l'�cole �l�mentaire Bridgeview sous l'œil avis� de Nettie Wild, l'une des plus �minentes cin�astes du Canada. Tales from Bridgeview a mis le pouvoir des m�dias et la force du r�cit au service du d�veloppement de la collectivit�.
Anime tes clics
Gr�ce � l'appui du Fonds M�moire canadienne, l'ONF a utilis� l'Ann�e McLaren comme un pr�texte pour interpeller les artistes en herbe � l'occasion du lancement du site Objectif Animation. Dans le cadre du concours Anime tes clics!, pr�s d'un millier de jeunes Canadiennes et Canadiens �g�s de 9 � 20 ans se sont initi�s � la technique de la pixilation, ch�re au ma�tre. Cent soixante-dix d'entre eux ont soumis une œuvre originale, � la mani�re de McLaren et sur des musiques qu'il a compos�es, qu'ils ont cr��e � l'aide d'un appareil photo num�rique ou d'un cellulaire.
I was here - Cin�aste en r�sidence
L'initiative Cin�aste en r�sidence, en plus d'�tre un projet soci�tal innovateur, a aussi g�n�r� le projet I was here, dans le cadre duquel sept jeunes femmes, enceintes ou m�res depuis peu, et qui toutes ont d�j� v�cu dans la rue, ont re�u des cam�ras num�riques et un site personnel de blogage photo pour documenter leur vie quotidienne � Toronto. Ces r�sultats remarquables ont entre autres pris la forme d'une expo photo, lanc�e � l'h�tel de ville de Toronto en pr�sence du maire.
3. Intensifier la pr�sence de l'ONF dans les communaut�s, � la t�l�vision et dans les r�seaux d'apprentissage.
R�sultat pr�vu :
Assurer une pr�sence soutenue des productions de l'ONF dans les divers r�seaux communautaires et �ducatifs au Canada;
Indicateurs :
- Mesurer l'assistance aux projections de films et aux r�trospectives de l'ONF
- �valuer le programme d'adh�sion
R�sultat pr�vu :
Assurer une pr�sence soutenue des productions de l'ONF dans les divers r�seaux communautaires et �ducatifs au Canada;
Indicateurs :
Mesurer l'assistance aux projections de films et aux r�trospectives de l'ONF
En vertu d'un partenariat avec la Ville de Montr�al, l'ONF a offert en 2006 une nouvelle saison de 23 projections gratuites, dont dix-sept soir�es documentaires souvent pr�c�d�es de films d'animation et six s�ances pour enfants, dans les Maisons de la culture Ahuntsic, C�te-des-Neiges, Montr�al-Nord, Notre-Dame-de-Gr�ce, Plateau Mont-Royal, Pointe-aux-Trembles, Rosemont-La-Petite-Patrie, Saint-Laurent et Verdun-Ile-des-Sœurs. La majorit� de ces programmes se d�roulait en pr�sence de cin�astes, d'artisans ou d'invit�s sp�ciaux venus �changer avec le public apr�s chaque projection. Un autre partenariat, cette fois-ci avec YWCA Canada, a permis de faire la promotion de la collection de l'ONF aupr�s de l'ensemble des organisations membres : douze d'entre elles ont tenu des projections publiques et priv�es de ses films � l'occasion de la Semaine sans violence, organis�e en octobre de chaque ann�e par l'organisation pour lutter contre la violence faite aux femmes.
Dans le cadre du concours national Mettons fin au racisme, organis� par Patrimoine canadien, l'ONF a con�u et donn� des s�minaires d'initiation au traitement vid�o aux enseignants int�ress�s � mobiliser leur classe autour du concours. Ces s�ances de formation ont imm�diatement enthousiasm� les professeurs participants. Cette ann�e, les ateliers ont �t� restructur�s pour que les participants se familiarisent � la fois avec les aspects techniques de la production, et la fa�on d'aborder les questions relatives au racisme avec les �tudiants. Au total, dix-sept ateliers d'une demi-journ�e (dont trois en fran�ais � Winnipeg, Montr�al et Moncton), ont �t� donn�s � travers le pays par trois facilitateurs de haut niveau, � quelque 250 professeurs d'�l�ves des 5e et 6e ann�es du primaire et du cours secondaire. Des �l�ves plus �g�s ont �galement particip� � ces formations pour devenir ensuite des leaders du projet au sein de leur classe. Produits par l'ONF, le Guide de l'animateur qui sugg�re aux professeurs diff�rentes fa�ons d'aborder le sujet en classe et le Manuel de ressources techniques ax�es sur la production vid�o, utilis�s durant les ateliers, sont d�sormais disponibles gratuitement sur son site Internet.
Le nombre de films soumis cette ann�e (319 au total), la qualit� des dix œuvres laur�ates, qui seront diffus�es toute l'ann�e par Radio-Canada/CBC, mais aussi les nombreux t�moignages re�us des professeurs participants ont confirm� le bien-fond� de la d�marche. Immens�ment populaires aupr�s des enseignants, le Guide et le Manuel de l'ONF sont aujourd'hui utilis�s dans d'autres contextes, notamment dans les cours d'�ducation aux m�dias.
�valuer le programme d'adh�sion
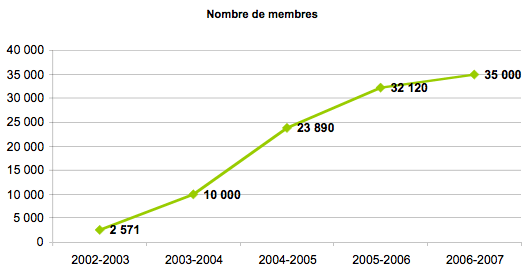
Le programme d'adh�sion au Cin�club ONF permet aux amateurs de l'ONF de devenir membres et de recevoir les derni�res nouvelles de l'ONF par courriel, de b�n�ficier de tarifs sp�ciaux pour l'achat de certains titres de l'ONF, de recevoir des invitations � des �v�nements organis�s par l'Office (lancements, classes de ma�tre, etc.) et d'avoir acc�s � Cin�Route sur Internet. En 2006-2007, le Cin�club comptait 35 000 membres, soit une hausse de 3000 cin�philes en un an.
4. Multiplier les occasions de faire rayonner l'image de marque de l'ONF au Canada et � l'�tranger.
R�sultat pr�vu :
Augmenter la couverture de presse et la visibilit� de l'ONF dans les m�dias.
R�sultat pr�vu :
Augmenter la couverture de presse et la visibilit� de l'ONF dans les m�dias.
En 2006-2007, l'ONF a poursuivi la consolidation de son image de marque en s'assurant que l'ensemble des facettes de ses activit�s de production, de distribution, d'acc�s et de d�veloppement des r�seaux, tout comme celles li�es � la recherche, obtiennent la visibilit� � laquelle elles ont droit. L'ONF a pris une approche plus globale pour la promotion des productions � venir, afin de s'assurer que les Canadiennes et Canadiens reconnaissent les productions de l'ONF et qu'ils puissent en tirer le meilleur parti selon leurs int�r�ts. Cette nouvelle approche est particuli�rement pertinente dans un contexte de changements technologiques qui bouleversent l'environnement. C'est d'ailleurs pour renforcer sa pr�sence et permettre un meilleur acc�s � ses productions que l'ONF s'est dot� d'une direction du marketing et des communications au cours de la derni�re ann�e. D�j�, en 2006-2007, la nouvelle orientation de la direction du marketing et communications a permis de bonifier et d'enrichir les relations que l'ONF entretient avec de nombreux partenaires, pour le plus grand b�n�fice des Canadiens, des Canadiennes et des spectateurs d'un peu partout dans le monde.
Le remarquable succ�s des nombreux �v�nements, au Canada et dans le monde, organis�s � l'occasion de l'Ann�e McLaren illustre le potentiel d'une telle approche. Les excellentes relations que l'ONF entretient avec les responsables du Festival de Cannes ont permis que le coup d'envoi international de ces c�l�brations soit donn� en mai, lors de la pr�sentation de treize de ses œuvres remasteris�es dans le cadre de Cannes Classics. C'est � Montr�al, dans le cadre du Festival du nouveau cin�ma, qu'� eu lieu la premi�re canadienne de l'Int�grale de l'œuvre du c�l�bre animateur. En tout, six villes canadiennes ont accueilli des r�trospectives Norman McLaren et ont offert des activit�s sp�ciales, soit : Montr�al, Halifax, Calgary, Ottawa, Vancouver et Winnipeg. C'est au Centre Pompidou, � Paris, qu'a eu lieu la premi�re internationale. Dans la seule capitale fran�aise, plus de 2500 personnes ont assist� aux projections et particip� aux ateliers organis�s durant les trois semaines qu'a dur� l'�v�nement. La tourn�e McLaren a ensuite travers� - entre autres - Londres, Milan, Turin, Rome, Bruxelles, Berlin, suscitant partout des �v�nements sp�ciaux et les commentaires �logieux des m�dias. Tandis que les spectateurs canadiens d�couvraient ou retrouvaient � leur tour l'œuvre embl�matique du cin�aste, de New York � Los Angeles en passant par Washington, Chicago et Denver, les Am�ricains ont aussi accueilli les films de McLaren avec enthousiasme. Au terme de cette tourn�e, des milliers de personnes avaient assist� � des projections ou particip� � des ateliers portant sur divers aspects du travail du grand cin�aste.
Activit� de programme 4 : Services de recherche et de conseil
L'ONF a pour mandat de � faire des recherches sur les activit�s filmiques � et d'en rendre les r�sultats disponibles ainsi que de � conseiller (...) en mati�re d'activit�s filmiques. �. L'activit� � recherche et conseil � s'entend de la recherche li�e � la r�alisation cin�matographique et � l'industrie du film ainsi que de la conduite de projets techniques et de d�veloppement visant � faire progresser l'art et la science du cin�ma. Depuis toujours, l'ONF cr�e un milieu propice � l'excellence et � l'innovation, un milieu qui favorise l'incubation et le prototypage de nouveaux projets, la collaboration avec l'industrie et l'ouverture de nouvelles voies vers la cr�ativit� dans le domaine audiovisuel.
| RMR 2006-2007 (selon l'AAP) | |
| Activit� de programme 4 | Priorit�s |
| Services de recherche et de conseil |
|
Ressources financi�res en milliers de dollars
| D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles |
| 3 640 | 3 656 | 6 847 |
Ressources humaines
| Pr�vues | Autorisations | R�elles |
| 70 | 70 | 95 |
Les priorit�s
1. Maintenir, favoriser et accro�tre les initiatives de recherche et d�veloppement afin de repositionner l'ONF comme chef de file, avec ses partenaires et dans le milieu cin�matographique canadien.
R�sultat pr�vu :
Un effort appr�ciable de recherche et d�veloppement des techniques et de la technologie en audiovisuel;
Indicateurs :
- Le d�veloppement et la mise en œuvre d'un plan de recherche annuel
- Le nombre de collaboration et de partenariats de recherche en tant que site-pilote et incubateur de recherche et d�veloppement
R�sultat pr�vu :
Un effort appr�ciable de recherche et d�veloppement des techniques et de la technologie en audiovisuel;
D�s ses d�buts, l'ONF a �t� un incubateur d'innovation technologique et cin�matographique tant sur la sc�ne nationale qu'internationale. Fid�le � sa tradition, il a toujours �t� une organisation pionni�re qui explore les fronti�res de la cin�matographie. En plus de conseiller le gouvernement et l'industrie, il entreprend �galement des projets techniques et de d�veloppement pour faire avancer l'art et la science cin�matographiques. Ses activit�s s'inscrivent dans un cadre vou� � l'excellence et � l'innovation propice � l'av�nement et au prototypage.
Indicateur :
Le nombre de collaboration et de partenariats de recherche en tant que site-pilote et incubateur de recherche et d�veloppement
L'ONF fait partie du R�seau E-Inclusion dont l'objectif est de fournir aux cr�ateurs d'œuvres audiovisuelles des outils puissants leur permettant de se concentrer sur les aspects de cr�ation et ainsi d'am�liorer la richesse de l'exp�rience multim�dia pour les personnes ayant une d�ficience sensorielle. Ce R�seau vise � d�velopper des outils de traitement de contenu audiovisuels et des m�thodes de cr�ation de contenu sp�cifiques aux sens pour les producteurs multim�dias. Dans le cadre d'un projet de recherche sur la vid�odescription visant � d�terminer les types d'information utiles pour les personnes vivant avec une d�ficience visuelle et afin d'�tablir une typologie d'�l�ments informationnels utiles pour la compr�hension de l'image en mouvement, quatre sessions interactives d'�coute de description vid�o ont eu lieu. Le but de ces sessions �tait d'�valuer le travail en cours dans l'�laboration de VD ainsi que l'impact de cette narration sur l'appr�ciation des films ONF. La vid�odescription consiste � offrir une description orale des �l�ments visuels cl�s d'un film, de telle sorte que les personnes vivant avec un handicap visuel peuvent concevoir une imagerie mentale en rapport avec le d�roulement des images � l'�cran.
Afin de favoriser des synergies fructueuses avec les institutions sp�cialis�es du monde de l'�ducation, l'ONF a sign� en juin dernier des ententes de partenariat avec l'�cole des m�dias de la Facult� de communication de l'UQAM et l'Institut national de l'image et du son (INIS) gr�ce auxquelles les �tudiants de ces deux institutions ont entre autres acc�s aux technologies de pointe dont l'ONF dispose dans ses bureaux de Montr�al. L'entente pr�voit aussi que l'ONF, l'INIS et l'UQAM examineront �galement la possibilit� pour l'ONF d'offrir des programmes de perfectionnement professionnel comme des ateliers de ma�tre aux �tudiants de l'INIS et des cours de postproduction � ceux de l'UQAM.
2. Mener des projets de recherche et participer � d'autres projets.
R�sultat pr�vu :
Maintenir l'ONF comme �tant le point de r�f�rence en cin�matographie;
Indicateurs :
- Le nombre de collaboration et de partenariats de recherche en tant que site-pilote et incubateur de recherche et de d�veloppement
- L'�valuation et l'utilisation des r�sultats de ses recherches
- La diffusion et l'utilisation des r�sultats de ses recherches
R�sultat pr�vu :
Maintenir l'ONF comme �tant le point de r�f�rence en cin�matographie;
L'ONF contribue au d�veloppement de nouvelles technologies dans le domaine de l'audiovisuel. Le savoir-faire de son personnel technique est reconnu par tous et fait l'envie de ses partenaires d'ici et d'ailleurs. L'excellence de ce secteur permet � l'Office d'accompagner ses nombreux collaborateurs dans leur recherche cin�matographique, que ce soit en production, en distribution ou pour l'accessibilit� � sa collection. De plus, il permet d'aider les nouveaux talents � acqu�rir une expertise durable et essentielle � leur d�veloppement. L'obtention de son 12e Oscar� pour le court m�trage d'animation, Le Po�te danois, confirme la r�putation d'excellence que l'ONF s'est forg�e � l'�chelle nationale et internationale au cours des ann�es.
Le nombre de collaboration et de partenariats de recherche en tant que site-pilote et incubateur de recherche et de d�veloppement
En f�vrier de cette ann�e, l'ONF a lanc� le D�fi Multim�dia ONF, ouvert uniquement aux producteurs canadiens. Directement inspir�s du programme Soci�t� nouvelle/Challenge for Change, les projets admissibles doivent �tre fond�s sur des concepts multiplateformes et mener � l'engagement de l'utilisateur par le biais d'une utilisation novatrice des r�seaux et des dispositifs num�riques. Le projet gagnant, qui b�n�ficiera d'une entente de d�veloppement avec l'ONF, sera d�voil� au Festival mondial de t�l�vision de Banff, en juin 2007.
3. Collaborer davantage avec le gouvernement et d'autres organismes.
R�sultat pr�vu :
Maintenir l'ONF comme �tant le point de r�f�rence en cin�matographie;
Indicateurs :
- Le nombre et le type de collaboration avec le secteur public et ses r�percussions
R�sultat pr�vu :
Maintenir l'ONF comme �tant le point de r�f�rence en cin�matographie;
Depuis sa cr�ation, en 1939, l'ONF a �tabli une tradition d'excellence cin�matographique reconnue tant au Canada que dans le reste du monde. Sa collection de pr�s de 12 000 titres en fait le plus important d�positaire de films canadiens. Au fil des ans, l'ONF a remport� plus de 5 000 prix � l'�chelle nationale et internationale, dont 90 prix G�nie, 69 mises en nomination � l'Academy Awards et 12 Oscars� �€” 11 pour des films et un pour l'ensemble de ses r�alisations � titre de producteur et de distributeur �€”, deux Palmes d'or � Cannes et un Ours d'or � Berlin. D�s ses d�buts, l'ONF a �t� au cœur du d�veloppement de la cin�matographie canadienne; il a jou� un r�le-cl� en �tant un incubateur de nouveaux talents et un lieu d'exp�rimentation. � son apog�e, ses artistes et artisans ont �t� louang�s pour avoir invent� un nouveau langage cin�matographique.
L'�tablissement de partenariat joue un r�le-cl� dans la r�ussite du mandat de l'ONF tout en permettant d'�largir son champ d'activit�s. L'Office s'est donn� pour strat�gie de d�velopper des partenariats en production, en distribution, en diffusion de m�me qu'en formation.
Indicateur :
Le nombre et le type de collaboration avec le secteur public et ses r�percussions
En 2006-2007, l'ONF a entrepris de nombreuses initiatives en collaboration avec diff�rents partenaires de l'industrie cin�matographique, dont notamment l'�tude The Case for Kids Programming en collaboration avec l'Association canadienne des producteurs de films et de t�l�vision. L'Office a �galement renforc� ses liens avec divers organismes du gouvernement f�d�ral, dont T�l�film Canada et Radio-Canada gr�ce � des initiatives conjointes telles que le Concours PICLO et le Fonds du long m�trage documentaire. Plusieurs programmes incluent diff�rents partenaires. Dans l'Atlantique, c'est le cas d'AnimAcadie (ONF, Connections Productions, T�l�vision fran�aise de Radio-Canada en Atlantique, Film Nouveau-Brunswick), ouvert aux sc�naristes et d'Inspired (ONF, CTV, IFC Canada et Festival du film de l'Atlantique), qui offrent une formation et des services de production aux documentaristes de la rel�ve, selon un mod�le semblable � celui du NFB-TVO Documentary Calling Card en Ontario. Les succ�s de First Stories, dans les provinces de l'Ouest et du Wapikoni mobile au Qu�bec (avec les Productions les beaux jours, de Manon Barbeau) ont contribu� � la mise sur pied de Yukon V�rit�, un programme de mentorat de l'ONF et de la Yukon Film Society, et du tout nouveau Nunavut Animation Lab qui, outre l'ONF, comprend pas moins de six partenaires. Autre nouveaut� cette ann�e, l'ONF a mis sur pied Open I, un programme de mentorat en vid�o num�rique destin� aux jeunes personnes vivant avec un handicap, qui met � contribution des cin�astes handicap�s du projet AccessNFB, des moniteurs de la Pacific Cinematheque et des conseillers jeunesse, en aidant de jeunes cin�astes � raconter leur propre histoire. Toujours dans un souci d'int�gration des personnes handicap�es dans le milieu de l'audiovisuel, l'ONF et l'ACPFT ont conclu une entente de partenariat dans le but d'offrir un programme de stages en cr�ation m�diatique. Cette initiative offre � des Canadiennes et Canadiens handicap�s - cin�astes, producteurs et autres - une formation en cours d'emploi.
Enfin, l'ONF a �t� un acteur de tout premier plan au Forum urbain mondial d'ONU-Habitat, dont le Canada �tait l'h�te en juin 2006. Trente ans apr�s avoir jou� un r�le tout aussi important lors du premier Forum, en 1976, sa participation, pilot�e par le Programme anglais, comprenait cette fois sept volets et la signature d'un protocole d'entente sur les collaborations futures entre l'ONF et ONU-Habitat. Du c�t� environnemental, l'ONF participe activement au projet Greencode qui vise � d�velopper un code environnemental pour l'industrie des m�dias. Cette initiative regroupe divers partenaires des secteurs priv�s et publics � l'�chelle nationale et internationale.
SECTION III - RENSEIGNEMENTS SUPPL�MENTAIRES
Renseignements sur l'organisation
L'ONF est redevable au Parlement par l'entremise de la ministre du Patrimoine canadien.
Structure organisationnelle

Gestion et administration de l'ONF
Gouvernance et responsabilit�
L'Office national du film a �t� cr�� en 1939 par une loi du parlement. En plus de la Loi sur le Cin�ma, l'ONF est assujetti � la Loi sur la gestion des finances publiques, une loi qui �tablit l'administration financi�re du gouvernement du Canada et des agences f�d�rales. L'ONF est �galement r�gi par la Loi sur l'acc�s � l'information, par la Loi sur la protection des renseignements personnels et par la Loi sur les langues officielles.
� titre d'agence culturelle f�d�rale, l'ONF rend compte au Parlement par le biais de la ministre de Patrimoine canadien. La ministre, pour sa part, a conf�r� au conseil d'administration de l'ONF le pouvoir de superviser le rendement g�n�ral de l'Office. Le conseil d'administration de l'ONF est responsable des affaires de l'Office et joue un r�le crucial qui consiste � assurer la bonne ex�cution des politiques f�d�rales au nom du gouvernement du Canada. Le conseil d'administration apporte un leadership et une orientation � l'Office, fournit des conseils judicieux, approfondis et opportuns et analyse et �tablit l'orientation g�n�rale et strat�gique de l'Office. Le commissaire du gouvernement � la cin�matographie occupe la fonction de pr�sident. Six membres repr�sentant la population canadienne mettent leur expertise au profit du conseil et le directeur g�n�ral de T�l�film Canada est un membre d'office du conseil.
L'ONF a un v�rificateur interne dont les activit�s rel�vent directement du conseil d'administration de l'ONF. De plus, Le Bureau du V�rificateur g�n�ral (BVG) agit � titre de v�rificateur externe de l'ONF. Une fois par an, le BVG examine les �tats financiers de l'ONF afin de d�terminer s'ils sont exacts et conformes aux autorisations.
Priorit�s
L'ONF maintient des pratiques d'affaires qui favorisent la bonne gouvernance, l'imputabilit� et assure le lien de confiance avec la population canadienne. Il s'est assur� que toutes ses activit�s respectent ou exc�dent les plus hauts standards dans ces domaines. Pour y parvenir, L'ONF s'est donn� les priorit�s suivantes :
- G�rer les ressources de mani�re efficace et efficiente en faisant les �valuations et v�rifications pertinentes.
- Am�liorer la responsabilisation, les pratiques commerciales et les syst�mes d'information.
Pour y arriver, nous avons mis en place une culture d'entreprise moderne o� la transparence, la bonne gouvernance, l'imputabilit� et la responsabilisation dans l'ensemble de l'organisation sont des �l�ments essentiels d'une gestion efficace et efficiente.
Producteur et distributeur d'un contenu culturel qui n�cessite des droits d'auteur importants, l'ONF s'est dot� d'un syst�me �lectronique de gestion du droit d'auteur (SEGDA). D�but� en 2003-2004, le syst�me est maintenant op�rationnel. Nous enrichissons cet outil continuellement par l'int�gration de nos bases de donn�es historiques.
De plus, nous avons am�lior� les syst�mes de production, de distribution et d'administration de mani�re � remplir les objectifs de l'ONF, qui consistent � produire des œuvres audiovisuelles de grande qualit� et � les rendre accessibles au plus large auditoire possible. Par exemple :
- L'ONF perfectionne constamment son syst�me de gestion int�gr�e de l'information et du savoir Synchrone. Un poste de gestionnaire de l'information a �t� cr�� en 2005-2006 pour favoriser une meilleure collecte et une meilleure utilisation de l'information disponible � l'ONF.
- Afin de mesurer la performance de l'ensemble de ses activit�s, depuis deux ans, l'ONF a d�velopp� de nouveaux indicateurs de rendement. En 2005-2006, nous avons termin� le volet financier de ces indicateurs. Un comit� des indicateurs de performance pour les diverses auditoires de l'ONF (Web, t�l�, consommateurs et institutionnels, visionnement public) a �t� mis en place et des indicateurs de performance pour les auditoires devraient �tre implant�s au cours de l'ann�e 2007-2008.
- L'ONF a �galement �labor� un nouveau Plan de v�rification interne de m�me qu'un cadre de gestion int�gr�e des risques et de gestion des renseignements personnels. Par exemple, nous avons revu les proc�dures li�es � la d�l�gation d'autorisation, particuli�rement pour la distribution. De plus, nous avons termin� une v�rification sur les coproductions internationales.
- L'ONF a �galement fait des �valuations cette ann�e, qui concernait les partenariats et les activit�s de l'ONF en court m�trage.
L'ONF s'efforce de maintenir les co�ts administratifs au plus bas niveau possible. Ces derni�res ann�es, il est parvenu � les maintenir � un niveau se situant aux environs de 10 % de son budget.
Cette ann�e encore, l'ONF a utilis� les fonds publics consciencieusement en respectant les plus hauts standards de transparence, de bonne gouvernance et d'imputabilit�. Nous nous sommes assur�s de tirer le maximum de valeur de nos activit�s pour les Canadiens et les Canadiennes.
LOI APPLIQU�E PAR LE PORTEFEUILLE
Loi sur le cin�ma, S.R.C.1985, ch. N-8.
(La derni�re modification est entr�e en vigueur en 2002.)
BUREAUX DE L'OFFICE NATIONAL DU FILM
Si�ge social : Ottawa
Bureau central : Montr�al
Distribution au Canada
- Cin�Roboth�que - Montr�al
- M�diath�que - Toronto
- Centre des appels (1 800 267-7710)
- Site Web (www.onf.ca)
Distribution � l'�tranger
- �tats-Unis (New York)
- Europe (Paris)
Centres de production anglaise
- Edmonton
- Halifax
- Montr�al
- Toronto
- Vancouver
- Winnipeg
Centres de production fran�aise
- Moncton
- Montr�al
- Toronto
- Qu�bec
LISTE DES PERSONNES-RESSOURCES POUR LE RAPPORT MINIST�RIEL SUR LE RENDEMENT
Luisa Frate
Directrice, Administration,c.a.
(514) 283-9050
l.frate@onf.ca
Deborah Drisdell
Directrice, Planification strat�gique et relations gouvernementales
(514) 283-3242
d.drisdell@onf.ca
| Tableau | Titre | Inclus / Sans objet |
| Tableau 1 | Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles (�quivalents temps plein compris) | Inclus |
| Tableau 2 | Ressources par activit� de programme | Inclus |
| Tableau 3 | Postes vot�s et l�gislatifs | Inclus |
| Tableau 4 | Services re�us � titre gracieux | Sans objet |
| Tableau 5 | Pr�ts, investissements et avances (non budg�taires) | Sans objet |
| Tableau 6 | Sources de revenus disponibles et non disponibles | Inclus |
| Tableau 7 | Fonds renouvelable (�tat des op�rations, �tat des mouvements de tr�sorerie et Utilisation pr�vue des autorisations) | Inclus |
| Tableau 8 | Besoins en ressources par direction ou secteur | Sans objet |
| Tableau 9 |
Frais d'utilisation
|
Sans objet |
| Tableau 10 | Progr�s accomplis au regard du plan de r�glementation du minist�re | Sans objet |
| Tableau 11 | Renseignements sur les d�penses de projets | Sans objet |
| Tableau 12 | Rapport d'�tape sur les grands projets de l'�tat | Sans objet |
| Tableau 13 | Renseignements sur les programmes de paiements de transfert (PPT) | Inclus |
| Tableau 14 | Subventions conditionnelles (fondations) | |
| Tableau 15 | �tats financiers des minist�res et organismes ( y compris les agents du Parlement) et �tats financiers du fonds renouvelable | Inclus |
| Tableau 16 | R�ponse aux comit�s parlementaires, aux v�rifications et aux �valuations | Sans objet |
| Tableau 17 | Strat�gie de d�veloppement durable | Sans objet |
| Tableau 18 | Approvisionnement et march�s | Sans objet |
| Tableau 19 | Service centr� sur le client | Sans objet |
| Tableau 20 | Initiatives horizontales | Sans objet |
| Tableau 21 | Politiques concernant les voyages | Sans objet |
| Tableau 22 | R�servoirs de stockage | Sans objet |
Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles (�quivalents temps plein compris)
| (En milliers de dollars) | 2004-05 D�penses r�elles | 2005-06 D�penses r�elles | 2006-2007 | |||
| Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles | |||
| Production | 46 891 | 47 337 | 47 103 | 47 103 | 50 890 | 45 847 |
| Distribution | 1 913 | 1 171 | 2 370 | 2 370 | 2 391 | 3 134 |
| Accessibilit� | 12 325 | 12 660 | 11 726 | 11 726 | 14 284 | 12 608 |
| Recherche | 3 781 | 3 943 | 3 640 | 3 640 | 3 656 | 6 847 |
| Total | 64 910 | 65 111 | 64 839 | 64 839 | 71 221 | 68 436 |
| Moins : revenus non disponibles | - | - | - | - | - | - |
| Plus : co�t des services re�us � titre gracieux | - | - | - | - | - | - |
| Total des d�penses minist�rielles | 64 910 | 65 111 | 64 839 | 64 839 | 71 221 | 68 436 |
| �quivalents temps plein | 498 | 498 | 500 | 500 | 500 | 486 |
Tableau 2 : Ressources par activit� de programme
En milliers de dollars
| 2006-2007 | |||||||||
| Activit� de programme | Budg�taire | Plus : Non-budg�taire | Total | ||||||
| Fonctionnement | Immobilisations | Sub-ventions | Contributions et autres paiements de transfert | Total : D�penses budg�taires brutes | Moins : Revenus disponibles | Total : D�penses budg�taires nettes | Pr�ts, investissements et avances | ||
| Production | |||||||||
| Budget principal | 49 231 | - | - | 151 | 49 382 | 2 279 | 47 103 | - | 47 103 |
| D�penses pr�vues | 49 231 | - | - | 151 | 49 382 | 2 279 | 47 103 | - | 47 103 |
| Total des autorisations | 52 993 | - | - | 176 | 53 169 | 2 279 | 50 890 | - | 50 890 |
| D�penses r�elles | 46 508 | - | - | 170 | 46 678 | 831 | 45 847 | - | 45 847 |
| Distribution | |||||||||
| Budget principal | 8 217 | - | - | - | 8 217 | 5 847 | 2 370 | - | 2 370 |
| D�penses pr�vues | 8 217 | - | - | - | 8 217 | 5 847 | 2 370 | - | 2 370 |
| Total des autorisations | 8 238 | - | - | - | 8 238 | 5 847 | 2 391 | - | 2 391 |
| D�penses r�elles | 8 385 | - | - | 6 | 8 391 | 5 257 | 3 134 | - | 3 134 |
| Accessibilit� | |||||||||
| Budget principal | 11 853 | - | - | 99 | 11 952 | 226 | 11 726 | - | 11 726 |
| D�penses pr�vues | 11 853 | - | - | 99 | 11 952 | 226 | 11 726 | - | 11 726 |
| Total des autorisations | 14 374 | - | - | 136 | 14 510 | 226 | 14 284 | - | 14 284 |
| D�penses r�elles | 12 934 | - | - | 136 | 13 070 | 462 | 12 608 | - | 12 608 |
| Recherche | |||||||||
| Budget principal | 3 823 | - | - | - | 3 823 | 183 | 3 640 | - | 3 640 |
| D�penses pr�vues | 3 823 | - | - | - | 3 823 | 183 | 3 640 | - | 3 640 |
| Total des autorisations | 3 839 | - | - | - | 3 839 | 183 | 3 656 | - | 3 656 |
| D�penses r�elles | 6 927 | - | - | - | 6 927 | 80 | 6 847 | - | 6 847 |
Tableau 3 : Postes vot�s et l�gislatifs
En milliers de dollars
| Poste vot� ou l�gislatif | Libell� tronqu� du poste vot� ou l�gislatif | 2006-2007 | |||
| Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles | ||
| 75 | Fonds renouvelable- Office national du film | 64 839 | 64 839 | 71 221 | 68 436 |
| Total | 64 839 | 64 839 | 71 221 | 68 436 | |
Tableau 6 : Sources des revenus disponibles
Revenus disponibles
| (en milliers de dollars) | D�penses r�elles 2004-2005 | D�penses r�elles 2005-2006 | 2006-2007 | |||
| Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles | |||
| Production | 2 467 | 960 | 2 279 | 2 279 | 2 279 | 831 |
| Distribution | 5 260 | 7 173 | 5 847 | 5 847 | 5 847 | 5 257 |
| Accessibilit� | 321 | 534 | 226 | 226 | 226 | 462 |
| Recherche | 189 | 215 | 183 | 183 | 183 | 80 |
| Total des revenus disponibles | 8 237 | 8 882 | 8 535 | 8 535 | 8 535 | 6 630 |
Tableau 7 : Fonds renouvelable - �tat des mouvements de tr�sorerie
| (En milliers de dollars) | D�penses r�elles 2004-2005 | D�penses r�elles 2005-2006 | 2006-2007 | ||
| D�penses pr�vues | Montant autoris� | D�penses r�elles | |||
| Revenus (Cr�dit parlementaire) | 64 910 | 65 111 | 64 839 | 71 221 | 68 436 |
| D�penses nettes | (64 910) | (65 111) | (64 839) | (71 221) | (68 436) |
| Exc�dent (d�ficit) | - | - | - | - | - |
| Ajouter les postes hors tr�sorerie : | - | - | - | - | - |
| D�pr�ciation / amortissement | (3 541) | (3 021) | (2 000) | (2 000) | (2 729) |
| Activit�s de placement | - | - | - | - | - |
| Acquisition de biens amortissables | 1 856 | 2 018 | 2 000 | 2 000 | 3 145 |
| Exc�dent de tr�sorerie (besoin) | (1 685) | (1 003) | - | - | 416 |
| Pouvoir : exc�dent cumulatif (pr�l�vement) | 11 937 | 10 934 | 13 825 | 13 825 | 11 350 |
Tableau 13 : Renseignements sur les programmes de paiements de transfert (PPT)
| Contribution et autres paiements de transfert | ||||||
| (En milliers de dollars) | 7) D�penses r�elles 2004-2005 | 8) D�penses r�elles 2005-2006 | 9) D�penses pr�vues 2006-2007 | 10) Total des autorisations 2006-2007 | 11) D�penses r�elles 2006-2007 | 12) �carts entre 9 et 11 |
| Distribution | - | 5 | - | - | 6 | (6) |
| Accessibilit� | 149 | 162 | 99 | 136 | 136 | (37) |
| Recherche | 1 | - | - | - | - | - |
| Total | 295 | 287 | 250 | 312 | 312 | (62) |
Tableau 15 : �tats financiers des minist�res et agences du gouvernement du Canada (y compris les mandataires du Parlement)
L'ONF pr�pare un rapport annuel qui comprend leurs �tats financiers, qui est d�pos� au Parlement et des �tats financiers qui sont disponibles �lectroniquement au moment du d�p�t des RMR � la Chambre des Communes � l'adresse suivante :
www.onf.ca/publications/fr/rapportannuel/rap2006-2007/ONF-RapportA_06-07.pdf
1 Conseil du Tr�sor, Le rendement Canada 2006 : la contribution du gouvernement du Canada, Ottawa, 2006, p.43
2 Patrimoine canadien, Rapport sur les plans et les priorit�s, Ottawa, 2006, p. 12
3Groupe Nordicit�, Profil 2007 : Rapport �conomique sur la production cin�matographique et t�l�visuelle au Canada, Ottawa, f�vrier 2007.
4Dans le rapport Profil 2007, la valeur d'exportation de la production cin�matographique canadienne se d�finie comme la mesure de l'apport �tranger � l'industrie canadienne de la production. L'expression �valeur d'exportation � est utilis�e de pr�f�rence au terme �exportation�, car elle permet de mieux refl�ter la nature de la production cin�matographique et t�l�visuelle canadienne.
6Garry Sears, William Murray et Deborah Drisdell, La production num�rique au Canada, 2006, p. 9.
7Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53.
8Groupe Nordicit�, Profil 2007 : Rapport �conomique sur la production cin�matographique et t�l�visuelle au Canada, Ottawa, f�vrier 2007
9Note : Incluant Fonds M�moire canadienne, Learn Alberta et Images d'une guerre oubli�e