ARCHIVÉ - Citoyenneté et Immigration Canada
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
2006-2007
Rapport sur le rendement
Citoyennet� et Immigration Canada
L'honorable Diane Finley
Ministre de la Citoyennet� et de l�Immigration du Canada
Table des mati�res
- Message de la ministre
- D�claration de la direction
- Renseignements sommaires
- Contexte op�rationnel
- Priorit�s du Minist�re
- Priorit�s en mati�re de gestion
- Importance capitale des partenariats
Partie 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique
Activit� 1 – Programme d’immigration
Activit� 2 – Programme des r�sidents temporaires
Activit� 3 – R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection
Activit� 4 – Programme de protection des r�fugi�s
Activit� 5 – Programme d’int�gration
Activit� 6 – Programme de citoyennet�
Partie 3 : Information suppl�mentaire
A. Organigramme
- Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et r�elles, y compris les ETP
- Tableau 2 : Ressources par activit� de programme
- Tableau 3 : Postes budg�taires vot�s et l�gislatifs
- Tableau 4 : Services re�us sans frais
- Tableau 5 : Pr�ts, investissements et avances (non budg�taires)
- Tableau 6 : Sources de recettes non disponibles
- Tableau 7-A : Frais d’utilisation
- Tableau 7-B : Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation
- Tableau 8 : Progr�s par rapport au plan de r�glementation du Minist�re
- Tableau 9 : Rapport d’�tape sur les grands projets de l’�tat
- Tableau 10 : Renseignements sur les programmes de paiement de transfert (PPT)
- Tableau 11 : �tats financiers
- Tableau 12 : R�ponse aux comit�s parlementaires, v�rifications et �valuations
- Tableau 13 : Strat�gie de d�veloppement durable (SDD)
- Tableau 14 : Service centr� sur le client
- Tableau 15 : Politique sur les voyages
Partie 5 : Autres sujets d’int�r�t
- Syst�me mondial de gestion des cas (SMGC)
- Recherche
- �valuation
- Metropolis
- Analyse comparative entre les sexes � CIC
- Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto (IRSRT)
Partie 1 : Survol
Message de la ministre
Je suis heureuse de pr�senter au Parlement le Rapport minist�riel sur le rendement de Citoyennet� et Immigration Canada (CIC) pour 2006-2007.
Depuis que je suis ministre de la Citoyennet� et de l’Immigration, CIC a pris d’importantes mesures pour faire en sorte que le syst�me d’immigration canadien fonctionne bien et respecte la tradition humanitaire du Canada. En ma qualit� de ministre, je m’efforce de veiller � ce que le programme d’immigration r�ponde aux besoins du pays de fa�on juste et transparente, tout en respectant la primaut� du droit et en prot�geant la sant� et la s�curit� des Canadiens.
Avec le quart de million de personnes qui arrivent au Canada chaque ann�e � titre d’immigrants, et le million de plus, environ, qui vient dans notre pays pour le visiter, y �tudier ou y travailler temporairement, il ne fait aucun doute que notre grand pays constitue une destination de choix.
Notre pays tire profit des comp�tences et de l’enthousiasme des nouveaux arrivants. Pour veiller � ce que le Canada poss�de les gens et les comp�tences dont il a besoin pour prosp�rer au XXIe si�cle, il faut utiliser de fa�on optimale les ressources humaines � notre disposition. Afin de maximiser les avantages sociaux, culturels et �conomiques qu’offrent les nouveaux arrivants � nos collectivit�s, CIC a lanc� un certain nombre d’importants projets visant � aider les nouveaux arrivants � r�ussir leur int�gration et � combler les besoins du march� du travail.
Pour ce faire, nous avons pr�vu 1,3 milliard de dollars suppl�mentaires en fonds pour l’�tablissement au cours des cinq prochaines ann�es, en vue d’aider les nouveaux arrivants � am�liorer leurs connaissances linguistiques et � trouver du travail et du soutien familial. Nous avons conclu un accord g�n�ral avec l’Ontario sur les responsabilit�s de chacun en mati�re d’immigration; celui-ci permettra aux nouveaux arrivants de b�n�ficier d’un meilleur syst�me au bout du compte. Nous avons �galement sign� un nouvel Accord de collaboration Canada-Alberta en mati�re d’immigration. Cet accord aidera l’Alberta � obtenir plus rapidement des immigrants et veillera � ce que nos programmes d’immigration r�pondent aux besoins de la province et des nouveaux arrivants.
De concert avec nos partenaires provinciaux et territoriaux, nous avons donn� suite � notre engagement d’am�liorer l’�valuation et la reconnaissance des titres de comp�tences �trangers en ouvrant le Bureau d’orientation relatif aux titres de comp�tences �trangers. Ce nouveau bureau dirige les nouveaux arrivants vers les renseignements et les services dont ils ont besoin pour obtenir leur reconnaissance professionnelle tant au Canada, dans le cas des nouveaux arrivants qui sont d�j� au pays, qu’� l’�tranger, dans le cas des personnes qui attendent l’occasion de venir au Canada. Le Bureau offre des services d’aiguillage concernant le march� du travail canadien et les processus d’�valuation des titres de comp�tences par l’entremise d’un num�ro 1-800 consacr� � cette fin, des centres de Service Canada � travers le pays (service en personne), d’un site Web et de bureaux � l’�tranger (service en personne).
Pour nous assurer de poss�der les ressources humaines qu’il nous faut, nous avons �galement trouv� des fa�ons de permettre aux employeurs d’obtenir plus facilement, plus rapidement et � moindre co�t les travailleurs dont ils ont besoin. Gr�ce � ces changements, les employeurs n’auront plus � annoncer aussi longtemps et aussi largement qu’auparavant leurs postes avant de pouvoir �tre admissibles � l’embauche d’un travailleur �tranger. Parall�lement, nous avons commenc� � collaborer avec Ressources humaines et D�veloppement social Canada (RHDSC), Service Canada et les provinces et territoires � l’�laboration de nouvelles mesures visant � faire en sorte que les employeurs respectent les conditions du programme.
Nous avons aussi commenc� � mettre en oeuvre une nouvelle solution en mati�re d’immigration pour permettre aux �tudiants �trangers qui poss�dent des titres de comp�tences canadiens et une exp�rience de travail qualifi� au Canada, ainsi qu’aux travailleurs �trangers temporaires qualifi�s qui se trouvent d�j� au Canada, d’obtenir la r�sidence permanente, sous certaines conditions.
Afin de r�pondre aux besoins particuliers des victimes de la traite de personnes, nous avons �labor� des directives � l’intention des agents d’immigration, selon lesquelles les victimes ont droit, sans frais, � un permis de s�jour temporaire qui leur permet de rester au Canada pendant une p�riode allant jusqu’� 120 jours (prolong�e � 180 jours depuis), et de recevoir des prestations pour soins de sant� dans le cadre du Programme f�d�ral de sant� int�rimaire.
Nous avons lanc� une campagne de sensibilisation � l’intention des r�sidents permanents pour leur rappeler qu’ils doivent faire renouveler leur carte tous les cinq ans.
En 2007, nous avons marqu� le 60e anniversaire de la citoyennet� canadienne et avons commenc� � prendre des mesures pour am�liorer les lois qui r�gissent la citoyennet� au Canada. Le projet de loi C-14, qui a re�u la sanction royale, pr�voit des modifications en vue d’�liminer les diff�rences excessives avec lesquelles les enfants n�s � l’�tranger adopt�s par des citoyens canadiens sont trait�s dans la Loi sur la citoyennet�.
Nous avons �galement mis sur pied une campagne d’information du public dans le but de rejoindre les personnes qui ont perdu leur citoyennet�, qui risquent de la perdre ou qui d�sirent �tre r�int�gr�es dans la citoyennet�.
J’ai exerc� les pouvoirs qui me sont conf�r�s, � titre de ministre, par la Loi sur la citoyennet� pour obtenir l’approbation, par l’entremise du gouverneur en conseil, d’attribuer � titre exceptionnel la citoyennet� � des personnes qui ne satisfont pas aux dispositions de la loi en vigueur en ce qui a trait � l’attribution r�guli�re de la citoyennet�, mais dont la situation exige qu’une attention sp�ciale soit port�e � leur cas.
J’ai aussi annonc� mon intention de pr�senter � la Chambre des communes un projet de loi proposant une s�rie de modifications � la Loi sur la citoyennet� pour faire en sorte de r�gler la plupart des questions de citoyennet� pour les personnes dont la citoyennet� a �t� remise en question. Ce projet de loi �liminerait �galement les exigences relatives � la citoyennet� on�reuses et pr�tant � confusion.
De plus, nous avons affermi la r�putation humanitaire du Canada en acceptant de r�installer les personnes ayant le plus besoin de protection, notamment plus de 32 000 r�fugi�s et autres personnes prot�g�es de partout dans le monde. Entre autres, nous nous sommes engag�s � r�installer jusqu’� 5 000 r�fugi�s bhoutanais qui vivent dans des camps au N�pal depuis les ann�es 1990.
Afin de maintenir l’int�grit� de notre syst�me d’immigration, nous avons reconduit l’entente relative � l’�change de renseignements conclue avec les �tats-Unis dans le cadre de la Strat�gie des fronti�res multiples du gouvernement du Canada, en vue d’intercepter les contrevenants �ventuels aux lois sur l’immigration avant leur arriv�e.
Finalement, dans le but constant d’am�liorer le service � la client�le, nous avons apport� des changements aux services �lectroniques offerts dans nos bureaux � l’�tranger pour permettre aux demandeurs �trangers de se renseigner sur l’�tat de leur demande de visa par courriel, peu importe o� ils se trouvent dans le monde. En outre, 71 % des personnes qui ont appel� au T�l�centre ont indiqu� �tre tr�s satisfaites des services re�us.
Ces r�alisations n’auraient pas �t� possibles sans le d�vouement des employ�s de CIC, qui ont mis leur talent et leurs comp�tences � contribution pour faire la promotion du Canada comme le merveilleux pays qu’il est r�ellement. Je tiens � remercier chacun d’entre eux pour leur travail acharn� et leur d�vouement � cet �gard.
L’honorable Diane Finley, C.P., d�put�e
Ministre de la Citoyennet� et de l’Immigration
D�claration de la direction
Je soumets, aux fins de d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement de Citoyennet� et Immigration Canada pour l’exercice 2006-2007.
Ce rapport a �t� pr�par� conform�ment aux principes �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006-2007 : Rapports sur les plans et priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement.
- Il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor;
- Il repose sur les r�sultats strat�giques approuv�s par le Minist�re et l’Architecture d’activit�s de programme approuv�e par le Conseil du Tr�sor;
- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable;
- Il fournit une base pour la reddition de comptes � l’�gard des r�sultats obtenus au moyen des ressources et des pouvoirs attribu�s;
- Il rend compte de la situation financi�re en fonction des chiffres des d�penses pr�vues et des Comptes publics du Canada.
Sign� :______________________________ Date :______________________
Richard B. Fadden
Sous-ministre
Renseignements sommaires
Vision, mission et mandat
Citoyennet� et Immigration Canada (CIC) [note 1] s�lectionne les immigrants et les r�sidents temporaires. Il aide les immigrants � s’�tablir et � s’int�grer – et leur octroie notamment la citoyennet� – tout en offrant la protection du Canada aux r�fugi�s et aux personnes se trouvant dans une situation semblable. CIC �tablit �galement la politique d’admissibilit� du Canada. Il fixe les conditions � respecter pour entrer et demeurer au Canada et filtre les immigrants et r�sidents temporaires de mani�re � prot�ger la sant� des Canadiens et � assurer leur s�curit�. Ce faisant, CIC, en collaboration avec ses partenaires, remplit son r�le dans la d�tection des demandeurs qui pourraient repr�senter des risques pour le Canada pour diverses raisons, notamment li�es � la s�curit�, � la criminalit�, au crime organis� et � la violation des droits humains et internationaux.
CIC compte plus de 4 000 employ�s au Canada et � l’�tranger [note 2] et poss�de 43 points de service au pays et 90 [note 3] dans 77 autres pays.
VISION DE CIC
CIC abordera l’immigration de mani�re � :
- r�pondre aux besoins des collectivit�s de toutes les r�gions du pays en mettant en place des conditions propres � attirer des personnes qui, tout en r�alisant pleinement leur potentiel, contribueront � la vie sociale, �conomique, culturelle et civique du Canada, et voudront en devenir des citoyens;
- appuyer les efforts humanitaires d�ploy�s par la communaut� internationale pour secourir les personnes ayant besoin de protection.
MISSION DE CIC
CIC, de concert avec ses partenaires, b�tira un Canada plus fort en :
- �laborant et en mettant en place des politiques, des programmes et des services qui :
- faciliteront la venue et l’int�gration des personnes de mani�re � optimiser leur apport, tout en prot�geant la sant� des Canadiens et en assurant leur s�curit�;
- perp�tueront la tradition humanitaire du Canada en prot�geant les r�fugi�s et les personnes ayant besoin de protection;
- permettront de renforcer les valeurs associ�es � la citoyennet� canadienne et de promouvoir les droits et les responsabilit�s qui y sont attach�s;
- favorisant l’adoption dans le monde de politiques migratoires qui concourront aux objectifs du Canada dans les domaines humanitaires et de l’immigration.
CIC, cr�� en 1994, regroupe les services d’immigration et de citoyennet� dans le but de promouvoir les id�aux uniques que partagent les Canadiens et de favoriser l’�dification d’un Canada plus fort. CIC tire son mandat de la Loi sur l’immigration et la protection des r�fugi�s (LIPR), aboutissement en 2002 d’une importante r�forme l�gislative, ainsi que de la Loi sur la citoyennet� de 1977. Selon la Loi constitutionnelle de 1867, l’immigration est un domaine de comp�tence partag�e avec les provinces et les territoires.
En raison de restructurations intervenues dans l’administration f�d�rale et dans lesquelles un certain nombre de fonctions cl�s de CIC ont �t� confi�es � l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) [note 4], l’administration de la LIPR est d�sormais une responsabilit� que partagent CIC et l’ASFC. Les organismes doivent travailler de concert pour atteindre et �quilibrer les objectifs du programme d’immigration en mati�re de facilitation et d’ex�cution.
Ressources financi�res (en millions de dollars)
| D�penses pr�vues | 1 148,8 $ | |
| Total des autorisations | 1 183,9 $ | |
| D�penses r�elles | 1 058,6 $ |
Explication des ressources utilis�es : Le total des autorisations comprenait des d�penses pr�vues de 1 148,8 millions de dollars plus 35,1 millions de dollars provenant du Budget suppl�mentaire des d�penses et des exigences r�glementaires suppl�mentaires, y compris les r�gimes d’avantages sociaux des employ�s, pour un total de 1 183,9 millions de dollars.
Les d�penses r�elles �taient de 125,3 millions de dollars inf�rieures au total des autorisations. Cela comprend 84 millions de dollars de fonds approuv�s pour les ann�es ult�rieures par report de fonds. Le solde des exigences r�duites (41,3 millions de dollars) �tait d� principalement � un montant de 21 millions de dollars de fonds d’exploitation mis de c�t� pour �tre report�s � l’exercice suivant, � des d�penses inf�rieures aux pr�visions dans les programmes d’�tablissement et � d’autres fonds g�n�raux d’exploitation non d�pens�s.
Priorit�s du Minist�re
CIC a �tabli les trois priorit�s suivantes pour guider les travaux du Minist�re au cours de l’ann�e 2006-2007 :
- Mettre en oeuvre un cadre strat�gique int�gr�
- Am�liorer le service � la client�le
- B�tir l’effectif de demain
R�sultats strat�giques et activit�s de programme de CIC
Les trois r�sultats strat�giques de CIC d�crivent les r�sultats � long terme que ses programmes visent. L’Architecture des activit�s de programme (AAP) est un cadre �num�rant les programmes et les activit�s du Minist�re tout en indiquant leur lien avec les trois r�sultats strat�giques. L’AAP fournit �galement une base durable pour la pr�sentation de rapports financiers et de rendement au Parlement.
Harmonisation des r�sultats strat�giques du Minist�re avec ceux du gouvernement f�d�ral
Le tableau ci-dessous t�moigne des activit�s de programme de CIC, de leurs lien avec les r�sultats strat�giques et la fa�on dont ils s’harmonisent avec les r�sultats du gouvernement f�d�ral [note 5] :
| R�sultats pertinents du gouvernement f�d�ral | R�sultats strat�giques de CIC | Activit�s de programme gouvernement f�d�ral de CIC |
|---|---|---|
|
�conomique Une croissance �conomique forte |
1. Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement social, culturel et �conomique du Canada |
1. Programme d’immigration 2. Programme des r�sidents temporaires |
|
International Un monde s�curitaire et s�curis� |
2. Prise en compte des valeurs et des int�r�ts canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s |
3. R�le du Canada dans les migrations internationales 4. Programme de protection des r�fugi�s |
|
Social Une soci�t� diversifi�e qui favorise la dualit� linguistique et l’inclusion sociale |
3. Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants et promotion de la citoyennet� canadienne |
5. Programme d’int�gration 6. Programme de citoyennet� |
En f�vrier 2006, on a annonc� une modification au AAP de CIC, qui a �t� approuv�e par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor (SCT) le 22 juin 2006. Ce changement rendait compte du transfert de la responsabilit�, y compris le financement, de l’Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto (IRSRT) au SCT et, par la suite, � Environnement Canada. Comme on peut le constater dans la Partie 2 ci-dessous, il n’y a aucune incidence sur l’affectation des fonds pour les autres r�sultats strat�giques et activit�s de programme de CIC.
�tat du rendement d’apr�s l’Architecture des activit�s de programme [note 6]
| Activit� de programme | R�sultat pr�vu * indicateur |
�tat du rendement |
D�penses pr�vues (en M$) |
D�penses r�elles (en M$) |
|---|---|---|---|---|
| R�sultat strat�gique 1 : Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement social, culturel et �conomique du Canada |
||||
| 1. Programme d’immigration |
Contribution, par l’entremise du programme d’immigration, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada |
Atteint |
197,2 $
|
244,8 $
|
| 2. Programme des r�sidents temporaires | Contribution, par l’entremise du Programme des r�sidents temporaires, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada * Nombre de r�sidents temporaires (traitement sur demande) |
D�pass� |
89,1 $
|
104,9 $
|
| R�sultat strat�gique 2 : Prise en compte des valeurs et int�r�ts canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s |
||||
| 3. R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection | Influence du Canada sur les politiques de la communaut� internationale en mati�re de migration et de protection * Influence sur les politiques internationales en mati�re de migration et de protection |
Atteint |
4,9 $
|
2,8 $
|
| 4. Programme des r�fugi�s | Maintien de la tradition humanitaire du Canada � l’�gard des r�fugi�s et des personnes ayant besoin de protection * Atteinte des objectifs du Plan d’immigration quant au nombre de personnes prot�g�es |
Atteint |
93,7 $
|
84,1 $
|
| R�sultat strat�gique 3 : Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants et promotion de la citoyennet� canadienne | ||||
| 5. Programme d’int�gration | Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants � la soci�t� canadienne dans un d�lai raisonnable; contribution des nouveaux arrivants afin de r�pondre aux besoins de d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada * Int�gration au march� du travail |
Atteint |
675,7 $
|
550,6 $
|
| 6. Programme de citoyennet� | Possibilit� donn�e aux r�sidents permanents admissibles � la citoyennet� de participer pleinement � la vie de la soci�t� canadienne; contribution au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada *Attitudes � l’�gard de la citoyennet� canadienne |
Atteint |
88,2 $
|
71,4 $
|
Contexte op�rationnel
Dans un monde en constante �volution, le programme de l’immigration et de la citoyennet� du Canada sera confront� � de nouveaux enjeux et devra relever de nouveaux d�fis li�s � l’�volution de l’�conomie mondiale, au changement des profils d�mographiques et aux tendances g�opolitiques.
Les facteurs qui ont influ� sur la migration ces derni�res d�cennies sont notamment la croissance de la population, la mondialisation des march�s, les progr�s des technologies de communication, la facilit� des transports et les conditions politiques, �conomiques et sociales, les conflits r�gionaux, de m�me que la d�t�rioration de l’environnement et les catastrophes naturelles. Le Canada a l’un des taux d’immigration permanente per capita les plus �lev�s du monde, soit approximativement 0,7 % par an ces derni�res ann�es, et il a accueilli 3,5 millions d’immigrants au cours des 15 derni�res ann�es.
La croissance de l’�conomie d�pend essentiellement de deux facteurs, � savoir la proportion de la population qui travaille et la productivit� de la main-d’oeuvre. Selon les projections d�mographiques les plus r�centes de Statistique Canada, la population canadienne devrait continuer de cro�tre entre maintenant et 2056, mais sa croissance ralentira progressivement. D’apr�s les tendances actuelles, la population en �ge de travailler, qui d�termine la taille de la population active, augmentera de plus en plus lentement jusqu’en 2020, demeurera stable pendant une d�cennie et ensuite, recommencera � augmenter. Le pourcentage de la population en �ge de travailler, toutefois, diminuera constamment, passant des quelque 70 % actuels � environ 60 % dans les ann�es 2030. Une augmentation du taux de natalit� ou de l’immigration augmenterait probablement la taille de la population active, mais n’aurait qu’une influence marginale sur les taux de participation � court ou � moyen termes.
L’immigration a grandement contribu� au d�veloppement du Canada et constitue depuis toujours un caract�re important de son histoire. Elle continuera de jouer un r�le cl� dans l’�volution de ce pays et soutiendra nos objectifs �conomiques et sociaux en r�pondant aux besoins du march� du travail et des collectivit�s. Le monde fait face � une p�nurie de main-d’oeuvre qualifi�e et le Canada fait concurrence � d’autres pays industrialis�s pour l’obtention de travailleurs qualifi�s. Certaines professions, certains secteurs industriels et certaines r�gions ont connu ces derni�res ann�es des p�nuries de main-d’oeuvre qualifi�e. Il est donc important que le Canada tire le maximum des comp�tences de chacun, y compris des nouveaux arrivants. Le gouvernement du Canada a propos� de travailler en collaboration avec ses partenaires provinciaux et territoriaux � mettre en place un processus �quitable d’�valuation des titres de comp�tence �trangers. Il doit aussi parfaire sa capacit� d’attirer et de retenir les immigrants par un recrutement proactif et des programmes efficaces d’int�gration et de r�unification des familles.
La mondialisation des march�s, des communications et des voyages a �galement entra�n� une hausse proportionnelle des risques. La facilit� de voyager signifie que les �pid�mies, par exemple le SRAS et la grippe aviaire, peuvent se propager rapidement dans le monde si elles ne sont pas g�r�es efficacement. Les conflits politiques et les troubles civils dans certaines parties du monde peuvent aussi avoir des ramifications profondes et miner notre sentiment collectif de s�curit�. L’un des grands d�fis du Canada est d’�tablir un �quilibre appropri� entre la facilitation de l’entr�e des �trangers susceptibles de contribuer � notre mieux-�tre �conomique, social et culturel et la protection de la sant� et de la s�curit� des Canadiens. CIC continue de travailler avec ses partenaires pour remplir son r�le et d�tecter les demandeurs qui pourraient repr�senter un risque en mati�re de sant� ou de s�curit�, de fa�on � veiller � ce que les avantages d’un syst�me d’immigration plus adapt� � la situation ne soient pas compromis.
Conform�ment � une tradition humanitaire de longue date, le Canada offre chaque ann�e un refuge s�r � nombre de personnes d�plac�es et pers�cut�es. L’un des grands d�fis est de veiller � ce que notre syst�me de protection des r�fugi�s soit �quitable, efficace et conforme aux valeurs canadiennes que sont le respect des droits de la personne, l’�galit�, l’�quit�, la paix et la primaut� du droit.
CIC s’acquitte de sa t�che en mati�re d’immigration, d’int�gration et de citoyennet�, en �troite collaboration avec divers partenaires, � savoir les autres minist�res et organismes f�d�raux, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales, les organismes non gouvernementaux (ONG) et les employeurs. D’autres entit�s f�d�rales, par exemple l’ASFC, le Service canadien du renseignement de s�curit� (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC), jouent un r�le cl� dans la gestion des activit�s consistant � amener les gens au Canada, notamment en aidant CIC � remplir son r�le en mati�re de s�curit� et de d�pistage. Les provinces et les territoires, les administrations municipales, les ONG et les employeurs jouent �galement un r�le essentiel dans la gestion des nouveaux arrivants au Canada. Le Minist�re travaille de concert avec d’autres minist�res (plus particuli�rement avec Patrimoine canadien, le minist�re des Affaires �trang�res et du Commerce international (MAECI), le minist�re de la Justice et celui de la S�curit� publique), pour promouvoir la citoyennet� et les pratiques civiques canadiennes, et pour d�velopper une compr�hension partag�e des droits et responsabilit�s des citoyens dans un environnement d’une diversit� grandissante.
CIC doit �tre conscient que, de plus en plus, les politiques relatives � la citoyennet�, � l’immigration et � l’int�gration devront �tre �labor�es en tenant compte du contexte mondial.
C’est l� un environnement difficile. L’objectif de CIC est de fournir des services aux bonnes personnes, au bon moment et � l’endroit appropri�. Pour y parvenir, le Minist�re doit se doter d’une approche enti�rement int�gr�e en mati�re d’�laboration de politiques, de conception de programmes et de prestation de services pour attirer, retenir et int�grer les immigrants, prot�ger les r�fugi�s et moderniser la citoyennet�.
En vue d’atteindre ses r�sultats strat�giques, CIC s’est concentr� sur trois domaines prioritaires en 2006-2007 :
- mettre en oeuvre un cadre strat�gique int�gr�;
- am�liorer le service � la client�le;
- b�tir l’effectif de demain.
Priorit�s du Minist�re
Priorit� 1 : Mettre en oeuvre un cadre strat�gique int�gr�
Le cadre strat�gique int�gr� contribue � atteindre les trois r�sultats strat�giques du Minist�re. Il :
- fournit des indications strat�giques pour veiller � ce que les programmes et les politiques de CIC fonctionnent harmonieusement afin de servir les int�r�ts du Canada et de remplir nos objectifs strat�giques qui consistent � contribuer � g�n�rer la richesse et � b�tir l’�conomie du Canada, � maintenir des collectivit�s fortes et � faciliter le r�le du Canada dans la protection de ceux qui en ont le plus besoin;
- facilite une meilleure coordination entre les partenaires et les autres intervenants;
- tire parti des capacit�s et m�canismes en place pour partager la responsabilit� de l’immigration avec les provinces et les territoires;
- fournit des m�canismes permanents permettant de communiquer les renseignements pertinents et de mieux les int�grer dans le processus d’�laboration de la politique et des programmes;
- positionne plus efficacement le Canada afin qu’il puisse r�pondre aux d�fis futurs et tirer parti des conditions �conomiques et sociales mondiales qui influent sur l’immigration, ainsi que des conditions int�rieures qui ont des r�percussions sur l’int�gration et l’�tablissement des nouveaux arrivants;
- modernise notre mod�le de service � la client�le et rel�ve les d�fis du syst�me actuel de prestation de services;
- trace la voie pour fournir les investissements durables n�cessaires.
Pour r�ussir la mise en oeuvre de ce cadre int�gr�, il faudra travailler en �troit partenariat avec d’autres minist�res et organismes f�d�raux, les provinces et les territoires et d’autres intervenants cl�s, notamment les collectivit�s, les employeurs et les ONG. Les consultations constantes aupr�s d’une vaste gamme d’intervenants d�finissent les d�fis auxquels est confront� le syst�me d’immigration et de citoyennet� et garantissent un soutien � l’�gard des orientations futures.
Au cours de l’ann�e �coul�e, nous nous sommes efforc�s de mieux r�pondre aux besoins du march� du travail, de r�pondre aux enjeux cl�s, par exemple les adoptions �trang�res et la r�vocation et l’acquisition de la citoyennet�, et d’�laborer des m�canismes de soutien suffisants pour l’�tablissement et l’int�gration. Au cours de l’ann�e qui vient, dans le cadre de nos efforts globaux, nous continuerons de faire progresser le cadre int�gr� et � �laborer des mesures appuyant ses orientations g�n�rales.
Priorit� 2 : Am�liorer le service � la client�le
Immigrer au Canada ou demander la citoyennet� est une d�cision importante. Les clients et CIC sont mieux servis si cette d�cision repose sur des renseignements r�alistes, opportuns et dignes de foi. Les gens ont besoin de conna�tre les d�bouch�s, les d�fis et les difficult�s que supposent immigrer, travailler et vivre au Canada et de savoir quels sont les privil�ges et les responsabilit�s rattach�s � la citoyennet� canadienne. Les clients et le Minist�re ont aussi int�r�t � ce que le traitement des demandes de citoyennet� et d’immigration soit simple, pr�visible et transparent.
M�me si le syst�me d’immigration du Canada permet de progresser � partir d’assises solides, la gestion des demandes et le service � la client�le posent n�anmoins certains d�fis. Relever ces d�fis exigera d’am�liorer le service � la client�le tout en maintenant l’int�grit� du syst�me, de rehausser la perception du public � l’�gard du syst�me et de veiller � ce que le Canada demeure une destination attrayante pour les immigrants qualifi�s. Le nombre croissant de demandes, � la fois pour les r�sidants temporaires et les r�sidants permanents, illustre bien le fait que le Canada demeure une destination de choix.
Toutefois, un nombre �lev� de demandes de r�sidence permanente qui d�passe les objectifs du gouvernement et la capacit� de traitement a contribu� � l’accumulation des demandes � traiter. Alors que CIC continue de donner la priorit� aux demandes des conjoints et des enfants qui font l’objet d’un parrainage et � celle des r�fugi�s, le nombre de demandes dans les cat�gories des travailleurs qualifi�s et des parents et grands-parents a continu� d’augmenter. Parall�lement, le nombre croissant de demandes de s�jour temporaire qui ne sont pas vis�es par les niveaux d’immigration a �galement sollicit� au maximum la capacit� de traitement et les ressources du Minist�re. Les demandes non trait�es ont continu� d’augmenter, ce qui exerce des pressions sur l’ex�cution du programme, contribue aux longs d�lais de traitement et rend difficile la gestion des attentes des clients. M�me si CIC poss�de les ressources n�cessaires pour respecter les objectifs annuels en mati�re d’immigration, il doit g�rer les demandes relevant de la cat�gorie des Travailleurs �trangers temporaires (TET) au moyen de ses ressources existantes. Parce que CIC doit traiter toutes les demandes re�ues, cela pourrait entra�ner une �rosion de sa capacit� de respecter ses objectifs pr�vus en mati�re d’admissions, puisque les demandes de travailleurs �trangers temporaires ont priorit� sur le traitement des visas de r�sidents permanents. Ces pressions font ressortir la n�cessit� de trouver un juste �quilibre entre les flux des migrations temporaires et permanentes.
En 2006, le Minist�re a adopt� un cadre triennal complet de modernisation du service � la client�le qui vise � am�liorer la prestation des services d’immigration et de citoyennet�. Il se concentre sur des am�liorations dans six domaines cl�s : orientations strat�giques appuyant le service � la client�le, gestion des programmes, mesures administratives, services et outils �lectroniques, ressources et participation des partenaires. Des progr�s importants ont �t� accomplis dans tous ces domaines, et CIC est r�solu � continuer de fournir des renseignements et services de qualit� pour r�pondre aux attentes et aux besoins changeants des clients. Pour soutenir cet engagement, CIC a �labor� et a adopt� un �nonc� d’engagement � l’�gard du service � la client�le et des principes directeurs pour l’am�lioration du service, une strat�gie de prestation de services du Minist�re inspir�e de la r�troaction re�ue de groupes de discussions tant internes qu’externes.
En 2006-2007, on a insist� sur l’am�lioration des programmes, la r�duction des d�lais de traitement dans un certain nombre de domaines, une meilleure utilisation d’Internet et des services en direct, la simplification des trousses et des processus de demande, la fourniture de meilleurs renseignements par l’entremise du T�l�centre de CIC et la simplification de la prestation des services avec les partenaires. Les am�liorations mises en oeuvre comprennent ce qui suit :
- Le permis de travail hors campus, par lequel les �tudiants �trangers fr�quentant des �tablissements d’enseignement postsecondaires publics peuvent travailler � temps partiel hors du campus, a �t� lanc� en avril 2006.
- Le Minist�re a mis en place des unit�s de TET � Vancouver et � Calgary en septembre 2006, � la suite du succ�s de l’unit� des TET, cr��e � Montr�al en 2003. Ces unit�s de TET fournissent des conseils aux employeurs qui comptent recruter des travailleurs �trangers temporaires dispens�s du processus de confirmation du march� du travail. Les unit�s pr�s�lectionnent �galement les documents justificatifs fournis par les employeurs afin de simplifier le processus de demande pour ces travailleurs.
- Les d�lais de traitement pour l’octroi de la citoyennet�, qui �taient de 15 � 18 mois dans les exercices pr�c�dents ont �t� r�duits � 12 mois et le nombre de demandes accumul�es, qui �tait de 345 500, a chut� � 185 000 en f�vrier 2007.
- Malgr� une croissance importante du volume de demandes de r�sidence temporaire � l’�tranger, 73 % de toutes les demandes de travailleurs temporaires ont �t� trait�es en 28 jours ou moins avec un taux d’approbation de 91 %, et 76 % des demandes d’�tudiants ont �t� trait�es en 28 jours ou moins avec un taux d’approbation de 77 %.
- Les frais relatifs au droit de r�sidence permanente ont �t� r�duits de 50 % (Budget de 2006). En f�vrier 2007, CIC avait rembours� environ 40 millions de dollars de frais � environ 83 000 demandeurs.
- Des outils en ligne, par exemple la calculatrice de la p�riode de r�sidence et l’�tat de la demande du cyberclient (EDC), ont �t� am�lior�s. Gr�ce � ces am�liorations, il sera plus facile pour les demandeurs d’�valuer leur admissibilit� � la r�sidence avant d’amorcer le processus de demande de citoyennet� et un plus grand nombre de personnes auront acc�s � des renseignements sur leurs demandes.
- Le processus de demande pour la plupart des demandeurs des cat�gories �conomiques a �t� simplifi�. D�sormais, les clients ne doivent pr�senter des documents � l’appui que lorsque le bureau des visas est pr�t � �valuer leur demande. La r�glementation et les frais de traitement en vigueur � la date de pr�sentation de leurs formulaires de demande de base s’appliqueront toutefois.
- Le Minist�re a entam� des pourparlers avec Service Canada concernant des projets pilotes communs d’am�lioration de la prestation de services, et des n�gociations ont commenc� au sujet d’un protocole d’entente (PE) qui permettra une validation plus rapide de l’information sur la citoyennet� aux fins des demandes de cartes de num�ro d’assurance sociale. Deux projets pilotes amorc�s avec Service Canada au Qu�bec en 2005-2006 se sont poursuivis. On teste des moyens d’�largir les services en personne et de renforcer le r�seau de prestation des services.
Les am�liorations sont apport�es progressivement aux services afin d’offrir des solutions � court terme et de garantir une transformation � moyen terme. Afin d’assurer une transition et une continuit� sans heurt dans la prestation de services, la s�quence des changements demeurera guid�e par la r�troaction des clients, la faisabilit� des projets, les co�ts et les exigences op�rationnelles.
Priorit� 3 : B�tir l’effectif de demain
Les employ�s de CIC contribuent activement � b�tir la soci�t� canadienne. Les services qu’ils fournissent sur le plan de la politique, du programme et � l’�gard des clients sont essentiels au succ�s actuel et futur du Canada du point de vue �conomique, social et international. CIC reconna�t l’importance des employ�s pour sa r�ussite en tant qu’organisation et le lien crucial et essentiel entre les employ�s, les clients et, en d�finitive, la confiance du public.
Des recherches nouvelles dans le secteur public [note 7] font ressortir un lien �vident et sans �quivoque entre les employ�s, la satisfaction des citoyens/clients en mati�re de service et la confiance des citoyens dans les institutions publiques. CIC doit relever les m�mes d�fis que les autres organismes dans la fonction publique f�d�rale canadienne et � l’ext�rieur : nous devons modifier la fa�on dont nous menons nos activit�s de fa�on � mieux servir les Canadiens et nos clients. CIC doit faire face � un nombre accru de d�parts � la retraite et � des taux relativement �lev�s de d�parts. Cela pose des probl�mes en mati�re de maintien de l’effectif, de recrutement et de gestion de la rel�ve. Cela constitue �galement un d�fi d’apprentissage et de transfert des connaissances, car nous devons int�grer un plus grand nombre de nouveaux employ�s que par le pass�.
Pour atteindre les r�sultats pr�vus et soutenir les priorit�s minist�rielles, en 2006-2007, CIC a amorc� l’�laboration de strat�gies visant � accro�tre la satisfaction et la loyaut� des employ�s et � faire en sorte que le Minist�re demeure un employeur int�ressant. � titre d’exemple, CIC offre un syst�me efficace de r�glement des diff�rends regroupant des approches pr�ventives et coop�ratives pour r�gler les probl�mes en milieu de travail. De nombreux r�seaux d’employ�s ont �galement �t� cr��s (r�seau des jeunes, comit� de la diversit�, collectivit� des cadres interm�diaires). Leurs membres se rencontrent r�guli�rement pour discuter et �laborer des moyens innovateurs d’am�liorer notre milieu de travail et la qualit� de la main-d’oeuvre.
En 2006-2007, CIC a mis sur pied un Bureau de renouvellement de l’effectif qui s’emploie � �laborer des solutions permanentes et durables � mesure que nous progressons. Le Bureau a amorc� des recherches et sollicit� la participation des employ�s de fa�on � cerner la priorit� et � mieux comprendre les facteurs et forces en jeu, de m�me qu’� sensibiliser les employ�s et les gestionnaires � la nature et � l’ampleur des d�fis que CIC doit relever en mati�re de main-d’oeuvre.
CIC a �galement pr�par� en 2006-2007 sa premi�re strat�gie triennale sur les ressources humaines et a amorc� le travail dans les domaines suivants :
- Renouvellement strat�gique
- Effectif repr�sentatif et diversifi�
- Culture organisationnelle habilitante
- Planification de la rel�ve et excellence en leadership
- Acquisition des comp�tences et milieu d’apprentissage continu
Par l’interm�diaire du processus de planification des activit�s de CIC, tous les secteurs du Minist�re se sont engag�s � amorcer des activit�s cl�s pour appuyer la priorit� � B�tir l’effectif de demain �. Ils y sont arriv�s par une planification logique des ressources humaines liant les orientations fonctionnelles [note 8] aux enjeux d�mographiques futurs, aux besoins d’apprentissage des employ�s, ainsi qu’aux strat�gies de recrutement, de formation et de perfectionnement. Les r�sultats du sondage 2005 aupr�s des employ�s de la fonction publique et les taux de roulement du Minist�re ont �t� analys�s pour d�gager les possibilit�s d’am�lioration du milieu de travail et �laborer des strat�gies.
Priorit�s en mati�re de gestion
CIC continue d’avoir � coeur l’am�lioration constante par la poursuite de l’excellence dans les pratiques de gestion. Le Minist�re est reconnu comme l’un des chefs de file dans ce domaine et il continuera d’�tablir et de renforcer ses pratiques de gestion. Dans ses efforts pour int�grer davantage le cadre de responsabilisation de gestion (CRG) aux activit�s, CIC a pris des mesures pour en promouvoir l’utilisation comme instrument privil�gi� de surveillance de ses pratiques de gestion.
CIC a accompli des progr�s d’envergure dans l’�laboration, le classement selon les risques, l’�tablissement de crit�res de v�rification et la prise en charge des contr�les fondamentaux du Minist�re. Nous sommes pr�ts � poursuivre notre validation des contr�les sp�cifiques au Minist�re et nous continuerons � travailler avec le SCT � cet �gard. De fa�on � servir l’horizontalit� interminist�rielle, CIC a fait conna�tre ses travaux aux autres minist�res int�ress�s.
CIC fonctionne actuellement � l’aide d’un processus de planification des activit�s int�grant les activit�s fonctionnelles aux plans strat�giques et op�rationnels des ressources humaines et se concentrant sur les risques cl�s, de m�me que sur les besoins en mati�re de finances, de technologie de l’information et de locaux. Les plans sectoriels au niveau des sous-ministres adjoints constituent d�sormais la base du plan des activit�s de CIC, qui couvre trois ann�es de priorit�s strat�giques et continues du Minist�re. Le processus de planification suppose une formation inter-services favorisant une compr�hension et des pratiques communes comme moyen d’am�liorer la planification des activit�s. Dans le cadre de la responsabilisation de la gestion, en 2006-2007, CIC a effectu� un examen de mi-�tape de ses plans afin de s’assurer qu’ils s’harmonisent avec les r�sultats des activit�s.
En 2006-2007, CIC a tenu des ateliers et des pourparlers multi-niveaux afin d’�laborer un profil de risque qui d�gage les principaux risques pour le Minist�re. Ce profil insiste sur les domaines de responsabilisation, la surveillance p�riodique et l’examen et l’ajustement continus des risques du Minist�re.
� CIC, le leadership conforme � l’�thique est un principe fondamental de responsabilisation, et les valeurs et l’�thique sont consid�r�s comme sous-tendant la responsabilisation en gestion. Le sous-ministre a clairement demand� que les cadres sup�rieurs envisagent des mesures pour renforcer les valeurs et l’�thique dans leurs plans de rendement pour l’ann�e. Le groupe de soutien sur les valeurs et l’�thique a �t� revigor�, le personnel int�ress� a suivi une formation et on a pr�par� un plan d’action et de communication.
CIC est en bonne voie de r�pondre aux exigences de la nouvelle politique du SCT sur la v�rification interne. En 2006-2007, le Minist�re a retenu les services d’autres v�rificateurs d’exp�rience ayant l’accr�ditation professionnelle et il a recrut� un nouveau membre externe pour le Comit� de v�rification. Il a �galement cr�� un secr�tariat du Comit� de v�rification pour faciliter les activit�s du comit�. La Direction g�n�rale de la v�rification interne a mis la derni�re main � un plan de v�rification ax� sur les risques pour 2007-2010. Il y a eu un examen pr�liminaire de l’�valuation de la qualit� de la v�rification interne et les r�sultats ont �t� pr�sent�s au Comit� de v�rification. CIC poursuivra son examen syst�matique des m�canismes de contr�le et de responsabilisation.
Importance capitale des partenariats
La gestion r�ussie du programme d’immigration du Canada d�pend de la collaboration permanente avec une vaste gamme de partenaires. CIC travaille avec de nombreux partenaires sur les questions d’immigration internationales et nationales, mais des relations plus solides avec une gamme encore plus large de partenaires s’imposent pour b�tir le Canada de demain.
Puisque la comp�tence en mati�re d’immigration est une responsabilit� partag�e, la gestion r�ussie du programme d’immigration repose sur une collaboration efficace entre le gouvernement f�d�ral et les provinces et territoires. Voil� pourquoi les gouvernements provinciaux et territoriaux sont les premiers partenaires de CIC. Notre objectif commun est de faire en sorte que les programmes d’immigration r�pondent aux besoins sp�cifiques de chaque province et territoire tant sur le plan �conomique et social qu’en ce qui concerne le march� du travail.
CIC a sign� des ententes cadres [note 9] de coop�ration en mati�re d’immigration avec huit provinces et territoires, ainsi que des ententes sur les candidats des provinces avec dix provinces ou territoires. Le Programme des candidats des provinces et territoires conf�re aux provinces et aux territoires le pouvoir de pr�senter la candidature de personnes comme r�sidents permanents pour r�pondre � des besoins sp�cifiques en mati�re de d�veloppement �conomique et du march� du travail.
L’Accord Canada-Qu�bec est l’accord bilat�ral le plus complet en mati�re d’immigration en ce qu’il accorde au Qu�bec l’enti�re responsabilit� de la s�lection de ses immigrants (� l’exception des membres de la cat�gorie du regroupement familial et de celle des r�fugi�s dont le statut est d�termin� au Canada) et de la prestation des services d’�tablissement et d’int�gration aux nouveaux arrivants, de m�me que le pouvoir de fixer ses propres objectifs annuels en mati�re d’immigration. CIC a continu� de travailler tr�s �troitement avec le Qu�bec pour g�rer et coordonner tout au long de l’ann�e ce partenariat en mati�re d’immigration.L’ann�e 2006-2007 a �t� marqu�e par l’�laboration de nouvelles ententes cadres et la reconduction de certaines autres. La premi�re entente globale avec l’Alberta a �t� ratifi�e en mai 2007. Pour r�pondre � la demande croissante de main-d’oeuvre de l’Alberta, l’accord �liminait la restriction concernant le nombre d’immigrants que la province pouvait nommer � titre de candidats dans le cadre du PCP, et on annon�ait l’intention de pr�parer une annexe afin de faciliter l’entr�e des travailleurs �trangers temporaires. L’accord sur les candidats de la province avec Terre-Neuve-et-Labrador a �t� reconduit au cours de l’exercice et est entr� en vigueur en novembre 2006.
�galement en novembre 2006, le gouvernement f�d�ral, le gouvernement de l’Ontario et la Ville de Toronto ont sign� un PE. C’est la premi�re fois que les int�r�ts des trois palliers de gouvernement sont officiellement repr�sent�s dans des discussions touchant les politiques et les programmes d’immigration. Le PE porte sur l’am�lioration des r�sultats pour les immigrants dans des domaines comme l’acc�s � l’emploi, les services, de m�me que les perspectives d’�ducation et de formation, sans oublier la citoyennet� et la participation � la vie civile.
On a de plus en plus recours aux rencontres multilat�rales pour d�battre d’approches et de pr�occupations communes concernant les questions d’immigration et mettre en commun les pratiques exemplaires. En 2006-2007, CIC a amorc� deux s�ries de consultations avec ses homologues provinciaux et territoriaux sur l’affectation et l’utilisation des nouveaux fonds touchant l’�tablissement. Dans une initiative distincte, un groupe de travail mixte f�d�ral-provincial a planifi� et lanc� les premi�res consultations jamais tenues avec les intervenants de l’ensemble du pays concernant l’�laboration d’un plan pluriannuel sur les niveaux d’immigration. � l’�chelle du Minist�re, il y a eu des pourparlers sur la planification des niveaux d’immigration, les besoins du march� du travail, la reconnaissance des titres de comp�tence �trangers, l’int�gration des immigrants dans les collectivit�s canadiennes et les fonds d’�tablissement � long terme.
CIC travaille en �troite collaboration avec la Commission de l’immigration et du statut de r�fugi� (CISR) [note 10] sur les questions touchant la gestion du portefeuille de l’immigration et de la protection des r�fugi�s. La CISR est un tribunal administratif ind�pendant qui statue sur les cas d’interdiction de territoire et de d�tention, les appels et les demandes d’asile pr�sent�s au Canada. L’ind�pendance de la CISR et de ses commissaires est toujours respect�e, mais ceux-ci collaborent �troitement avec CIC dans les dossiers relevant des politiques et des programmes.
CIC et l’ASFC assument de concert la responsabilit� de l’administration de la LIPR et se soutiennent mutuellement dans l’ex�cution de leurs fonctions respectives. Gr�ce � l’appui de l’ASFC et des organismes responsables de la s�curit�, CIC s�lectionne les immigrants et les r�sidents temporaires, aide les immigrants � r�ussir leur �tablissement et leur int�gration, tout en offrant la protection du Canada aux r�fugi�s et aux personnes se trouvant dans des situations semblables. Par ailleurs, CIC offre un soutien � l’ASFC dans la gestion et l’administration des points d’entr�e au pays, fournit des renseignements et d’autres services de soutien pour emp�cher la venue au Canada de personnes interdites de territoire et d�pister les personnes pr�sentes au Canada en contravention � la LIPR. En mars 2006, CIC et l’ASFC ont officialis� leur partenariat dans un PE d�finissant la fa�on dont les deux organismes travaillent de concert pour ex�cuter tous les aspects des programmes d’immigration et de protection des r�fugi�s et de citoyennet�. Au fil de la mise en oeuvre du PE, CIC continuera de travailler en �troite collaboration avec l’ASFC pour faciliter le renvoi des personnes interdites de territoire et �tudier la fa�on d’utiliser la biom�trie et les autres technologies pour mieux identifier les clients et contribuer � l’int�grit� des documents et au respect du programme.
Au Canada comme � l’�tranger, CIC ex�cute ses programmes de concert avec le MAECI, S�curit� publique Canada, ainsi que d’autres organismes qui jouent un r�le cl� dans la gestion de l’acc�s au Canada et la protection de la soci�t� canadienne. Il s’agit notamment de l’ASFC, de la GRC et du SCRS, qui veillent � la s�curit� publique, de m�me que de Sant� Canada et de l’Agence de sant� publique du Canada (ASPC), qui s’occupent, avec CIC, des questions relatives � la sant� des immigrants. CIC travaille �galement avec Ressources humaines et D�veloppement social Canada (RHDSC) sur plusieurs dossiers, notamment le programme des travailleurs �trangers temporaires et le Bureau d’orientation relatif aux des titres de comp�tence �trangers, ainsi qu’avec Patrimoine canadien, aux activit�s de promotion de la citoyennet� et � l’ex�cution du Plan d’action canadien contre le racisme. Enfin, CIC travaille avec l’Agence canadienne de d�veloppement international (ACDI) pour r�pondre aux besoins en mati�re d’aide humanitaire et intensifier le dialogue international sur la migration et le d�veloppement.
Compte tenu des complexit�s de la gestion des migrations, il n’existe que de rares domaines d’int�r�t strat�gique et de programmes o� le Canada peut agir seul. CIC maintient une multitude de relations bilat�rales, r�gionales et multilat�rales cl�s qui sont des v�hicules importants pour faire progresser les objectifs canadiens. CIC se concentre encore sur l’affirmation du r�le du Canada dans les migrations internationales et la protection. Il aide � �tablir le programme international de protection des r�fugi�s par l’entremise de s�ances r�guli�res du Haut Commissariat des Nations Unies pour les r�fugi�s (HCR), de son groupe de travail sur le r��tablissement et de son Comit� ex�cutif. Il travaille �galement avec d’autres �tats membres � �laborer des orientations strat�giques pour l’Organisation internationale pour les migrations. CIC est �galement membre actif de tribunes comme les Consultations intergouvernementales sur l’asile, les r�fugi�s et la migration, la Conf�rence des quatre nations et le Groupe r�gional de consultation sur les migrations (Processus de Puebla). Le Minist�re travaille avec d’autres �tats afin d’influer sur l’organisation d’une tribune non ex�cutoire dirig�e par les �tats, le Forum mondial sur la migration et le d�veloppement. CIC repr�sente aussi le Canada aupr�s de l’Organisation pour la coop�ration et le d�veloppement �conomiques concernant les questions de migration.
Le Canada maintient des relations essentielles avec un certain nombre d’autres pays ayant un int�r�t dans les migrations et CIC favorise ses principaux liens bilat�raux et r�gionaux. Dans le contexte nord-am�ricain, CIC s’emploie � faciliter le mouvement des travailleurs aux termes de l’Accord de libre�change nord-am�ricain, de m�me que dans le cadre d’autres ententes sur les travailleurs agricoles saisonniers avec le Mexique et plusieurs pays des Cara�bes. CIC s’est engag� � participer avec les �tats- Unis � diverses initiatives ax�es sur la gestion de la fronti�re commune, notamment dans le cadre du Partenariat nord-am�ricain pour la s�curit� et la prosp�rit�.
De plus, CIC travaille en �troite collaboration avec une vaste gamme d’intervenants, notamment les employeurs, les organismes fournisseurs de services (FS) et divers groupes d’intervenants. Le Minist�re continuera de maintenir ces liens et d’encourager les intervenants � assumer de plus grandes responsabilit�s en ce qui a trait au programme d’immigration.
Partie 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique
La pr�sente partie offre un aper�u de l’AAP de CIC et fait ressortir les activit�s de programme et les r�sultats atteints pour chacun des trois r�sultats strat�giques du Minist�re. Elle contient �galement, sous forme de tableaux, une illustration des ressources financi�res pr�vues et r�elles pour 2006-2007 par activit� de programme.
En exigeant des frais pour l’octroi de droits et le traitement des demandes, les programmes de CIC g�n�rent des recettes qui, vers�es au Tr�sor, ne peuvent �tre d�pens�es par le Minist�re. Le Tableau 6 donne la liste des recettes non disponibles par activit�. Les activit�s contribuant � plus d’un r�sultat ou touchant l’ensemble du Minist�re par leur nature sont trait�es � la Partie 5 : � Autres sujets d’int�r�t �.
Le tableau suivant illustre comment les r�sultats de programme vis�s par le Minist�re contribuent � l’atteinte de ses r�sultats strat�giques.
| R�sultats strat�giques | R�sultats pr�vus |
|---|---|
| RS1 : Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada |
1. Programme d’immigration : Contribution, par l’entremise du programme d’immigration, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. 2. Programme des r�sidents temporaires : Contribution, par l’entremise du programme des r�sidents temporaires, au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. |
| RS2 : Prise en compte des valeurs et des int�r�ts Canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s |
3. R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection : Influence du Canada sur les politiques de la communaut� internationale en mati�re de migration et de protection. 4. Programme des r�fugi�s : Maintien de la tradition humanitaire du Canada � l’�gard des r�fugi�s et des personnes ayant besoin de protection. |
| RS3 : Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants et promotion de la citoyennet� canadienne |
5. Programme d’int�gration : Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants � la soci�t� canadienne dans un d�lai raisonnable; contribution des nouveaux arrivants afin de r�pondre aux besoins de d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. 6. Programme de citoyennet� : Possibilit� donn�e aux r�sidents permanents admissibles � la citoyennet� de participer pleinement � la vie de la soci�t� canadienne; contribution au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada. |
A. R�sultat strat�gique 1 : Optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada
Les migrations sont une force positive pour le d�veloppement �conomique et social. CIC continue de promouvoir le Canada en tant que destination de choix pour ceux qui ont du talent, qui veulent innover et qui sont d�sireux d’investir ou qui recherchent de nouvelles perspectives. Le syst�me d’immigration du Canada facilite l’entr�e au pays d’immigrants et de r�sidents temporaires qui, par le capital qu’ils investissent, peuvent contribuer au march� du travail et � l’�conomie. Le Canada accueille �galement des immigrants de la cat�gorie du regroupement familial qui sont parrain�s et donc financi�rement soutenus par de proches parents. Bon nombre des personnes parrain�es au titre de cette cat�gorie apportent aussi une contribution appr�ciable � la vie �conomique. Pour que ces programmes donnent des r�sultats satisfaisants, il faut concilier l’objectif d’accueillir des immigrants et la n�cessit� de veiller � la sant� et � la s�curit� des Canadiens.
En 2006-2007, CIC s’est efforc�, avec ses partenaires, d’accro�tre la contribution de l’immigration �conomique � la prosp�rit� et � la comp�titivit� du Canada. L’objectif �tait de mettre en place un syst�me d’immigration mieux adapt�, permettant de recruter et de s�lectionner les immigrants les plus susceptibles de r�pondre aux besoins �conomiques et du march� du travail et cela, tout en am�liorant la situation des nouveaux immigrants et en maintenant l’int�grit� du programme d’immigration. Les demandeurs s�lectionn�s par les provinces pour r�pondre � leurs besoins d’emploi et d�mographiques sp�cifiques ont continu� de b�n�ficier d’un traitement prioritaire. De plus, CIC a cherch� des moyens de faciliter la transition de la r�sidence temporaire � la r�sidence permanente pour ceux qui pr�sentent le potentiel de bien s’int�grer � la soci�t� canadienne, � savoir notamment les r�sidents temporaires, tel que les travailleurs �trangers qui viennent au Canada pour une p�riode d�termin�e, et les �tudiants �trangers. Les travailleurs temporaires et les �tudiants �trangers constituent une source pr�cieuse d’immigrants �ventuels, car ils peuvent non seulement contribuer � r�pondre aux besoins actuels du march� du travail ainsi qu’� atteindre les objectifs �conomiques, mais ils sont �galement plus aptes � r�ussir au Canada sur le plan �conomique. CIC, par ses efforts, n’est pas �tranger � l’annonce, dans le Budget 2007, des am�liorations apport�es au programme des travailleurs �trangers temporaires et d’une nouvelle voie d’immigration pour les �tudiants �trangers form�s au Canada et les travailleurs �trangers temporaires exp�riment�s.
CIC a continu� de r�unifier les familles en traitant de fa�on prioritaire, dans tous ses bureaux, les conjoints et les enfants � charge parrain�s. Le nombre de demandes de parents et de grands-parents trait�es a connu une hausse par rapport aux deux exercices pr�c�dents. Au cours de l’exercice pass�, CIC a renforc� ses partenariats afin de favoriser l’immigration dans l’ensemble du Canada. Le Minist�re a continu� de collaborer �troitement avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de s�lectionner des immigrants et des travailleurs temporaires r�pondant aux besoins �conomiques, sociaux et culturels sp�cifiques des provinces et des territoires.
CIC a �galement continu� de remplir son r�le dans la d�tection des demandeurs de r�sidence temporaire ou permanente qui pourraient pr�senter un risque pour la s�curit� ou la sant� des Canadiens, afin de veiller � ce que les avantages offerts par un syst�me d’immigration mieux adapt� ne soient pas min�s. De fa�on � mieux d�pister et � d�courager la fraude, CIC a continu� de compter sur les partenariats efficaces �tablis avec d’autres minist�res et organismes, notamment l’ASFC, la GRC, l’ASPC et Sant� Canada, de m�me que sur ses propres comp�tences.
En vertu de l’article 94 de la LIPR, la ministre de la Citoyennet� et de l’Immigration doit d�poser chaque ann�e au Parlement un plan d’immigration pr�cisant le nombre total d’immigrants que le Canada compte accueillir l’ann�e suivante. CIC a atteint ou d�pass� ses objectifs en mati�re d’immigration depuis sept ans. Nous donnons dans le tableau qui suit les fourchettes d’immigration et le nombre d’admissions pour 2006.
Activit� 1 – Programme d’immigration
| Description | R�sultats pr�vus |
|---|---|
| Concevoir, �laborer et mettre en oeuvre des politiques et des programmes pour faciliter l’entr�e des r�sidents permanents et maximiser leur contribution �conomique, sociale et culturelle au Canada, tout en prot�geant la sant� des Canadiens et en assurant leur s�curit� |
Contribution, par l’entremise du programme d’immigration, au d�veloppement �conomique social, et culturel du Canada |
Ressources financi�res (en millions de dollars)
| D�penses pr�vues | 197,2 $ | |
| Total des autorisations | 267,5 $ | |
| D�penses r�elles | 244,8 $ |
Explications des ressources utilis�es : Le total des autorisations a augment� de 70,3 millions de dollars par rapport aux d�penses pr�vues, principalement en raison des exigences r�glementaires suppl�mentaires, notamment les r�gimes d’avantages sociaux des employ�s.
Les d�penses r�elles �taient de 22,7 millions de dollars inf�rieures au total des autorisations en raison de la non-utilisation de fonds g�n�raux de fonctionnement � reporter sur 2007-2008 et des co�ts inf�rieurs aux pr�visions planifi�es concernant le traitement des demandes des parents et des grands-parents.
Atteinte des niveaux d’immigration
CIC a atteint ses objectifs en mati�re d’immigration en 2006. La fourchette pour 2006 �tait de 225 000 � 255 000, et 251 649 r�sidents permanents ont �t� admis.
| Fourchettes du Plan 2006 |
Admis | ||
|---|---|---|---|
| Nombre | % | ||
| Cat�gories �conomiques | |||
| Travailleurs qualifi�s |
105 000 – 116 000
|
105 949
|
42,10
|
| Gens d’affaires immigrants |
9 000 – 11 000
|
12 077
|
4,80
|
| Aides familiaux r�sidants |
3 000 – 5 000
|
6 895
|
2,74
|
| Candidats des provinces/territoires |
9 000 – 11 000
|
13 336
|
5,30
|
| Total – Cat�gories �conomiques (personnes � charge comprises) |
126 000 – 143 000
|
138 257
|
54,94
|
| Regroupement familial | |||
| �poux conjoints enfants et autres |
44 000 – 46 000
|
50 500
|
20,07
|
| Parents et grands-parents |
17 000 – 19 000
|
20 006
|
7,95
|
| Total – Regroupement familial |
61 000-65 000
|
70 506
|
28,02
|
| Personnes Prot�g�es | |||
| R�fugi�s parrain�s par le gouvernement |
7 300 – 7 500
|
7 316
|
2,91
|
| R�fugi�s parrain�s par le secteur priv� |
3 000 – 4 000
|
3 337
|
1,33
|
| Personnes prot�g�es au Canada |
19 500 – 22 000
|
15 892
|
6,32
|
| Personnes � charge des r�fugi�s � l’�tranger |
3 000 – 6 800
|
5 947
|
2,36
|
| Total – Personnes prot�g�es |
32 800 – 40 300
|
32 492
|
12,91
|
| Autres | |||
| Motifs d’ordre humanitaire et int�r�t public |
5 100 – 6 500
|
10 223
|
4,06
|
| Titulaires de permis |
100 – 200
|
159
|
0,06
|
| Total – Autres |
5 200 – 6 700
|
10 382
|
4,12
|
| Cat�gorie non mentionn�e |
12
|
> 0,01
|
|
| TOTAL |
225 000 – 255 000
|
251 649
|
100,0
|
�laboration des politiques et des programmes
Le travail strat�gique et de planification visant � �laborer des options pour faciliter la transition du statut de r�sident temporaire � celui de r�sident permanent a abouti � l’annonce, dans le Budget de 2007, d’une nouvelle porte pour l’immigration en autorisant, sous certaines conditions, les �tudiants �trangers ayant un dipl�me canadien et une exp�rience professionnelle, de m�me que les travailleurs �trangers temporaires qualifi�s qui se trouvent d�j� au Canada, � demander la r�sidence permanente. Au cours du lancement du programme dans les mois qui viennent, on pr�voit pour ce groupe d’immigrants �conomiques de meilleurs r�sultats et un succ�s plus rapide.
Les efforts strat�giques et de d�veloppement sur la planification pluriannuelle visant l’�tablissement des niveaux d’immigration constituaient l’une des grandes priorit�s en 2006-2007. � la r�union de juin 2006 des ministres f�d�ral, provinciaux et territoriaux responsables de l’immigration, les ministres ont ent�rin� l’�laboration d’un plan pluriannuel et d’un processus de consultation conjoint avec les intervenants dans l’ensemble du pays. � l’automne et au d�but de l’hiver 2006, CIC a pr�par� une strat�gie de consultation et une approche de concert avec les minist�res provinciaux et territoriaux. Les consultations, lanc�es en mars 2007 dans l’ensemble du pays, �claireront le travail sur l’approche propos�e en mati�re de planification pluriannuelle.
Une approche pluriannuelle permettrait � CIC d’adopter une vision davantage � long terme dans sa planification de l’immigration. Elle permettrait d’accueillir un nombre �quilibr� d’immigrants temporaires et permanents pour r�pondre aux besoins imm�diats et futurs des collectivit�s canadiennes et du march� du travail. � longue �ch�ance, l’approche pluriannuelle favoriserait une coh�sion accrue du syst�me d’immigration et contribuerait � l’am�lioration des r�sultats �conomiques et sociaux pour les immigrants.
L’un des grands d�fis strat�giques concerne la fa�on dont les avantages de l’immigration peuvent �tre r�partis de fa�on plus �quitable dans l’ensemble du Canada. Ainsi, sous les auspices de la Table d�mographique de l’Atlantique, CIC continue de collaborer avec l’Agence de promotion �conomique du Canada Atlantique, les quatre provinces de l’Atlantique et RHDSC afin de cr�er des initiatives int�gr�es favorisant une augmentation de l’immigration pour r�pondre aux besoins locaux. Plus particuli�rement, CIC collabore � des initiatives appuyant la recherche en mati�re d’immigration et l’int�gration au march� du travail des �tudiants �trangers dans le Canada Atlantique.
CIC et le minist�re des Affaires civiques et de l’Immigration de l’Ontario, de concert avec l’Association des municipalit�s de l’Ontario (AMO), s’efforcent d’augmenter la participation des administrations municipales aux efforts visant � attirer et � retenir les immigrants ainsi qu’� les aider � s’�tablir et � s’int�grer. Ce travail, qui fait suite aux engagements pris dans le cadre de l’Accord Canada- Ontario sur l’immigration (ACOI), porte principalement sur les besoins des immigrants dans les centres secondaires et les collectivit�s rurales, nordiques et de minorit�s de langue officielle de l’ensemble de la province. De plus, CIC verse � la province des fonds visant � favoriser le d�veloppement d’un contenu en direct pour le portail ontarien sur l’immigration. Le contenu favorisera les municipalit�s ontariennes aupr�s des immigrants �ventuels et des nouveaux arrivants au Canada. En mai 2006, des fonds ont �t� annonc�s pour cinq municipalit�s : London, Ottawa, Windsor/Essex, Sudbury et Toronto.
En septembre 2006, CIC publiait son Plan strat�gique pour favoriser l’immigration au sein des communaut�s francophones en situation minoritaire, qui est un plan � long terme visant � attirer, � int�grer et � retenir des immigrants francophones dans les collectivit�s de tout le Canada [note 11].
Dans le cadre de l’examen permanent de la politique actuelle sur les motifs d’ordre humanitaire, le Minist�re a termin� en d�cembre 2006 un cadre d’�valuation. L’examen se poursuivra en 2007-2008 et devrait permettre de d�gager les aspects o� la politique doit �tre am�lior�e de fa�on � augmenter la responsabilisation et � am�liorer la prestation de services.
Dans le cadre de l’engagement du Minist�re � prot�ger les victimes de la traite des personnes, CIC a publi� en mai 2006 des lignes directrices permettant aux agents d’immigration de d�livrer aux victimes un permis de s�jour temporaire (PST) de courte dur�e. Un PST de plus longue dur�e peut �tre d�livr� lorsqu’il a �t� d�montr� que la personne est r�ellement victime de la traite des personnes. Les victimes de la traite seront exempt�es des droits pour le PST initial et seront admissibles aux prestations de soins de sant� dans le cadre du Programme f�d�ral de sant� int�rimaire. CIC continue de surveiller la mise en oeuvre de ces lignes directrices provisoires. Pour les compl�ter, de concert avec l’ASFC, le Minist�re pr�pare des programmes de formation � l’intention des agents de premi�re ligne afin de les sensibiliser au probl�me de la traite des personnes.
De fa�on � mieux servir les immigrants qui ont opt� pour un repr�sentant en mati�re d’immigration, CIC pr�pare une ligne de conduite sur l’�change d’information entre le Minist�re et ces organismes, de fa�on � favoriser l’int�grit� du programme et la protection des consommateurs.
En 2006-2007, CIC a �galement cr�� un r�seau et un bulletin anti-fraude pour renforcer la sensibilisation � la fraude et faciliter la mise en commun des pratiques exemplaires entre les agents de CIC au Canada et � l’�tranger.
S�lection et traitement des demandes des travailleurs qualifi�s
Le Minist�re a continu� de recueillir des donn�es de base qui serviront � une �valuation formative visant � pr�ciser les premiers r�sultats des immigrants travailleurs qualifi�s s�lectionn�s en vertu du nouveau crit�re introduit par la LIPR en juin 2002. � la fin de 2006-2007, le volume de donn�es n’�tait toujours pas suffisamment grand ni suffisament repr�sentatif pour commencer les travaux. Une �valuation commencera en 2007-2008 et les r�sultats seront communiqu�s en 2008-2009.
En 2006, le nombre de travailleurs qualifi�s admis a atteint 105 949, ce qui respecte la fourchette pr�vue annonc�e au Plan des niveaux d’immigration 2006.
S�lection et traitement des demandes des gens d’affaires immigrants
En 2006-2007, le Minist�re a pr�cis� les exigences de donn�es afin d’�valuer la politique du programme f�d�ral des entrepreneurs et a amorc� la collecte des donn�es. CIC s’efforcera de simplifier et de coordonner les pratiques exemplaires d’ex�cution du programme.
En 2006-2007, CIC a continu� d’exercer une surveillance sur environ 60 fonds d’investissement sous administration priv�e et provinciale et fonctionnant en vertu de la Loi de 1976 sur l’immigration. Cette surveillance vise � veiller � ce que les fonds respectent la loi et la r�glementation aff�rentes.
Dans le cadre du Programme d’immigration des investisseurs (PII) lanc� en avril 1999, CIC agit � titre d’agent pour r�partir les capitaux des immigrants investisseurs entre les gouvernements provinciaux et territoriaux participants, afin qu’ils puissent les utiliser pour leurs initiatives de d�veloppement �conomique. Les participants au programme sont demeur�s les m�mes en 2006-2007. CIC poursuit les pourparlers avec les autres provinces qui ont manifest� leur int�r�t � participer.
Au 31 mars 2007, CIC avait en circulation des affectations brutes de 875 200 000 de dollars aux fonds des gouvernements provinciaux fonctionnant en vertu du nouveau PII. Ce montant n’est inscrit ni � l’actif, ni au passif du gouvernement du Canada parce que CIC est simplement l’agent des provinces. Seuls les investissements recueillis et non encore remis aux fonds provinciaux ou aux investisseurs (c.-�-d. les investissements qui sont encore conserv�s pour une p�riode limit�e dans le compte de CIC) sont inscrits.
Voici les d�tails des montants remis aux provinces participantes :
| Ann�e de r�ception |
Investis-seurs | Montant investi | Ontario | C.-B. | �.-P.-�. | Manitoba | T.N.-O. | T.-N.-L. | Ann�e de rembour-sement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03 |
80
|
32 000 000
|
17 600 216
|
8 970 814
|
5 428 970
|
–
|
–
|
–
|
2007-08
|
| 2003-04 |
105
|
42 000 000
|
21 875 124
|
10 615 401
|
6 104 484
|
1 384 506
|
2 020 485
|
–
|
2008-09
|
| 2004-05 |
723
|
289 200 000
|
133 807 464
|
59 016 231
|
29 740 972
|
37 029 218
|
29 606 115
|
–
|
2009-10
|
| 2005-06 |
757
|
302 800 000
|
132 781 133
|
57 648 800
|
26 905 490
|
34 279 968
|
26 870 025
|
24 314 584
|
2010-11
|
| 2006-07 |
527
|
210 800 000
|
90 939 316
|
39 979 871
|
18 136 775
|
23 240 523
|
18 154 036
|
20 349 479
|
2011-12
|
| Total $ |
2192
|
876 800 000
|
397 003 253
|
176 231 117
|
86 316 691
|
95 934 215
|
76 650 661
|
44 664 063
|
En 2006-2007, les montants suivants affect�s aux fonds provinciaux ont �t� rembours�s aux investisseurs par CIC. Les investisseurs peuvent demander un remboursement si aucun visa de r�sident permanent n’a �t� �mis.
| Ann�e de placement | Investis-seurs | Montant investi |
Ontario | C.-B. | �.-P.-�. | Manitoba | T.N.-O. | T.-N.-L. | Ann�e de rembour-sement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-06 |
1
|
400 000
|
173 867
|
74 684
|
34 430
|
44 130
|
34 365
|
38 524
|
2006-07
|
| 2004-05 |
3
|
1 200 000
|
556 344
|
243 711
|
123 420
|
153 834
|
122 691
|
–
|
2006-07
|
En 2006, le nombre de gens d’affaires admis � titre d’immigrants a atteint 12 077. Ce nombre d�passe la fourchette pr�vue de 9 000 � 11 000 annonc�e dans le Plan des niveaux de 2006.
Cat�gorie du regroupement familial
En d�cembre 2006, la politique provisoire du Minist�re sur les mariages entre personnes de m�me sexe a �t� abrog�e. Ainsi, les mariages homosexuels sont maintenant reconnus aux fins de l’immigration, tant que le mariage est reconnu l�galement en vertu des lois canadiennes et de celles de l’endroit o� il a eu lieu.
Le processus d’adoption internationale est une responsabilit� que partagent le gouvernement f�d�ral et les gouvernements provinciaux ou territoriaux. En mars 2007 une table ronde a eu lieu avec nos partenaires afin de d�battre des r�les et responsabilit�s de chacun en vue d’am�liorer la protection des enfants adopt�s.
En 2006, les admissions dans la cat�gorie du regroupement familial ont atteint 70 506 personnes, ce qui d�passe la fourchette planifi�e de 61 000 � 65 000 annonc�e dans le Plan des niveaux de 2006. La plus forte proportion de cette hausse consistait en 4 500 admissions se situant au-del� de l’extr�mit� sup�rieure de la fourchette de planification pour la cat�gorie des �poux, partenaires et enfants, en raison du nombre de demandes sup�rieur aux pr�visions en 2006. Le reste de l’augmentation, soit environ 1 000 admissions, se situait dans la cat�gorie des parents et grands-parents; il d�coulait d’une augmentation des ressources fournies au milieu de l’ann�e pour traiter les arri�r�s au Canada et dans les missions � l’�tranger.
Programme des candidats des provinces et des territoires (PCP)
En 2006-2007, CIC a offert dans l’ensemble du Canada plusieurs s�ances de formation � l’intention des fonctionnaires provinciaux, pour am�liorer le traitement des demandeurs de la cat�gorie du PCP. De plus, CIC est co-organisateur de travail semestriels f�d�raux-provinciaux/territoriaux et participant r�gulier � ces groupes. Il s’agit d’une tribune o� les partenaires f�d�raux et provinciaux responsables du PCP �changent de l’information et des pratiques exemplaires.
En 2006-2007, le Minist�re a amorc� des n�gociations touchant de nouveaux accords PCP avec l’Alberta, l’�le-du-Prince-�douard, le Yukon et la Nouvelle-�cosse et a sign� une nouvelle entente avec Terre-Neuve-et-Labrador. Ces nouvelles ententes comportent des dispositions visant � renforcer les collectivit�s minoritaires de langue officielle dans tout le Canada.
En 2006, le nombre de candidats des provinces admis a atteint 13 336, ce qui d�passe la fourchette pr�vue de 9 000 � 11 000 annonc�e dans le Plan des niveaux de 2006. Cette augmentation est en grande partie attribuable � l’augmentation du nombre de candidats des provinces en raison de la forte demande de travailleurs poss�dant des comp�tences sp�cialis�es dans certaines r�gions et certains march�s au Canada. CIC a continu� d’assurer un traitement prioritaire des demandeurs s�lectionn�s par les provinces.
Carte de r�sident permanent
Le Minist�re a termin� une analyse des tendances en mati�re d’immigration et de citoyennet� afin de pr�dire les quantit�s de renouvellement de cartes de r�sident permanent (RP). On ne pr�voit aucune pression financi�re importante, sauf pour 2008-2009, o� le volume de demandes de cartes RP devrait d�passer de loin la capacit� de CIC. On avait d�j� pr�vu cette demande parce que les cartes RP ont �t� distribu�es pour la premi�re fois en 2002, qu’elles expirent apr�s cinq ans, et que la majorit� de ces cartes ont �t� distribu�es en 2003-2004.
Le Minist�re a lanc� une campagne de renouvellement de la carte RP et les produits ont �t� distribu�s aux bureaux de CIC au Canada et � l’�tranger, ainsi qu’� l’ASFC, aux d�put�s et aux autres partenaires. De la publicit� a �t� ins�r�e dans la majorit� des journaux canadiens, les revues, les sites de voyage et les m�dias et journaux ethniques. La campagne rappelle aux r�sidents permanents la date d’�ch�ance de leur carte et a donc une influence sur le moment o� ils d�cideront d’en demander le renouvellement. La page Web de CIC fournit �galement de l’information sur le renouvellement de la carte de r�sident permanent.
Activit� 2 – Programme des r�sidents temporaires
| Description | R�sultats pr�vus |
|---|---|
| Concevoir, �laborer et mettre en oeuvre des politiques et programmes pour faciliter l’entr�e des travailleurs temporaires, des �tudiants et des visiteurs de fa�on � maximiser leur contribution au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada, tout en prot�geant la sant� des Canadiens et en assurant leur s�curit� |
Contribution, par l’entremise du programme
|
Ressources financi�res (en millions de dollars)
| D�penses pr�vues |
89,1 $
|
|
| Total des autorisations |
118,3 $
|
|
| D�penses r�elles |
104,9 $
|
Explication des ressources utilis�es : Le total des autorisations s’�tablissait � 29,2 millions de dollars de plus que les d�penses pr�vues, surtout en raison de fonds suppl�mentaires re�us au Budget suppl�mentaire des d�penses et d’exigences r�glementaires suppl�mentaires pour les r�gimes d’avantages sociaux des employ�s.
Des ressources totalisant 13,4 millions de dollars n’ont pas �t� utilis�es, en raison surtout des fonds de la biom�trie dont les d�penses ont �t� approuv�es pour les ann�es futures, de fonds non utilis�s pour le traitement des �tudiants �trangers et de fonds g�n�raux non utilis�s � reporter pour 2007-2008.
Travailleurs �trangers temporaires
Conjointement avec RHDSC, CIC a annonc� en 2006-2007, un certain nombre d’am�liorations au Programme concernant les travailleurs �trangers temporaires (PTET). Ces am�liorations comprennent le prolongement de 12 mois � 24 mois de la dur�e maximale du permis de travail pour les travailleurs �trangers temporaires moins form�s, le prolongement d’un an � trois ans et trois mois de la dur�e maximale du permis de travail pour les aides familiaux r�sidants et l’acc�l�ration du processus applicable aux employeurs recrutant un travailleur �tranger. Ainsi, � la demande du travailleur, la demande de permis de travail sera trait�e en m�me temps que la demande d’avis sur le march� du travail.
Le bureau des visas de Manille a lanc� une initiative sp�ciale afin de r�duire l’important arri�r� de demandes dans la cat�gorie des aides familiaux r�sidants. Un nouveau m�canisme de s�lection et de diagnostic appel� SPEAK (test d’anglais parl� et de connaissances), �labor� conjointement avec un fournisseur de services bien implant�, fait partie int�grante du projet. Cette initiative a consid�rablement r�duit le nombre de cas � traiter ainsi que les d�lais de traitement pour les demandeurs de la cat�gorie des aides familiaux r�sidants.
Le Budget de 2007 comprenait 50,5 millions de dollars sur les deux prochaines ann�es pour financer une s�rie d’am�liorations du PTET dans le but de r�duire les d�lais de traitement et de r�agir plus efficacement aux p�nuries r�gionales de main-d’oeuvre et de comp�tences. Un certain nombre de ces am�liorations seront mises en oeuvre en 2007-2008 et les autres, dans les ann�es ult�rieures.
Les n�gociations avec le gouvernement de l’Ontario concernant l’annexe relative aux travailleurs �trangers temporaires de l’ACOI ont bien avanc�. Elles devraient se terminer au cours de l’�t� ou au d�but de l’automne 2007. L’annexe offrira un m�canisme par lequel les deux ordres de gouvernement pourront travailler de concert et faciliter l’entr�e des travailleurs �trangers temporaires de fa�on � favoriser la stabilit� et la croissance �conomiques r�gionales. Les n�gociations d’accords accessoires analogues avec les provinces et les territoires int�ress�s devraient d�buter sous peu.
En 2006, CIC a d�livr� 112 658 permis de travail temporaires.
S�lection et traitement des demandes des visiteurs et des �tudiants �trangers
De concert avec ses partenaires, CIC a men� � bien des initiatives cl�s afin d’aider le Canada � maintenir son avantage concurrentiel pour attirer les �tudiants �trangers. Le programme de permis de travail hors campus, lanc� en avril 2006, est un programme national qui permet aux �tudiants �trangers inscrits dans des �tablissements postsecondaires publics de chercher un emploi hors campus. CIC a cr�� une unit� sp�cialis�e pour s’occuper de la d�livrance des permis hors campus. Ainsi, 14 964 �tudiants ont re�u des permis de travail au cours de l’exercice 2006-2007. De plus, le programme des permis de travail pour dipl�m�s a �t� am�lior� de fa�on consid�rable : la dur�e des permis de travail aux �tudiants �trangers dipl�m�s d’�tablissements postsecondaires publics et de certains �tablissements priv�s des r�gions situ�es � l’ext�rieur de Montr�al, de Toronto et de Vancouver peut d�sormais atteindre 2 ans. L’objectif est d’aider � disseminer les avantages de l’immigration dans un plus grand nombre de r�gions du Canada. En 2006-2007, au total, 1 388 �tudiants ont obtenu un permis de travail de deux ans. Tout au long de 2006-2007, des pourparlers avec les intervenants ont eu lieu, afin d’examiner les possibilit�s d’am�liorer et d’�largir ces programmes. Des discussions sont en cours avec les partenaires � propos des orientations futures.
Les touristes et les visiteurs commerciaux contribuent de fa�on importante � notre �conomie. Ils cr�ent une demande pour les services de l’industrie touristique et permettent aux entreprises canadiennes de tirer partie de leur expertise sp�cialis�e. Pr�sentement, les citoyens de 146 pays ont besoin d’un visa de r�sident temporaire pour visiter le Canada. En 2006, CIC a trait� les demandes de visa de r�sident temporaire de 987 378 personnes d�sirant venir au Canada comme touristes ou comme visiteurs commerciaux.
B. R�sultat strat�gique 2 : Prise en compte des valeurs et int�r�ts canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s
Les questions de migration et d’enjeux humanitaires continuent d’attirer l’attention au niveau international et elles sont devenues un enjeu central dans plusieurs domaines. CIC a continu� d’�largir son r�le en encadrant et en faisant progresser une s�rie d’importants dialogues sur la politique et la gouvernance en mati�re de migrations internationales. Ces dialogues, qui progressent � des rythmes diff�rents, englobent de fa�on g�n�rale les liens entre les politiques migratoires et les affaires �trang�res dans des secteurs tels que l’aide au d�veloppement, le commerce, la sant� et les flux de capital humain. Une partie du r�le de CIC consiste � harmoniser les positions respectives du Minist�re et du gouvernement du Canada. Ce r�le r�affirme la volont� de CIC d’�tablir un plan strat�gique en mati�re de migrations internationales et de protection et de chercher des occasions de promouvoir les priorit�s des programmes et politiques du Canada, par l’�tablissement de liens et de partenariats � l’�chelle nationale et internationale.
Chaque ann�e, le Canada accorde sa protection � des milliers de personnes, dont pr�s de la moiti� sont s�lectionn�es � l’�tranger. Les autres demandent l’asile au Canada et obtiennent le statut de r�sident permanent lorsqu’il est d�termin� qu’elles remplissent les conditions requises � titre de personnes prot�g�es.
Il est essentiel de fournir, en temps opportun, des soins de sant� efficaces pour bien int�grer les personnes prot�g�es dans la soci�t� canadienne. La prestation de soins de sant� essentiels, ainsi que le diagnostic rapide des maladies et la gestion des soins n�cessaires demeurent des aspects importants de la protection des demandeurs d’asile et des autres immigrants vuln�rables, tout comme de la sant� des Canadiens.
Activit� 3 – R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection
| Description | R�sultats pr�vus |
|---|---|
| Affirmer la position du Canada dans le contexte des migrations internationales afin d’influencer le programme international en mati�re des migrations et de la protection |
Influence du Canada sur les politiques de la communaut� internationale en mati�re de migration et de protection |
Ressources financi�res (en millions de dollars)
| D�penses pr�vues |
4,9 $
|
|
| Total des autorisations |
3,9 $
|
|
| D�penses r�elles |
2,8 $
|
Explication des ressources utilis�es : Le total des autorisations a �t� inf�rieur de 1 million de dollars aux d�penses pr�vues, surtout en raison de la hausse de la valeur du dollar canadien de change pour la contribution de CIC � l’OIM.
Politique de gestion des migrations internationales
De concert avec d’autres minist�res et organismes f�d�raux, CIC a pr�par� une strat�gie concernant la participation du Canada � la gestion des migrations internationales. Au cours des consultations, il a �t� d�cid� d’�largir l’enjeu de la strat�gie de fa�on � am�liorer la coop�ration interminist�rielle. Ce travail sera entrepris en 2007-2008. � l’automne de 2006, CIC a de plus r�activ� le groupe interminist�riel sur les migrations pour renforcer la collaboration entre les minist�res et organismes f�d�raux sur les questions de migrations internationales, y compris les migrations et le d�veloppement.
CIC a dirig� les op�rations visant � faire valoir les positions et int�r�ts du Canada. � cette fin, le Minist�re a coordonn� la participation interminist�rielle � plusieurs tribunes sur les migrations internationales, notamment les Consultations intergouvernementales sur les politiques concernant le droit d’asile, les r�fugi�s et les migrations (CIG), la Conf�rence r�gionale sur les migrations (CRM), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et les Nations Unies. CIC a accord� une aide financi�re au fonctionnement et aux activit�s de la CRM, des CIG et du Migration Policy Institute (MPI), ce dernier organisant des discussions strat�giques sur les migrations aux �tats-Unis et une discussion sur la politique migratoire transatlantique. En 2006-2007, CIC a contribu� de fa�on importante au succ�s des n�gociations des lignes directrices r�gionales sur les enfants victimes de traite par l’entremise de la CRM, ainsi qu’� une nouvelle orientation strat�gique pour l’OIM. Par ailleurs, CIC a pr�par� les prises de position du gouvernement du Canada, de concert avec d’autres minist�res et organismes f�d�raux et a fait valoir efficacement les int�r�ts du Canada aux Nations Unies, dans le cadre du Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le d�veloppement, en septembre 2006.
CIC a �galement particip� directement aux dialogues bilat�raux sur les questions migratoires. Le Minist�re s’est efforc� d’obtenir un accord de coop�ration plus �troite avec la direction g�n�rale pour la libert�, la s�curit� et la justice de la Commission europ�enne, en vue de faciliter l’�change d’information et d’id�es sur les migrations. Le Minist�re a �galement re�u des d�l�gations d’�lus, de fonctionnaires et d’universitaires d’un certain nombre de pays, entre autre la Norv�ge, les �tats-Unis, la Su�de, le Royaume-Uni, la Russie et le Mexique, qui souhaitaient conna�tre l’approche du Canada en mati�re de programmes d’immigration, de protection des r�fugi�s et de citoyennet�.
Sur la sc�ne internationale, CIC a fait valoir les points de vue du Canada concernant les migrations contr�l�es. Ainsi le Minist�re a-t-il organis� et pr�sid� un atelier sur les syst�mes de points pour l’immigration � l’intention des membres de la CIG, donn� un expos� sur le sujet lors d’un s�minaire sur les lois relatives � l’immigration, au Guatemala, et particip� � l’�tablissement de l’ordre du jour et � la d�claration de cl�ture de plusieurs tribunes internationales importantes, notamment la r�union du groupe Justice et de l’Int�rieur du G8. CIC a de plus parrain� une initiative, par l’entremise de la CRM, pour pr�parer et diffuser un guide destin� � aider les membres � renforcer leur capacit� de gestion des migrations.
En 2006-2007, CIC a poursuivi ses efforts pour accro�tre son r�le et son importance dans les questions touchant le renseignement, la s�curit� et la fraude dans les programmes de la LIPR. CIC a particip� aux conf�rences de la ceinture du Pacifique et aux Conf�rences sur la fraude en mati�re d’immigration. Le Minist�re a aussi continu� d’�tablir des alliances et de promouvoir ses int�r�ts et ceux du Canada dans d’autres tribunes multilat�rales et bilat�rales.
Activit� 4 – Programme de protection des r�fugi�s
| Description | R�sultats pr�vus |
|---|---|
| Maintenir la tradition humanitaire du Canada en prot�geant les r�fugi�s et les personnes au Canada et � l’�tranger ayant besoin de protection |
Maintien de la tradition humanitaire du Canada � l’�gard des r�fugi�s et des personnes ayant besoin de protection |
Ressources financi�res (en millions de dollars)
| D�penses pr�vues |
93,7 $
|
|
| Total des autorisations |
88,7 $
|
|
| D�penses r�elles |
84,1 $
|
Explication des ressources utilis�es : Le total des autorisations a diminu� d’un montant net de 5 millions de dollars par rapport aux d�penses pr�vues en raison de transferts par le Budget suppl�mentaire des d�penses.
Les d�penses r�elles ont �t� inf�rieures de 4,6 millions de dollars au total des autorisations en raison de fonds non utilis�s pour le Programme f�d�ral de sant� int�rimaire et en raison d’une baisse des co�ts li�s � des volumes de demandes d’asile inf�rieurs aux pr�visions.
�laboration des politiques et des programmes
L’objectif du programme de protection des r�fugi�s est d’offrir une protection � ceux dont la vie est menac�e ou qui risquent la pers�cution, la torture ou encore des traitements ou des peines cruels ou inhabituels.
En 2006-2007, CIC a continu� d’examiner et de mettre en oeuvre diverses solutions pour simplifier le programme de protection des r�fugi�s au Canada. L’objectif est de parvenir plus rapidement � des d�cisions, c’est-�-dire d’octroyer la r�sidence permanente aux demandeurs admissibles dans les meilleurs d�lais et de veiller � ce que les demandeurs non admissibles voient leur situation r�gl�e promptement, sans compromettre l’�quit� et l’int�grit� du syst�me. Dans les efforts pour simplifier les m�canismes, CIC, l’ASFC et la CISR ont fusionn� les divers formulaires qu’ils utilisaient pour recueillir de l’information des demandeurs d’asile, en un seul formulaire uniformis�. Le nouveau formulaire a �t� mis � l’essai en 2006-2007 dans le cadre d’un projet pilote dans certains bureaux et l’�valuation des r�sultats est en cours.
En 2006-2007, le d�lai de traitement des demandes de r�sidence permanente pr�sent�es par les personnes prot�g�es au Canada a �t� r�duit de plusieurs mois. De plus, le fait de fournir dans les bureaux � l’�tranger de l’information sur les membres de sa famille � l’�tranger, aux premiers stades du traitement de la demande du demandeur principal, a permis de proc�der � un traitement simultan� des dossiers, ce qui a contribu� � une r�unification plus rapide des membres des familles.
En 2006-2007, CIC a maintenu ses efforts visant � utiliser de fa�on plus strat�gique le programme de r��tablissement, afin d’en accro�tre les effets sur les besoins internationaux en mati�re de protection. Le Minist�re a pris des mesures pour collaborer avec les autres minist�res et organismes f�d�raux et la collectivit� internationale, ainsi qu’avec d’autres pays de r��tablissement, afin de trouver des solutions plus durables pour les r�fugi�s. CIC a particip� en 2006-2007 aux r�ponses � diverses situations qui s’�ternisaient relativement aux r�fugi�s. le Minist�re s’est attaqu� au probl�me des r�fugi�s karens en Tha�lande et � celui des r�fugi�s rohingyas au Bangladesh et il a particip� � un groupe central international traitant des r�fugi�s bhoutanais du N�pal. CIC a �galement utilis� son programme de r��tablissement des r�fugi�s pour r�pondre � d’autres appels urgents, par exemple celui du HCR, demandant d’augmenter le nombre de recommandations pour les Irakiens.
CIC a amorc� un examen des proc�dures qui permettrait de recenser efficacement les besoins de sant� des r�fugi�s s�lectionn�s pour r��tablissement au Canada, tout en respectant leurs droits en mati�re de protection des renseignements personnels. Cet examen devrait aboutir � une am�lioration des proc�dures en 2007-2008.
En 2006, les gouvernements du Canada et des �tats-Unis ont fait un examen de la premi�re ann�e de mise en oeuvre de l’Entente sur les tiers pays s�rs. L’examen a �t� men� en collaboration avec le HCR et avec la participation des ONG. Les constatations sont les suivantes : l’accord a �t� mis en oeuvre ad�quatement et les demandeurs d’asile ont acc�s, dans un pays ou dans l’autre, � un processus int�gral et �quitable de la d�termination du statut de r�fugi�. Pour la majorit�, les recommandations du HCR ont d�j� �t� mises en oeuvre. Apr�s la publication du rapport en novembre 2006, le HCR a int�gr� son r�le de surveillance de l’accord � celui de surveillance du programme canadien de protection des r�fugi�s. CIC, l’ASFC et le HCR ont �galement cr�� un groupe de consultation qui poursuivra la t�che du groupe de travail sur les tiers pays s�rs.
En 2006-2007, CIC a poursuivi son �troite collaboration avec le HCR pour ex�cuter son programme de r��tablissement � l’�tranger et veiller � ce que le syst�me canadien d’asile respecte le droit humanitaire international. CIC a aussi collabor� avec le HCR sur des questions touchant la protection internationale en g�n�ral. En novembre 2006, le Canada a accueilli la premi�re visite de l’actuel haut-commissaire des Nations Unies pour les r�fugi�s, M. Ant�nio Guterres.
Les repr�sentants de CIC ont continu� de communiquer p�riodiquement avec le Conseil canadien pour les r�fugi�s (CCR) dans le cadre de diverses consultations, r�unions et conf�rences t�l�phoniques. Ainsi a-t-il pu y avoir des discussions constructives et importantes entre CIC et le CCR.
Une �valuation officielle du Programme de parrainage priv� de r�fugi�s (PPPR) a �t� amorc�e en 2006, de fa�on � v�rifier si le programme demeurait pertinent, dans quelle mesure il atteignait les r�sultats souhait�s et s’il serait rentable. CIC et la collectivit� des r�pondants ont travaill� de concert afin de renforcer le PPPR. � titre d’exemple, dans un effort particulier pour r�duire le volume de cas en instance, les signataires d’ententes de parrainage ont volontairement r�duit le nombre de demandes pr�sent�es en 2006 de plus de 30 %, et CIC a accru le nombre de cas du PPPR trait�s. Il en a r�sult� la plus faible augmentation annuelle des demandes � traiter en plus de cinq ans. On pr�voit une autre baisse du nombre de demandes � traiter en 2007-2008. L’extr�mit� sup�rieure de la fourchette du PPPR a �t� port�e � 4 500 pour 2007 afin d’accro�tre la marge de manoeuvre en ce qui concerne la gestion des cas de r�fugi�s qui s’�ternisent. De plus, CIC a continu� de financer un programme de formation sur l’admissibilit� des r�fugi�s afin d’aider les r�pondants priv�s � identifier les r�fugi�s. D’autres mesures administratives visant � surmonter les probl�mes du programme seront d�termin�es apr�s une conf�rence sur le programme de parrainage priv� de r�fugi�s qui doit se tenir � l’automne 2007.
L’annexe relative aux demandes d’asile de la D�claration d’entente sur l’�change d’information entre le Canada et les �tats-Unis relative aux demandeurs d’asile et demandeurs du statut de r�fugi� pr�voit l’�change syst�matique de renseignements biographiques et biom�triques entre les deux pays. L’�valuation d’un projet pilote men� en 2005 a confirm� qu’il �tait possible de mettre l’annexe en oeuvre. Avant la mise en application int�grale de l’annexe, il y aura des essais concernant l’�change de donn�es biom�triques dans les d�lais impartis.
M�me si le syst�me canadien de d�termination du statut de r�fugi� satisfait aux exigences juridiques, offre la protection � ceux qui en ont besoin et comporte des possibilit�s de contr�le des d�cisions, CIC reste d�termin� � am�liorer le syst�me de fa�on continue. Au cours de l’exercice 2006-2007, CIC a affect� des ressources suppl�mentaires au processus d’examen des risques avant renvoi (ERAR) de fa�on � relever la capacit� d�cisionnelle de l’ERAR et � mieux g�rer le nombre de cas d’ERAR attendant une d�cision.
En janvier 2007, CIC a amorc� une �valuation globale du programme d’ERAR afin de s’assurer que celui-ci prot�ge les personnes qui en ont besoin et permet de renvoyer celles qui n’en ont pas besoin. L’�valuation permettra aussi de d�gager les aspects � am�liorer. Les r�sultats de l’�valuation pourraient favoriser de futures r�formes administratives visant � am�liorer la capacit� de CIC de prendre au bon moment des d�cisions relatives aux demandeurs d’asile.
En 2006-2007, CIC, par l’entremise de l’ACDI, a fourni 1 million de dollars d’aide financi�re pour des initiatives d�coulant du Plan d’action pour le Mexique. Cette aide permettra d’aider les pays en d�veloppement d’Am�rique latine � se doter d’une capacit� de r��tablissement des r�fugi�s.
S�lection et traitement des demandes des personnes prot�g�es (r��tablissement/asile)
Le nombre de demandes de r�sidence permanente � traiter re�ues de personnes prot�g�es au Canada a �t� r�duit de pr�s de moiti�. En septembre 2005, les demandes � traiter �taient de l’ordre de 16 300; � la fin de mars 2007, leur nombre �tait d’environ 9 400 demandes. Cette baisse du nombre de demandes � traiter est due � des ressources suppl�mentaires et � un fl�chissement du nombre de demandes en 2004 et 2005.
La fourchette de 7 300 � 7 500 r�fugi�s parrain�s par le gouvernement � admettre a �t� atteinte, 7 316 r�fugi�s �tant arriv�s en 2006 dans le cadre du programme. CIC a statu� sur les demandes de plus de 8 300 personnes dans le but de r�duire le nombre de demandes � traiter dans le PPPR. La fourchette de ce programme fix�s � 3 000 � 4 000, a �galement �t� atteinte, ce qui a permis au Canada de r��tablir 3 337 r�fugi�s de plus en 2006.
En 2006, le Canada a octroy� la r�sidence permanente � 15 892 personnes prot�g�es au Canada, soit moins que la fourchette pr�vue de 19 500 � 22 000. Le nombre de personnes prot�g�es au Canada admises au pays d�pend largement du nombre de demandes d’asile pr�sent�es et du nombre de demandeurs dont on constate qu’ils ont besoin de la protection du Canada. Il n’est pas inhabituel que ces chiffres varient consid�rablement d’une ann�e � l’autre, tenu compte de l’�volution de la situation dans les pays sources. En 2006, le nombre de nouveaux cas de personnes prot�g�es au Canada a �t� tr�s inf�rieur aux pr�visions initiales. Il faut �galement signaler la baisse consid�rable du nombre de demandes en instance et la r�duction de plusieurs mois du d�lai de traitement de ces demandes de r�sidence permanente.
La fourchette cible de 3 000 � 6 800 personnes � charge de personnes prot�g�es au Canada se trouvant � l’�tranger a �t� facilement atteinte, 5 947 personnes ayant obtenu la r�sidence permanente en 2006.
Programme de pr�ts aux immigrants
Le Canada offre des pr�ts aux r�fugi�s pour les aider � assumer le co�t des examens m�dicaux � l’�tranger, des titres de voyage et (ou) du transport au Canada. Cette aide financi�re est essentielle car, souvent, les r�fugi�s n’ont que peu de ressources financi�res personnelles et ne sont pas en mesure de s’adresser aux institutions offrant habituellement des pr�ts.
Ce programme, qui a 50 ans, affiche un taux de remboursement de plus de 90 %. En 2006- 2007, CIC a continu� de faire preuve de diligence raisonnable dans le recouvrement des pr�ts, pour que le taux de recouvrement des remboursements demeure � ce niveau. Ainsi le Minist�re s’assure-t-il de la durabilit� du programme d’aide aux r�fugi�s. La limite actuelle du fonds est de 110 millions de dollars; sur cette somme, les comptes de pr�ts en souffrance totalisaient 38,1 millions de dollars au 31 mars 2007.
En 2006-2007, CIC a vers� 1,2 million de dollars du Programme d’aide au r��tablissement (PAR) afin d’all�ger les pr�ts consentis � certains r�fugi�s ayant des besoins sp�ciaux (personnes �g�es, r�fugi�s ayant des probl�mes de sant�, parents seuls ayant une famille nombreuse). De plus, le Parlement a approuv� la radiation de 978 102 $ en pr�ts � l’immigration dans le Budget suppl�mentaire des d�penses final de 2006-2007.
Programme f�d�ral de sant� int�rimaire
Dans le cadre du Programme f�d�ral de sant� int�rimaire (PFSI), CIC a continu� de fournir aux demandeurs d’asile et aux personnes prot�g�es, pendant la p�riode o� ils ne sont pas admissibles � l’assurance-maladie provinciale, la couverture de base et suppl�mentaire en mati�re de soins de sant�. En 2006-2007, 517 300 demandes ont �t� trait�es, pour un total de 44,7 millions de dollars de d�penses directes du programme. Le PFSI a ouvert l’acc�s aux services de sant� � plus de 95 000 clients admissibles, dont plus de 25 000 enfants et jeunes. De plus, le PFSI a permis de fournir des services de sant� personnalis�s � plus de 750 r�fugi�s karens de Tha�lande pour r�pondre � leurs besoins particuliers.
CIC a commenc� � pr�parer le cadre int�gr� de responsabilisation de gestion ax� sur les r�sultats et les risques du PFSI, conform�ment aux recommandations formul�es lors de l’examen ind�pendant du programme en 2006. � travers les consultations intraminist�rielles et la participation au Partenariat f�d�ral pour les soins de sant�, les politiques et les syst�mes d’ex�cution du PFSI ont �t� examin�s pour am�liorer l’efficacit�, la capacit� de r�ponse et l’int�grit� du programme. Une analyse des �carts en mati�re de communication avec les fournisseurs de services et les fournisseurs de soins de sant� a �t� men�e � bien.
C. R�sultat strat�gique 3 : Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants et promotion de la citoyennet� canadienne
Pour que le Canada tire profit des retomb�es �conomiques, sociales et culturelles de l’immigration, les nouveaux arrivants doivent s’int�grer � la soci�t� canadienne. Les programmes d’int�gration et d’�tablissement sont �galement d’une importance d�cisive pour fournir aux immigrants et aux r�fugi�s un cadre favorable qui leur permette de maximiser leur potentiel et de r�aliser leurs aspirations. Au Canada, c’est au niveau de la collectivit� que les nouveaux arrivants sont accueillis et qu’ils re�oivent une aide pour s’int�grer. Ces efforts sont soutenus par des partenariats conclus avec les provinces, les municipalit�s et les organismes communautaires. L’obtention de la citoyennet� canadienne constitue une �tape importante du processus d’�tablissement, car elle permet aux immigrants de participer pleinement � la vie de la soci�t� canadienne.
Activit� 5 – Programme d’int�gration
| Description | R�sultats pr�vus |
|---|---|
| �laborer des politiques et des programmes visant � faciliter l’�tablissement, le r��tablissement, l’adaptation et l’int�gration des nouveaux arrivants dans la soci�t� canadienne, en assurant l’ex�cution de programmes d’orientation, d’adaptation et de cours de langue � leur intention |
Int�gration r�ussie des nouveaux arrivants � la soci�t� canadienne dans un d�lai raisonnable; contribution des nouveaux arrivants afin de r�pondre aux besoins de d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada |
Ressources financi�res (en millions de dollars)
| D�penses pr�vues |
675,7 $
|
|
| Total des autorisations |
630,5 $
|
|
| D�penses r�elles |
550,6 $
|
Explication des ressources utilis�es : Le total des autorisations a diminu� d’un montant net de 45,2 millions de dollars par rapport aux d�penses pr�vues, mais surtout en raison des fonds au r��tablissement, dont la demande n’a pas progress�, mais dont l’approbation des d�penses a �t� accord�e pour les ann�es ult�rieures.
Les d�penses r�elles ont �t� inf�rieures de 79,9 millions de dollars au total des autorisations, surtout en raison de la mise de c�t� (pour report) de 67,8 millions de dollars des fonds du programme d’�tablissement en d�penses pour les ann�es futures. Le solde du montant non utilis� (12,1 millions de dollars) d�coule essentiellement d’une baisse des d�penses pr�vues dans les programmes d’�tablissement et de la p�remption de fonds g�n�raux de fonctionnement li�e � la baisse des d�penses dans le cadre de l’ACOI.
�laboration des politiques et des programmes d’�tablissement
Au cours de 2006-2007, de vastes consultations interminist�rielles et intergouvernementales ont eu lieu. Pilot�es par RHDSC, en �troite collaboration avec CIC, elles avaient pour but d’�tablir le mandat et de pr�ciser les activit�s et les structures de gouvernance n�cessaires � la cr�ation du Bureau d’orientation relatif aux titres de comp�tence �trangers (BORTCE) annonc� dans le Budget de 2007. Lanc� � CIC au printemps 2007, le BORTCE est un nouveau bureau f�d�ral qui aidera tant � l’�tranger qu’au Canada, les personnes ayant re�u une formation � l’�tranger � trouver de l’information et � avoir acc�s aux services d’aiguillage dont elles ont besoin pour mettre � profit leurs comp�tences sur le march� du travail canadien. Le BORTCE travaille en outre en �troite collaboration avec les partenaires des provinces et des territoires ainsi qu’avec les employeurs et autres intervenants afin de renforcer les m�canismes d’�valuation et de reconnaissance des titres de comp�tence �trangers au Canada.
En 2006-2007, CIC a obtenu une participation plus efficace du secteur de la recherche universitaire afin d’amorcer, dans le programme de r��tablissement, une analyse factuelle de sa politique en mati�re d’int�gration des r�fugi�s r��tablis. Le processus se poursuivra en 2007-2008.
CIC a lanc� en 2006-2007 des initiatives pilotes pour mener une �valuation et recueillir des donn�es concernant l’�laboration de programmes d’�tablissement ax�s sur les clients � l’intention de r�fugi�s r��tablis. Parmi les initiatives, mentionnons des �tudes devant aboutir � des recommandations visant des programmes mieux adapt�s aux besoins d’int�gration socio�conomique des r�fugi�s, y compris les enfants et les jeunes. Ces initiatives englobent la vaste gamme de programmes d’int�gration des nouveaux arrivants et sont mis au point avec la participation des intervenants.
En 2006-2007, CIC a termin� une �valuation nationale des besoins de formation du PAR dans le but de rendre son ex�cution plus efficace pour les clients. L’�valuation servira de base au financement de certaines initiatives de formation qui seront inscrites au budget national du PAR pour 2007-2008.
Le Minist�re a amorc� en 2006-2007 un examen des strat�gies de mesure du rendement touchant les programmes d’�tablissement. L’objectif �tait de mieux harmoniser les r�sultats des immigrants avec les r�sultats attendus du programme d’�tablissement et d’�valuer les progr�s accomplis par les immigrants, de l’obtention du droit d’�tablissement � l’int�gration � la soci�t� et (ou) au march� du travail. CIC a �galement examin� la pertinence de l’approche ax�e sur le client pour surmonter les lacunes, les obstacles et les d�fis qui touchent les immigrants. Les projets pilotes lanc�s un peu partout au Canada visaient � promouvoir l’innovation et le recours aux pratiques exemplaires dans le domaine de l’�tablissement. Parmi les projets, mentionnons les cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC) s’adressant � certains groupes, l’ajout de deux niveaux de CLIC plus �lev�s, l’apprentissage � distance, la programmation d’accueil pour les jeunes et le lancement du Programme des travailleurs de l’�tablissement dans les �coles dans de nouvelles villes et r�gions.
CIC a financ� de nouveaux projets de cours de langue de niveau avanc� (CLNA) partout au Canada (sauf au Qu�bec, au Nunavut et dans les Territoires du Nord-Ouest). La gestion et la surveillance des accords de contribution des CLNA avec les fournisseurs de services (FS) ont �t� d�centralis�es de fa�on � fusionner davantage la prestation des services d’�tablissement et d’int�gration dans les collectivit�s de l’ensemble du Canada et � appuyer les fournisseurs de services locaux. La deuxi�me conf�rence nationale sur les CLNA a rassembl� des repr�sentants des provinces et des territoires et les FS de l’ensemble du pays (sauf du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest) afin de mettre en commun les le�ons tir�es et les pratiques prometteuses. La conf�rence a �t� �galement l’occasion de communiquer les constatations pr�liminaires des questionnaires de collecte des donn�es des CLNA, remplis par les FS en Ontario, � Terre-Neuve-et-Labrador, en Alberta, en Nouvelle-�cosse et au Yukon. D’apr�s ces constatations, il appara�t que les programmes de CLNA rejoignent � la fois les hommes et les femmes de toute une gamme de pays sources. Les programmes sont utilis�s surtout par des sp�cialistes tr�s instruits de 35 � 44 ans. En majorit�, les nouveaux arrivants qui s’inscrivent � un programme de CLNA le suivent jusqu’� la fin et nombre d’entre eux ont trouv� un emploi � leur mesure. En bref, d’apr�s les constatations pr�liminaires, les CLNA atteignent leur public cible, � savoir les nouveaux arrivants qualifi�s. De plus, facteur plus important, le service aide ces nouveaux arrivants � am�liorer leurs comp�tences linguistiques, � se familiariser davantage avec le milieu du travail canadien et � �tablir des contacts dans leurs domaines professionnels.
Dans le cadre de la contribution de CIC au Plan d’action canadien contre le racisme, le Minist�re a lanc� un appel national de propositions pour appuyer les activit�s nationales antiracisme en 2006-2008, dans le cadre de l’Initiative pour les collectivit�s accueillantes. Des fonds ont �t� accord�s aux provinces et aux territoires (sauf au Qu�bec et � l’Ontario) � l’�gard d’activit�s permanentes de lutte contre le racisme. Six nouvelles initiatives ont �t� financ�es afin de soutenir les efforts de lutte contre le racisme (p. ex., recherche, outils et services directs).
CIC a men� des consultations multilat�rales avec les provinces et les territoires au cours de l’�t� 2006 afin d’�laborer un mod�le de r�partition pour distribuer de fa�on �quitable les fonds suppl�mentaires annonc�s au Budget de 2006. Les fonds seront distribu�s aux provinces et aux territoires, sauf au Qu�bec et � l’Ontario, au cours des exercices 2006-2007 et 2007-2008. La nouvelle formule de financement biennale r�pondra aux besoins imm�diats d’int�gration des immigrants et des r�fugi�s dans les provinces et territoires pertinents. Elle permettra d’am�liorer les programmes en place et de lan�er des projets pilotes pour r�pondre aux besoins de certains groupes de clients.
Soutien � l’�tablissement des nouveaux arrivants
CIC continue d’�tablir et de promouvoir des relations efficaces avec les FS charg�s de l’ex�cution du PAR. CIC a tenu en f�vrier 2007 une conf�rence nationale sur le PAR, � laquelle ont assist� 240 repr�sentants des FS, des provinces, des ONG nationales et internationales et de CIC. La conf�rence a �t� l’occasion, pour les FS, de mettre en commun leurs exp�riences, de parfaire leurs comp�tences et de fournir des recommandations aux fins d’une programmation d’�tablissement mieux ax�e sur les besoins des clients r�fugi�s.
En r�ponse � une �valuation du PAR en 2004, CIC l’a enrichi en 2006-2007 afin qu’il puisse r�pondre de fa�on plus efficace aux besoins imm�diats et essentiels des RPG, notamment une programmation de soutien accrue et un soutien au revenu pour les RPG. Les allocations du PAR ont �t� major�es pour �quivaloir aux augmentations des taux d’aide sociale des provinces, et une nouvelle allocation scolaire mensuelle a �t� ajout�e pour les enfants.
Parmi les am�liorations apport�es � la programmation en 2006-2007, il faut mentionner un nouveau programme d’orientation � l’autonomie fonctionnelle � l’intention des r�fugi�s r��tablis qui ont besoin de formation aux connaissances pratiques de base ainsi qu’une augmentation globale des heures subventionn�es de soutien des services pour chaque RPG. Ces am�liorations offrent aux FS une marge de manoeuvre accrue pour r�pondre aux besoins particuliers des r�fugi�s r��tablis.
Le programme des CLIC a permis d’offrir aux immigrants adultes une formation linguistique de base � plein temps ou � temps partiel dans l’une des langues officielles du Canada. Une nouvelle grille de placement des CLIC a �t� pr�par�e afin de favoriser la coh�rence � l’�chelle du pays dans l’application des standards linguistiques canadiens (SLC). La grille servira de nouvelle ligne directrice op�rationnelle sur la correspondance entre les nouveaux CLIC, les SLC et les quatre comp�tences linguistiques.
Le Programme d’accueil a continu� d’aider les nouveaux arrivants � s’�tablir, � s’adapter et � s’int�grer � la vie canadienne. Ce programme fait appel � des b�n�voles connaissant bien le mode de vie canadien et ayant �t� form�s par les fournisseurs de services qui s’occupent du jumelage.
Le portail de l’immigration Se rendre au Canada (www.serendreaucanada.gc.ca), mis au point par CIC et RHDSC offre des renseignements complets et int�gr�s aux immigrants �ventuels et nouveaux afin de les aider � se pr�parer � vivre, � travailler et � �tudier au Canada. Dans le cadre de cette initiative, voici les r�alisations en 2006-2007.
- Le Minist�re a conclu des ententes pluriannuelles avec la majorit� des provinces et des territoires pour les aider � pr�parer des portails Internet � l’intention des nouveaux arrivants et des immigrants �ventuels. Les portails provinciaux et territoriaux comporteront un lien vers le portail de l’immigration Se rendre au Canada du gouvernement du Canada.
- CIC et RHDSC ont amorc� une recherche d’opinion publique au Canada et � l’�tranger afin d’orienter le d�veloppement des outils et du contenu du portail.
Avec la signature de l’ACOI en novembre 2005, les gouvernements f�d�ral et provincial ont amorc� des consultations et des rencontres avec divers intervenants afin de dresser un plan strat�gique qui exposera quatre strat�gies d’intervention concernant les services d’�tablissement, la formation linguistique, les partenariats, ainsi que la recherche et la responsabilisation. Dans le cadre de l’ACOI, un ensemble de comit�s et de groupes de travail f�d�raux-provinciaux ont �t� cr��s afin de mettre en oeuvre les dispositions de l’accord et de ses annexes.
Activit� 6 – Programme de citoyennet�
| Description | R�sultats pr�vus |
|---|---|
| Concevoir, �laborer et mettre en oeuvre des politiques et des programmes visant � administrer le processus d’octroi de la citoyennet� canadienne et � promouvoir les valeurs, les droits et les obligations li�s � la citoyennet� canadienne |
Possibilit� donn�e aux r�sidents permanents admissibles � la citoyennet� de participer pleinement � la vie de la soci�t� canadienne; contribution au d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada |
Ressources financi�res (en millions de dollars)
| D�penses pr�vues |
88,2 $
|
|
| Total des autorisations |
75,0 $
|
|
| D�penses r�elles |
71,4 $
|
Explication des ressources utilis�es : Le total des autorisations �tait inf�rieur de 13,2 millions de dollars aux d�penses pr�vues en raison de transferts de fonds par l’entremise du budget suppl�mentaire des d�penses.
Les d�penses r�elles �taient inf�rieures de 3,6 millions de dollars au total des autorisations, surtout en raison de fonds g�n�raux non utilis�s � reporter sur 2007-2008.
�laboration de la politique et des programmes de citoyennet�
En mai 2006, le projet de loi C-14, Loi modifiant la Loi sur la citoyennet� (adoption) �tait d�pos� au Parlement. En 2006–2007, CIC a appuy� le projet de loi C-14 � la Chambre des communes et il prend actuellement des mesures en pr�paration � la mise en oeuvre de la Loi. � cette fin, il m�ne entre autres des consultations avec les provinces et les intervenants portant sur le contenu envisag� dans la r�glementation.
� la suite de l’annonce de la ministre en janvier 2007, le Minist�re a mis en place des politiques et des proc�dures op�rationnelles afin d’identifier les personnes qui ont r�sid� la plus grande partie de leur vie au Canada et qui croyait raisonnablement d�tenir la citoyennet� canadienne alors qu’elles ne la poss�daient pas et de faciliter leur demandes de citoyennet�. Un d�cret de remise visant les frais li�s � la citoyennet� a ainsi �t� approuv� en mars 2007. Celui-ci autorise le remboursement des droits li�s � la citoyennet� aux personnes ayant obtenu la citoyennet� ou ayant une demande de citoyennet� � l’�tude en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi sur la citoyennet�, lors qu’elles satisfassent aux conditions qui y sont expos�es.
CIC revoit continuellement ses proc�dures existantes afin d’identifier et de mettre en oeuvre des changements de mani�re � am�liorer les services destin�s � sa client�le. En 2006–2007, on a mis en oeuvre dans tous les bureaux de CIC au Canada des am�liorations en mati�re de pr�paration de dossiers, d’identification et d’examen des documents. Ces am�liorations renforceront l’int�grit� du programme et permettront d’obtenir un niveau sup�rieur de coh�rence dans la prestation des services � la client�le dans l’ensemble du pays.
Compte tenu de l’augmentation des demandes de passeports canadiens et de l’attention consacr�e par les journalistes � la citoyennet�, CIC a mis � jour son site Internet afin de fournir davantage de renseignements aux personnes qui s’inqui�tent de leur statut en mati�re de citoyennet�. Le Minist�re a de plus collabor� avec Service Canada, Passeports Canada et le MAECI de fa�on � actualiser les sites Internet des partenaires. Une unit� sp�cialis�e temporaire du T�l�centre a �t� cr��e afin de r�pondre � ces m�mes pr�occupations. De plus, nous mettons � jour les publications actuelles et en pr�parons de nouvelles pour r�pondre � ces pr�occupations.
En collaboration avec l’Institut de la citoyennet� canadienne, plusieurs s�ances de dialogues ont eu lieu entre de nouveaux citoyens et des Canadiens �tablis afin de discuter de la valeur de la citoyennet� et de la citoyennet� active.
CIC a lanc� l’Initiative des c�r�monies de citoyennet� am�lior�es afin de les rendre plus significatives et plus interactives, tant pour les nouveaux Canadiens que pour les Canadiens �tablis, et de favoriser la participation des collectivit�s. Parmi les activit�s, mentionnons la tenue de r�ceptions apr�s la majorit� des c�r�monies, l’incitation des candidats � la citoyennet� � raconter leur histoire pendant la c�r�monie, l’invitation de membres de la collectivit� aux c�r�monies tenues dans les bureaux de CIC et l’augmentation du nombre de Canadiens �tablis r�affirmant leur citoyennet� au cours de ces c�r�monies.
Traitement des demandes de citoyennet�
En 2006–2007, CIC a continu� de trouver et de mettre en oeuvre des solutions durables pour r�duire le nombre de demandes en attente et acc�l�rer le traitement de fa�on � am�liorer l’efficacit� et la satisfaction de la client�le.
� la suite du lancement d’un projet pilote en d�cembre 2006, CIC s’est joint en mars 2007 � la phase 1 du projet d’identification en temps r�el de la GRC qui permet la transmission �lectronique des empreintes digitales. Cela r�duira les d�lais de traitement des demandeurs de citoyennet� qui sont tenus de pr�senter leurs empreintes digitales.
En juillet 2006, une version am�lior�e de la calculatrice en ligne de la p�riode de r�sidence, �tait lanc�e. Cet outil en direct permet aux demandeurs d’�valuer leur admissibilit� avant d’entamer le processus de demande. Parmi les fonctions am�lior�es, mentionnons la capacit� de sauvegarder les calculs et d’y revenir ult�rieurement et celle d’inclure le temps d’incarc�ration ou de probation dans l’�valuation de l’admissibilit� � la r�sidence.
Une date d’expiration a �t� ajout�e au certificat de citoyennet� � l’intention des titulaires assujettis � des exigences de conservation. Il s’agit d’un rappel suppl�mentaire destin� � certains citoyens n�s � l’ext�rieur du Canada d’un parent canadien, qui leur incombe de pr�senter une demande de r�tention avant leur 28e anniversaire afin de conserver leur citoyennet�.
En 2006–2007, le Canada a accueilli plus de 243 000 nouveaux citoyens et a d�livr� plus de 71 000 preuves de citoyennet� canadienne.
Promotion de la citoyennet�
CIC continue de promouvoir la citoyennet� par la tenue de c�r�monies d’affirmation et de r�affirmation de la citoyennet� dans les bureaux du Minist�re et dans les collectivit�s partout au Canada. Au total, 2 999 c�r�monies de citoyennet� ont eu lieu en 2006–2007, dont 377 ont �t� tenues dans les collectivit�s.
La campagne du 60e anniversaire de la citoyennet� canadienne a �t� lanc�e au cours d’une c�r�monie de citoyennet� qui s’est tenue � la Cour supr�me du Canada en f�vrier 2007. D’autres c�r�monies du 60e anniversaire ont eu lieu tout au long de l’ann�e � travers le pays. Parmi les autres �v�nements nationaux qui ont eu lieu en 2006–2007, il faut mentionner le S�minaire national des 4 H, tenu en partenariat avec le Conseil canadien des 4 H, Red�couvrons notre citoyennet� en partenariat avec le Rotary Club d’Ottawa, une c�r�monie du cr�puscule, en partenariat avec la GRC, ainsi que des c�r�monies sp�ciales tenues dans diverses r�gions du pays lors de la F�te du Canada et pendant la Semaine des anciens combattants. La Semaine de la citoyennet� du Canada offre l’occasion � tous les Canadiens de r�fl�chir � la valeur de la citoyennet�, � la signification que rev�t le fait d’�tre Canadien, ainsi qu’aux droits, privil�ges et responsabilit�s attach�s � la citoyennet�.
Partie 3 : Information suppl�mentaire
A. Organigramme
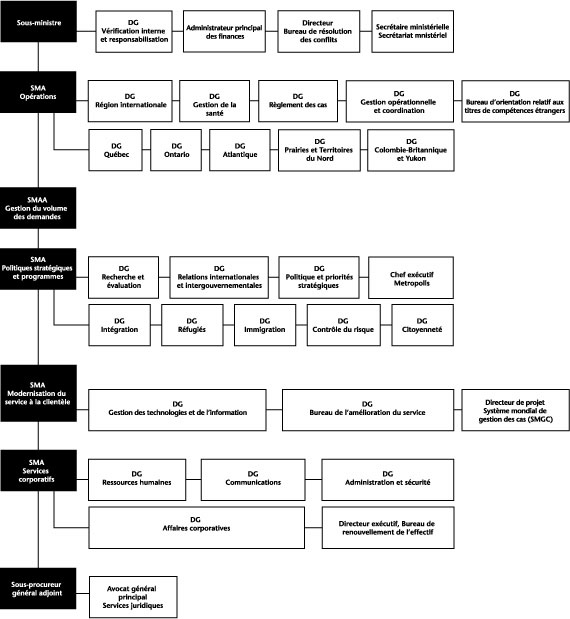
B. Responsabilit�s
Ministre
L’honorable Diane Finley est la ministre responsable de Citoyennet� et Immigration Canada.
Sous-ministre
Le sous-ministre, Richard B. Fadden, est appuy� par quatre sous-ministres adjoints et un sousministre adjoint associ�. Rel�vent �galement de lui le directeur g�n�ral, V�rification interne et responsabilisation, l’administrateur principal des finances, le directeur du Bureau de r�solution des conflits et la secr�taire minist�rielle. Le sousprocureur g�n�ral adjoint dirige
l’�quipe du minist�re de la Justice fournissant des services juridiques au Minist�re.
Sous-ministre adjoint, Op�rations
Le Secteur des op�rations est responsable de toutes les activit�s d’ex�cution des programmes du Minist�re et comprend les R�gions int�rieures, la R�gion internationale, les directions g�n�rales du R�glement des cas et de la Gestion de la sant�, de m�me que le Bureau d’orientation relatif aux titres de comp�tences �trangers. Il comprend aussi la Direction g�n�rale de la
gestion op�rationnelle et de la coordination, qui g�re des centres sp�cialis�s de traitement des cas � Mississauga (Ontario), � Vegreville (Alberta) et � Sydney (Nouvelle-�cosse), de m�me que le T�l�centre national � Montr�al et le Centre des demandes de renseignements, situ� � Ottawa.
Sous-ministre adjoint associ�, Gestion du volume des demandes
Le Secteur de la gestion du volume des demandes dirige le projet visant � mettre au point une strat�gie pour g�rer le volume de demandes en instance. Le SMAA travaille en �troite collaboration avec le SMA des Op�rations et son homologue de Politiques strat�giques et programmes, pour r�pondre aux priorit�s du Minist�re et du gouvernement en ce qui a trait au programme
d’immigration.
Sous-ministre adjoint, Politiques strat�giques et de programmes
Le Secteur des politiques strat�giques et de programmes g�re le programme strat�gique du Minist�re sur le plan national et international et m�ne � bonne fin les strat�gies connexes en mati�re de politique, de planification et de recherche. Ce secteur comprend : Politique strat�gique et priorit�s, Immigration, Int�gration, R�fugi�s, Citoyennet�, Contr�le du risque, Relations
internationales et intergouvernementales et Recherche et �valuation.
Sous-ministre adjoint, Modernisation du service � la client�le
Le Secteur de la modernisation du service � la client�le g�re la restructuration du mod�le de prestation de services de CIC, �tablit les priorit�s en mati�re d’am�lioration des services et dirige les investissements dans les programmes afin d’obtenir les meilleurs r�sultats possibles pour les clients de CIC. Ce secteur comprend la Direction g�n�rale de la gestion et des
technologies de l’information (qui comprend le projet du Syst�me mondial de gestion des cas), de m�me que le Bureau de l’am�lioration du service.
Sous-ministre adjoint, Services corporatifs
Le Secteur des services corporatifs est charg� du programme de gestion de CIC et regroupe les principales fonctions de gestion minist�rielles. Le secteur comprend les directions g�n�rales suivantes : Administration et s�curit�, Ressources humaines, Communications, Affaires corporatives et le Bureau de renouvellement de l’effectif.
Partie 4 : Tableaux
Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et r�elles, y compris les ETP (�quivalents temps plein)
Le tableau qui suit contient un �tat des d�penses par activit� de programme. Il fournit �galement une comparaison des d�penses totales pr�vues pour 2006-2007 et des d�penses r�elles inscrites aux Comptes publics.
| Activit� de programme (en millions de dollars) |
D�penses r�elles 2004–2005 |
D�penses r�elles 2005–2006 |
2006–2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des d�penses |
D�penses pr�vues |
Total des autorisations |
D�penses r�elles [a] |
|||
| Programme d’immigration |
206,3
|
191,1
|
198,4
|
197,2
|
267,5
|
244,8
|
| Programme des r�sidents temporaires |
110,3
|
101,5
|
89,5
|
89,1
|
118,3
|
104,9
|
| R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection |
5,0
|
2,6
|
4,9
|
4,9
|
3,9
|
2,8
|
| Programme des r�fugi�s |
88,8
|
80,3
|
94,0
|
93,7
|
88,7
|
84,1
|
| Programme d’int�gration |
414,7
|
445,0
|
638,6
|
675,7
|
630,5
|
550,6
|
| Programme de citoyennet� |
57,7
|
61,2
|
85,6
|
88,2
|
75,0
|
71,4
|
| Revitalisation du secteur riverain de Toronto [b] |
0,0
|
0,8
|
115,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| Total [c] |
882,8
|
882,5
|
1 226,8
|
1 148,8
|
1 183,9
|
1 058,6
|
| Moins : Recettes non disponibles |
(506,6)
|
(500,8)
|
(436,1)
|
(436,1)
|
(436,1)
|
(451,6)
|
| Plus : Co�t des services re�us sans frais [d] |
240,6
|
231,6
|
223,8
|
223,8
|
237,1
|
237,1
|
| Total des d�penses minist�rielles |
616,8
|
613,3
|
1 014,5
|
936,5
|
984,9
|
844,1
|
| �quivalents temps plein (ETP) |
4 039
|
|||||
[a] Pour une explication des �carts, voir la Partie 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique.
[b] La responsabilit� de l’Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto (IRSTR) a �t� transf�r�e par d�cret au SCT le 6 f�vrier 2006.
[c] Les d�penses pr�vues, d’un montant de 1 148,8 millions de dollars, ont diminu� par rapport au Budget principal des d�penses en raison surtout du transfert pr�vu de l’IRSRT. Les d�penses r�elles, soit 1 058,6 millions de dollars, �taient inf�rieures de 125,3 millions de dollars au total des autorisations, en raison surtout des fonds r�serv�s � d�penser par report dans les ann�es ult�rieures. Le reste de la baisse des besoins (41,3 millions de dollars) �tait surtout imputable � un montant de 21 millions de dollars de fonds de fonctionnement inutilis�s d�sign�s pour report � l’exercice suivant, � des d�penses inf�rieures aux pr�visions dans les programmes d’�tablissement et � d’autres fonds g�n�raux de fonctionnement inutilis�s.
[d] Sont compris dans les services re�us sans frais les locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, la contribution de l’employeur aux primes d’assurances des employ�s, pay�e par le SCT, les services juridiques fournis par le minist�re de la Justice et les services d’immigration fournis � l’�tranger par Affaires �trang�res et Commerce international Canada (voir tableau 4).
Tableau 2 : Ressources par activit� de programme
Le tableau qui suit contient des renseignements sur la fa�on dont les ressources ont �t� utilis�es en 2006-2007, par activit� de programme et type de d�penses. Pour une explication des �carts dans chaque activit� de programme, voir la Partie II : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique.
| Activit� de programme (en millions de dollars) |
Fonctionnement [a] |
Subventions et contributions [b] |
Total |
|---|---|---|---|
| Programme d’immigration | |||
| Budget principal des d�penses |
198,4
|
0,0
|
198,4
|
| D�penses pr�vues |
197,2
|
0,0
|
197,2
|
| Total des autorisations |
267,5
|
0,0
|
267,5
|
| D�penses r�elles |
244,8
|
0,0
|
244,8
|
| Programme des r�sidents temporaires | |||
| Budget principal des d�penses |
89,5
|
0,0
|
89,5
|
| D�penses pr�vues |
89,1
|
0,0
|
89,1
|
| Total des autorisations |
118,3
|
0,0
|
118,3
|
| D�penses r�elles |
104,9
|
0,0
|
104,9
|
| R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection |
|||
| Budget principal des d�penses |
2,6
|
2,3
|
4,9
|
| D�penses pr�vues |
2,6
|
2,3
|
4,9
|
| Total des autorisations |
1,6
|
2,3
|
3,9
|
| D�penses r�elles |
1,4
|
1,4
|
2,8
|
| Programme des r�fugi�s | |||
| Budget principal des d�penses |
94,0
|
0,0
|
94,0
|
| D�penses pr�vues |
93,7
|
0,0
|
93,7
|
| Total des autorisations |
88,7
|
0,0
|
88,7
|
| D�penses r�elles |
84,1
|
0,0
|
84,1
|
| Programme d’int�gration | |||
| Budget principal des d�penses |
43,8
|
594,8
|
638,6
|
| D�penses pr�vues |
45,5
|
630,2
|
675,7
|
| Total des autorisations |
37,1
|
593,4
|
630,5
|
| D�penses r�elles |
32,2
|
518,4
|
550,6
|
| Programme de citoyennet� | |||
| Budget principal des d�penses |
85,6
|
0,0
|
85,6
|
| D�penses pr�vues |
85,2
|
3,0
|
88,2
|
| Total des autorisations |
72,0
|
3,0
|
75,0
|
| D�penses r�elles |
68,4
|
3,0
|
71,4
|
| Revitalisation du secteur riverain de Toronto | |||
| Budget principal des d�penses |
1,2
|
114,6
|
115,8
|
| D�penses pr�vues |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| Total des autorisations |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| D�penses r�elles |
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| TOTAL | |||
| Budget principal des d�penses |
515,1
|
711,7
|
1,226,8
|
| D�penses pr�vues |
513,3
|
635,5
|
1,148,8
|
| Total des autorisations |
585,2
|
598,7
|
1,183,9
|
| D�penses r�elles |
535,8
|
522,8
|
1,058,6
|
[a] Les d�penses de fonctionnement comprennent les cr�dits l�gislatifs indiqu�s au Tableau 3 : Postes budg�taires vot�s et l�gislatifs.
[b] Plus de pr�cisions sur les subventions et contributions au Tableau 10 : D�tails sur les programmes de paiement de transfert.
Tableau 3 : Postes budg�taires vot�s et l�gislatifs
Le tableau qui suit illustre la fa�on dont le Parlement accorde des ressources au Minist�re dans le Budget principal des d�penses (cr�dits 1, 2 et 5) et fournit � titre d’information des d�tails l�gislatifs (marqu�s d’un � L �).
| Poste (en millions de dollars) |
2006–2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal des d�penses |
D�penses pr�vues [a] |
Total des autorisations [b] |
D�penses r�elles [c] |
||
| 1 | D�penses de fonctionnement |
471,9
|
470,1
|
489,6
|
440,2
|
| 2 | Radiation de dettes |
0,0
|
0,0
|
1,0
|
1,0
|
| 5 | Subventions et contributions |
711,7
|
635,5
|
598,7
|
522,8
|
| (L) | Salaires et allocations d’automobile |
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
| (L) | Contributions aux r�gimes d’avantages sociaux des employ�s |
43,1
|
43,1
|
40,5
|
40,5
|
| (L) | Remboursement des sommes cr�dit�es aux recettes des exercices pr�c�dents |
0,0
|
0,0
|
53,9
|
53,9
|
| (L) | Montants adjug�s par les tribunaux |
0,0
|
0,0
|
0,1
|
0,1
|
| Total [d] |
1 226,8
|
1 148,8
|
1 183,9
|
1 058,6
|
|
[a] Le total des d�penses pr�vues provient du Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007.
[b] Le total des autorisations est tir� des Comptes publics 2006-2007, qui comprennent le Budget principal des d�penses, plus le Budget suppl�mentaire des d�penses.
[c] Le total des d�penses r�elles est tir� des Comptes publics 2006-2007. Pour une explication des �carts par activit� de programme, voir la Partie 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique.
[d] Les d�penses pr�vues, d’un montant de 1 148,8 millions de dollars, ont diminu� par rapport au Budget principal des d�penses, en raison surtout du transfert pr�vu de l’IRSRT. Les d�penses r�elles, soit 1 058,6 millions de dollars, �taient inf�rieures de 125,3 millions de dollars au total des autorisations, en raison surtout des fonds r�serv�s � d�penser par report aux ann�es ult�rieures. Le reste de la baisse des besoins (41,3 millions de dollars) �tait surtout imputable � un montant de 21 millions de dollars de fonds de fonctionnement inutilis�s d�sign�s pour report � l’exercice suivant, � des d�penses inf�rieures aux pr�visions dans les programmes d’�tablissement et � d’autres fonds g�n�raux de fonctionnement inutilis�s.
Tableau 4 : Services re�us sans frais
Le tableau qui suit fait �tat des co�ts des services fournis gratuitement par d’autres minist�res.
| (en millions de dollars) | 2006–2007 |
|---|---|
| Locaux • Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
30,0
|
| Contribution de l’employeur aux avantages sociaux des employ�s couvrant les primes d’assurances et les d�penses • Secr�tariat du Conseil du Tr�sor |
20,3
|
| Co�t de l’indemnisation des travailleurs • Ressources humaines et D�veloppement social Canada |
0,1
|
| Services juridiques • Justice Canada |
38,7
|
| Services d’immigration � l’�tranger • Affaires �trang�res et Commerce international Canada |
148,0
|
| Total des services re�us sans frais |
237,1
|
Tableau 5 : Pr�ts, investissements et avances (non budg�taires)
| Changements annuels (en millions de dollars) |
2004–2005 | 2005–2006 | 2006–2007 |
|---|---|---|---|
| Solde d’ouverture |
42 494 280$
|
41 942 973 $
|
40 271 171 $
|
| Nouveaux pr�ts et int�r�ts courus |
14 120 206$
|
13 573 606 $
|
13 049 038 $
|
| Recettes (montants recouvr�s) |
(13 757 773 $)
|
(15 245 408 $)
|
(14 261 861 $)
|
| Radiation |
(913 740 $)
|
0,00 $
|
(978 102 $)
|
| Solde de cl�ture |
41 942 973 $
|
40 271 171 $
|
38 080 246 $
|
Le total des autorisations est de 110 millions de dollars en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’immigration et la protection des r�fugi�s.
Tableau 6 : Sources des recettes non disponibles
| Activit� de programme (en millions de dollars) |
Recettes r�elles 2004–2005 |
Recettes r�elles 2005–2006 |
2006–2007 | |
|---|---|---|---|---|
| Recettes pr�vues |
Recettes r�elles |
|||
| Programme d’immigration | ||||
| Frais de traitement – R�sidents permanents |
149,2
|
130,1
|
154,5
|
164,9
|
| Frais relatifs au droit de r�sidence permanente [a] |
165,8
|
145,0
|
73,5
|
74,1
|
| Int�r�ts sur pr�ts (Programme de pr�ts aux immigrants) |
0,9
|
0,8
|
1,0
|
0,7
|
| Programme des r�sidents temporaires | ||||
| Frais de traitement – R�sidents temporaires |
132,0
|
142,7
|
140,0
|
147,2
|
| R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales |
N�ant
|
N�ant
|
N�ant
|
N�ant
|
| Programme des r�fugi�s | ||||
| Frais de traitement – R�fugi�s |
6,9
|
11,2
|
11,0
|
14,0
|
| Programme d’int�gration |
N�ant
|
N�ant
|
N�ant
|
N�ant
|
| Programme de citoyennet� | ||||
| Frais de traitement – Citoyennet� |
26,0
|
38,1
|
33,7
|
27,6
|
| Droits exig�s pour la citoyennet� |
18,4
|
26,9
|
22,3
|
18,4
|
| Sous-total |
499,2
|
494,8
|
436,0
|
446,9
|
| Autres recettes | ||||
| Droits pour l’acc�s � l’information |
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
| Remboursements de d�penses des ann�es ant�rieures [b] |
7,0
|
5,7
|
N�ant
|
4,0
|
| Divers [c] |
0,3
|
0,2
|
N�ant
|
0,6
|
| Total des recettes [d] |
506,6
|
500,8
|
436,1
|
451,6
|
[a] Le 3 mai 2006, les frais relatifs au droit de r�sidence permanente ont �t� ramen�s de 975 $ � 490 $, ce qui entra�ne une baisse des recettes en 2006-2007.
[b] Les remboursements de d�penses des ann�es ant�rieures comprennent le recouvrement des cr�ances irr�couvrables, les ajustements aux comptes cr�diteurs des ann�es ant�rieures et les remboursements de d�penses des ann�es ant�rieures.
[c] En 2004-2005, des recettes associ�es � la perte de droits aux prestations ont �t� transf�r�es � l’ASFC, dans le cadre du transfert des responsabilit�s effectu� le 8 octobre 2004.
[d] En 2006-2007, les recettes r�elles, soit 451,6 millions de dollars, d�passaient de 15,5 millions de dollars les recettes pr�vues, �tablies � 436,1 millions de dollars. L’augmentation est en grande partie attribuable au programme d’immigration (augmentation de 10,7 millions de dollars) et au programme des r�sidents temporaires (augmentation de 7,2 millions de dollars). Cela rend compte d’un volume de demandes de r�sidence permanente et de r�sidence temporaire plus �lev� que pr�vu et de recettes plus �lev�es tir�es des frais associ�s.
REMARQUES :
- Des frais sont exig�s par rapport au co�t total du service fourni par le gouvernement du Canada.
- Les recettes sont vers�es au Tr�sor et ne peuvent �tre d�pens�es par le Minist�re.
- Pour le bar�me des frais exig�s par CIC, voir au www.cic.gc.ca/francais/information/frais/bareme.asp.
Tableau 7-A : Frais d’utilisation
| 2006–2007 | Ann�es de planification | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frais d’utilisation | Type de frais | Pouvoir d’exiger des frais | Date de la derni�re modification | Recettes pr�vues (en milliers de $) [note 1] |
Recettes r�elles (en milliers de $) [note 2] |
Co�t total (en milliers de $) [note 3] |
Norme de rendement [notes 4 et 5] |
R�sultats li�s au rendement [notes 5 et 6] | Exercice | Recettes pr�vues (en milliers de $) [note 7] |
Co�t total estimatif (en milliers de $) |
| Frais relatifs au droit de r�sidence permanente | Frais r�glementaires | Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP); LIPR et RIPR | 3 mai 2006 | 73 500 $ | 74 132 $ | Ces frais n’entra�nent aucun co�t, parce qu’ils sont exig�s en reconnaissance des avantages tangibles et intangibles que procure l’acquisition du statut de r�sident permanent. Ces frais ont �t� �tablis dans le budget f�d�ral de 1995. | Ces frais doivent �tre acquitt�s par les personnes qui acqui�rent le statut de r�sident permanent. (Voir : Nouveau r�sident permanent en 2006, tableau de la page 21) Les personnes prot�g�es et leurs personnes � charge ne paient pas ces frais. |
Ces frais sont �troitement li�s au traitement des demandes de r�sidence permanente. | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
73 500 $ 73 500 $ 73 500 $ |
Ces frais n’entra�nent aucun co�t parce qu’ils sont exig�s en reconnaissance des avantages tangibles et intangibles que procure l’acquisition du statut de r�sident permanent. Ces frais ont �t� �tablis dans le budget f�d�ral de 1995. |
| Frais relatifs au traitement de la demande de r�sidence permanente, frais relatifs � la carte de r�sident permanent, frais relatifs au titre de voyage de r�sident permanent et frais relatifs � la demande de parrainage pour les cat�gories du regroupement familial | Frais r�glementaires | LIPR et RIPR | 28 juin 2002 | 164 000 $ | 177 031 $ | 282 600 $ |
Demandes de r�sidence permanente Au Canada : Les d�lais moyens de traitement observ�s r�cemment pour les Centres de traitement des demandes sont publi�s sur le site Web de CIC. Ces d�lais sont des estimations et sont mis � jour chaque semaine. www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp Carte de r�sident permanent :
Titre de voyage de r�sident permanent : |
Demande de r�sidence permanente Au Canada : Parrainage : Actuellement, 99 % des engagements (�poux, enfants) sont trait�s dans les 32 jours. Autres cat�gories : L’examen initial des demandes de RP est actuellement effectu� dans les 6 � 19 mois selon la cat�gorie d’immigrants. Carte de r�sident permanent : Au Canada : Les demandes de carte des nouveaux RP sont trait�es dans les 3 � 4 semaines. Le d�lai de traitement des demandes d’une premi�re carte ou de remplacement ou de renouvellement d’une carte de RP est actuellement de 30 jours. Titre de voyage de r�sident permanent : � l’�tranger : Les d�lais de traitement r�cemment observ�s laissent voir que 70 % des demandes se d�cident dans les 2 jours. |
2007-2008 2008-2009 2009-2010 | 171 200 $ 178 900 $ 178 900 $ | 282 600 $ 282 600 $ 282 600 $ |
| Frais relatifs au permis de travail (individus ou groupes d’artistes de spectacle) | Frais r�glementaires | LIPR et RIPR | 2 janvier 1997 | 27 300 $ | 33 565 $ | 73 500 $ |
� l’�tranger : Au Canada : Les d�lais moyens r�cents de traitement des Centres de traitement des demandes sont publi�s sur le site Web de CIC. Ces d�lais sont des estimations et sont mis � jour chaque semaine. www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp |
� l’�tranger : Dans l’ann�e civile 2006, 72 % des demandes ont �t� trait�es dans les 28 jours. Au Canada : La moyenne des d�lais de traitement observ�e r�cemment est de 24 jours civils au CTD-Vegreville |
2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
27 300 $ 27 300 $ 27 300 $ |
73 500 $ 73 500 $ 73 500 $ |
| Frais relatifs au permis d’�tudes | Frais r�glementaires | LIPR et RIPR | 1er juin 1994 | 20 000 $ | 18 874 $ | 33 100 $ | Voir ci-dessus. |
� l’�tranger : Dans l’ann�e civile 2006, 76 % des demandes ont �t� trait�es dans les 28 jours. Au Canada : La moyenne des d�lais de traitement observ�e r�cemment est de 37 jours civils au CTD-Vegreville |
2007-2008 2008-2009 |
20 000 $ 20 000 $ 20 000 $ |
33 100 $ 33 100 $ 33 100 $ |
| Frais relatifs � la demande de visa de r�sident temporaire et frais relatifs � la demande de prorogation de l’autorisation de s�journer au Canada � titre de r�sident temporaire | Frais r�glementaires | LIPR et RIPR | 2 janvier 1997 | 88 800 $ | 90 534 $ | 102 300 $ |
� l’�tranger : Au Canada : Prorogation : Les d�lais de traitement moyens r�cents des Centres de traitement des demandes sont publi�s sur le site Web de CIC. Ces d�lais sont des estimations et sont mis � jour chaque semaine. www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp |
� l’�tranger : Dans l’ann�e civile 2006, 62 % des demandes de visa de r�sident temporaire ont �t� trait�es dans les 2 jours. Au Canada : Prorogation du statut : Le d�lai moyen de traitement observ� r�cemment est de 34 jours civils au CTD-Vegreville. |
2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
88 800 $ 88 800 $ 88 800 $ |
102 300 $ 102 300 $ 102 300 $ |
| Frais de permis de s�jour temporaire | Frais r�glementaires | LIPR et RIPR | 2 janvier 1997 | 2 500 $ | 2 321 $ | 6 900 $ |
� l’�tranger : Traitement rapide Au Canada : Les d�lais de traitement moyens r�cents des Centres de traitement des demandes sont publi�s sur le site Web de CIC. Ces d�lais sont des estimations et sont mis � jour chaque semaine. www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp |
Permis de s�jour temporaire : Le d�lai de traitement moyen observ� r�cemment est de 34 jours civils au CTD-Vegreville. � l’�tranger : Les PST visent � surmonter une interdiction de territoire d�gag�e au cours du traitement de tout type de demande de visa. Il n’existe pas de donn�es sur les d�lais de traitement des PST. Ils sont trait�s rapidement, mais les diff�rences sur le plan de la complexit� des cas et des interdictions de territoire dont il faut tenir compte signifient qu’il ne peut y avoir de norme de service. |
2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ |
6 900 $ 6 900 $ 6 900 $ |
| Frais relatifs au r�tablissement du statut de r�sident temporaire | Frais r�glementaires | LIPR et RIPR | 28 juin 2002 | 1 400 $ | 1 932 $ | Les co�ts de r�tablissement du statut de r�sident temporaire ne sont pas divulgu�s s�par�ment dans le mod�le de gestion des co�ts de CIC, mais sont inclus dans les co�ts des visas de r�sident temporaire, permis d’�tudes et permis de travail. | Les d�lais de traitement moyens r�cents sont publi�s sur le site Web de CIC. Ces d�lais sont des estimations et sont mis � jour chaque semaine. www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp | Le d�lai de traitement moyen observ� r�cemment est de 34 jours civils au CTD-Vegreville. | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
1 400 $ 1 400 $ 1 400 $ |
Les co�ts de r�tablissement du statut de r�sident temporaire ne sont pas divulgu�s s�par�ment dans le mod�le de gestion des co�ts de CIC, mais sont inclus dans les co�ts des visas de r�sident temporaire, permis d’�tudes et permis de travail. |
| Autres services d’immigration (r�adaptation, autorisation de revenir au Canada, donn�es statistiques sur l’immigration, attestation et remplacement de documents d’immigration) | Frais r�glementaires | LIPR et RIPR | Divers | 1 500 $ | 1 853 $ | 2 200 $ [note 8] |
Attestation et remplacement de documents d’immigration : 6 � 8 semaines. � l’�tranger : Les autorisations de revenir au Canada (ARC) sont trait�es rapidement, mais, en raison de la nature et de la complexit� extr�mement variable des cas d’ARC, il n’existe pas de norme de service. |
Remplacement de documents d’immigration : actuellement, 6 � 8 semaines. � l’�tranger : Voir les observations sur les normes de service. |
2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ |
2 200 $ 2 200 $ 2 200 $ [note 8] |
| Droits exig�s pour la citoyennet� | Frais r�glementaires | LGFP; Loi sur la citoyennet� et R�glement sur la citoyennet� | 2 janvier 1997 | 22 300 $ | 18 370 $ | Ces frais ont �t� �tablis dans le Budget f�d�ral de 1995 et sont exig�s en reconnaissance des avantages tangibles et intangibles que procure l’acquisition du statut de citoyen au Canada. Aucun co�t n’est associ� � ces frais. | Ces frais sont exig�s des personnes obtenant le statut de citoyen. (Voir la section 2 sur la citoyennet� pour les d�tails.) Les personnes de moins de 18 ans ne paient pas ces droits. |
Ces droits sont li�s � l’acquisition du statut de citoyen canadien. (Voir Frais relatifs � une modification de la citoyennet�.) | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 |
22 300 $ 22 300 $ 22 300 $ |
Ces frais ont �t� �tablis dans le Budget f�d�ral de 1995 et sont exig�s en reconnaissance des avantages tangibles et intangibles que procure l’acquisition du statut de citoyen au Canada. Aucun co�t n’est associ� � ces frais. |
| Frais relatifs � une modification de la citoyennet� : attribution, conservation, r�int�gration, r�pudiation | Frais r�glementaires | Loi sur la citoyennet� et R�glement sur la citoyennet� | 2 janvier 1997 | 27 900 $ | 22 443 $ | 68 600 $ | Les d�lais de traitement moyens r�cents sont publi�s sur le site Web de CIC. Ces d�lais sont des estimations et sont mis � jour chaque semaine. www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp | En 2006-2007, les d�lais de traitement des demandes de citoyennet� (attribution de la citoyennet�) ont �t� ramen�s de 15 � 18 mois � 12 mois. | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 | 27 900 $ 27 900 $ 27 900 $ |
68 600 $ 68 600 $ 68 600 $ |
| Frais relatifs au document de la citoyennet� : attestation de la citoyennet� et recherches dans les dossiers de la citoyennet� | Frais r�glementaires | Loi sur la citoyennet� et R�glement sur la citoyennet� | 2 janvier 1997 | 5 800 $ | 5 184 $ | 20 700 $ | Les d�lais de traitement moyens r�cents sont publi�s sur le site Web de CIC. Ces d�lais sont des estimations et sont mis � jour chaque semaine. www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp | En 2006-2007, les d�lais de traitement pour la d�livrance d’un certificat de citoyennet� (attestation de la citoyennet�) ont �t� ramen�s de 5 � 7 mois � 3 mois. | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 | 5 800 $ 5 800 $ 5 800 $ |
20 700 $ 20 700 $ 20 700 $ |
| Frais exig�s pour le traitement des demandes d'acc�s � l’information en vertu de la Loi sur l’acc�s � l'information (LAI) | Autres produits et services | Loi sur l’acc�s � l’information | 1992 | 100 $ | 79 $ | 1 800 $ [note 9] |
R�ponse fournie dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande; le d�lai de r�ponse peut �tre prorog� conform�ment � l'article 9 de la LAI. Un avis de prorogation doit �tre envoy� dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande. La Loi sur l’acc�s � l'information fournit de plus amples d�tails: http://laws.justice.gc.ca/fr/a-1/218072.html. |
En 2006-2007, CIC a re�u 10 497 demandes pr�sent�es en vertu de la Loi sur l'acc�s � l'information et a trait� 10 667 demandes pendant la m�me p�riode (certaines demandes �taient report�es de l’ann�e pr�c�dente). CIC a fourni une r�ponse dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande dans 67,8 % des cas. Le d�lai de r�ponse a �t� prorog� dans 32,2 % des cas. Globalement, CIC a respect� les d�lais dans 95 % des demandes, au cours de l’ann�e. | 2007-2008 2008-2009 2009-2010 | 100 $ 100 $ 100 $ |
1 800 $ 1 800 $ 1 800 $ [note 9] |
| Frais d’utilisation | Total 435 100 $ |
Total 446 318 $ |
Total 591 700 $ |
Sous‑total : Sous-total : Sous-total : |
442 300 $ 450 000 $ 450 000 $ |
591 700 $ 591 700 $ 591 700 $ |
REMARQUES
Note 1 : Source : Rapport sur les plans et les priorit�s 2006-2007.
Note 2 : Les remises pour l’ann�e en cours ont �t� d�falqu�es de tous les montants.
Note 3 : Les montants globaux du co�t total et du co�t total estimatif pour 2004-2005 comprennent une estimation des co�ts pour les autres minist�res et correspondent aux meilleures donn�es disponibles. Les autres minist�res et organismes qui participent au mod�le de gestion des co�ts de CIC pour 2004-2005 sont : MAECI; Travaux publics et Services gouvernementaux Canada; Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, CISR; GRC; Services administratifs des tribunaux judiciaires; Cour f�d�rale, Section de premi�re instance; Cour d’appel f�d�rale et RHDSC. L’ASFC, le minist�re de la Justice et le Service canadien du renseignement de s�curit� ne sont pas compris.
Note 4 : Les d�lais de traitement indiqu�s correspondent � une moyenne et changent souvent selon le nombre de demandes re�ues. Les d�lais de traitement � l’�tranger ne sont pas une moyenne.
Note 5 : Les frais qui existaient et ceux qui ont �t� modifi�s avant l’entr�e en vigueur de la Loi sur les frais d’utilisation, le 31 mars 2004, ne sont pas assujettis � cette loi. Par cons�quent :
- la norme de rendement, si elle est fournie, peut ne pas avoir fait l’objet d’un examen parlementaire;
- la norme de rendement, si elle est fournie, peut ne pas respecter toutes les exigences pr�vues par la Loi sur les frais d’utilisation (p. ex., comparaison internationale; traitement ind�pendant des plaintes);
- les r�sultats li�s au rendement, s’ils sont fournis, ne sont pas juridiquement assujettis � la Loi sur les frais d’utilisation.
Note 6 : Les donn�es statistiques pour les r�gions int�rieures ont �t� actualis�es au 31 mars 2007.
Note 7 : Source : Rapport sur les plans et priorit�s 2006-2007.
Note 8 : Le co�t total ne comprend que les frais relatifs aux cas de r�adaptation et � l’autorisation de revenir au Canada.
Note 9 : Source : Rapport annuel 2005-2006 – Loi sur la protection des renseignements personnels et Loi sur l’acc�s � l’information.
Tableau 7-B : Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation
Consulter le site www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr2/06-07/index_f.asp pour obtenir des renseignements concernant la politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation.
Tableau 8 : Progr�s par rapport au plan de r�glementation du Minist�re
Consulter le site www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr2/06-07/index_f.asp pour obtenir des renseignements concernant le progr�s en fonction du plan de r�glementation du Minist�re.
Tableau 9 : Rapport d’�tape sur les grands projets de l’�tat
On trouvera ci-apr�s un r�sum� des grands projets de l’�tat auxquels est associ� le Minist�re. Pour en savoir davantage sur les grands projets de l’�tat, voir au www.tbs-sct.gc.ca/rma/dpr2/06- 07/index_f.asp.
| Grand projet de l’�tat | Description |
|---|---|
| Syst�me mondial de gestion des cas (SMGC) |
Le SMGC est un programme pluriannuel destin� � remplacer plusieurs syst�mes administratifs d�suets, archa�ques et incompatible de CIC et de l’ASFC, dont certains sont vieux de 30 ans, et � appuyer le fonctionnement de plus de 240 points de service au Canada et de par le monde. C’est un ensemble int�gr� d’applications et d’�l�ments d’infrastructure ax�s sur la gestion des cas qui soutiendra les activit�s relatives aux clients de CIC et de l’ASFC. Une fois en place, le SMGC permettra de mieux prot�ger l’int�grit� globale du programme, d’en accro�tre l’efficacit� et d’am�liorer la prestation des services � la client�le, en plus de faciliter la communication et l’�change de donn�es entre CIC et l’ASFC et les autres partenaires aux fins de l’administration de la LIPR. De plus, le SMGC fournira �galement l’assise technologique n�cessaire pour soutenir les nouvelles initiatives fonctionnelles et tirer parti des technologies innovatrices en rempla�ant des syst�mes p�rim�s qui sont extr�mement difficiles � supporter et � maintenir. |
Tableau 10 : Renseignements sur les programmes de paiement de transfert (PPT)
| Activit� de programme (en millions de $) |
D�penses r�elles 2004–2005 |
D�penses r�elles 2005–2006 |
2006–2007 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D�penses pr�vues |
Total des autorisations |
D�penses r�elles |
|||
| Programme d’int�gration – Subventions | |||||
| Subvention pour l’Accord Canada-Qu�bec [a] |
160,8
|
188,4
|
196,2
|
196,2
|
193,9
|
| Institut de la citoyennet� canadienne |
0,0
|
0,0
|
3,0
|
3,0
|
3,0
|
| Total des subventions |
160,8
|
188,4
|
199,2
|
199,2
|
196,9
|
| R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection – Contributions |
|||||
| �laboration de la politique de migration |
0,3
|
0,2
|
0,3
|
0,4
|
0,4
|
| Organisation internationale pour les migrations |
1,2
|
1,1
|
2,0
|
1,9
|
1,1
|
| Programme des consultants en immigration |
0,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
| Programme d’int�gration – Contributions | |||||
| Programme d’accueil [c] |
3,1
|
3,3
|
7,4
|
6,7
|
5,0
|
| Programme d’�tablissement et d’adaptation des immigrants [b] |
38,4
|
42,9
|
104,4
|
73,0
|
70,2
|
| Programme d’aide au r�tablissement [e] |
42,5
|
39,7
|
44,6
|
44,6
|
44,1
|
| Contributions aux provinces |
45,7
|
49,0
|
87,5
|
82,8
|
82,8
|
| Cours de langue pour les immigrants au Canada [d] |
94,0
|
93,5
|
190,1
|
190,1
|
122,3
|
| Total des contributions |
225,7
|
229,7
|
436,3
|
399,5
|
325,9
|
| Total des paiements de transfert [f] |
386,5
|
418,1
|
635,5
|
598,7
|
522,8
|
[a] La subvention pour l’Accord Canada-Qu�bec et les contributions aux provinces soulignent l’importance de services d’�tablissement qui r�pondent au besoin croissant d’aider les immigrants � s’int�grer.
[b] Le Programme d’�tablissement et d’adaptation des immigrants fournit des fonds pour des services tels que l’orientation, le counseling paraprofessionnel, la traduction, la recherche d’emploi et les Cours de langue de niveau avanc�.
[c] Les fonds du programme d’accueil servent � jumeler les nouveaux arrivants avec des b�n�voles canadiens (particuliers et groupes) qui les aident � s’�tablir et � s’int�grer.
[d] Le programme des Cours de langue pour les immigrants au Canada fournit des fonds pour une formation linguistique de base dans les deux langues officielles afin d’aider les immigrants adultes � r�ussir leur int�gration sociale, culturelle, �conomique et politique.
[e] Le Programme d’aide au r�tablissement, ant�rieurement appel� Programme d’aide � l’adaptation, aide � payer pour le logement temporaire, les v�tements, les meubles et les frais de subsistance, jusqu’� concurrence d’un an, dans le cas des r�fugi�s indigents au sens de la Convention.
[f] Globalement, les d�penses pr�vues, soit 635,5 millions de dollars, ont regress� � 598,7 millions de dollars, car les fonds pr�vus pour l’�tablissement ont �t� report�s aux ann�es ult�rieures. Les d�penses r�elles de 522,8 millions de dollars �taient inf�rieures de 75,9 millions de dollars au total des autorisations, surtout en raison d’autres approbations pour la mise de c�t� (report) des ressources d’�tablissement aux ann�es ult�rieures.
Tableau 11 : �tats financiers
D�claration de responsabilit� de la direction
La responsabilit� de l’int�grit� et de l’objectivit� des �tats financiers ci-joints pour l’exercice termin� le 31 mars 2007 et toute l’information figurant dans ces �tats incombe � la direction du Minist�re. Ces �tats financiers ont �t� pr�par�s par la direction conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public.
La direction est responsable de l’int�grit� et de l’objectivit� de l’information pr�sent�e dans les �tats financiers. Certaines informations pr�sent�es dans les �tats financiers sont fond�es sur les meilleures estimations et le jugement de la direction et tiennent compte de l’importance relative. Pour s’acquitter de ses obligations au chapitre de la comptabilit� et de la pr�sentation des rapports, la direction tient des comptes qui permettent l’enregistrement centralis� des op�rations financi�res du Minist�re. L’information financi�re soumise pour la pr�paration des Comptes publics du Canada et incluse dans le Rapport minist�riel sur le rendement du Minist�re concorde avec les �tats financiers ci-joints.
La direction poss�de un syst�me de gestion financi�re et de contr�le interne con�u pour fournir une assurance raisonnable que l’information financi�re est fiable, que les actifs sont prot�g�s et que les op�rations sont conformes � la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’elles sont ex�cut�es en conformit� avec les r�glements, qu’elles respectent les autorisations du Parlement et qu’elles sont comptabilis�es de mani�re � rendre compte de l’utilisation des fonds du gouvernement. La direction veille �galement � l’objectivit� et � l’int�grit� des donn�es de ses �tats financiers par la s�lection appropri�e, la formation et le perfectionnement d’employ�s qualifi�s, par une organisation assurant une s�paration appropri�e des responsabilit�s et par des programmes de communication visant � assurer la compr�hension des r�glements, des politiques, des normes et des responsabilit�s de gestion dans tout le Minist�re.
Les �tats financiers du Minist�re n’ont pas fait l’objet d’une v�rification.
| Richard B. Fadden Sous-ministre |
Wayne Ganim Agent financier sup�rieur |
Citoyennet� et Immigration Canada
�tat des r�sultats (non v�rifi�)
Pour l’exercice se terminant le 31 mars (en milliers de dollars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Charges (Note 4) | ||
| Programme d’int�gration |
568 236
|
452 198
|
| Programme d’immigration |
272 603
|
271 025
|
| Programme des r�sidents temporaires |
145 439
|
167 759
|
| Programme de citoyennet� |
118 299
|
80 610
|
| Programme pour les r�fugi�s |
94 241
|
94 306
|
| R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection |
4 039
|
3 788
|
| Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto |
0
|
765
|
| Total des charges | 1 202 857 | 1 070 451 |
| Revenus (Note 5) | ||
| Programme d’immigration |
216 909
|
293 098
|
| Programme des r�sidents temporaires |
153 927
|
144 909
|
| Programme de citoyennet� |
46 306
|
69 014
|
| Programme pour les r�fugi�s |
14 581
|
13 163
|
| Programme d’int�gration |
734
|
825
|
| Total des revenus |
432 457
|
521 009
|
| Co�t de fonctionnement net |
770 400
|
549 442
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des pr�sents �tats.
Citoyennet� et Immigration Canada
�tat de la situation financi�re (non v�rifi�)
Au 31 mars (en milliers de dollars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| ACTIFS | ||
| Actifs financiers | ||
| D�biteurs et avances (Note 6) |
22 617
|
13 506
|
| Pr�ts (Note 7) |
34 407
|
35 984
|
| Total des actifs financiers |
57 024
|
49 490
|
| Actifs non financiers | ||
| Immobilisations corporelles (Note 8) |
224 294
|
184 816
|
| Stocks |
8 010
|
5 743
|
| Charges pay�es d’avance |
1 341
|
1 230
|
| Total des actifs non financiers |
233 645
|
191 789
|
| TOTAL DE L’ACTIF |
290 669
|
241 279
|
| PASSIFS | ||
| Revenus report�s (Note 9) |
235 045
|
282 876
|
| Cr�diteurs et charges � payer |
123 020
|
115 947
|
| Autres passifs (Note 14) |
24 000
|
28 020
|
| Indemnit�s de vacance et cong�s compensatoires |
14 487
|
13 305
|
| Indemnit�s de d�part (Note 10) |
51 634
|
46 555
|
| TOTAL DES PASSIFS |
448 186
|
486 703
|
| AVOIR DU CANADA |
(157 517)
|
(245 424)
|
| TOTAL |
290 669
|
241 279
|
Passif �ventuel (Note 11)
Obligations contractuelles (Note 12)
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des pr�sents �tats.
Citoyennet� et Immigration Canada
�tat de l’avoir du Canada (non v�rifi�)
Pour l’exercice se terminant le 31 mars (en milliers de dollars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Avoir du Canada d�but de l’exercice |
(245 424)
|
(284 651)
|
| Co�t de fonctionnement net |
(770 400)
|
(549 442)
|
| Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s (Note 3) |
1 056 436 |
880 780
|
| Revenus non disponibles pour d�penser |
(432 457)
|
(521 009)
|
| Variation de la situation nette du Tr�sor (Note 3c) |
(2 832)
|
(2 698)
|
| Services fournis gratuitement par d’autres minist�res (Note 13) |
237 160
|
231 596
|
| Avoir du Canada fin de l’exercice |
(157 517)
|
(245 424)
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des pr�sents �tats.
Citoyennet� et Immigration Canada
�tat des flux de tr�sorerie (non v�rifi�)
Pour l’exercice se terminant le 31 mars (en milliers de dollars)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| ACTIVIT�S DE FONCTIONNEMENT | ||
| Co�t de fonctionnement net |
770 400
|
549 442
|
| �l�ments n’affectant pas l’encaisse : Services fournis gratuitement par d’autres minist�res |
(237 160) |
(231 596)
|
| Amortissement des immobilisations corporelles |
(8 207)
|
(7 994)
|
| Perte sur l’ali�nation d’immobilisations corporelles |
(61)
|
(2 554)
|
| Variations de l’�tat de la situation financi�re : Diminution du passif |
38 517 |
25 130 |
| Augmentation (diminution) des d�biteurs et avances |
9 111
|
(11 526)
|
| Diminution des pr�ts |
(1 577)
|
(2 004)
|
| Augmentation des stocks et des charges pay�es d’avance |
2 378
|
1 300
|
| Encaisse utilis�e par les activit�s de fonctionnement |
573 401
|
320 198
|
| ACTIVIT�S D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS | ||
| Acquisitions d’immobilisations corporelles |
47 746
|
36 875
|
| Encaisse utilis�e pour les activit�s d’investissement en immobilisations |
47 746
|
36 875
|
| ACTIVIT�S DE FINANCEMENT | ||
| Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada |
(621 147)
|
(357 073)
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des pr�sents �tats.
Citoyennet� et Immigration Canada
Notes compl�mentaires aux �tats financiers (non v�rifi�s)
1. Mandat et objectifs
Citoyennet� et Immigration Canada (CIC) a �t� cr�� le 23 juin 1994 par la Loi sur le Minist�re de la Citoyennet� et de l’Immigration. C’est un minist�re nomm� dans la Partie I de la Loi sur la gestion des finances publiques qui se rapporte pr�sentement au Parlement par l’entremise de la Ministre de la Citoyennet� et de l’Immigration du
Canada.
Les r�sultats strat�giques du Minist�re sont :
- optimisation de la contribution des migrations au d�veloppement social, culturel et �conomique du Canada;
- prise en compte des valeurs et des int�r�ts canadiens dans la gestion des migrations internationales, y compris la protection des r�fugi�s;
- int�gration des nouveaux arrivants avec succ�s, et promotion de la citoyennet� canadienne.
Ces trois r�sultats strat�giques sont repr�sent�s dans les activit�s principales suivantes.
- Programme d’immigration : Concevoir, �laborer et mettre en oeuvre des politiques et des programmes pour faciliter l’entr�e des r�sidents permanents et maximiser leur contribution �conomique, sociale et culturelle au Canada, tout en prot�geant la sant� des Canadiens et en assurant leur s�curit�.
- Programme des r�sidents temporaires : Concevoir, �laborer et mettre en oeuvre des politiques et des programmes pour faciliter l’entr�e des travailleurs temporaires, des �tudiants et des visiteurs, et � maximiser leur contribution �conomique, sociale et culturelle au Canada, tout en prot�geant la sant� des Canadiens et en assurant leur s�curit�.
- R�le du Canada dans la gestion des migrations internationales et la protection : Affirmer la position du Canada dans le contexte des migrations internationales afin d’influencer le programme international en mati�re de migrations et de la protection.
- Programme des r�fugi�s : Maintenir la tradition humanitaire du Canada en prot�geant les r�fugi�s et les personnes au Canada et � l’�tranger ayant besoin de protection.
- Programme d’int�gration : �laborer des politiques et des programmes visant � faciliter l’�tablissement, le r��tablissement, l’adaptation et l’int�gration des nouveaux arrivants dans la soci�t� canadienne en assurant l’ex�cution de programmes d’orientation, d’adaptation et de cours de langue � leur intention.
- Programme de citoyennet� : Concevoir, �laborer et mettre en oeuvre des politiques et des programmes visant � administrer le processus d’octroi de la citoyennet� canadienne et � promouvoir les valeurs, les droits et les obligations li�s � la citoyennet� canadienne.
CIC est responsable de l’application de la Loi sur la citoyennet� et de la Loi sur l’immigration et la protection des r�fugi�s (LIPR).
CIC est financ� sur une base de cr�dits annuels budg�taires. Les recettes, incluant les frais et droits, sont d�pos�es au Tr�sor et ne sont pas disponibles pour fins d’utilisation par le Minist�re. Les frais et les droits sont per�us � travers le R�glement sur l’immigration et la protection des r�fugi�s de m�me qu’� travers le R�glement sur la citoyennet�. Les avantages sociaux des employ�s sont autoris�s � partir d’une autorisation l�gislative. CIC �met des pr�ts � l’immigration � partir d’une autorit� non budg�taire permanente.
2. Sommaire des principales conventions comptables
Les �tats financiers ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public.
Les principales conventions comptables sont les suivantes.
(a) Cr�dits parlementaires – Le Minist�re est financ� par le gouvernement du Canada au moyen de cr�dits parlementaires. Les cr�dits consentis au Minist�re ne correspondent pas � la pr�sentation des rapports financiers en conformit� avec les principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada �tant donn� que les cr�dits sont fond�s, dans une large mesure, sur les besoins de tr�sorerie. Par cons�quent, les postes comptabilis�s dans l’�tat des r�sultats et dans l’�tat de la situation financi�re ne sont pas n�cessairement les m�mes que ceux qui sont pr�vus par les cr�dits parlementaires. La note 3 pr�sente un rapprochement g�n�ral entre les deux m�thodes de rapports financiers.
(b) Encaisse nette fournie par le gouvernement – Le Minist�re fonctionne au moyen du Tr�sor, qui est administr� par le Receveur g�n�ral du Canada. La totalit� de l’encaisse re�ue par le Minist�re est d�pos�e au Tr�sor, et tous les d�caissements faits par le Minist�re sont pr�lev�s sur le Tr�sor. L’encaisse nette fournie par le gouvernement est la diff�rence entre toutes les rentr�es de fonds et toutes les sorties de fonds, y compris les op�rations entre les minist�res au sein du gouvernement f�d�ral.
(c) La variation de la situation nette du Tr�sor correspond � la diff�rence entre l’encaisse nette fournie par le gouvernement et les cr�dits utilis�s au cours d’un exercice, � l’exclusion du montant des revenus non disponibles comptabilis�s par le Minist�re. Il d�coule d’�carts temporaires entre le moment o� une op�ration touche un cr�dit et le moment o� elle est trait�e par le Tr�sor.
(d) Revenus
- Les revenus provenant de frais r�glementaires sont constat�s dans les comptes en fonction des services fournis au cours de l’exercice.
- Les autres revenus sont comptabilis�s dans l’exercice o� les op�rations ou les faits sousjacents surviennent.
- Les revenus d�j� encaiss�s mais non gagn�s sont pr�sent�s � titre de revenus report�s. La comptabilisation des revenus provenant des frais est report�e jusqu’� ce que la demande soit trait�e, alors que la comptabilisation des revenus provenant des droits (droit de la citoyennet� et au droit de r�sidence permanente) sont report�s lorsque le droit est accord�.
(e) Charges – Les charges sont comptabilis�es selon la m�thode de la comptabilit� d’exercice.
- Les subventions sont comptabilis�es dans l’exercice au cours duquel les crit�res de paiement sont satisfaits.
- Les contributions sont comptabilis�es dans l’exercice au cours duquel le b�n�ficiaire a satisfait aux crit�res d’admissibilit� ou a rempli les conditions de l’accord de transfert.
- Les indemnit�s de vacances et de cong�s compensatoires sont pass�es en charges au fur et � mesure que les employ�s en acqui�rent le droit en vertu de leurs conditions d’emploi respectives.
- Les services fournis gratuitement par d’autres minist�res pour les locaux, les cotisations de l’employeur aux r�gimes de soins de sant� et de soins dentaires et les services juridiques et services internationaux d’immigration sont comptabilis�s � titre de charges de fonctionnement � leur co�t estimatif.
(f) Avantages sociaux futurs
i. Prestations de retraite : Les employ�s admissibles participent au R�gime de retraite de la fonction publique, un r�gime multi employeurs administr� par le gouvernement du Canada. Les cotisations du Minist�re au r�gime sont pass�es en charges dans l’exercice au cours duquel elles sont engag�es et elles repr�sentent l’obligation totale du Minist�re d�coulant du r�gime. En vertu des dispositions l�gislatives en vigueur, le Minist�re n’est pas tenu de verser des cotisations au titre de l’insuffisance actuarielle du r�gime.
ii. Indemnit�s de d�part : Les employ�s ont droit � des indemnit�s de d�part, pr�vues dans leurs conventions collectives ou les conditions d’emploi. Le co�t de ces indemnit�s s’accumule � mesure que les employ�s effectuent les services n�cessaires pour les gagner. Le co�t des avantages sociaux gagn�s par les employ�s est calcul� � l’aide de l’information provenant des r�sultats du passif d�termin� sur une base actuarielle pour les prestations de d�part pour l’ensemble du gouvernement.
(g) Les d�biteurs et les pr�ts sont comptabilis�s en fonction des montants que l’on pr�voit r�aliser. Des provisions sont �tablies pour les d�biteurs dont le recouvrement est incertain. Les pr�ts qui ne peuvent �tre rembours�s sont radi�s une fois que le Parlement a donn� son approbation, conform�ment au R�glement sur la radiation des dettes.
(h) Passif �ventuel – Le passif �ventuel repr�sente des obligations possibles qui peuvent devenir des obligations r�elles selon que certains �v�nements futurs se produisent ou non. Dans la mesure o� l’�v�nement futur risque de se produire ou non et si l’on peut �tablir une estimation raisonnable de la perte, on comptabilise un passif estimatif et une charge. Si la probabilit� ne peut �tre d�termin�e ou s’il est impossible de faire une estimation raisonnable du montant, l’�ventualit� est pr�sent�e dans les notes compl�mentaires aux �tats financiers.
(i) Stocks – Les stocks se composent de formulaires et d’�quipement conserv�s pour l’ex�cution de programmes � une date ult�rieure et ne sont pas destin�s � la revente. Ils sont �valu�s au co�t.
(j) Op�rations en devises – Les op�rations en devises sont converties en dollars canadiens en s’appuyant sur le taux de change en vigueur � la date de l’op�ration. Les actifs et les passifs mon�taires libell�s en devises sont convertis en dollars canadiens en utilisant le taux de change en vigueur le 31 mars. Les gains et les pertes r�sultant de la conversion de devises sont pr�sent�s au niveau des autres revenus et autres d�penses dans les notes 4 et 5.
(k) Immobilisations corporelles – Toutes les immobilisations corporelles et les am�liorations locatives dont le co�t initial est d’au moins 10 000 $ sont comptabilis�es � leur co�t d’achat.
Les immobilisations corporelles sont amorties selon la m�thode lin�aire sur la dur�e de vie utile estimative de l’immobilisation, comme suit :
| Cat�gorie d’actifs | P�riode d’amortissement | |
|---|---|---|
| Machines et mat�riel | 15 ans | |
| Mat�riel informatique | 5 ans | |
| Logiciels informatiques | 7 ans | |
| Mobilier et autres | 10 ans | |
| V�hicules automobiles | 8 ans | |
| Am�liorations locatives | Le moindre du reste de la dur�e du bail ou de la vie utile de l’am�lioration | |
| Actifs en construction | Une fois qu’ils sont en service, selon la cat�gorie d’immobilisations |
(l) Incertitude relative � la mesure – La pr�paration de ces �tats financiers conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor du Canada, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypoth�ses qui influent sur les montants d�clar�s des actifs, des passifs, des revenus et des charges pr�sent�s dans les �tats financiers. Au moment de la pr�paration des pr�sents �tats financiers, la direction consid�re que les estimations et les hypoth�ses sont raisonnables. Les principaux �l�ments pour lesquels des estimations sont faites sont le passif �ventuel, le passif pour les indemnit�s de d�part, la dur�e de vie utile des immobilisations corporelles et les revenus report�s. Les r�sultats r�els pourraient diff�rer des estimations de mani�re significative. Les estimations de la direction sont examin�es p�riodiquement et, � mesure que les rajustements deviennent n�cessaires, ils sont constat�s dans les �tats financiers de l’exercice o� ils sont connus.
3. Cr�dit parlementaires
Le minist�re de la Citoyennet� et de l’Immigration re�oit son financement par l’interm�diaire de cr�dits parlementaires annuels. Les postes reconnus dans l’�tat des r�sultats d’exploitation et dans l’�tat de la situation financi�re d’un exercice donn� peuvent �tre financ�s par l’interm�diaire de cr�dits parlementaires des exercices pr�c�dents,
actuel ou ult�rieurs. Par cons�quent, le Minist�re affiche des r�sultats d’exploitation nets diff�rents pour l’exercice, sur la base des fonds gouvernementaux, par rapport � la comptabilit� d’exercice. Nous donnons dans les tableaux qui suivent un rapprochement des diff�rences.
a) Rapprochement du co�t de fonctionnement net et des cr�dits parlementaires de l’exercice en cours :
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Co�t de fonctionnement net |
770 400
|
549 442
|
| Ajustements pour les postes ayant une influence sur le co�t de fonctionnement net mais qui n’ont pas d’incidence sur les cr�dits |
|
|
| Ajouter (d�duire) : | ||
| Revenu non disponible pour d�penser |
432 457
|
521 009
|
| Services fournis gratuitement par d’autres minist�res |
(237 160)
|
(231 596)
|
| Remboursement des revenus des exercices pr�c�dents |
53 895
|
12 306
|
| Amortissement des immobilisations corporelles |
(8 207)
|
(7 994)
|
| Indemnit�s de d�part |
(5 079)
|
(5 101)
|
| Stock utilis� dans le cadre des activit�s |
(1 678)
|
(3 956)
|
| Indemnit�s de vacance et cong�s compensatoires |
(1 182)
|
1 663
|
| Autres |
3 217
|
4 232
|
| Rajustements pour les postes sans incidence sur le co�t de fonctionnement net mais ayant une incidence sur les cr�dits | ||
| Ajouter (d�duire) : | ||
| Acquisition d’immobilisations corporelles |
47 746
|
36 875
|
| Achat de stocks et charges pay�es d’avance |
4 283
|
5 601
|
| Pr�ts non budg�taires |
(2 191)
|
(1 672)
|
| Autres |
(65)
|
(29)
|
| Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
1 056 436
|
880 780
|
b) Cr�dits fournis et utilis�s
| Cr�dits vot�s | ||
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| (en milliers de dollars) | ||
| Cr�dit 1 – D�penses de fonctionnement |
489 636
|
428 908
|
| Cr�dit 2a – Radiation de pr�ts |
987 |
0
|
| Cr�dit 5 – Subventions et contributions |
598 704
|
429 405
|
| Montants l�gislatifs |
94 607
|
53 856
|
| Moins : | ||
| Cr�dits 1 annul�s : D�penses d’exploitation |
(49 377)
|
(18 430)
|
| Cr�dits 2a annul�s : Radiation de pr�ts |
(9)
|
0
|
| Cr�dits 5 annul�s : Subventions et contributions |
(75 898)
|
(11 279)
|
| Cr�dits annul�s : Gain provenant de la vente d’actifs de la Couronne |
(8)
|
0
|
| Postes non budg�taires |
(2 191)
|
(1 672)
|
| Cr�dits disponibles pour emploi dans les exercices ult�rieurs |
(15)
|
(8)
|
| Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
1 056 436
|
880 780
|
c) Rapprochement de l’encaisse nette fournie par le gouvernement et des cr�dits de l’exercice en cours utilis�s
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Encaisse nette fournie par le gouvernement |
621 147
|
357 073
|
| Revenu non disponible pour d�penser |
432 457 |
521 009
|
| Variation de la situation nette du Tr�sor | ||
| Remboursements des revenus des exercices pr�c�dents |
53 895
|
0
|
| Variation des d�biteurs et des avances |
(9 111)
|
11 526
|
| Variation des cr�diteurs et des charges � payer |
3 053
|
7 233
|
| Variation des revenus report�s |
(47 831)
|
(38 220)
|
| Autres |
2 826
|
22 159
|
| Sous-total |
2 832
|
2 698
|
| Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
1 056 436
|
880 780
|
4. D�penses
Le tableau suivant donne le d�tail des charges par cat�gorie.
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Paiements de transfert | ||
| Autres paliers de gouvernement au Canada |
276 722 |
234 215
|
| Organisations � but non lucratif |
211 483
|
152 591
|
| Particuliers |
33 164
|
30 063
|
| Autres pays et organismes internationaux |
1 436
|
1 256
|
| Remboursement des paiements de transfert de l’exercice pr�c�dent |
(2 474)
|
(3 138)
|
| Total des paiements de transfert |
520 331
|
414 987
|
| D�penses de fonctionnement | ||
| Salaires et avantages sociaux |
459 195
|
431 445
|
| Services professionnels et sp�ciaux |
124 938
|
129 327
|
| Installations |
29 998
|
28 894
|
| Transports et communications |
25 372
|
21 739
|
| R�parations et entretien |
6 421
|
12 990
|
| Services publics mat�riel et fournitures |
16 037
|
12 125
|
| Amortissement des immobilisations corporelles |
8 207
|
7 994
|
| Services d’information |
3 832
|
3 239
|
| Locations d’�quipement |
6 779
|
2 362
|
| Autres |
1 747
|
5 349
|
| Total des charges de fonctionnement |
682 526
|
655 464
|
| Total des charges |
1 202 857
|
1 070 451
|
| D�tails sur les paiements de transfert | ||
| Subvention aux fins de l’Accord Canada-Qu�bec sur l’immigration |
193 893
|
188 353
|
| Cours de langue pour les nouveaux immigrants au Canada |
122 288
|
93 561
|
| Contributions aux provinces |
82 829
|
48 975
|
| �tablissement et adaptation des immigrants |
70 208
|
42 900
|
| Aide � la r�installation |
44 128
|
39 754
|
| Programme d’accueil |
5 023
|
3 326
|
| Subvention � l’Institut pour la citoyennet� canadienne |
3 000
|
0
|
| Organisation internationale pour les migrations |
1 075
|
1 012
|
| �laboration des politiques en mati�re de migration |
361
|
244
|
| Remboursement des paiements de transfert de l’exercice pr�c�dent |
(2 474)
|
(3 138)
|
| Total |
520 331
|
414 987
|
5. Revenus
Le tableau suivant donne le d�tail des revenus par cat�gorie.
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Frais de services � l’immigration |
315 066
|
292 366
|
| Droit de r�sidence permanente |
70 266
|
158 774
|
| Frais de services � la citoyennet� |
27 249
|
37 359
|
| Droit de citoyennet� |
19 011
|
31 561
|
| Int�r�ts sur les pr�ts � l’immigration |
734
|
799
|
| Autres |
131
|
150
|
| Total |
432 457
|
521 009
|
6. D�biteurs et avances
Le tableau suivant donne le d�tail des d�biteurs et des avances.
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| D�biteurs des autres minist�res et organismes f�d�raux |
17 887
|
10 131
|
| D�biteurs de l’ext�rieur |
4 746
|
3 352
|
| Avances aux employ�s |
161
|
240
|
| Moins : Provision pour cr�ances douteuses sur les d�biteurs de l’ext�rieur |
(177)
|
(217)
|
| Total |
22 617
|
13 506
|
7. Pr�ts
En vertu de la LIRP, CIC peut consentir des pr�ts aux immigrants jusqu’� concurrence de 110 000 000 $. Depuis le 28 f�vrier 1995, tous les pr�ts aux immigrants portent int�r�t au taux fix� par le ministre des Finances au d�but de chaque ann�e civile. Le R�glement pr�voit un d�lai allant jusqu’� sept ans pour le remboursement des pr�ts. Le taux d’int�r�t sur les
pr�ts en circulation portants int�r�t varie de 3,56 % � 10,842 %. Une provision pour mauvaises cr�ances est �tablie sur les pr�ts dont le recouvrement est consid�r� incertain.
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Pr�ts � l’immigration |
38 080
|
40 271
|
| Moins : Provision pour cr�ances douteuses |
(3 673)
|
(4 287)
|
| Total |
34 407
|
35 984
|
| (en milliers de dollars) | ||||
|---|---|---|---|---|
| �ge | Nombre de pr�ts | Capital | Int�r�ts | Total |
| 0 � 1 ans |
4 278
|
11 146
|
0
|
11 146
|
| 1 � 2 ans |
3 398
|
7 932
|
3
|
7 935
|
| 2 � 3 ans |
2 603
|
5 015
|
9
|
5 024
|
| 3 � 4 ans |
2 155
|
3 688
|
39
|
3 727
|
| 4 � 5 ans |
1 159
|
1 727
|
45
|
1 772
|
| 5 � 6 ans |
813
|
1 467
|
86
|
1 553
|
| 6 � 7 ans |
599
|
1 328
|
140
|
1 468
|
| 7 ans et plus |
2 079
|
4 584
|
871
|
5 455
|
| TOTAL |
17 084
|
36 887
|
1 193
|
38 080
|
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Solde d’ouverture |
40 271
|
41 943
|
| Nouveaux pr�ts (y compris les int�r�ts courus) |
13 049
|
13 574
|
| Remboursements |
(14 270)
|
(15 246)
|
| Radiation |
(970)
|
0
|
| Solde de cl�ture |
38 080
|
40 271
|
Il n’y a eu aucune radiation en 2005-2006, car le Parlement n’a approuv� aucun Budget suppl�mentaire des d�penses.
8. Immobilisations corporelles
| (en milliers de dollars) | CO�TS | AMORTISSEMENT CUMUL� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat�gorie d’immobilisations |
Solde d’ouverture |
Acquisitions | Ali�nations et radiations |
Solde de fermeture |
Solde d’ouverture |
Amortization | Ali�nations et radiations |
Solde de fermeture |
2007 Valeur comptable nette |
2006 Valeur comptable nette |
|
| Machines et mat�riel |
1 810
|
124
|
0
|
1 934
|
620
|
121
|
0
|
741
|
1 193
|
1 190
|
|
| Mat�riel informatique |
29 553
|
1 239
|
2 187
|
28 605
|
19 870
|
4 766
|
2 184
|
22 452
|
6 153
|
9 683
|
|
| Logiciels achet�s |
20 053
|
234
|
110
|
20 177
|
4 787
|
1 982
|
109
|
6 660
|
13 517
|
15 266
|
|
| Mobilier et autres |
835
|
305
|
20
|
1 120
|
238
|
93
|
20
|
311
|
809
|
597
|
|
| V�hicules automobiles |
985
|
163
|
160
|
988
|
515
|
111
|
103
|
523
|
465
|
470
|
|
| Am�liorations locatives |
7 428
|
5 939
|
0
|
13 367
|
2 216
|
1 134
|
0
|
3 350
|
10 017
|
5 212
|
|
| Actif en construction |
152 398
|
39 742
|
0
|
192 140
|
0
|
0
|
0
|
0
|
192 140
|
152 398
|
|
| Total |
213 062
|
47 746
|
2 477
|
258 331
|
28 246
|
8 207
|
2 416
|
34 037
|
224 294
|
184 816
|
|
L’amortissement de l’exercice prenant fin le 31 mars 2007 est de 8 207 $ (2206, 7 994 $).
9. Revenus report�s
Le compte de revenus report�s a �t� cr�� afin de comptabiliser les frais et les droits d�coulant de la Loi sur la citoyennet� et de son r�glement, ainsi que de la LIRP et de son r�glement.
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Solde d’ouverture |
282 876
|
337 958
|
| Paiements re�us |
180 345
|
210 347
|
| Revenus constat�s |
(184 507)
|
(265 429)
|
| Remises – r�duction du droit de r�sidence permanente |
(43 669)
|
0
|
| Solde de cl�ture |
235 045
|
282 876
|
10. Avantages sociaux
a) Prestations de retraite : Les employ�s du Minist�re participent au R�gime de retraite de la fonction publique, qui est parrain� et administr� par le gouvernement du Canada. Les prestations de retraite s’accumulent sur une p�riode maximale de 35 ans � un taux de 2 % par ann�e de service ouvrant droit � la pension, multipli� par la moyenne des gains des cinq meilleures ann�es
cons�cutives. Les prestations sont int�gr�es au R�gime de pensions du Canada et du R�gime des rentes du Qu�bec et sont index�es � l’inflation.
Tant les employ�s que le Minist�re versent des cotisations couvrant le co�t du r�gime. En 2006-2007, les charges s’�l�vent � 29 867 771 $ (30 569 614 $ en 2005-2006), soit environ 2,2 fois les cotisations des employ�s (2,6 en 2005-2006).
La responsabilit� du Minist�re relative au R�gime de retraite se limite aux cotisations vers�es. Les exc�dents ou les d�ficits actuariels sont constat�s dans les �tats financiers du gouvernement du Canada, en sa qualit� de r�pondant du r�gime.
b) Indemnit�s de d�part : Le Minist�re verse des indemnit�s de d�part aux employ�s en fonction de l’admissibilit�, des ann�es de service et du salaire final. Ces indemnit�s ne sont pas capitalis�es d’avance. Les prestations seront pr�lev�es sur les cr�dits futurs. Voici quelles �taient les indemnit�s de d�part au 31 mars :
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Obligation au titre des prestations constitu�es, d�but de l’exercice |
46 555
|
41 454
|
| Charge pour l’exercice |
9 461
|
8 746
|
| Prestations vers�es pendant l’exercice |
(4 382)
|
(3 645)
|
| Obligation au titre des prestations constitu�es, fin de l’exercice |
51 634
|
46 555
|
11. Passif �ventuel
Recours et proc�dures judiciaires
Des recours ont �t� intent�s contre le Minist�re dans le cours normal des op�rations. Au 31 mars 2007, on s’attend � ce qu’aucun passif �ventuel ne survienne de ces r�clamations. Cependant, certains passifs �ventuels pourraient devenir des passifs r�els lorsqu’un ou plusieurs �v�nements futurs se produiront ou ne se produiront pas. Dans la mesure o� l’�v�nement
futur est susceptible de se produire ou non et o� l’on peut �tablir une �valuation vraisemblable de la perte, on inscrit une charge � payer estimative et on comptabilise une d�pense dans les �tats financiers.
12. Obligations contractuelles
De par leur nature, les activit�s du Minist�re peuvent donner lieu � des contrats et � des obligations en vertu desquels le Minist�re sera tenu d’effectuer des paiements �chelonn�s sur plusieurs ann�es pour l’acquisition de biens ou services. Voici les principales obligations contractuelles pour lesquelles une estimation raisonnable peut �tre faite.
| (en milliers de dollars) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 et apr�s |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paiements de transfert |
325 000
|
338 000
|
338 000
|
338 000
|
338 000
|
1 677 000
|
| D�penses de fonctionnement |
2 200
|
2 300
|
2 300
|
2 200
|
2 000
|
11 000
|
| Total |
327 200
|
340 300
|
340 300
|
340 200
|
340 000
|
1 688 000
|
13. Op�rations entre apparent�s
En vertu du principe de propri�t� commune, le minist�re est apparent� � tous les minist�res, organismes et soci�t�s d’�tat du gouvernement du Canada. Le minist�re conclut des op�rations avec ces entit�s dans le cours normal des ses activit�s et selon des modalit�s commerciales normales. De plus, au cours de l’exercice, le minist�re re�oit gratuitement des services
d’autres minist�res, comme il est indiqu� � la partie a).
a) Services fournis gratuitement par d’autres minist�res
Au cours de l’exercice, le minist�re re�oit gratuitement des services d’autres minist�res gouvernementaux (installations, frais juridiques et cotisations de l’employeur au r�gime de soins de sant� et au r�gime de soins dentaires). De plus, le minist�re re�oit les services d’immigration internationale de la part du Minist�re des Affaires �trang�res et du commerce international, personnel et installations dans les postes � l’�tranger. Ces services gratuits ont �t� constat�s comme suit dans l’�tat des r�sultats du minist�re.
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| Installations |
29 998
|
28 894
|
| Cotisations de l’employeur au r�gime de soins de sant� et au r�gime de soins dentaires |
20 316
|
18 565
|
| Indemnit�s d’accident du travail |
143
|
140
|
| Services juridiques |
38 703
|
38 797
|
| Services d’immigration � l’�tranger |
148 000
|
145 200
|
| Total |
237 160
|
231 596
|
Le gouvernement a structur� certaines de ses activit�s administratives de mani�re � optimiser l’efficience et l’efficacit� de sorte qu’un seul minist�re m�ne sans frais certaines activit�s au nom de tous. Le co�t de ces services, qui comprennent les services de paye et d’�mission des ch�ques offerts par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada ne sont pas inclus � titre de charge dans l’�tat des r�sultats du minist�re.
b) Soldes des cr�diteurs et d�biteurs � la fin de l’exercice entre apparent�s
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| (en milliers de dollars) | ||
| D�biteurs – Autres minist�res et organismes |
11 361
|
8 386
|
| Cr�diteurs – Autres minist�res et organismes |
5 960
|
8 960
|
14. Autre passif
Le Programme d’immigration des investisseurs permet aux immigrants qualifi�s d’obtenir la r�sidence permanente au Canada en investissant 400 000 $ dans l’�conomie canadienne. Le montant investi est remis � l’investisseur, sans int�r�t, cinq ans et deux mois apr�s r�ception du paiement initial.
Apr�s avoir r�pondu � d’autres exigences en mati�re d’immigration, les candidats sont tenus de verser 400 000 $ au Receveur g�n�ral du Canada. CIC agit � titre de mandataire pour les fonds provinciaux approuv�s en percevant les montants des investissements pour les r�partir en fonction de la formule de r�partition pr�vue (50 % des sommes investies sont divis�es �galement entre tous les fonds approuv�s et 50 % des sommes sont r�parties en fonction du produit int�rieur brut des provinces). Les investissements sont remis aux provinces et aux territoires participants (l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’�le-du-Prince-�douard, les Territoires du Nord-Ouest, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador) le premier jour du deuxi�me mois suivant la r�ception.
Les provinces et les territoires participants ont la responsabilit� d’investir les capitaux re�us afin de favoriser la croissance de leur �conomie ainsi que de cr�er ou de conserver des emplois. Ils doivent pr�senter des rapports trimestriels � CIC et, apr�s cinq ans, remettre au Minist�re le montant de 400 000 $ investi. CIC, dans les 30 jours suivant la r�ception, remet ce m�me montant de 400 000 $ � l’investisseur, sans int�r�t.
La valeur des transactions financi�res trait�es pendant l’ann�e suit.
| (en milliers de dollars) | 1er avril 2006 | Rentr�es et autres cr�dits |
Paiements et autres frais |
31 mars 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Programme d’immigration des investisseurs |
28 000
|
579 116
|
583 116
|
24 000
|
Tableau 12 : R�ponse aux comit�s parlementaires, aux v�rifications et aux �valuations
R�ponse aux comit�s parlementaires
Rapport 4 : Moratoire imm�diat sur les expulsions de tous les travailleurs sans papiers
Le Comit� permanent de la citoyennet� et de l’immigration a recommand� au gouvernement d’imposer un moratoire imm�diat sur les expulsions de travailleurs sans papiers et leurs familles qui satisfont aux v�rifications judiciaires et de s�curit� en attendant la mise en place d’une nouvelle politique de l’immigration.
La r�ponse du gouvernement du Canada se trouve � l’adresse suivante : http://cmte.parl.gc.ca/cmte/CommitteePublication.aspx?SourceId=210586&SwitchLanguage=1
R�ponse aux rapports du v�rificateur g�n�ral (y compris au Commissaire � l’environnement et au d�veloppement durable)
BVG – Grands projets de technologies de l’information
Le BVG a men� un examen des grands projets de technologies de l’information dans l’ensemble de l’administration f�d�rale. Il a examin� sept projets, dont le Syst�me mondial de gestion des cas (SMGC). Le BVG a remarqu� que le SMGC �tait raisonnablement bien g�r�, mais que des am�liorations s’imposaient sur les plans de la gouvernance et de la capacit� organisationnelle.
Vous trouverez des renseignements suppl�mentaires sur le site du BVG, au : www.oag-bvg.gc.ca/domino/rapports.nsf/html/20061103cf.html/$file/20061103cf.pdf
V�rifications externes (Autres v�rifications externes men�es par la commission de la fonction publique du Canada ou le Commissariat aux langues officielles)
S.O.
V�rifications et �valuations internes
V�RIFICATIONS INTERNES
Il est pr�cis� � l’annexe 13 du Rapport sur les plans et priorit�s (RPP) 2006-2007 que la Direction g�n�rale de la v�rification interne et de la responsabilisation avait amorc� la pr�paration d’un plan de v�rification ax�e sur les risques pour 2006-2009 selon les exigences indiqu�es par le Conseil du Tr�sor dans sa politique sur la v�rification interne. Le plan a �t� �labor� et approuv� par le Comit� de v�rification en novembre 2006.
V�rifications men�es en 2006-2007
V�rification du programme d’immigration de Bucarest
www.cic.gc.ca/francais/ressources/verification/bucarest.asp
V�rification du cadre de contr�le de gestion des m�decins d�sign�s
www.cic.gc.ca/francais/ressources/verification/medecin-designe.asp
V�rification du programme d’�tablissement et d’adaptation des immigrants et du programme de contribution d’accueil www.cic.gc.ca/francais/ressources/verification/peai-prog-daccueil.asp
V�rification du programme d’immigration de S�oul
www.cic.gc.ca/francais/ressources/verification/seoul.asp
V�rification de l’immigration – Syst�me de mesure pour la reddition de comptes concernant les programmes de contributions de l’immigration (iSMRP)
www.cic.gc.ca/francais/ressources/verification/ismrp.asp
V�rifications commenc�es en 2006-2007 et termin�es en 2007-2008
Ces v�rifications seront pr�sent�es � la prochaine r�union du Comit� de v�rification (�t� 2007) :
V�rification du programme d’immigration de Buenos Aires
V�rification du programme d’immigration de Caracas
�VALUATIONS
Cadres de gestion et de responsabilisation ax�s sur les r�sultats (CGRR) et cadres d’�valuation termin�s en 2006-2007
�valuation des risques avant renvoi (ERAR)
Cours de langue de niveau avanc� (CLNA)
�tudiants �trangers – Programme d’emplois hors campus
�tudiants �trangers – Programme d’emplois pour les dipl�m�s
Participation aux CGRR horizontaux suivants
Programme des crimes contre l’humanit� et des crimes de guerre
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010
Plan d’action du Canada contre le racisme
�valuations et examens termin�s en 2006-2007
Examen de Metropolis
�valuation formative de l’initiative sur les communaut�s minoritaires de langue officielle
�valuation sommative du Programme de parrainage des r�fugi�s par le secteur priv�
De plus, plusieurs grandes �tudes sont en cours. En raison de donn�es insuffisantes, l’�valuation formative relative aux travailleurs qualifi�s n’a pas �t� entreprise, contrairement aux pr�visions, mais elle devrait commencer en 2007-2008.
Tableau 13 : Strat�gie de d�veloppement durable (SDD)
| �l�ments � traiter | Observations du Minist�re |
|---|---|
| 1. Quels sont les buts, les objectifs et les objectifs � long terme de la SDD? |
But I : R�duire le plus possible les effets n�fastes des activit�s du Minist�re sur l’environnement; But II : Sensibiliser le personnel du Minist�re, les intervenants et les clients aux principes et aux objectifs du d�veloppement durable; But III : Favoriser la p�rennit� socioculturelle; But IV : Promouvoir la reddition de comptes et garantir la conformit�. |
| 2. Comment ces buts, objectifs et objectifs � long terme aident-ils � atteindre les r�sultats strat�giques du Minist�re? |
Le d�veloppement durable consiste � trouver un �quilibre entre les besoins�conomiques et sociaux des Canadiens et la n�cessit� de prot�ger l’environnement. Ce principe repose sur des �l�ments enracin�s dans des valeurs comme l’�quit� et la qualit� de vie, de m�me que sur des processus d�cisionnels int�gr�s. Puisque les r�sultats strat�giques de CIC sont ax�s sur le d�veloppement �conomique, social et culturel du Canada, le partage des valeurs canadiennes avec la collectivit� internationale et l’int�gration des nouveaux arrivants dans la soci�t� canadienne, les objectifs de d�veloppement durable de CIC sont con�us pour appuyer la totalit� de ces aspects. Le but I a pour objet de tenir compte d’une valeur canadienne importante, soit la protection de l’environnement, dans la gestion des m�canismes fonctionnels de l’immigration. Le but II a pour objet de fournir � tous les intervenants concern�s par les m�canismes d’immigration (employ�s, intervenants et clients) l’occasion d’obtenir les connaissances qui les aideront � participer aux progr�s du Canada vers le d�veloppement durable. Les buts I et II contribuent au d�veloppement �conomique, social et culturel de notre pays. Le but III suppose que le Minist�re porte une attention particuli�re � l’aspect socioculturel du d�veloppement durable. � long terme, cela aidera CIC � atteindre son troisi�me r�sultat strat�gique. Le but IV se concentre sur les progr�s du programme de d�veloppement durable du Minist�re, qui appuiera les trois autres buts. |
| 3. Quelles sont les objectifs �tablis pour la p�riode vis�e? |
Dans la SDD d�pos�e par CIC au Parlement en f�vrier 2004, quatre objectifs seulement doivent �tre atteints en 2006-2007. En majorit�, les autres activit�s de la strat�gie ont �t� mises en oeuvre en 2004-2005 et 2005-2006 et se sont poursuivies dans les ann�es subs�quentes. Objectifs pour 2006-2007 1.1.1 �laborer une strat�gie globale de r�duction des ressources couvrant les domaines de gestion suivants : parc de v�hicules, obtention de locaux et questions aff�rentes. 1.1.2 Dans le cadre de la strat�gie globale de r�duction des ressources, pr�parer un chapitre portant sur le mat�riel informatique (TI) et les questions connexes. 1.2.10 Utiliser 10 % d’�thanol (minimum) comme combustible pour les v�hicules de CIC. 2.1.9 Favoriser un soutien � la strat�gie de r�duction des ressources qui pr�c�de (objectif 1.1). Faire ressortir le r�le des mesures mat�rielles et autres dans l’obtention des avantages tangibles et intangibles (p. ex., attitudes � l’�gard du changement). |
| 4. Quels sont les progr�s obtenus jusqu’� maintenant? |
Activit�s 1.1.1, 1.1.2 et 2.1.9 Ces activit�s sont interreli�es. CIC n’a pas de document d�taill� d�gageant une strat�gie de r�duction des ressources pour le Minist�re. Toutefois, voici les pratiques qui ont �t� adopt�es : 1. Depuis le 1er avril 2005, CIC met en oeuvre Vers l’avenir, strat�gie aux vastes ramifications pilot�e par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada qui vise � am�liorer la fa�on dont le gouvernement m�ne ses activit�s, notamment en les rendant plus �cologiques. 2. En 2006-2007, CIC a dot� un poste, aux Services d’achat et de contrats, pour mettre en oeuvre un syst�me de march�s publics �cologique � l’�chelon national. 3. De fa�on � garantir une utilisation maximale de ses ressources en TI, CIC ne remplace pas l’�quipement en raison de l’�ge uniquement. Tout l’�quipement de TI est utilis� le plus longtemps possible avant d’�tre remplac�. Au Canada, CIC envoie tous les �quipements de TI exc�dentaires au programme Ordinateurs pour les �coles afin qu’ils soient r�utilis�s. � l’�tranger, les missions vendent localement aux ench�res leurs �quipements exc�dentaires. Les serveurs sont conserv�s beaucoup plus longtemps que cinq ans et lorsqu’ils sont mis � niveau, les anciens serveurs sont r�affect�s � des sites plus petits ou utilis�s � des fins de d�veloppement et d’essais. Les pi�ces de rechange sont conserv�es en disponibilit� afin que tout mat�riel fonctionnant mal puisse �tre r�par� plut�t que remplac�. 4. CIC recycle les cartouches d’encre d’imprimante vides, que les fournisseurs reprennent d�sormais pour les r�utiliser. Activit� 1.2.10 L’Administration centrale de CIC a �mis une directive � tous les conducteurs de CIC stipulant qu’ils ne doivent faire le plein que dans les stations-service offrant de l’�thanol, si possible. |
| 5. Quels ajustements avez-vous faits, le cas �ch�ant? (Pour mieux mettre ces renseignements en contexte, d�crivez la fa�on dont les le�ons tir�es ont influenc� ces ajustements.) |
Les changements apport�s par CIC � sa strat�gie de d�veloppement durable sont d�gag�s dans la quatri�me �dition de la strat�gie, d�pos�e au Parlement le 13 d�cembre 2006. Dans la SDD IV, l’approche de CIC � l’�gard du d�veloppement durable sera ax�e sur les domaines dans lesquels on estime que le Minist�re pourra faire une diff�rence notable. Dans les ann�es qui viennent, CIC se concentrera sur le renforcement des capacit�s du Minist�re gr�ce � la formation et aux communications et � la pr�paration des �valuations environnementales strat�giques de ses propositions de politiques, de plans et de programmes, pour s’assurer que l’on y a int�gr� les trois piliers du d�veloppement durable. CIC resserrera �galement ses lignes directrices et ses m�thodes pour rassembler des informations sur son syst�me de gestion et travaillera de concert avec la haute direction pour int�grer les aspects du d�veloppement durable dans le processus d�cisionnel. Enfin, au lieu d’adopter une politique minist�rielle de r�duction des ressources, chaque direction g�n�rale sera encourag�e � cr�er son propre plan vert. Les pratiques exemplaires seront diffus�es dans l’ensemble du Minist�re. De cette fa�on, CIC esp�re �tablir une v�ritable culture de changement chez ses employ�s. |
Tableau 14 : Service centr� sur le client
Le Bureau de l’am�lioration du service de CIC fait partie du groupe de travail interminist�riel sur les normes de service pr�sid� par le SCT. Le groupe de travail a �labor� une politique et des directives sur les services et des normes qui devraient �tre approuv�es � l’automne de 2007. En pr�vision de l’adoption de la politique et des directives, CIC a pr�par� un plan d’action comportant l’�tablissement d’un r�pertoire des services de CIC, la d�finition des normes de service et des proc�dures d’�valuation et la communication de l’information au public et au personnel, le tout dans le but de respecter les d�lais de la politique lorsqu’elle sera adopt�e.
Tableau 15 : Politique sur les voyages
CIC respecte les autorisations sp�ciales de voyager du SCT ainsi que la Directive sur les voyages, y compris les tarifs et les indemnit�s.
Partie 5 : Autres sujets d’int�r�t
Syst�me mondial de gestion des cas (SMGC)
Le SMGC est un �l�ment essentiel de l’infrastructure qui aidera CIC � atteindre ses r�sultats et � se conformer � ses priorit�s strat�giques. Le SMGC est une initiative pluriannuelle con�ue pour remplacer 12 syst�mes anciens utilis�s actuellement par le personnel de CIC et de l’ASFC. Offrant un syst�me int�gr� et automatis� de gestion des cas pour appuyer les op�rations clients de par le monde, le SMGC facilitera le passage vers des activit�s plus simplifi�es, des pratiques fonctionnelles normalis�es et une am�lioration du service � la client�le dans les deux organismes. Le SMGC, qui est l’un des �l�ments cl�s du plan d’am�lioration du service � la client�le de CIC, facilitera en outre la communication et le partage des donn�es appropri�es avec les partenaires et fournira au moment voulu les renseignements pr�cis n�cessaires pour servir l’efficacit� des op�rations et permettre � la gestion de prendre les d�cisions appropri�es.
Sur la base des besoins du Minist�re, CIC a re�u l’approbation de lancer le projet du SMGC en 2000-2001. Le march� d’acquisition du syst�me et de d�veloppement de l’application a �t� sign� en mars 2003. Plus tard au cours de l’ann�e, la cr�ation de l’ASFC et, par la suite, le transfert de certaines fonctions d’immigration de CIC � l’ASFC ont fait que le SMGC est devenu un syst�me partag� et un outil essentiel pour les deux organismes afin de g�rer le mouvement des clients.
La premi�re version du SMGC a �t� mise en oeuvre dans les bureaux de la citoyennet� partout au Canada et le centre de traitement des demandes de citoyennet� de Sydney (Nouvelle-�cosse) en septembre 2004. Le lancement r�ussi du volet Citoyennet� du SMGC a prouv� que le syst�me �tait rentable. Le travail se poursuivant sur le projet, toutefois, il est devenu �vident que le parach�vement des autres fonctionnalit�s n�cessiterait plus de temps que ce que l’on pr�voyait au d�part. Les complications qui sont ressorties pendant la phase d’essai ont entra�n� la d�cision de mener un examen approfondi du projet. L’�valuation reposait sur l’exp�rience totale des clients, de fa�on � �tablir les moyens les plus efficaces de mener le projet � terme avec succ�s. Les constatations d’un examen ind�pendant men�es en d�cembre 2006 ont laiss� voir que la d�cision de r��valuation �tait en fait prudente.
En f�vrier 2007, CIC a demand� au SCT l’autorisation, par une pr�sentation au Conseil du Tr�sor, de r�viser l’approbation d�finitive du projet modifi� (ADP/M) en ce qui a trait au budget et � l’�ch�ancier. La modification visait � permettre que se poursuive le travail d’examen et d’analyse et � proposer la pr�paration, pour le 31 octobre 2007, d’une pr�sentation ADP/M demandant l’autorisation de parachever le projet. La pr�sentation �tait appuy�e par un plan r�vis� assorti d’un �ch�ancier propos� et des co�ts estimatifs. Avec cette pr�sentation, l’�quipe du projet s’engageait en outre � fournir un rapport d’�tape complet au SCT en juin 2007.
L’objectif du projet du SMGC est encore de veiller � une mise en oeuvre s�re et peu risqu�e du syst�me.
Recherche
La tenue de recherches objectives, effectu�es au bon moment, est une condition pr�alable � la prise de d�cisions �clair�es en mati�re d’intervention strat�gique et d’�laboration de programmes. Les recherches strat�giques essentielles de CIC comportent trois activit�s cl�s : un investissement permanent dans les sources de donn�es; des recherches et des analyses appuyant les politiques et les programmes tant � l’�chelon f�d�ral qu’� l’�chelon provincial/territorial; et la diffusion de ces renseignements.
En 2006–2007, CIC a continu� d’investir des ressources dans de grands ensembles de donn�es, notamment l’Enqu�te longitudinale aupr�s des immigrants du Canada (ELIC), la Banque de donn�es longitudinales sur les immigrants (BDIM), l’Enqu�te sur la langue (citoyennet�), la World Values Survey (WVS), et le recensement. De plus, CIC a continu� de travailler �troitement avec Statistique Canada afin d’explorer la possibilit� d’utiliser les bases de donn�es actuelles pour �tudier les entreprises des immigrants. Il y a �galement eu des �tudes sur les approches m�thodologiques afin d’�largir l’utilisation des donn�es actuelles � l’analyse des parrainages d’immigrants. De plus, des progr�s consid�rables ont �t� accomplis, avec Statistique Canada et RHDSC, pour faire l’essai pilote d’un nouveau contenu pour l’Enqu�te sur la population active, de fa�on � mieux comprendre et � mieux surveiller la participation des immigrants au march� du travail.
CIC a continu� de suivre les r�sultats �conomiques des immigrants, en se souciant surtout des travailleurs qualifi�s, ainsi que les ensembles de professions et d’industries. Le Minist�re a publi� un rapport comparant les r�sultats au Canada et en Australie, et des rapports portant sur la dynamique du revenu et de l’aide sociale seront accessibles sous peu. CIC a termin� l’Enqu�te sur la langue (citoyennet�), et l’analyse des r�sultats avance � grands pas. Le Minist�re a �tudi� la composition des quartiers de plusieurs villes selon le statut d’immigrant des gens qui y vivent, tant du point de vue du lieu de r�sidence que de celui du travail, et les r�sultats ont �t� communiqu�s aux coll�gues provinciaux. Une �tude sur les recherches existantes ax�es sur les jeunes immigrants a �t� termin�e; il s’agit de la premi�re �tape d’un examen des r�sultats de recherche pour cette cohorte d’�ge. CIC a continu� d’�largir la gamme des renseignements offerts au public par l’interm�diaire de produits comme Faits et chiffres et L’Observateur.
�valuation
CIC a renforc� en 2006-2007 son attitude strat�gique � l’�gard de l’�valuation en pr�parant un plan d’�valuation ax�e sur les risques. Celui-ci permettra de veiller � ce que les programmes et politiques ayant les r�percussions les plus fortes et comportant les risques les plus �lev�s fassent l’objet d’une �valuation critique p�riodique. CIC a �galement mis la derni�re main � sa politique d’�valuation.
Celle-ci expose en d�tail la gouvernance et le fonctionnement du service d’�valuation ainsi que les r�les et responsabilit�s officiels du sous-ministre, de la haute direction de CIC, des gestionnaires de programme et de la Direction de l’�valuation. Nous donnons au Tableau 12 du pr�sent rapport des renseignements sur les activit�s sp�cifiques d’�valuation men�es en 2006-2007.
Metropolis
Le Secr�tariat du Projet Metropolis et les repr�sentants du Portugal ont organis� la 11e Conf�rence internationale Metropolis � Lisbonne, Portugal, du 2 au 6 octobre 2006. Le th�me de la conf�rence �tait � � la crois�e des chemins : la migration et l’�volution du paysage urbain �. La conf�rence portait sur une vaste gamme d’enjeux touchant la mondialisation, la diversit� et les ph�nom�nes migratoires complexes actuels. Metropolis et le Centre d’excellence conjoint pour la recherche sur l’immigration et l’�tablissement des immigrants (CERIS) ont organis� la 9e Conf�rence nationale Metropolis qui a eu lieu � Toronto du 1er au 4 mars 2007. Plus de 800 participants y assistaient. Le th�me de la conf�rence �tait : � Explorer la diversit� du Canada, aujourd’hui et demain �.
Metropolis a produit des �ditions du bulletin national du projet, le Bulletin mondial Metropolis, un num�ro sp�cial de la revue �tudes ethniques au Canada consacr� aux avenirs multiculturels, un num�ro sp�cial de la Revue canadienne de recherche urbaine sur le th�me � Nos diverses cit�s : D�fis et possibilit�s �, ainsi qu’une livraison sp�ciale du magazine Nos diverses cit�s portant sur les collectivit�s rurales. De concert avec l’Association d’�tudes canadiennes, Metropolis a produit le num�ro de l’hiver 2006 de la revue Diversit� canadienne intitul� � Int�gration des nouveaux arrivants : approches internationales �.
Metropolis a aid� le Monash Institute for the Study of Global Movements et l’Australian Multicultural Foundation � organiser, du 17 au 19 mai 2006 � Prato (Italie), un forum international sur le th�me � L’immigration et le futur �. Metropolis a �galement organis� les activit�s suivantes.
S�rie Metropolis pr�sente :
- � Les jeunes de deuxi�me g�n�ration au Canada �, � Ottawa (Ontario) le 20 mars 2007, activit� du r�seau de recherche de CIC appuy�e par Recherche et statistiques strat�giques de CIC, Justice pour les jeunes (Justice Canada), le Programme du multiculturalisme (Patrimoine canadien) et Recherche et relations universitaires (S�curit� publique Canada).
- Les trois derniers d’une s�rie de 12 �v�nements sur � Ottawa : Notre ville diversifi�e �.
S�rie de conversations Metropolis :
- La s�lection des immigrants �conomiques en fonction des besoins du march� du travail (avril 2006)
- Le maintien de l’ordre et la s�curit� dans une soci�t� diversifi�e : �quilibre entre la justice et l’�tat de droit (janvier 2007)
- La Loi sur le multiculturalisme canadien : vingt ans plus tard (mars 2007)
Le comit� interminist�riel a tenu quatre r�unions et le comit� directeur international, deux.
Collectivement, les cinq centres d’excellence continuent d’effectuer des recherches qui viennent ajouter aux articles, aux ouvrages et aux expos�s � des conf�rences universitaires engendr�es par le projet Metropolis.
Metropolis a n�goci� la reconduction du projet canadien pour une autre p�riode de cinq ans.
Analyse comparative entre les sexes � CIC
En vertu de la LIPR, CIC doit rendre compte au Parlement de la tenue d’analyses comparatives entre les sexes (ACS) concernant les r�percussions de la Loi et de son r�glement. Le Minist�re a pr�par� un cadre strat�gique pour l’ACS � CIC pour 2005-2010. L’objectif global de ce cadre est d’int�grer l’ACS au travail de CIC de fa�on � r�pondre aux exigences de rapports par l’entremise des plans d’ACS des directions g�n�rale et d’atteindre les objectifs d’ensemble de la politique et du programme du Minist�re et de respecter ses engagements concernant l’ACS.
CIC a �t� restructur� en avril 2006 et la fonction d’ACS a �t� c�d�e au Secteur des services corporatifs, ce qui �largit les perspectives d’int�gration de l’ACS dans les m�canismes de planification et � la pr�sentation de rapports. De plus, le Comit� des politiques de CIC, qui guide les orientations, les priorit�s et les processus d�cisionnels strat�giques du Minist�re, joue un r�le de supervision de sorte que les consid�rations propres aux sexes soient prises en compte dans le processus d’�laboration des politiques et des programmes.
CIC a continu� d’offrir des cours de formation en �laboration des politiques, portant sur l’ACS, de fa�on � constituer les connaissances n�cessaires pour int�grer l’ACS au travail quotidien du Minist�re. CIC a amorc� en 2006-2007 toute une gamme d’autres initiatives dans le cadre de ses plans d’ACS.
En 2006, CIC a tenu son engagement d’effectuer un contr�le de l’Entente sur les tiers pays s�rs de fa�on � r�unir des donn�es de r�f�rence touchant les cons�quences sur les hommes et les femmes et les tendances au fil du temps. La proportion de femmes dans le nombre total de demandeurs et chez les demandeurs � la fronti�re est demeur�e relativement constante, malgr� une l�g�re augmentation au cours des cinq derni�res ann�es (42 % en 2002 � 45 % en 2006). Cela laisserait pr�sumer que l’entente n’a pas eu un effet tr�s dissuasif et que les femmes continuent de pr�senter des demandes d’asile au Canada et �taient admissibles � le faire en vertu de l’Entente. M�me si le nombre total de demandeurs d’asile mineurs non accompagn�s est demeur� inchang� en 2006, la proportion de demandeurs d’asile a chut� � 35 %. Compte tenu de la vuln�rabilit� particuli�re de ce sous-groupe et de l’engagement du gouvernement � tenir compte de l’int�r�t sup�rieur de l’enfant, cette cat�gorie continuera de faire l’objet d’une surveillance �troite. Le lecteur trouvera les d�tails de ces r�sultats dans le Rapport annuel sur l’immigration 2007.
CIC a appuy� l’introduction, par le gouvernement, de modifications � la LIPR afin d’�viter que les travailleurs �trangers vuln�rables soient exploit�s ou maltrait�s. Ces modifications accorderaient au ministre de CIC le pouvoir de demander aux agents d’immigration de refuser des permis de travail � des personnes, notamment les danseuses exotiques, qui risqueraient de subir des traitements humiliants ou d�gradants ou m�me d’�tre exploit�es sexuellement au Canada.
CIC s’est engag� � cr�er une nouvelle voie d’immigration pour les �tudiants �trangers form�s au Canada et les travailleurs �trangers temporaires d’exp�rience. La cr�ation d’une possibilit� d’immigration pour les �tudiants �trangers form�s au Canada et les travailleurs �trangers temporaires d’exp�rience pourrait am�liorer l’�quilibre entre les hommes et les femmes dans nos programmes d’immigration en offrant � plus de femmes la possibilit� de demander de demeurer au Canada comme demandeurs principaux. Les r�percussions selon le sexe continueront de faire l’objet d’une surveillance dans cette nouvelle initiative.
D’autres initiatives viennent d’�tre lanc�es. Dans le cadre de l’engagement du Minist�re � prot�ger les victimes de la traite des personnes, les lignes directrices publi�es en mai 2006 permettent aux agents d’immigration de d�livrer aux victimes un PST de courte dur�e. M�me si, d’apr�s les donn�es internationales, la traite des personnes vise surtout les femmes et les enfants, les hommes peuvent �galement en �tre victimes. On en tiendra compte dans les documents de formation concernant la traite des personnes.
Initiative de revitalisation du secteur riverain de Toronto (IRSRT)
La responsabilit� de l’IRSRT est pass�e du ministre de CIC au pr�sident du SCT en vertu d’un d�cret du 6 f�vrier 2006. L’IRSRT rel�ve actuellement d’Environnement Canada.
Notes
1 On trouvera davantage de renseignements sur les programmes de CIC au www.cic.gc.ca/francais/index.asp.
2 Ces chiffres excluent les 1 236 employ�s recrut�s sur place dans les missions � l'�tranger (au 30 septembre 2006).
3 Le point de service de Saint-P�tersbourg a �t� ferm� le 31 mars 2007.
4 Pour plus de pr�cisions sur l'ASFC, voir la rubrique Partenariats critiques.
5 On trouvera davantage de renseignements sur les r�sultats du gouvernement du Canada dans le Rapport sur le
rendement du Canada 2006, au www.tbs-sct.gc.ca/report/govrev/06/cp-rc_f.asp.
6 On trouvera davantage de renseignements sur les r�sultats et les d�penses pour chaque activit� de programme � la
Partie 2 : Analyse des activit�s de programme par r�sultat strat�gique.
7 Les personnes, les services et la confiance : liens � l'int�rieur d'une cha�ne de valeur des services du secteur public au
www.psagency-agencefp.gc.ca/veo-bve/publications/atricle_f.asp?printable=True
8 Dans son 14e Rapport annuel au Premier ministre sur la Fonction publique du Canada, le greffier du Conseil priv� et secr�taire du Cabinet a insist� sur l'importance d'une planification int�gr�e des activit�s et des ressources humaines qui rend compte des forces de l'effectif et des faiblesses � combler par le recrutement ou le perfectionnement et qui implique les employ�s au service de leur organisation.
9 Pour de plus amples renseignements sur les ententes provinciales et territoriales de CIC, voir au
www.cic.gc.ca/francais/ausujet/lois-politiques/ententes/index.asp.
10 Pour plus de pr�cisions, voir au www.irb-cisr.gc.ca/fr/index_f.htm.
11 Voir au : www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/etablissement/plan-minoritaires.asp.
Tableau 7-B : Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation
|
A. Frais d’utilisation |
Norme de service |
R�sultats de rendement |
Consultation aupr�s des intervenants |
|---|---|---|---|
|
Frais relatifs au droit de r�sidence permanente (anciennement, droit exig� pour l’�tablissement) |
Ce ne sont pas des frais de traitement, mais plut�t des frais exig�s pour obtenir le droit de r�sidence permanente. L�galement, ils ne doivent �tre pay�s qu’au moment de la d�livrance d’un visa de RP � l’�tranger ou avant l’octroi du statut de RP au Canada. Le choix du moment de paiement appartient jusqu’� un certain point au demandeur, qui peut l’acquitter au moment du traitement de sa demande de RP, avant la fin du processus de d�livrance du visa de RP � l’�tranger ou avant d’obtenir le statut de RP au Canada. Puisque c’est le client qui fixe le moment du paiement des frais, aucune norme de service n’y est rattach�e. La norme de service et les d�lais de traitement sont plut�t li�s au traitement de la demande m�me, qui comporte d’autres frais (voir l’�l�ment suivant). |
Ces frais sont �troitement li�s au traitement des demandes de r�sidence permanente. Le moment du paiement des frais relatifs au droit de r�sidence permanente d�pend dans une certaine mesure du choix du client. La loi exige seulement que les frais soient acquitt�s avant la d�livrance du visa de RP � l’�tranger et avant l’octroi du statut de RP au Canada. |
Le gouvernement a fait savoir qu’il souhaitait �liminer les frais relatifs au droit de r�sidence permanente au cours de son mandat. Les frais ont �t� r�duits de moiti� au d�but de l’exercice 2006–2007.
|
|
Frais relatifs au traitement de la demande de r�sidence permanente, frais relatifs � la carte de r�sident permanent, frais relatifs au titre de voyage du r�sident permanent |
Les niveaux d’immigration sont fix�s par le Cabinet une fois l’an. CIC se conforme aux niveaux �tablis. Puisque la demande d�passe de loin les niveaux fix�s, les demandes re�ues en sus peuvent �tre mises en attente pendant de longues p�riodes, jusqu’� ce que des places se lib�rent l’ann�e suivante. Il n’est pas possible � CIC, sans contr�le des demandes re�ues et sans faire outrage au Parlement, d’�tablir des normes de service pour les demandes en attente non consid�r�es comme prioritaires. La priorit� maximale est accord�e aux demandes des membres directs de la cat�gorie du regroupement familial (�poux, etc.). Dans les missions � l’�tranger et au Canada, la norme de service est de traiter la majorit� des cas dans les 6 mois. En deuxi�me lieu viennent les candidats des provinces et la cat�gorie �conomique du Qu�bec (travailleurs qualifi�s et gens d’affaires). Dans les missions � l’�tranger. Titre de voyage de r�sident permanent : 2 jours pour les cas normaux |
Demande de r�sidence permanente
Au Canada : Parrainage : 99 % (�pouse, enfants) sont actuellement trait�s dans les 32 jours. Autres cat�gories : Examen initial des demandes de RP actuellement de 6 � 19 mois selon la cat�gorie d’immigrants Carte de r�sident permanent : Au Canada : Les demandes des RP sont trait�es dans les 3 � 4 semaines. Le d�lai de traitement des demandes d’une premi�re carte ou du remplacement ou du renouvellement d’une carte pour les RP actuels est actuellement de 30 jours au CTD. Titre de voyage de r�sident permanent : |
Tous les frais actuels rel�vent du processus r�glementaire du gouvernement du Canada pour le recouvrement des co�ts, qui pr�voit des exigences en mati�re de consultation. Les consultations ont eu lieu au moment o� le processus l’exigeait. Le Comit� permanent de la citoyennet� et de l’immigration tient des consultations p�riodiques sur diverses questions li�es � son mandat, notamment les frais et les normes de service. CIC consulte p�riodiquement les intervenants, notamment le Barreau canadien, le Conseil canadien pour les r�fugi�s et les sp�cialistes en immigration. Dor�navant, les nouveaux frais de traitement rel�veront du projet de loi C-212 sur les frais d’utilisation. L’article 4 de la Loi sur les frais d’utilisation pr�cise les exigences en mati�re de consultation � respecter en vue de l’�tablissement de nouveaux frais d’utilisation. |
|
Frais relatifs au permis de travail (individus ou artistes du spectacle) |
� l’�tranger : 4 semaines dans la majorit� des cas Au Canada : 40 jours civils (dont 10 jours de d�lai d’envoi) dans la majorit� des cas. |
� l’�tranger : Au cours de l’ann�e civile 2006, 72 % des demandes ont �t� trait�es dans les 28 jours. Au Canada : Les d�lais de traitement moyens r�cents sont de 24 jours civils au CTD-Vegreville. |
Voir ci-dessus |
|
Frais relatifs au permis d’�tudes |
Voir ci-dessus. |
� l’�tranger : Au cours de l’ann�e civile 2006, 76 % des demandes ont �t� trait�es dans les 28 jours. Au Canada : D’apr�s les donn�es r�centes, les d�lais moyens de traitement sont de 37 jours civils au CTD-Vegreville. |
Voir ci-dessus |
|
Frais relatifs � la demande de visa de r�sident temporaire (VRT) et frais relatifs � la demande de prorogation de l’autorisation de s�journer au Canada � titre de r�sident temporaire |
� l’�tranger : 2 jours dans la majorit� des cas. Au Canada : 40 jours civils (dont 10 jours de d�lai d’envoi) dans la majorit� des cas. |
� l’�tranger : Au Canada : Prorogation du statut : Le d�lai moyen de traitement observ� r�cemment est de 34 jours civils au CTD-Vegreville. |
Voir ci-dessus |
|
Frais relatifs au permis de s�jour temporaire (PST) |
� l’�tranger : Les PST visent � surmonter une interdiction de territoire constat�e au cours du traitement de n’importe quel type de demande de visa. En majorit�, les cas sont trait�s dans les 2 jours, mais les diff�rences et la complexit� des cas et de l’interdiction de territoire � r�soudre peuvent influer sur la norme de service. Au Canada : 40 jours civils (dont 10 jours de d�lai d’envoi) dans la majorit� des cas. |
Au Canada : Le d�lai moyen de traitement observ� r�cemment est de 34 jours civils au CTD-Vegreville. |
Voir ci-dessus |
|
Frais relatifs au r�tablissement du statut de r�sident temporaire |
Au Canada : 40 jours civils (dont 10 jours de d�lai d’envoi) dans la majorit� des cas. |
Le d�lai moyen de traitement observ� r�cemment est de 34 jours civils au CTD-Vegreville. |
Voir ci-dessus |
|
Autres services d’immigration (divers) |
Attestation et remplacement d’un document d’immigration : 6 � 8 semaines dans la majorit� des cas. � l’�tranger : Les autorisations de revenir au Canada (ARC) sont trait�es rapidement, mais la nature et la complexit� tr�s variables des cas d’ARC peuvent influer sur la norme de service. |
Remplacement de documents d’immigration : actuellement dans les 6 � 8 semaines. |
Voir ci-dessus |
|
Droit exig� pour la citoyennet� |
La norme de service est li�e au traitement de la demande de citoyennet�, comme pour les frais relatifs au droit de r�sidence permanente. |
Ces frais sont li�s � l’acquisition du statut de citoyen canadien (voir Frais relatifs � une modification de la citoyennet�, ci-apr�s). |
Voir ci-dessus |
|
Frais relatifs � une modification de la citoyennet� : attribution, conservation, r�int�gration, r�pudiation |
12 � 15 mois dans la majorit� des cas. |
En 2006–2007, les d�lais de traitement des demandes de citoyennet� (attribution de la citoyennet�) ont �t� r�duits de 15 � 18 mois � 12 � 15 mois. |
Voir ci-dessus |
|
Frais relatifs au document de la citoyennet� : attestation de la citoyennet� et recherches dans les dossiers de la citoyennet� |
3 mois dans la majorit� des cas. |
En 2006–2007, les d�lais de traitement pour la d�livrance d’un certificat de citoyennet� (attestation de la citoyennet�) ont �t� r�duits de 5 � 7 mois � 3 mois. |
Voir ci-dessus |
|
Frais exig�s pour le traitement des demandes d’acc�s � l’information en vertu de la Loi sur l’acc�s � l’information (LAI)
|
30 jours suivant la r�ception de la demande, � moins qu’une prorogation soit n�cessaire. |
En 2006–2007, CIC a re�u 10 497 demandes en vertu de la Loi sur l’acc�s � l’information et en a trait� 10 667 pendant la m�me p�riode (certaines demandes �taient report�es de l’exercice pr�c�dent). CIC a r�pondu dans les 30 jours suivant la r�ception de la demande dans 67,8 % des cas. Le d�lai de
r�ponse a �t� prorog� dans 32,2 % des cas. |
La norme de service est �tablie par la Loi sur l’acc�s � l’information et son r�glement. Des consultations avec les intervenants ont �t� organis�es par le minist�re de la Justice et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor concernant les modifications apport�es en 1986 et en 1992. |
Remarques :
Note 1 : Les normes de service relatives aux proc�dures d’immigration et de citoyennet� ne sont pas publi�es, mais servent de r�f�rences internes. Les d�lais moyens de traitement relatifs � tous les processus sont publi�s sur le site Web de CIC et mis � jour p�riodiquement. http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/index.asp. REMARQUE : Les d�lais de traitement � l’�tranger ne sont pas exprim�s en moyennes. La prestation d’un bon service � la client�le lorsque des frais sont exig�s n’est pas seulement une question de d�lai de traitement. Souvent, un traitement plus rapide ne serait pas un bon service client (par exemple, le service peut �tre compromis en accordant un d�lai exag�r�ment court pour produire les documents n�cessaires ou en rejetant une bonne excuse du demandeur qui ne peut se pr�senter � une entrevue fix�e). Plusieurs �l�ments du d�lai de traitement sont hors du contr�le de CIC et d�pendent du demandeur ou d’autres organismes, tels que le SCRS, la GRC et l’ASFC. La complexit� des cas et les exigences juridiques fait que les normes de traitement ne peuvent qu’une majorit� couvrir des cas, au cours d’une p�riode bien d�finie.
Note 2 : Tous les frais ou les modifications aux frais qui existaient avant l’entr�e en vigueur de la Loi sur les frais d’utilisation le 31 mars 2004 ne sont pas assujettis � la loi. Par cons�quent :
- la norme de rendement, si elle est fournie, peut ne pas avoir fait l’objet d’un examen parlementaire;
- la norme de rendement, si elle est fournie, peut ne pas respecter toutes les exigences de la Loi sur les frais d’utilisation (p. ex., comparaisons internationales, traitement ind�pendant des plaintes);
- les r�sultats li�s au rendement, s’ils sont fournis, ne sont pas juridiquement assujettis � l’article 5.1 de la LFU.
Tableau 8 : Progr�s accomplis au regard du plan r�glementaire du Minist�re
|
R�glementation |
R�sultats pr�vus |
Crit�res de mesure du rendement |
R�sultats obtenus |
|---|---|---|---|
|
CIC analyse les mesures n�cessaires pour moderniser le programme de citoyennet� du Canada en ce qui a trait � l’adoption d’enfants n�s � l’�tranger. |
Introduction du projet de loi et pr�publication du r�glement facilitant l’acc�s � la citoyennet� pour les enfants n�s � l’�tranger et adopt�s par des citoyens canadiens. |
Projet de loi adopt� et r�glement appliqu�. |
Le projet de loi C-14, Loi sur la citoyennet� (adoption), a �t� d�pos� le 15 mai 2006. Le 31 mars 2007, le projet �tait en attente de troisi�me lecture � la Chambre des communes. |
|
CIC demandera des orientations sur une approche visant � r�gler le volume de cas en instance et � obtenir l’approbation des modifications l�gislatives ou r�glementaires requises tout en explorant les options concernant un nouveau syst�me d’admission des demandes. |
Cr�er un fondement durable pour g�rer l’admission des demandes de r�sidence permanente. |
Cr�ation et mise en œuvre d’une approche durable pour g�rer l’admission des demandes de r�sidence permanente. |
Au cours de 2006–2007, CIC a amorc� une analyse d�taill�e, notamment des modifications l�gislatives et r�glementaires �ventuelles, concernant les solutions qui permettraient de r�gler le volume de cas en instance et d’�laborer un nouveau syst�me d’admission des demandes. Toutefois, d’autres travaux s’imposent en 2007–2008 et au-del�, pour s’occuper des questions strat�giques en suspens, des facteurs concernant la mise en œuvre et des r�percussions en mati�re de ressources. |
|
CIC compte pr�parer des amendements � la r�glementation afin de rendre compte des politiques actualis�es et d’appuyer le programme du gouvernement. |
Appuyer le renouvellement des politiques cibl�es et accro�tre la souplesse dans l’administration des programmes. |
R�glementation refl�tant l’actualisation des politiques et appuyant le programme du gouvernement. |
Plusieurs initiatives ont �t� amorc�es au cours de l’ann�e �coul�e, notamment :
Le Minist�re a �galement re�u l’autorisation de commencer � travailler sur le programme des travailleurs �trangers temporaires afin qu’il soit plus facile aux �tudiants �trangers qui ont fait leurs �tudes au Canada et aux travailleurs �trangers temporaires de devenir r�sidents permanents sans quitter le Canada. |
Tableau 9 : Rapport d’�tape sur les grands projets de l’�tat
SYST�ME MONDIAL DE GESTION DES CAS (SMGC)
Description
Le SMGC est un programme pluriannuel destin� � remplacer plusieurs syst�mes administratifs d�suets, archa�ques et incompatibles de CIC et de l’ASFC, dont certains sont vieux de 30 ans, et � appuyer le fonctionnement plus de 240 points de service au Canada et de par le monde. C’est un ensemble int�gr� d’applications et d’�l�ments d’infrastructure ax�s sur la gestion des cas qui soutiendra les activit�s li�es aux clients de CIC et de l’ASFC.
Une fois en place, le SMGC permettra de mieux prot�ger l’int�grit� globale du programme, d’en accro�tre l’efficacit� et d’am�liorer la prestation des services � la client�le, en plus de faciliter la communication et l’�change de donn�es entre CIC et l’ASFC et les autres partenaires aux fins de l’administration de la LIPR. De plus, le SMGC fournira �galement l’assise technologique n�cessaire pour soutenir les nouvelles initiatives fonctionnelles et tirer parti des technologies innovatrices en rempla�ant des syst�mes p�rim�s qui sont extr�mement difficiles � supporter et � maintenir.
Phase du projet : Le SMGC est actuellement dans une phase d’examen et les travaux se poursuivent pour am�liorer la qualit� du syst�me.
Minist�re responsable : Citoyennet� et Immigration Canada
Organisme participant : Agence des services frontaliers du Canada
Autorit� contractante : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Entrepreneur principal : Accenture Inc., 160, rue Elgin, Bureau 2100, Ottawa (ON) K2P 2C4
|
Jalons importants |
Date |
|
Le Conseil du Tr�sor (CT) approuve la totalit� des fonds pour le projet du SMGC en m�me temps que la pr�sentation au CT de CIC concernant la mise en œuvre de ses r�formes strat�giques et de la nouvelle Loi sur l’immigration et la protection des r�fugi�s. |
Ao�t 2000 |
|
Le CT approuve l’avant-projet du SMGC et le d�signe grand projet de l’�tat. |
Mars 2001 |
|
Approbation d�finitive du projet (ADP) du SNGC par le CT. |
Janvier 2002 |
|
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada affiche une demande de propositions pour l’acquisition d’un progiciel commerciale de gestion des cas du commerce. |
F�vrier 2002 |
|
Attribution du contrat pour le progiciel commercial de gestion des cas. |
Mars 2003 |
|
Ach�vement de la mod�lisation et de la d�termination des exigences de haut niveau. |
Mai 2003 |
|
Approbation d�finitive du projet modifi� par le CT. |
Octobre 2003 |
|
Mise en œuvre de la premi�re composante fonctionnelle (Citoyennet�) du SMGC. |
Septembre 2004 |
|
Deuxi�me modification de l’ADP du SMGC approuv�e par le CT. |
Septembre 2005 |
|
Les conclusions pr�liminaires de la v�rification de syst�me en voie d’�laboration du projet du SMGC �taient disponibles au moment de la pr�sentation de l’ADP modifi�e et le rapport final a �t� pr�sent� en novembre 2005. |
Novembre 2005 |
|
Approbation, par le CT, d’une modification technique � l’ADP. |
D�cembre 2006 |
|
Mise au point des autres composantes fonctionnelles du SMGC. |
En cours |
|
Troisi�me modification de l’ADP du SMGC approuv�e par le CT. |
F�vrier 2007 |
|
Mise en œuvre des autres composantes fonctionnelles du SMGC. |
En examen |
Rapport d’�tape et explication des �carts
- Le Conseil du Tr�sor a accord� son approbation pr�liminaire au projet le 1er mars 2001 et les co�ts pr�vus �taient de 194,8 millions de dollars (TPS exclue).
- L’approbation d�finitive du projet (ADP) a �t� accord�e par le Conseil du Tr�sor le 31 janvier 2002 et les co�ts pr�vus �taient de 194,8 millions de dollars (TPS exclue). Le projet devait �tre termin� le 31 mars 2005.
- Peu de temps apr�s l’approbation pr�liminaire du projet, il a �t� d�cid� d’acqu�rir et de configurer un progiciel commercial de gestion des relations avec les clients, plut�t que de cr�er la fonctionnalit� requise pour le SMGC. En raison de cette d�cision, il a fallu mettre en place un long processus concurrentiel d’acquisition amorc� en mars 2001 et devant se terminer le 1er juillet 2002. Les retards cumulatifs li�s � l’acquisition et au march� et �chappant au contr�le de CIC ont �t� de neuf mois, de sorte que le march� n’a pas �t� adjug� avant le 26 mars 2003. Ce retard a eu des r�percussions sur les activit�s et les ressources �troitement li�es � l’issue du processus d’acquisition. Malgr� les mesures prises par les responsables du projet pour r�duire les r�percussions du retard, ses co�ts ont �t� �valu�s � 7,8 millions de dollars.
- Le Conseil du Tr�sor a accord� une ADP modifi�e le 9 octobre 2003. Reconnaissant les r�percussions des retards li�s � l’acquisition, le Conseil du Tr�sor a major� l’autorisation de d�penses de 7,8 millions de dollars pour l’�tablir � 202,6 millions de dollars (TPS exclue). Les plans ult�rieurs de mise en œuvre visaient � r�gler les r�percussions du retard li� � l’acquisition et on a �tabli une nouvelle date d’ach�vement, soit le 31 d�cembre 2005.
- Le transfert de certaines fonctions de CIC � la nouvelle ASFC � compter de d�cembre 2003, de m�me que les le�ons tir�es de la premi�re installation du SMGC en septembre 2004 ont n�cessit� d’autres ajustements au plan du projet du SMGC. Ces changements �taient � l’origine d’une deuxi�me modification de l’ADP accord�e par le Conseil du Tr�sor en septembre 2005 et ont entra�n� une augmentation nette de 40,2 millions de dollars du budget du projet sur deux exercices suppl�mentaires, pour un budget total de 242,8 millions de dollars (TPS exclue) entre les exercices 2000–2001 et 2007–2008. La majoration comprend de nouvelles caract�ristiques fonctionnelles li�es � la s�curit� et qui ne figuraient pas au projet initial (6,2 millions de dollars), en sus d’un montant de 16,3 millions de dollars pour impr�vus. Malgr� des modifications d’�ch�ancier importantes, l’�cart pr�visionnel entre les objectifs initiaux du projet, � l’exclusion des retards d’approvisionnement, des fonctionnalit�s suppl�mentaires financ�es et des impr�vus �tait d’environ 10 %.
- Lors de la pr�paration de l’ADP modifi�e de septembre 2005, le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor a demand�, � l’�gard du SMGC, une v�rification de syst�me en cours d’�laboration. Les constatations pr�liminaires de la v�rification �taient disponibles au moment de la pr�sentation de l’ADP modifi�e et les r�sultats finaux de la v�rification ont �t� pr�sent�s en novembre 2005. D’apr�s la v�rification de syst�me en cours d’�laboration, l’�quipe de gestion du projet devait instaurer une plus grande discipline dans certains �l�ments de gestion du projet. Toutes les recommandations du v�rificateur ont �t� accept�es et des mesures correctives ont �t� prises.
- CIC et l’ASFC r��valuent actuellement les options de mise en œuvre par suite d’un examen ind�pendant men� en d�cembre 2006. Les auteurs du rapport recommandaient que les responsables du projet prennent le temps de mener une v�rification de la qualit� du projet et une analyse des options. Par cons�quent, en f�vrier 2007, CIC a demand� et obtenu du Conseil du Tr�sor l’autorisation de modifier l’ADP amend�e pour faire en sorte que ces travaux aient lieu, portant le budget total � 277 millions de dollars (TPS exclue) ou 290,9 millions de dollars (TPS comprise) jusqu’au 31 octobre 2007. Les r�sultats de la v�rification de la qualit� du projet et de l’analyse des options seront pris en compte dans l’�laboration d’un plan r�vis� de mise en œuvre garantissant le parach�vement r�ussi du SMGC et une mise en œuvre la plus s�re possible de par le monde.