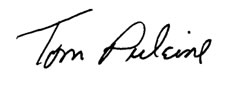ARCHIVÉ - Commissariats à l’information et à la protection de la vie privée du Canada
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Table des mati�res
Commissariats � la protection de la vie priv�e du Canada
Section I: Aper�u
- Message de la commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada
- D�claration de la direction
- Architecture des activit�s de programme
- Raison d’�tre
- Ressources financi�res et humaines
- Facteurs influant sur le rendement du Commissariat en 2006‑2007
- �tat du rendement relativement aux priorit�s du Commissariat
Section II: Analyse par activit� de programme
Section III: Information additionnelle
- Renseignements sur l’organisation
- Autres r�alisations en mati�re de gestion
- Tableaux des ressources
- Sources de renseignements suppl�mentaires
- Les �tats financiers v�rifi�s
Commissariats � l'information du Canada
- Message du commissaire � l’information du Canada
- D�claration de la direction
- Architecture des activit�s de programme
- Raison d’�tre
- Ressources financi�res et humaines
- Contexte relatif au rendement du CIC en 2006-2007
- �tat du rendement par rapport aux priorit�s du CIC
Section II : Analyse par activit� de programme
- Rendement du CIC en 2006-2007
- Activit� de programme 1 – �valuer, enqu�ter, examiner, faire appel aux tribunaux et fournir des conseils
Section III : Information additionnelle
Section IV : Autres sujets d’int�r�t
2006-2007
Rapport sur le rendement
Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada
L’honorable Robert D. Nicholson, C.P., c.r., d�put�
Ministre de la Justice et procureur g�n�ral du Canada
Section I : Aper�u
 1.1 Message de la commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada
1.1 Message de la commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada
C’est avec grand plaisir que je pr�sente au Parlement le Rapport minist�riel sur le rendement du Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada pour l’exercice qui s'est termin� le 31 mars 2007.
C’est une mission sacr�e que d’avoir pour mandat de maintenir et de prot�ger le droit � la vie priv�e des Canadiennes et des Canadiens, et cette responsabilit� doit �tre exerc�e avec circonspection. Le Commissariat s’efforce de remplir ce mandat, mais les outils dont nous avons besoin pour �tre encore plus efficace dans notre r�le de d�fenseur aupr�s des Canadiennes et des Canadiens sont actuellement hors de notre port�e.
Nous c�l�brons cette ann�e le 25e anniversaire de la mise en application de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui r�glemente la fa�on dont les minist�res et organismes du gouvernement g�rent les renseignements personnels. Malgr� plus de deux d�cennies de changements politiques et technologiques, les protections pr�vues par la Loi n’ont pas chang�. La Loi ne permet plus � la population canadienne d’exiger du gouvernement qu’il soit responsable de la gestion des renseignements personnels la concernant. Cette situation a �t� d�cri�e par les diff�rents intervenants et commissaires � la protection de la vie priv�e, sans que rien ne change. Cela est malheureux, car le gouvernement devrait donner l’exemple. En juin dernier, nous avons pr�sent� une proposition d’amendement de la Loi sur la protection des renseignements personnels devant le Comit� permanent de l’acc�s � l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’�thique de la Chambre des communes, mais, � ce jour, nous n’avons obtenu aucun r�sultat.
Au moment o� nous terminons un exercice et en commen�ons un nouveau, nous exhortons le Parlement de profiter de l’occasion pour confirmer la position du Canada en tant que chef de file dans le domaine de la protection des renseignements personnels en r�formant la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissariat attend avec h�te l’occasion de collaborer avec le Parlement dans ce dossier afin de mettre en place des mesures de protection importantes pour le bien de la population et l’int�grit� de nos institutions.
Par ailleurs, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques (LPRPD�) devait �tre soumise � un examen obligatoire en 2006. Le Comit� permanent de l’acc�s � l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’�thique de la Chambre des communes a entam� ce processus, et nous avons comparu � deux reprises devant ce comit� afin de faire part de nos r�flexions sur cette loi et son incidence sur le secteur priv�. � titre de loi �tablissant la norme de protection de la vie priv�e pour les organisations du secteur priv� r�gies par le gouvernement f�d�ral, la LPRPD�s’est av�r�e une loi efficace. Cependant, la Loi doit �tre peaufin�e dans plusieurs domaines afin d’aborder des questions comme la notification des br�ches dans la protection des donn�es et la circulation transfrontali�re des donn�es. Nous attendons avec impatience la conclusion heureuse de cet examen.
En terminant, j’ajouterai que le Commissariat vit une p�riode d’effervescence puisqu’il s’appr�te � accueillir des responsables de la protection des renseignements personnels du monde entier dans le cadre de la 29e Conf�rence internationale des commissaires � la protection des donn�es et de la vie priv�e qui se tiendra � Montr�al, en septembre 2007. L’ann�e derni�re, nous avons consacr� beaucoup de temps � la planification de cette conf�rence qui promet de stimuler la collaboration � la mise en place d’une politique mondiale. D’�minents penseurs de la protection de la vie priv�e, des autorit�s en mati�re de protection des donn�es et des membres de la soci�t� civile de partout dans le monde se joindront � nous pour discuter et �changer des id�es au sujet des d�fis imminent � la protection de la vie priv�e associ�s � des dragons et des mesures que nous pouvons prendre, ensemble, afin de relever les d�fis qui se pr�sentent.
Ces activit�s servent donc de toile de fond � notre rapport, qui explique en d�tail le rendement du Commissariat au cours de l’exercice qui vient de s’�couler en ce qui concerne notre mandat de protection des donn�es et l’assurance que le Canada continue d’�tre un chef de file mondial dans le domaine du droit � la vie priv�e.

La commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada
Jennifer Stoddart
1.2 D�claration de la direction
Je soumets, en vue de son d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement de 2006‑2007 du Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada.
Le document a �t� r�dig� suivant les principes de pr�sentation �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006‑2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement :
- Il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor.
- Il est fond� sur l'architecture des activit�s de programme et sur le r�sultat strat�gique du Commissariat approuv�s par le Conseil du Tr�sor.
- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable.
- Il fournit une base pour la reddition de comptes � l'�gard des r�sultats obtenus avec les ressources et les autorisations qui sont confi�es au Commissariat.
- Il rend compte de la situation financi�re d'apr�s les chiffres approuv�s dans le Budget des d�penses et les Comptes publics du Canada.

La commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada
Jennifer Stoddart
1.3 Architecture des activit�s de programme
L’architecture des activit�s de programme (AAP) et le r�sultat strat�gique du Commissariat qui ont �t� approuv�s par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor sont, pour l’essentiel, demeur�s les m�mes; seules des r�visions mineures ont �t� apport�es � la formulation, dans le cadre d’un exercice visant l’�tablissement d’un cadre de mesure du rendement et des r�sultats du Commissariat pendant l’exercice 2006‑2007. C’est pourquoi l’AAP, le nombre d’activit�s de programme et l’affectation correspondante des fonds n’ont pas chang�, et le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor n’a exig� aucune modification officielle. N�anmoins, et ce, � des fins de clart� et de transparence, nous pr�sentons dans le tableau ci‑dessous les r�visions mineures qui ont �t� apport�es � la formulation de l’AAP du Commissariat.
| Formulation de l’AAP dans le RPP de 2006‑2007 |
Formulation r�vis�e de l’AAP dans le RMR de 2006‑2007 |
|---|---|
|
R�sultat strat�gique : Le droit � la vie priv�e des Canadiens est prot�g� |
R�sultat strat�gique : Le droit des personnes � la vie priv�e est prot�g� |
|
Activit� de programme 1 : �valuation et enqu�te de conformit� des obligations en mati�re de vie priv�e |
Activit� de programme 1 : Activit�s li�es � la conformit� |
|
Activit� de programme 2 : Enjeux de la protection des renseignements personnels : recherche et politique |
Activit� de programme 2 : Recherche et �laboration des politiques |
|
Activit� de programme 3 : �ducation en mati�re de vie priv�e – promotion et protection de la vie priv�e |
Activit� de programme 3 : Sensibilisation du grand public |
|
Autres activit�s |
Autres activit�s : Excellence en mati�re de gestion |
Lien avec les r�sultats relevant de la comp�tence du gouvernement du Canada : comme le Commissariat est un organisme ind�pendant du gouvernement, nous ne faisons aucun lien entre l’information provenant du Commissariat et les r�sultats du gouvernement du Canada.
1.4 Raison d’�tre
Le mandat du Commissariat � la protection de la vie priv�e est de prot�ger et de promouvoir le droit � la vie priv�e des personnes.
Le Commissariat est charg� de surveiller le respect de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui porte sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels dans les minist�res et les organismes f�d�raux, et de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques (LPRPD�), c'est‑�‑dire la loi canadienne sur la protection des renseignements personnels dans le secteur priv�.
La commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada, Jennifer Stoddart, est une haute fonctionnaire du Parlement qui rel�ve directement de la Chambre des communes et du S�nat.
La commissaire est un d�fenseur du droit � la vie priv�e des Canadiennes et des Canadiens. Elle a, entre autres pouvoirs, les suivants :
- mener des enqu�tes sur les plaintes, proc�der � des v�rifications et entamer des poursuites conform�ment aux deux lois f�d�rales;
- publier des rapports sur les pratiques relatives au traitement des renseignements personnels dans les organisations des secteurs public et priv�;
- soutenir, entreprendre et publier des recherches sur des enjeux inh�rents � la protection de la vie priv�e;
- sensibiliser la population aux enjeux associ�s � la protection de la vie priv�e et l'aider � en comprendre les r�percussions.
La commissaire enqu�te sur les plaintes concernant le gouvernement f�d�ral et le secteur priv� d�pos�es par des personnes et ce, ind�pendamment de toute autre structure du gouvernement. En ce qui concerne le secteur public, toute personne peut d�poser une plainte aupr�s de la commissaire pour l'un des motifs pr�vus � l'article 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette loi s'applique aux renseignements personnels que d�tiennent les institutions du gouvernement du Canada.
La commissaire peut �galement mener des enqu�tes sur des plaintes touchant le secteur priv� en vertu de l'article 11 de la LPRPD�, sauf dans les provinces qui ont adopt� des lois sur la protection des renseignements personnels r�put�es �tre essentiellement similaires � la loi f�d�rale, c’est-�-dire le Qu�bec, la Colombie‑Britannique et l'Alberta. L'Ontario fait maintenant partie de cette cat�gorie en ce qui concerne la protection des renseignements personnels sur la sant� d�tenus par les d�positaires d'information sur la sant�, aux tenues de sa l�gislation sur la protection des renseignements personnels sur la sant�. Toutefois, dans les provinces ayant adopt� des lois r�put�es �tre essentiellement similaires comme ailleurs au Canada, la LPRPD� continue de s'appliquer aux renseignements personnels recueillis, utilis�s ou communiqu�s par les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activit�s f�d�rales, y compris les renseignements personnels de leurs employ�s. De plus, la LPRPD� s'applique � toute donn�e personnelle qui traverse les fronti�res provinciales ou nationales dans le cadre de transactions commerciales auxquelles participent des organismes assujettis � la Loi ou � une loi essentiellement similaire.
Pour r�gler les plaintes, nous privil�gions la n�gociation et la persuasion et, s’il y a lieu, nous avons recours � la m�diation et � la conciliation. Toutefois, si les parties refusent de collaborer, la commissaire a le pouvoir d'assigner des t�moins, de faire pr�ter serment et d’exiger des preuves. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, en particulier en ce qui a trait � la LPRPD�, elle peut porter l’affaire devant la Cour f�d�rale et demander une ordonnance d’un tribunal afin de corriger la situation.
En r�sum�, en tant que d�fenseur du droit � la vie priv�e des Canadiennes et des Canadiens, la commissaire accomplit les t�ches suivantes :
- elle enqu�te sur les plaintes et publie des rapports, comprenant, s’il y a lieu, des recommandations visant � corriger la situation, � l’intention des institutions du gouvernement f�d�ral et des organisations du secteur priv�;
- elle entame des poursuites judiciaires devant des cours f�d�rales lorsque les plaintes demeurent irr�solues;
- elle �value le respect des obligations contenues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels et la LPRPD� par le truchement d’activit�s de v�rification ind�pendantes et d’examen, et rend compte publiquement de ses conclusions;
- elle examine les �valuations des facteurs relatifs � la vie priv�e (�FVP) touchant les projets existants et nouveaux du gouvernement et donne des conseils dans ce domaine;
- elle fournit des analyses et une expertise en mati�re juridique et politique afin de guider l’examen par le Parlement de l’�volution des lois en vue d'assurer le respect du droit � la vie priv�e des personnes;
- elle r�pond aux questions des parlementaires, des citoyens canadiens et des organisations qui cherchent des renseignements et des conseils, et elle prend des mesures proactives afin de les informer des enjeux �mergents li�s � la protection de la vie priv�e;
- elle encourage la conformit� et la sensibilisation du grand public et favorise la compr�hension des droits et obligations li�s � la protection de la vie priv�e par les moyens suivants : un engagement actif aupr�s des institutions du gouvernement f�d�ral, des associations industrielles, des professionnels du droit, des universitaires, des associations professionnelles et d’autres intervenants; elle pr�pare et diffuse du mat�riel pour la sensibilisation du grand public, des positions sur l’�volution des lois, des r�glements et des politiques, des documents d’orientation et des r�sultats de recherche � l’intention du grand public, des institutions du gouvernement f�d�ral et des organisations du secteur priv�;
- elle fournit des opinions juridiques et porte des affaires devant les tribunaux afin de faire avancer l’interpr�tation et l’application des lois f�d�rales sur la protection des renseignements personnels;
- elle surveille les tendances dans les pratiques relatives � la protection de la vie priv�e, cerne les probl�mes syst�miques en mati�re de protection de la vie priv�e qui doivent �tre trait�s par les institutions du gouvernement f�d�ral et les organisations du secteur priv� et encourage l’adoption des pratiques exemplaires;
- elle collabore avec les intervenants du domaine de la protection de la vie priv�e des autres juridictions du Canada et des autres pays, afin d’aborder les probl�mes mondiaux li�s � la protection de la vie priv�e qui d�coulent de la circulation transfrontali�re croissante des donn�es.
1.5 Ressources financi�res et humaines
Les deux tableaux qui suivent pr�sentent le total des ressources financi�res et humaines que le Commissariat a g�r�es en 2006‑2007.
Ressources financi�res (en milliers de dollars)
| D�penses pr�vues | Autorisations | D�penses r�elles |
|---|---|---|
| 16 298 $ | 16 033 $ | 15 716 $ |
Ressources humaines
| Pr�vues | D�penses r�elles | �cart |
|---|---|---|
| 125 ETP | 108 ETP* | (17) ETP |
* �quivalent temps plein
1.6 Facteurs influant sur le rendement du Commissariat en 2006‑2007
Facteurs externes
En 2006‑2007, le Commissariat s’est concentr� sur des questions cl�s d’importance nationale. Nous avons aussi abord� des questions urgentes au fur et � mesure qu’elles ont �t� soulev�es au Parlement et dans les d�bats nationaux. Voici quelques‑unes de ces questions :
Nouvelles technologies
En collaboration avec le groupe Droit et technologie de l’Universit� d’Ottawa, le Commissariat a tenu un � Symposium sur la protection de la vie priv�e sur Internet � en f�vrier 2007. Les principaux experts des questions li�es � la protection de la vie priv�e sur Internet se sont rencontr�s � Ottawa pour discuter des nouvelles menaces � la protection de la vie priv�e en ligne, des tendances �mergentes et des fa�ons de mieux prot�ger les renseignements personnels � l’avenir. Le symposium s’est concentr� sur la recherche que finance le Commissariat par le truchement de son Programme des contributions. Voici quelques‑uns des sujets qui ont �t� abord�s : dossiers de sant� �lectroniques et protection des renseignements personnels des patients; aider les enfants � comprendre les questions li�es � la protection de la vie priv�e sur Internet; protection de la vie priv�e sur Internet en milieu de travail; protection des renseignements personnels et vol d’identit�.
Dans le cadre de son Programme des contributions, le Commissariat a financ� en 2006 quatre projets de recherche sur les nouvelles technologies portant sur les questions suivantes : technologies de gestion des droits num�riques et protection de la vie priv�e des consommateurs; choix de technologies et politiques de protection de la vie priv�e dans le secteur de la sant�; technologies � bord des v�hicules et protection de la vie priv�e des consommateurs; utilisations secondaires des renseignements personnels sur la sant� et des dossiers m�dicaux �lectroniques.
En novembre 2006, le Commissariat a rendu public un r�sum� de ses conclusions dans une affaire concernant l’utilisation en milieu de travail des syst�mes mondiaux de localisation (GPS), qui peuvent donner la position d’un v�hicule en temps r�el. Le Commissariat a conclu que les employeurs doivent tenir compte du droit � la vie priv�e de leurs employ�s et
r�server l’installation d’un GPS dans les v�hicules de leur flotte � des fins pr�cises. Plusieurs travailleurs ont d�pos� une plainte � l'effet que leur employeur, une entreprise de t�l�communication, utilisait des GPS pour recueillir de fa�on indue leurs renseignements personnels, plus particuli�rement en ce qui concerne leurs d�placements quotidiens pendant les heures de
travail.
Enfin, le Commissariat a publi� sur son site Web trois fiches d’information qui traitent des nouvelles technologies et des probl�mes qu’elles posent sur le plan de la protection de la vie priv�e. Ces documents traitent de la gestion des droits num�riques et des mesures de protection techniques, des risques associ�s aux m�tadonn�es et des m�thodes pouvant �tre utilis�es
pour pirater des renseignements personnels en ligne.
R�seaux d’op�rations interconnect�s
En ce qui concerne les r�seaux d’op�rations interconnect�s (interop�rables), la principale inqui�tude est que le partage des connexions suppose le partage des risques. Plus les r�seaux sont interconnect�s, moins le propri�taire d’un r�seau donn� sera renseign� sur la circulation et l’utilisation des renseignements personnels et moins il pourra les contr�ler. Pour r�duire ce risque, il faut assurer un contr�le et une gouvernance efficaces de l’ensemble des r�seaux collectifs. Cela constitue un d�fi de taille pour les organisations des secteurs priv� et public qui cr�ent de tels � r�seaux de r�seaux �. Il s’agit d’un probl�me particuli�rement complexe puisque les connexions des r�seaux et les flux de renseignements connexes traversent les fronti�res des juridictions et que diff�rentes lois et normes peuvent s’appliquer. Le Commissariat a abord� cette question dans quelques‑uns de ses travaux.
Pendant son examen de certaines �valuations des facteurs relatifs � la vie priv�e des r�seaux interconnect�s de la GRC, le Commissariat a fait part de ses pr�occupations en ce qui concerne la gouvernance, le contr�le et la responsabilit� relatifs � l'�change de renseignements personnels � des fins polici�res entre les services de police f�d�raux, provinciaux et municipaux. Pour cette raison, la GRC a entrepris de proc�der � une �valuation plus vaste et plus compl�te des facteurs relatifs � la vie priv�e du Syst�me national int�gr� d’information et de communications interorganismes (N‑III).
M�me si les r�seaux de TI ne sont pas directement interconnect�s, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) transmet des renseignements personnels � des juridictions �trang�res. Il est essentiel d’assurer une responsabilisation et un contr�le efficaces. Dans le cadre de la v�rification de l’ASFC, le Commissariat a recommand� ce qui suit :
- L’ASFC devrait tenter de mettre � jour et de renforcer ses ententes d'�change de renseignements personnels avec les �tats‑Unis, notamment en �tablissant un processus qui permet d’assurer de part et d’autre que les renseignements personnels �chang�s sont prot�g�s de fa�on appropri�e;
- Une entente de service officielle, incluant des normes de s�curit� mutuellement accept�es, devrait �tre mise en œuvre par les �tats‑Unis et le Canada, pour faire en sorte que chaque partie prenne des mesures pour s’assurer que les renseignements personnels �chang�s sont complets, � jour et exacts;
- L’ASFC, conjointement avec le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, devrait mieux informer le Parlement et le public au sujet des renseignements personnels transmis � d’autres pays.
L’initiative continue visant � cr�er et � mettre en œuvre des solutions pancanadiennes touchant les dossiers de sant� �lectroniques est un autre excellent exemple de r�seaux interconnect�s. Le Commissariat s’est particuli�rement int�ress� � la cr�ation d’un r�seau de solutions de DSE interop�rables au Canada et a contribu� � l’avancement du d�bat sur ces questions en finan�ant un certain nombre de projets de recherche importants et en contribuant aux discussions avec les intervenants et aux consultations sur les questions cruciales en mati�re de protection de la vie priv�e qui sont associ�es � cette initiative.
Circulation transfrontali�re des donn�es
Tel que mentionn� plus haut, en juin 2006, le Commissariat a publi� les r�sultats de sa v�rification des pratiques de gestion des renseignements personnels de l’Agence des services frontaliers du Canada, au regard de la circulation transfrontali�re des donn�es. Le rapport contient 19 recommandations ou ensembles de recommandations visant l’am�lioration du traitement des �changes internationaux de renseignements personnels par l’ASFC. M�me si la v�rification a montr� que l’ASFC a mis en place des syst�mes et proc�dures pour la gestion des renseignements personnels et leur transmission � d’autres pays, il y a d’importantes occasions d’am�lioration en ce qui concerne la gestion des menaces � la vie priv�e et en mati�re de responsabilit�, de transparence et de contr�le de la circulation transfrontali�re des donn�es.
C’est aussi en juin que le Commissariat a annonc� qu’il tentait de d�terminer si les autorit�s �trang�res avaient acc�s de fa�on indue aux dossiers financiers des Canadiennes et des Canadiens. Cette annonce faisait suite � des reportages de nouvelles et � une lettre que l’organisation Privacy International a envoy�e aux autorit�s de protection des donn�es de partout dans le monde, y compris le Canada, et dans laquelle elle soutient que des autorit�s peuvent avoir acc�s aux renseignements des Canadiennes et des Canadiens par l’entremise de la soci�t� SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), coop�rative financi�re �tablie en Europe.
En avril 2006, la commissaire � la protection de la vie priv�e a publi� un communiqu� dans lequel elle f�licite le gouvernement du Canada pour sa strat�gie f�d�rale visant � examiner les pr�occupations soulev�es par la USA Patriot Actet la circulation transfrontali�re des donn�es, que venait de lancer officiellement le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada. Le Commissariat a aussi particip� activement au processus d’�laboration de cette strat�gie.
Pendant l’exercice, le Commissariat a continu� � travailler avec deux organismes internationaux, l’Organisation de coop�ration et de d�veloppement �conomiques (OCDE) et la Coop�ration �conomique Asie‑Pacifique (APEC), afin d’am�liorer la protection des renseignements personnels qui circulent de par le monde et d’encourager la collaboration transfrontali�re dans l’application de la loi.
Enfin, dans l’affaireX. c. Accusearch Inc., s/n ABIKA.com et la commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada, la Cour f�d�rale du Canada a rendu une d�cision qui fait la lumi�re sur notre pouvoir d’enqu�ter sur une plainte contre une organisation exploitant ses activit�s � l’ext�rieur du Canada qui recueille, utilise et communique des renseignements personnels au sujet de personnes r�sidant au Canada � des fins commerciales. Cette d�cision confirme l’�tendue de notre pouvoir dans les affaires concernant la circulation transfrontali�re de renseignements personnels.
S�curit� nationale et application de la loi
En juin 2006, le Commissariat a soumis un m�moire au Comit� s�natorial permanent des banques et du commerce � propos de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalit� et le financement des activit�s terroristes. Le Comit� �tait charg� de proc�der � un examen de la Loi, tel que pr�vu par la disposition relative � l’examen quinquennal de la Loi. Un peu plus tard, toujours en 2006, le Commissariat a comparu devant ce m�me comit� s�natorial relativement � la m�me question, cette fois pour donner son opinion sur le projet de loi C‑25, la Loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalit� et le financement des activit�s terroristes. Dans les deux cas, le Commissariat a soutenu que le r�gime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activit�s terroristes est novateur et cr�e un pr�c�dent en raison de la quantit� de renseignements qu’il demande aux entit�s du secteur priv� de recueillir au nom de l’�tat. Le Commissariat a demand� au Comit� d’examiner avec soin les propositions d’expansion du r�gime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activit�s terroristes pr�sent�es dans le projet de loi C‑25 afin de d�terminer si elles sont n�cessaires et raisonnables.
En d�cembre 2006, le Commissariat s’est vu confier de nouvelles responsabilit�s de surveillance dans le cadre du projet de loi C‑25. Le Commissariat a maintenant pour mandat de v�rifier r�guli�rement la conformit� avec la Loi sur la protection des renseignements personnels du Centre d’analyse des op�rations et d�clarations financi�res (CANAFE). La Loi donne � la commissaire � la protection de la vie priv�e le mandat d’examiner les activit�s du CANAFE et d’en rendre compte au Parlement tous les deux ans. Par cons�quent, le Commissariat a d�j� pr�vu de proc�der � une v�rification du CANAFE en 2007‑2008. Le fait d’accorder � la commissaire le mandat d’examiner les activit�s du CANAFE constitue une �tape importante, car le projet de loi C‑25 fera augmenter le nombre d’organisations devant contr�ler et recueillir des renseignements sur leurs clients ainsi que la quantit� de renseignements personnels recueillis, et exigera que davantage de transactions fassent l’objet d’un examen minutieux et d’une reddition de comptes.
R�vision de la l�gislation : garder � jour le droit � la vie priv�e des Canadiennes et des Canadiens
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques (LPRPD�)
En juillet 2006, en pr�vision de l’examen obligatoire de la LPRPD�, le Commissariat a publi� les r�sultats d’une consultation qui d�crit plusieurs questions devant �tre prises en compte au cours de l’examen. Le Commissariat a demand� des suggestions quant aux enjeux et aux modifications possibles qui devraient �tre �tudi�s au cours de l’examen de la LPRPD�. En retour, le Commissariat a re�u 63 m�moires qui ont orient� sa r�flexion sur cette question. Apr�s cette consultation, en novembre 2006, le Commissariat a pr�sent� au Comit� permanent de l’acc�s � l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’�thique un document d’information r�sumant les points de vue exprim�s et mettant de l’avant ses opinions pr�liminaires quant au fonctionnement de la LPRPD�. Suite � cela, le Commissariat a comparu devant le Comit�, en f�vrier 2007, et la commissaire a pr�sent� un m�moire d�crivant la position plus d�finie du Commissariat sur l’examen de la Loi. Ce document faisait remarquer que m�me si le Commissariat juge que laLPRPD� fonctionne plut�t bien, des lacunes qui n’ont pas �t� anticip�es au moment o� la Loi a �t� r�dig�e, il y a plusieurs ann�es, ont �t� observ�es.
La Loi sur la protection des renseignements personnels
En octobre 2005, lors d’une comparution de la commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada portant sur les rapports annuels du Commissariat, le Comit� permanent de l’acc�s � l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’�thique l’a invit�e � formuler des propositions de modification de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En r�ponse, la commissaire a pr�sent� en juin 2006 un document de travail sur la r�forme de la Loi. Ce document contenait des informations sur les facteurs justifiant une modification de la Loi sur la protection des renseignements personnels de m�me que des recommandations et des propositions g�n�rales de modification de la Loi. Le Commissariat a aussi comparu devant le Comit� en juin 2006 afin de pr�senter ce document de travail, qui contient de nombreuses recommandations. La Loi sur la protection des renseignements personnels en est � sa premi�re mouture et n’a pas �t� modifi�e de fa�on importante depuis son adoption en 1982. Le Commissariat croit que la population canadienne, les �lus et les fonctionnaires, de m�me que les groupes de la soci�t� civile repr�sentant de vastes int�r�ts soci�taux, devraient participer � une discussion s�rieuse, d�lib�r�e et �clair�e sur la r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Facteurs internes
L’exercice 2006‑2007 �tait la premi�re ann�e du plan de mise en œuvre de l’analyse de rentabilisation de trois ans du Commissariat (pr�sent� en 2005‑2006 au Comit� consultatif sur le financement et la surveillance des hauts fonctionnaires du Parlement). Le Commissariat s’est concentr� sur la structure organisationnelle, la dotation en personnel et les exigences de classification, au cours de cette premi�re ann�e, � la suite de l’approbation r�cente d’une augmentation de pr�s de 40 % des ressources visant l’effectif. Le Commissariat n’a toutefois pas atteint tous les objectifs de son analyse de rentabilisation en raison de probl�mes de recrutement et, par cons�quent, les nouveaux postes ne sont pas encore tous pourvus.
Le Commissariat a recouvr� sa pleine autorit� en mati�re de dotation en mai 2006, ce qui a facilit� les efforts de recrutement et prouv� l’am�lioration continue de nos pratiques de gestion des ressources humaines.
Le Commissariat a d� relever certains d�fis relatifs aux installations en raison de la croissance de l’organisation en 2006‑2007. Pour r�gler le probl�me, le Commissariat a travaill� en �troite collaboration avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada afin d’acqu�rir un espace suppl�mentaire de 550 m2 dans ses bureaux actuels, sur la rue Kent, � Ottawa. Cela a aid� quelque peu, mais il ne s’agit pas d’une solution � long terme car les besoins du Commissariat continueront de cro�tre pendant encore quelques ann�es. Le Commissariat a ex�cut� certains travaux pr�liminaires li�s � la pr�paration d’une analyse de rentabilisation visant l’approbation d’un plan de locaux � long terme. Au cours du prochain exercice, nous continuerons de travailler sur ce plan afin de r�gler les besoins continus en mati�re d’installations.
1.7 �tat du rendement relativement aux priorit�s du Commissariat
Le Commissariat a cern� six priorit�s pour 2006‑2007. Le tableau qui suit offre un r�sum� des priorit�s et r�sultats attendus, fournit des renseignements de haut niveau sur notre rendement r�el et inclut une auto�valuation de l’�tat du rendement selon les notations utilis�es par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor : satisfait aux attentes, ne satisfait pas aux
attentes ou d�passe les attentes.
Vous trouverez davantage de renseignements sur le rendement r�el � la partie II : Analyse par activit� de programme.
|
R�sultat strat�gique : le droit des personnes � la vie priv�e est prot�g�. |
|||
|---|---|---|---|
| Priorit�s pour 2006‑2007 et r�sultats attendus |
Type |
R�sultats obtenus |
�tat du rendement |
|
1. Am�liorer et �largir la prestation de services : |
Continu | ||
|
|
Partiellement satisfait aux attentes | |
|
Les arri�r�s d’�VFP n’ont pas diminu� – mais sont essentiellement demeur�s stables au cours de l’exercice – en raison de la perte de l’un des principaux agents d’examen des �VFP et du retard dans la dotation du poste vacant. |
Ne satisfait pas aux attentes |
||
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
Satisfait aux attentes | ||
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
2. R�pondre au Parlement |
Continu |
||
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
3. Participer � l’examen de la LPRPD� et � la r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels |
Continu |
|
|
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
|
Satisfait aux attentes | |
| 4. Planifier la Conf�rence internationale des commissaires � la protection des donn�es et de la vie priv�e de 2007 et se pr�parer pour celle‑ci | Nouveau | ||
|
|
|
Satisfait aux attentes |
|
5.
Accro�tre la capacit� organisationnelle : embaucher de nouveaux employ�s et les int�grer, mobiliser et former les employ�s actuels |
Nouveau | ||
|
|
|
Ne satisfait pas aux attentes
|
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
6. �laborer des syst�mes et des crit�res ax�s sur des r�sultats |
Nouveau | ||
|
|
Satisfait aux attentes | |
|
|
|
Satisfait aux attentes |
Section II : Analyse par activit� de programme
2.1 Rendement du Commissariat en 2006‑2007
Le Commissariat compte un seul r�sultat strat�gique appuy� par une architecture d’activit�s de programme (AAP) qui comprend trois activit�s op�rationnelles visant � prot�ger le droit des personnes � la vie priv�e ainsi qu'une activit� de gestion qui soutient les trois activit�s op�rationnelles.
| Protection du droit des personnes � la vie priv�e | |||
|
Activit�s de programme |
1. Activit�s li�es � la conformit� | 2. Recherche et �laboration des politiques | 3. Sensibilisation du grand public |
| Excellence en mati�re de gestion | |||
La pr�sente section d�crit le rendement du Commissariat par activit� de programme et �tablit le lien entre chaque activit� et les six priorit�s de 2006‑2007.
Activit� de programme 1 : Activit�s li�es � la conformit�
Description de l’activit�
 Le Commissariat doit enqu�ter sur les plaintes d�pos�es par des personnes ou la commissaire. Il r�pond aux demandes de renseignements pr�sent�es par des personnes ou des organisations qui communiquent avec lui pour obtenir des conseils et de l’aide concernant diverses
questions li�es � la protection de la vie priv�e. En proc�dant � des v�rifications et � des examens, le Commissariat �value �galement la mesure dans laquelle les organisations se conforment aux exigences fix�es par les deux lois f�d�rales et formule des recommandations sur les �FVP, conform�ment � la politique du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor. Cette activit� repose sur le travail
du service juridique, qui fournit des conseils sp�cialis�s et de l’assistance en cas de litige, et de l’�quipe de recherche comptant des conseillers principaux dans le domaine technique et en mati�re d’�valuation des risques.
Le Commissariat doit enqu�ter sur les plaintes d�pos�es par des personnes ou la commissaire. Il r�pond aux demandes de renseignements pr�sent�es par des personnes ou des organisations qui communiquent avec lui pour obtenir des conseils et de l’aide concernant diverses
questions li�es � la protection de la vie priv�e. En proc�dant � des v�rifications et � des examens, le Commissariat �value �galement la mesure dans laquelle les organisations se conforment aux exigences fix�es par les deux lois f�d�rales et formule des recommandations sur les �FVP, conform�ment � la politique du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor. Cette activit� repose sur le travail
du service juridique, qui fournit des conseils sp�cialis�s et de l’assistance en cas de litige, et de l’�quipe de recherche comptant des conseillers principaux dans le domaine technique et en mati�re d’�valuation des risques.
Ressources financi�res (en milliers de dollars)
| D�penses pr�vues | D�penses autoris�es | D�penses r�elles |
|---|---|---|
| 10 154 $ | 9 678 $ | 9 373 $ |
Ressources humaines
| Pr�vues | R�elles | �cart |
|---|---|---|
| 88 ETP | 82 ETP | (6) ETP |
Le niveau de ressources pr�vu pour 2006‑2007 est fond� sur la mise en place progressive des nouveaux niveaux de ressource obtenus pour la p�riode de trois ans allant de 2005‑2006 � 2007‑2008 et comprend les co�ts uniques li�s � l’�quipement des nouveaux bureaux et les ressources suppl�mentaires pr�vues pour ces ann�es en vue d’�liminer les arri�r�s li�s aux enqu�tes, aux demandes de renseignements et aux �FVP.
R�sultats attendus pour 2006‑2007
- Am�lioration de la qualit� des services – rapidit� de l’ex�cution, capacit� de r�action, initiative
- R�duction des arri�r�s des dossiers de plainte et d’examens des �FVP
- Augmentation du nombre de plaintes et de v�rifications initi�es par la commissaire
Priorit�s li�es � cette activit� de programme
Les op�rations relatives � cette activit� ont contribu� � la r�alisation de la priorit� suivante, qui est d�crite � la Section I.
| Priorit� | Type |
|---|---|
|
Am�liorer et �largir la prestation de services |
Continu |
Rendement en 2006‑2007
La commissaire a am�lior� la prestation de services aux personnes, aux institutions du gouvernement f�d�ral et aux organisations du secteur priv� gr�ce aux moyens d�crits ci‑dessous.
Am�lioration de la qualit� du service
Traitement des plaintes
Le Commissariat a re�u 385 plaintes d�pos�es en vertu de la LPRPD� et en a r�gl� 386, et 651 autres plaintes sont en cours de traitement (c.‑�‑d. plaintes report�es de l’ann�e pr�c�dente). Le Commissariat a �galement men� 33 enqu�tes sur des incidents en vertu de la LPRPD�. Par rapport � l’ann�e pr�c�dente, le Commissariat a r�ussi � r�gler davantage de dossiers, soit 59 % comparativement � 54 %.
Le Commissariat a re�u 843 plaintes d�pos�es en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et en a r�gl� 957, et 1 106 autres plaintes sont en cours de traitement. Il a �galement r�gl� 43 dossiers d’incident li�s � la Loi sur la protection des renseignements personnels et a �t� avis� de 90 communications d’int�r�t public en vertu de cette m�me loi. Par rapport � l’ann�e pr�c�dente, le pourcentage de dossiers r�gl�s compar� aux dossiers en cours de traitement s’est am�lior�, passant de 84 � 86 %.
En 2006‑2007, le temps de traitement moyen d’une plainte d�pos�e en vertu de la LPRPD� (calcul� � partir de la r�ception de la plainte jusqu’� l’envoi de la lettre de conclusions) �tait de 17 mois. Cela repr�sente une augmentation de cinq mois par rapport � l’exercice pr�c�dent, augmentation attribuable � la plus grande complexit� de certaines enqu�tes, � un nouveau processus interne exigeant l’envoi de lettres de conclusions pr�liminaires et � la perte d’employ�s d’exp�rience.
En 2006‑2007, le temps de traitement moyen d’une plainte d�pos�e en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (calcul� � partir de la r�ception de la plainte jusqu’� l’envoi de la lettre de conclusions) �tait de 13,4 mois. Cela repr�sente une augmentation de 2,9 mois par rapport � l’exercice pr�c�dent, qui est attribuable � la perte d’employ�s d’exp�rience et � l’arri�r�, ce qui fait en sorte qu’une p�riode plus longue s’�coule avant que les dossiers soient trait�s. De plus, les enqu�teurs doivent consacrer une partie de leur temps � aider � la gestion des dossiers en retard, ce qui comprend l’envoi d’accus�s de r�ception et de lettres d’avis et la communication avec les plaignants concernant l’�tat de leurs dossiers. En ce qui concerne plus particuli�rement la Loi sur la protection des renseignements personnels, bon nombre de plaintes constituent maintenant des dossiers volumineux, dont l’examen et l’analyse exigent beaucoup plus de temps. De plus, le Commissariat re�oit un certain nombre de plaintes en format multim�dia, notamment des CD, des vid�os et des bandes audio. Encore une fois, ces plaintes sont plus difficiles � examiner et n�cessitent beaucoup de temps.
Le remplacement des enqu�teurs a en outre accus� un certain retard. En effet, un nombre limit� de personnes poss�dent l’exp�rience recherch�e en mati�re de protection des renseignements personnels et d’enqu�te. De plus, un enqu�teur nouvellement int�gr� au Commissariat doit suivre une formation pouss�e et n’offre donc pas, pendant sa premi�re ann�e au Commissariat, le m�me rendement qu’un enqu�teur d’exp�rience pleinement form�.
Suivi des organisations en ce qui a trait � la mise en œuvre des recommandations
Au cours de l’exercice, le Commissariat a continu� d’officialiser sa surveillance des organisations en ce qui a trait � la mise en œuvre des recommandations formul�es au cours d’enqu�tes sur les plaintes d�pos�es en vertu de la LPRPD�. Cet objectif a �t� r�alis� gr�ce � la diffusion de 26 rapports pr�liminaires demandant des changements comme la modification de politiques et de proc�dures existantes ainsi que l’�laboration et la promotion de nouvelles politiques et proc�dures. � la fin de l’exercice, tous les r�sultats �taient conformes. Ce nouveau processus nous a permis d’encourager tr�s efficacement le secteur priv� � trouver des solutions novatrices en vue de combler les lacunes li�es � la protection des renseignements personnels cern�es au cours des enqu�tes. Il a �galement permis de renforcer les engagements des organisations � se conformer � la LPRPD�.
En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les modifications des politiques et proc�dures gouvernementales existantes sont souvent n�goci�es ou accept�es dans le cadre du processus d’enqu�te et avant l’envoi des lettres de conclusions. Ces ententes et recommandations sont �nonc�es dans les lettres de conclusions.
Modes alternatifs de r�glement des diff�rends
Le Commissariat met l’accent sur l’utilisation de modes alternatifs de r�glement de diff�rends, comme le r�glement des plaintes en cours d’enqu�te et la r�solution rapide, afin de clore une enqu�te. Les parties concern�es ont vu la plainte se r�soudre plus rapidement, le long processus d’enqu�te a �t� �court� et certaines ressources ont pu �tre �conomis�es. Le Commissariat a r�ussi � r�gler 109 plaintes pr�sent�es en vertu de la LPRPD� sur un total de 386 plaintes ferm�es, ce qui repr�sente 28 % du nombre total de dossiers r�gl�s. La mention � Plainte r�gl�e en cours d’enqu�te � indique que le plaignant et l’organisation mise en cause sont satisfaits des mesures prises par le Commissariat. De plus, le Commissariat a utilis� un processus de r�solution rapide afin de fermer 15 dossiers li�s � la LPRPD� sur les 386 plaintes ferm�es, ce qui repr�sente 4 % des dossiers r�gl�s. Le r�glement rapide est un moyen utilis� pour r�pondre aux pr�occupations en mati�re de protection des renseignements personnels du plaignant avant d’aviser l’organisation mise en cause.
Sur les 957 plaintes ferm�es, 61 plaintes d�pos�es en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont �t� r�gl�es, ce qui repr�sente 6 % du nombre total de plaintes ferm�es. Toujours sur les 957 plaintes ferm�es, 38 autres plaintes pr�sent�es en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels ont �t� r�gl�es rapidement, ce qui repr�sente 4 % du nombre total de plaintes ferm�es.
Demandes de renseignements
Le Commissariat a re�u du grand public plus de 10 000 demandes de renseignements concernant les lois. Plus particuli�rement, elle a re�u 6 619 demandes de renseignements � propos de la LPRPD� et 3 829 demandes de renseignements li�s � la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissariat a r�pondu � 6 436 demandes li�es � la LPRPD�, � 3 400 demandes � propos de la Loi sur la protection des renseignements personnels et � 3 557 demandes de renseignements g�n�raux au cours de l’exercice.
Litiges
Litiges li�s � la LPRPD� pendant la p�riode de rapport de 2006‑2007
La commissaire � la protection de la vie priv�e intente une poursuite judiciaire lorsqu’une organisation refuse d’adopter les recommandations du Commissariat formul�es dans le cadre de plaintes fond�es d�pos�es en vertu de la LPRPD�. Cette politique, appliqu�e depuis 2005, a permis d’�tablir un niveau �lev� de conformit�. Les recommandations formul�es par la commissaire en 2006‑2007 suite aux enqu�tes ont �t� adopt�es avant la fin de l’exercice. Le faible pourcentage de cas fond�s pr�sent�s en 2006‑2007 qui n’ont pas �t� r�gl�s avant que la commissaire n’ait d�pos� son rapport final a �t� r�solu dans le cadre de n�gociations entre les avocats du contentieux. Dans quatre (4) cas, le litige a �t� r�gl� dans les 45 jours suivant la pr�sentation du rapport de la commissaire et avant qu’elle ne demande � la Cour f�d�rale une ordonnance d’ex�cution. Dans quatre (4) autres cas, le litige a �t� r�gl� ou �tait en voie d’�tre r�gl� peu apr�s que la commissaire eut pr�sent� une demande � la Cour f�d�rale. � la fin de l’exercice, toutes les recommandations formul�es par la commissaire en 2006‑2007 avaient �t� adopt�es ou allaient �tre adopt�es � la satisfaction de la commissaire, de sorte qu’elle n’a pas eu besoin d’intenter de poursuite judiciaire.
Plusieurs poursuites intent�es par des plaignants ainsi que des demandes d’examen judiciaire ont �t� port�es devant des tribunaux f�d�raux. Trois (3) demandes de contr�le judiciaire ont �t� d�pos�es contre la commissaire par des personnes ou des organisations voulant que la cour examine la port�e de son pouvoir discr�tionnaire en vertu de la LPRPD�. Six (6) demandes de nature judiciaire pr�sent�es par des plaignants �taient toujours trait�es en vertu de la LPRPD� et, dans ces demandes, le Commissariat �tait concern� en tant que partie jointe. Parmi ces neuf (9) litiges actifs, deux (2) ont �t� r�gl�s ou annul�s au cours du processus, deux (2) se sont poursuivis � l’�tape de l’audience et cinq (5) ont men� � d’importantes d�cisions de la Cour f�d�rale pr�cisant les concepts juridiques cl�s qui permettront certainement d’aider les organisations � interpr�ter la Loi et � l’appliquer � l’avenir. L’autorisation de porter l’une de ces d�cisions en appel aupr�s de la Cour supr�me du Canada a �t� obtenue le 29 mars 2007.
Litiges li�s � la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant la p�riode de rapport de 2006‑2007
Du c�t� du secteur public, il y a eu peu d’activit�s dans les tribunaux en 2006‑2007. Une demande de contr�le judiciaire a �t� d�pos�e contre le Commissariat, r�gl�e et annul�e peu apr�s. Le Commissariat a demand� et obtenu le statut d’intervenant dans un autre litige qui portait sur la Loi sur l’acc�s � l’information, mais concernait l’interpr�tation de l’expression � renseignements personnels � selon la d�finition �nonc�e dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, ce qui est un aspect essentiel de notre mandat.
R�duction de l’arri�r� des plaintes et des examens des �FVP
Plaintes
Afin d'optimiser la gestion des cas, d'acc�l�rer les enqu�tes et de r�duire le risque d'�puisement professionnel de nos enqu�teurs, nous avons �tabli la charge de travail normale pour un enqu�teur d'exp�rience � 60 dossiers. Les dossiers qui sont en suspens en attendant qu’un enqu�teur se lib�re sont consid�r�s comme des plaintes en arri�r�.
� la fin de la p�riode vis�e par le rapport, il y avait 104 dossiers de plaintes d�pos�es en vertu de la LPRPD� en suspens en attendant qu'ils soient attribu�s � un enqu�teur (une am�lioration par rapport au 264 dossiers en suspens l'ann�e pr�c�dente). Et il y avait 372 dossiers de plaintes d�pos�es en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels en attente d’attribution � un enqu�teur (une am�lioration par rapport aux 644 dossiers en suspens l'ann�e pr�c�dente). Il s'agit d'une am�lioration significative de l'arri�r� des plaintes – de 60 % en ce qui concerne les plaintes d�pos�es en vertu de la LPRPD� et de 42 % en ce qui concerne celles d�pos�es en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le Commissariat a pu atteindre ces r�sultats principalement gr�ce � l'adoption des mesures suivantes :
- une augmentation du nombre d'enqu�teurs, bien que l'effectif ne soit pas encore complet;
- des am�liorations apport�es aux pratiques et aux proc�dures d'enqu�te, y compris le traitement acc�l�r� des plaintes qui sont susceptibles de se r�gler rapidement;
- la cr�ation d'une unit� administrative centralis�e permettant d'offrir au personnel un soutien constant et efficace;
- de la formation de groupe visant � am�liorer les comp�tences en mati�re d'enqu�tes.
Le Commissariat pr�voit �liminer l'arri�r� d'ici 18 mois si les niveaux de dotation pr�vus sont respect�s.
Examens des �FVP
En ce qui a trait aux examens des �valuations des facteurs relatifs � la vie priv�e (�FVP), au d�but de l'exercice financier (avril 2006), le Commissariat avait 49 �FVP en attente d'examen. Au cours de l'exercice financier, nous avons re�u des minist�res et des organismes du gouvernement un total de 23 demandes d'examen, dont 22 ont �t� effectu�s. Il y avait donc 50 �FVP en attente d'examen au 31 mars 2007.
Le nombre total d’�FVP en arri�r� n'a pas diminu�, il est demeur� essentiellement le m�me. Toutefois, des examens volumineux et complexes ont �t� r�alis�s en priorit� au cours de l'ann�e. De plus, s’ajoutant � l'examen des soumissions d’�FVP, nous avons tenu plusieurs r�unions de consultation avec divers minist�res et organismes qui cherchaient � obtenir l'avis du Commissariat sur la mani�re de mener les �FVP ainsi que de cerner et de g�rer les risques en mati�re de protection de la vie priv�e. Les examens des �FVP du Commissariat et les consultations en face � face ont entra�n� la formulation de nombreuses recommandations qui permettent d'att�nuer encore les risques relatifs � la protection de la vie priv�e associ�s � l'instauration, au gouvernement f�d�ral, de syst�mes nouveaux ou sensiblement modifi�s.
Le Commissariat a continu� � effectuer le suivi de rapports d'examens ant�c�dents d’�FVP – et a re�u 20 r�ponses d'institutions f�d�rales – indiquant des r�actions positives des minist�res et organismes concern�s aux examens du Commissariat, et la prise de mesures efficaces.
Le Commissariat avait pr�vu de r�duire l'arri�r� des examens des �FVP, mais les contraintes continues en mati�re de ressources ont frein� sa capacit� de traitement. En effet, au d�but de l'exercice financier, le Commissariat comptait deux agents d'examen des �FVP. Deux autres agents devaient �tre embauch�s, mais le processus de dotation s'est av�r� plus long que pr�vu. Par ailleurs, l'agent d'examen principal a quitt� le Commissariat au d�but de l'exercice financier, r�duisant ainsi notre effectif � un seul agent d'examen des �FVP.
Nous avons donc pris des mesures d'urgence et embauch� un employ� occasionnel pour une p�riode de quatre mois pour l’ex�cution des examens des �FVP. Par ailleurs, nous avons �tabli des contrats de services professionnels. En cons�quence, en date du 31 mars 2007, 13 examens d’�FVP �taient en cours.
Une fois que la Direction de la v�rification et de la revue disposera de l’effectif complet pr�vu, soit de 19 employ�s (comparativement � sept en date de mars 2007), l'arri�r� des examens des �FVP devrait diminuer de mani�re significative, et davantage de v�rifications pourront �tre compl�t�es. L'op�ration de dotation pour la Direction a progress� dans son ensemble et avait atteint sa vitesse de croisi�re en mars 2007. Il est � noter que les comp�tences requises en mati�re de v�rification et d’�FVP sont tr�s en demande et difficiles � trouver.
Augmentation du nombre de plaintes et de v�rifications �manant de la commissaire
Plaintes
Le nombre de plaintes d�pos�es par la commissaire est pass� � six en 2006‑2007, soit une de plus que l'ann�e derni�re.
Les plaintes d�pos�es par la commissaire compl�tent la proc�dure selon laquelle le Commissariat ouvre des dossiers d'incidents qui deviennent une forme de notification d’une br�che par des institutions du gouvernement f�d�ral ou des organisations du secteur priv�. En 2006‑2007, le CPVP a connu une augmentation globale de 9 % par rapport � l’ann�e pr�c�dente du nombre de dossiers d’incidents qui ont fait l’objet d’une enqu�te et qui ont �t� ferm�s.
V�rifications
Des progr�s consid�rables ont �t� r�alis�s au cours des deux derni�res ann�es dans l’�laboration et la r�alisation de v�rifications en mati�re de protection de la vie priv�e. En effet, les v�rifications sont non seulement plus nombreuses que par le pass�, mais plus exhaustives aussi.
Quatre v�rifications qui �taient en cours � la fin de l’ann�e financi�re pr�c�dente (mars 2006) ont �t� termin�es durant l’ann�e 2006‑2007.
Pour 2006‑2007, le CPVP avait envisag� d’entreprendre sept projets de v�rification en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels;un huiti�me projet s’est ajout� en cours d’ann�e. De ces huit projets, deux ont �t� compl�t�s au cours de l’exercice financier, deux autres �taient termin�s pour l’essentiel (rapports � venir) en mars, deux �taient en cours au 31 mars, et deux autres �taient report�s � des ann�es ult�rieures.
De plus, le Commissariat a lanc� deux v�rifications dans le secteur priv� en vertu de la LPRPD�. Celles‑ci �taient termin�es pour l’essentiel au 31 mars 2007, et les rapports suivront.
Au d�but de l’ann�e, la CPVP esp�rait effectuer cinq nouvelles v�rifications en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels au cours de l’exercice financier. Toutefois, en raison des d�lais dans les processus de dotation et de la perte de membres de l’effectif de v�rification pour cause de cong� de maladie prolong� et de d�part, le Commissariat s’est trouv� dans l’impossibilit� de terminer deux des cinq v�rifications pr�vues initialement avant la fin de l’exercice financier. L’embauche de v�rificateurs professionnels � contrat a permis d’att�nuer quelque peu le probl�me.
Activit� de programme 2 : Recherche et �laboration des politiques
Description de l’activit�
 Le CPVP joue un r�le de centre d'expertise sur les nouveaux enjeux en mati�re de protection de la vie priv�e au Canada et � l'�tranger en effectuant de la recherche sur les tendances et les d�veloppements technologiques, en suivant les initiatives l�gislatives et r�glementaires,
en offrant des analyses juridiques, politiques et techniques sur des enjeux cl�s et en �laborant des positions strat�giques visant � faire progresser la protection de la vie priv�e. Une partie importante du travail effectu� consiste � appuyer la commissaire et les hauts fonctionnaires dans la prestation de conseils au Parlement relativement aux incidences possibles sur la protection
de la vie priv�e de projets de lois, de programmes gouvernementaux et d'initiatives du secteur priv�. Comme les effets de la technologie de l'information sont tr�s importants en mati�re de protection de la vie priv�e, l'analyse des initiatives de TI qui font partie int�grante de projets constitue un volet important de cette activit�.
Le CPVP joue un r�le de centre d'expertise sur les nouveaux enjeux en mati�re de protection de la vie priv�e au Canada et � l'�tranger en effectuant de la recherche sur les tendances et les d�veloppements technologiques, en suivant les initiatives l�gislatives et r�glementaires,
en offrant des analyses juridiques, politiques et techniques sur des enjeux cl�s et en �laborant des positions strat�giques visant � faire progresser la protection de la vie priv�e. Une partie importante du travail effectu� consiste � appuyer la commissaire et les hauts fonctionnaires dans la prestation de conseils au Parlement relativement aux incidences possibles sur la protection
de la vie priv�e de projets de lois, de programmes gouvernementaux et d'initiatives du secteur priv�. Comme les effets de la technologie de l'information sont tr�s importants en mati�re de protection de la vie priv�e, l'analyse des initiatives de TI qui font partie int�grante de projets constitue un volet important de cette activit�.
Ressources financi�res (en milliers de dollars)
| D�penses pr�vues | D�penses autoris�es | D�penses r�elles |
|---|---|---|
| 3 393 $ | 3 701 $ | 2 976 $ |
Ressources humaines
| Pr�vues | R�elles | �cart |
|---|---|---|
| 19 ETP | 14 ETP | (5) ETP |
R�sultats attendus pour 2006‑2007
- Engagement clair envers le Parlement
- Dialogue avec les provinces et les territoires sur des enjeux pr�sentant un int�r�t commun
- Offre de documents cadres sur l'examen de la LPRPD� et sur la r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- �laboration et mise en œuvre d'une strat�gie du CPVP relativement � l'examen de la LPRPD� et � la r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels
- Planification en vue de la Conf�rence internationale des commissaires � la protection des donn�es et de la vie priv�e de 2007
Priorit�s li�es � cette activit� de programme
Les op�rations relatives � cette activit� ont contribu� � la r�alisation des priorit�s suivantes, qui sont d�crites � la Section I.
| Priorit�s | Type |
|---|---|
|
R�pondre au Parlement |
Continu |
|
Participer � l’examen de la LPRPD� et � la r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels |
Continu |
|
Planifier la Conf�rence internationale des commissaires � la protection des donn�es et de la vie priv�e de 2007 et se pr�parer pour celle ci |
Nouveau |
Rendement en 2006‑2007
Engagement clair envers le Parlement
Les repr�sentants du CPVP ont comparu � 11 reprises devant les comit�s de la Chambre des communes et du S�nat relativement � diverses questions, telles que :
- le projet de loi C‑2 : la Loi f�d�rale sur la responsabilit�
- le projet de loi C‑25 : la loi modifiant la Loi sur le recyclage des produits de la criminalit� et le financement des actes terroristes et la Loi de l'imp�t sur le revenu
- le projet de loi C‑31 : la Loi �lectorale
Le CPVP a �t� invit� � deux reprises � compara�tre devant le Comit� permanent de l'acc�s � l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'�thique relativement � l'examen quinquennal obligatoire de la LPRPD�. � ces deux occasions, le CPVP a propos� des modifications � la LPRPD� et a d�pos� des m�moires sur son application. En juin 2006, le CPVP a d�pos� sa proposition de r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels, demandant encore une fois un examen en profondeur de cette loi.
Le CPVP continue � soutenir les parlementaires sur des questions relatives � la protection de la vie priv�e.
Participation au dialogue avec les provinces et les territoires sur des questions pr�sentant un int�r�t commun
Le CPVP a continu� � travailler � diverses initiatives en collaboration avec les commissaires provinciaux � la protection de la vie priv�e. � titre d'exemple, en mars 2007, dans le cadre du Mois de la pr�vention de la fraude, la commissaire f�d�rale et ses homologues provinciaux et territoriaux se sont r�unis pour demander le renouvellement des efforts de lutte contre la fraude telle que le vol d'identit�.
De plus, le Commissariat a particip� � deux rencontres f�d�rales/provinciales/territoriales, une au Nunavut en juin 2006 et l'autre � Banff, en janvier 2007. Le Commissariat a �galement organis� la Conf�rence des enqu�teurs, qui a eu lieu � Winnipeg en mars 2007. Ces rencontres, de m�me que d'autres rencontres d'ordre op�rationnel, constituent d’excellentes tribunes pour discuter des exp�riences v�cues et des approches adopt�es ainsi que pour continuer � faire progresser l'harmonisation de la protection de la vie priv�e.
�galement, nous �laborons actuellement un plan de projet pilote visant � accro�tre notre pr�sence dans diff�rentes r�gions du pays, en commen�ant par le Canada Atlantique. Notre id�e consiste � poster des repr�sentants du CPVP dans la r�gion afin qu'ils puissent travailler plus �troitement avec les ombudsmans de la protection de la vie priv�e du Canada Atlantique et lancer des initiatives cibl�es de sensibilisation du public et de diffusion aupr�s de ce dernier, plus particuli�rement les petites entreprises.
�tat des processus d'examen de la LPRPD� et de la r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques
En juillet 2006, le CPVP a publi� un document de consultation d�crivant plusieurs enjeux qui, selon nous, m�ritent consid�ration dans le cadre de l'examen de la Loi. En novembre 2006, le Commissariat a d�pos� devant le Comit� permanent de l'acc�s � l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'�thique un document contextuel r�sumant les points de vue recueillis dans le cadre de cette consultation et mettant de l'avant la position pr�liminaire du CPVP sur le fonctionnement de la LPRPD�. Le Commissariat a ensuite comparu devant le Comit� en f�vrier 2007. Veuillez consulter la section 1.6 ci‑haut (� Facteurs externes �) pour plus de d�tails.
La Loi sur la protection des renseignements personnels
La commissaire � la protection de la vie priv�e a pr�sent� au Parlement, en juin 2006, un document de discussion portant sur la r�forme de la Loi. Le Commissariat a �galement comparu devant le comit� en juin 2006 pour pr�senter ce document, qui contient de nombreuses recommandations. Veuillez consulter la section 1.6 ci‑haut (� Facteurs externes �) pour plus de d�tails.
Plan pour la Conf�rence internationale des commissaires � la protection des donn�es et de la vie priv�e de 2007
En septembre 2007, le CPVP sera l'h�te de la 29e Conf�rence internationale des commissaires � la protection des donn�es et de la vie priv�e � Montr�al. En r�unissant certains des plus grands experts au monde dans le domaine de la protection des donn�es afin qu’ils auscultent clairement les d�fis qui nous attendent, la conf�rence permettra d'explorer des moyens de prot�ger et de rehausser le droit de tous � la vie priv�e.
Les principales �tapes qu’a franchies le CPVP dans la pr�paration de cette conf�rence incluent :
- l’�laboration d'un programme pr�liminaire et l’�tablissement des principaux th�mes de discussion;
- l’affichage du programme pr�liminaire sur le site Web de la Conf�rence;
- l’�tablissement de la liste des conf�renciers et des experts potentiels;
- les premiers contacts avec les conf�renciers et les experts potentiels ou les invitations;
- la confirmation des lieux pour la tenue de la Conf�rence � Montr�al;
- l’embauche de ressources externes et internes suppl�mentaires charg�es d’aider � la planification et � l'organisation de la Conf�rence;
- la promotion de la Conf�rence lors d’�v�nements nationaux et internationaux reli�s � la protection de la vie priv�e.
Pour ouvrir la voie � la Conf�rence, des homologues provinciaux de la commissaire pr�senteront trois pr�conf�rences qui rehausseront l’ensemble du programme. En effet, la commissaire � l'information et � la protection de la vie priv�e de l'Ontario pr�sentera une conf�rence portant sur les renseignements personnels sur la sant�. De leur c�t�, les commissaires � l'information et � la protection de la vie priv�e de la Colombie‑Britannique et de l'Alberta pr�senteront une conf�rence sur le cadre de protection de la vie priv�e adopt� par les ministres de l'APEC. Entre-temps, le pr�sident de la Commission d’acc�s � l’information du Qu�bec pr�sidera une conf�rence sur la protection des donn�es dans le monde de la Francophonie. Le Commissariat collabore �troitement avec ses vis-�-vis provinciaux en vue de garantir la r�ussite de leurs pr�conf�rences.
Principaux documents de recherche et de politiques produits
Programme des contributions
Le Commissariat �value les demandes de financement aux termes du Programme des contributions en fonction de leur bien‑fond� et de leur conformit� aux priorit�s du Commissariat en mati�re de recherche et d’�laboration de politiques. Un total de 388 319 $ a �t� octroy� � 11 organismes en 2006‑2007 pour la r�alisation de recherches sur des enjeux �mergents en mati�re de protection de la vie priv�e, y compris sur les questions suivantes :
- l'�tablissement de normes de certification pour les professionnels travaillant dans le domaine de la protection de la vie priv�e et de l'acc�s � l'information;
- l'utilisation de technologies de gestion des droits num�riques au Canada et ses effets sur la protection de la vie priv�e;
- les divers aspects des politiques relatives � l'identit� au Canada;
- l'efficacit� des politiques en mati�re de protection de la vie priv�e ax�es sur les enfants;
- les d�fis de la d�personnalisation des renseignements personnels sur la sant�;
- la relation entre la technologie et les choix strat�giques dans les soins de sant�;
- les effets sur la protection de la vie priv�e de l'utilisation de diverses technologies de surveillance dans les v�hicules;
- les utilisations secondaires des renseignements sur la sant� et des dossiers de sant� �lectroniques;
- les effets sur les Canadiennes et les Canadiens du commerce de renseignements personnels et l'efficacit� des lois canadiennes � prot�ger les consommateurs;
- l'utilisation et le traitement de l'ADN recueilli dans le cadre d'enqu�tes criminelles.
De plus, une organisation a re�u du financement pour la diffusion de r�sultats de recherche portant sur la protection de la vie priv�e en milieu de travail.
En plus de financer de la recherche dans le cadre de son Programme des contributions, en 2006‑2007, le Commissariat a entrepris deux initiatives visant la communication des connaissances acquises par l'entremise du Programme. En f�vrier 2007, le Commissariat a organis�, en collaboration avec le Groupe de droit et technologie de l’Universit� d’Ottawa, un symposium sur la protection de la vie priv�e sur Internet. Cette activit� d’une journ�e, tenue sur le campus de l'Universit� d'Ottawa, a r�uni les chercheurs financ�s dans le cadre du Programme qui ont travaill� sur des enjeux de protection de la vie priv�e li�s � Internet. L'activit� a �t� une r�ussite avec plus de 100 participants venant de partout au Canada et de l'�tranger. En pr�vision de la Conf�rence internationale des commissaires � la protection des donn�es et de la vie priv�e, qui aura lieu en 2007 � Montr�al, le Commissariat a entrepris de r�sumer tous les rapports de recherche pr�par�s dans le cadre du Programme depuis sa cr�ation, soit quelque 25 r�sum�s au total. En plus de faire l'objet d'une distribution � la conf�rence, ces r�sum�s seront affich�s sur le site Web du CPVP.
Autres activit�s li�es � la recherche
En plus des documents produits dans le cadre du Programme des contributions, le Commissariat a publi� plusieurs fiches d'information sur son site Web, dont trois qui traitent des nouvelles technologies et des d�fis qu'elles posent pour la protection de la vie priv�e (consultez la section Sensibilisation du grand public ci‑apr�s pour la liste compl�te des fiches d’information). Le Commissariat a fourni aux comit�s parlementaires des soumissions �crites et d'autres documents contextuels relatifs aux enjeux � propos desquels on lui a demand� de t�moigner, notamment des expos�s de position sur l'examen de la LPRPD� et le renouvellement de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le CPVP a pr�sent� un document contextuel sur les normes de protection de la vie priv�e lors d’un atelier sur cette question qui a lieu � Ottawa en f�vrier 2007. L'activit� a r�uni des intervenants de tout le Canada. Enfin, le CPVP a entrepris l'�laboration d'un document d'orientation portant sur l'utilisation de la technologie d'identification par radiofr�quence et de la surveillance vid�o dans le secteur priv�, et il s'est attaqu� � la cr�ation d'un cadre conceptuel pour la gestion de l'identit�. Le Commissariat pr�voit publier ces documents au cours de l'exercice financier de 2007‑2008.
Activit� de programme 3 : Sensibilisation du grand public
Description de l’activit�
 Le Commissariat planifie et r�alise diverses activit�s de communication et de sensibilisation du grand public, y compris la pr�sentation d’expos�s et la tenue d’�v�nements sp�ciaux, l’�tablissement de relations avec les m�dias ainsi que la production et la
diffusion de documents de promotion et d’information.
Le Commissariat planifie et r�alise diverses activit�s de communication et de sensibilisation du grand public, y compris la pr�sentation d’expos�s et la tenue d’�v�nements sp�ciaux, l’�tablissement de relations avec les m�dias ainsi que la production et la
diffusion de documents de promotion et d’information.
Ressources financi�res (en milliers de dollars)
| D�penses pr�vues | D�penses autoris�es | D�penses r�elles |
|---|---|---|
| 2 751 $ | 2 654 $ | 3 367 $ |
Ressources humaines
| Pr�vues | R�elles | �cart |
|---|---|---|
| 18 ETP | 10 ETP | (8) ETP |
R�sultats attendus pour 2006‑2007
- D�termination des principaux enjeux et �laboration de positions en mati�re de protection de la vie priv�e
- Lancement d’activit�s d’engagement pour les auditoires cl�s, tels que le Parlement, les entreprises, le gouvernement f�d�ral, le grand public, les universitaires et les professionnels du droit
Priorit�s li�es � cette activit� de programme
Les op�rations relatives � cette activit� ont contribu� � la r�alisation des priorit�s suivantes, qui sont d�crites � la Section I.
| Priorit�s | Type |
|---|---|
|
Am�liorer et �tendre la prestation de services |
Continu |
|
R�pondre au Parlement |
Continu |
Rendement en 2006‑2007
D�termination des principaux enjeux et �laboration de positions en mati�re de protection de la vie priv�e
Tel que mentionn� dans le pr�sent rapport, le Commissariat a comparu � 11 reprises devant des comit�s de la Chambre des communes et du S�nat au sujet de diverses questions touchant la vie priv�e (projets de loi C‑2, C‑25 et C‑31) et a �t� invit� trois fois par le Comit� permanent de l'acc�s � l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'�thique pour discuter de l’examen obligatoire quinquennal de la LPRPD� et de la r�forme de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Activit�s d’engagement
L’augmentation des fonds d�coulant de l’analyse de rentabilisation a permis au Commissariat d’entreprendre des initiatives de sensibilisation du grand public plus pouss�es et de mettre en œuvre la strat�gie proactive et exhaustive de communication et de sensibilisation �labor�e en 2004‑2005.
|
Les Canadiennes et les Canadiens continuent � accorder une tr�s grande importance � la l�gislation en mati�re de protection de la vie priv�e, comme le montrent les niveaux d’importance indiqu�s dans le sondage de cette ann�e, niveaux les plus �lev�s de puis mars 2005. Les Associ�s de recherche EKOS inc. (mars 2007) |
Le Commissariat a command� son sondage d’opinion publique annuel en mars 2007 afin de prendre � nouveau le pouls des Canadiennes et des Canadiens en ce qui a trait � certains enjeux �mergents en mati�re de protection de la vie priv�e, plus particuli�rement ceux li�s � la circulation transfrontali�re des renseignements personnels, � la technologie et � la protection de la vie priv�e et � la connaissance et la perception g�n�rale du droit � la vie priv�e. Le sondage a contribu� � recueillir des donn�es utiles sur le point de vue du public au regard d’importantes questions de vie priv�e. Ces renseignements seront analys�s aux fins d’�laboration d’activit�s de sensibilisation du public, de politiques et de lignes directrices. Un rapport sur le sondage sera diffus� sur le site Web du Commissariat.
En plus d’effectuer des recherches d’opinion publique, le Commissariat pr�pare tous les jours des dossiers de coupures de presse et des analyses m�diatiques sur des enjeux cl�s pour aider la direction � prendre des d�cisions. Au cours du pr�sent exercice, le Commissariat a r�pondu � environ 450 demandes d’information et d’entrevue de la part de m�dias sur d’importantes questions li�es � la vie priv�e.
Dans le but de r�pondre aux parlementaires et de nouer le dialogue avec eux, le Commissariat a comparu � 11 reprises devant des comit�s permanents (du S�nat et de la Chambre des communes). Entre autres, il a pr�sent� 8 m�moires au Parlement, il a fourni des renseignements et des clarifications sur des questions touchant la protection de la vie priv�e � des d�put�s et a particip� � une s�ance d’information sur le Commissariat � l’intention des parlementaires et de leur personnel.
Le Commissariat a men� des recherches, amorc� des d�bats publics et contribu� � mieux faire conna�tre quelques‑uns des grands enjeux nationaux en mati�re de vie priv�e aux groupes d’intervenants, dont le public, les intim�s et les plaignants, les minist�res et organismes f�d�raux, le milieu juridique et les universitaires. En outre, le CPVP poursuit sa s�rie de conf�rences bimensuelles sur la protection de la vie priv�e, au cours desquelles il donne des opinions sur des enjeux en mati�re de vie priv�e et sur les tendances futures � des auditoires comprenant des repr�sentants du gouvernement, des universitaires, des membres d’organisations du secteur priv� et d’organismes � but non lucratif et des employ�s du CPVP.
Dans le cadre de ses efforts de collaboration avec d’autres intervenants du domaine de la vie priv�e, le CPVP maintient ses liens avec les commissaires provinciaux � la protection de la vie priv�e en vue de clarifier les responsabilit�s en mati�re de protection de la vie priv�e. Le CPVP tient �galement ses homologues provinciaux et territoriaux inform�s de ses principales activit�s et de la diffusion de documents ou de soumissions li�s � la protection de la vie priv�e.
Pour que son site Web offre la meilleure information qui soit, le CPVP fait tous les efforts possibles pour que des renseignements � jour et utiles soient r�guli�rement affich�s. Par exemple, le Commissariat a cr�� un module d’apprentissage �lectronique � l’intention des d�taillants. Des membres de la F�d�ration canadienne de l’entreprise ind�pendante et du Conseil canadien du commerce de d�tail ont offert un soutien important � cette initiative de sensibilisation du grand public et, pendant le prochain exercice, collaboreront avec le CPVP � des essais du module �lectronique aupr�s de groupes cibles. Dans l’ensemble, les sections les plus populaires du site Web sont celles qui portent sur la l�gislation en mati�re de protection de la vie priv�e, les fiches d’information et le guide � l’intention des entreprises – le site du CPVP a d�pass� le cap des 1,3 million de visiteurs pour la deuxi�me ann�e cons�cutive. Des essais aupr�s de groupes cibles repr�sentant des auditoires cl�s ont �t� effectu�s en vue d’am�liorer davantage le site afin de garantir qu’il constitue une ressource de premier plan pour les questions de protection de la vie priv�e. Des conclusions seront analys�es et int�gr�es � un projet de site Web, qui sera lanc� pendant le prochain exercice.
|
Liste des fiches d’information �labor�es en 2006-2007 :
|
Des possibilit�s d’allocutions ont aid� le Commissariat � accro�tre la sensibilisation aux questions de protection de la vie priv�e au sein des divers auditoires et milieux, dont les associations professionnelles et industrielles, les organismes � but non lucratif, les groupes de d�fense et les universit�s. En 2006‑2007, le Commissariat a re�u 114 demandes d’allocution, et ses dirigeants ont fait 86 allocutions et pr�sentations � diff�rents �v�nements et conf�rences, entre autres des discours pour le Conseil canadien du commerce du d�tail � Toronto et le Barreau du Qu�bec, ainsi qu’� une conf�rence sur l’acc�s � l’information et la protection des renseignements personnels organis�e par l’Universit� de l’Alberta.
Il importe de souligner que le CPVP a maintenu son programme de publications. Cette ann�e, le CPVP a distribu� plus de 4 050 exemplaires de ses publications – allant des textes des lois en mati�re de protection de la vie priv�e au guide sur la LPRPD� � l’intention des entreprises et aux rapports annuels – � des intervenants, au grand public et aux communaut�s juridiques. En outre, nous avons travaill�, en partenariat avec le Conseil canadien du commerce de d�tail, � une campagne visant � fournir � 5 000 de leurs membres un guide � l’intention des entreprises expliquant en quoi la LPRPD� s’applique � eux. Ces r�alisations montrent l’engagement du CPVP � �tre plus proactif dans les activit�s de sensibilisation du grand public et � �tendre la port�e de ses services.
En outre, nous avons �labor� plusieurs documents didactiques destin�s au grand public. Par exemple, nous avons mis � jour et r�imprim� le guide � l’intention des entreprises afin de d�finir plus clairement les obligations en vertu de la LPRPD�, �labor� des lignes directrices pour l’identification et l’authentification qui respectent les pratiques �quitables li�es � l’information pr�vues dans la LPRPD� et garantissent la conformit� � ses dispositions en mati�re de s�curit�, et produit de nombreuses fiches d’information sur les renseignements personnels, qui ont �t� mises � la disposition du public. De plus, le Commissariat a affich� sur son site des Questions et R�ponses qui expliquent aux Canadiennes et aux Canadiens comment d�poser une plainte devant la Cour f�d�rale en vertu de la LPRPD�. Le document vise � d�mystifier le processus afin que les citoyens comprennent la proc�dure � suivre et qu’ils puissent exercer leurs droits.
Autres activit�s : Excellence en mati�re de gestion
Description de l’activit�
Le CPVP continue d’am�liorer ses pratiques de gestion afin de satisfaire aux normes les plus strictes de rendement et de responsabilisation. Les ressources associ�es � la Direction de la gestion int�gr�e ont �t� r�parties entre les trois premi�res activit�s de programme qu’elle appuie. On s’attend � ce que tous les gestionnaires soient responsables des r�sultats attendus et qu’ils int�grent � leurs plans op�rationnels les activit�s requises pour obtenir ces r�sultats.
R�sultats attendus pour 2006-2007
- Pleine utilisation des ressources allou�es
- Int�gration compl�te des nouveaux employ�s
- Gestionnaires et employ�s form�s, gestionnaires subd�l�gataires
- Extraction facile et rapide de l’information des dossiers
- Conformit� � la GSTI
- Plan de continuit� des op�rations mis en vigueur
- Planification des bureaux r�gionaux termin�e
- �bauche de cadre de gestion du rendement et mesures de base en place
Priorit�s li�es � cette activit� de programme
Les op�rations relatives � cette activit� contribuent � la r�alisation des priorit�s suivantes, qui sont d�crites � la Section I.
| Priorit�s | Type |
|---|---|
|
Am�liorer et �tendre la prestation de services |
Continu |
|
Accro�tre la capacit� organisationnelle : embaucher de nouveaux employ�s et les int�grer, mobiliser et former les employ�s actuels |
Nouveau |
|
�laborer des syst�mes et des crit�res ax�s sur des r�sultats |
Nouveau |
Rendement en 2006-2007
D’autres r�alisations sur le plan de la gestion sont pr�sent�es � la section 3.2 du pr�sent Rapport minist�riel sur le rendement.
En 2006-2007, dans le cadre de la mise en œuvre de l’analyse de rentabilisation, le CPVP a effectu� un examen de sa structure organisationnelle. Trente-sept (37) des 47 postes organisationnels requis selon l’analyse de rentabilisation (ou 79 %) ont �t� cr��s ou revus en 2006‑2007 et les mesures de dotation connexes ont �t� prises. Les 10 autres postes (ou 21 %) seront examin�s en 2007‑2008. � l’instar d’autres organisations, le CPVP a �t� confront� � des d�fis en ce qui a trait � l’embauche de personnel, ce qui a eu une incidence sur son obligation de pourvoir pleinement les postes additionnels dans le cadre de l’analyse de rentabilisation.
Les nouveaux employ�s ont �t� pleinement int�gr�s dans leur direction g�n�rale respective. Par exemple, les nouveaux enqu�teurs et les nouveaux agents des demandes de renseignements ont suivi un programme complet d’orientation comprenant, entre autres, un mentorat, une formation en cours d’emploi et des cours collectifs sur les techniques d’entrevue et de communication t�l�phonique, et ont particip� � une conf�rence nationale des enqu�teurs qui leur a permis de cr�er des liens et de partager des exp�riences avec des homologues provinciaux.
Tous les gestionnaires subd�l�gataires et la majorit� des gestionnaires non vis�s par la d�l�gation ont eu une formation en classe offerte par l’�cole de la fonction publique du Canada et assist� � des s�ances d’information avec des employ�s et � une r�union du Comit� de la haute gestion; ils ont eu acc�s � de l’information sur Internet et � des bulletins, et ont obtenu un mentorat individuel par des sp�cialistes en dotation du CPVP.
Des am�liorations ont �t� apport�es au syst�me de d�p�t de documents (SGDDI), et des r�gles administratives pour la gestion efficace de l’information ont �t� �labor�es afin de r�duire les cloisonnements d’information et de rendre les donn�es faciles � consulter et � extraire. Ces am�liorations sont actuellement mises � l’essai dans le cadre d’un projet pilote, et tous les employ�s du CPVP pourront en profiter � compter de juin 2007.
Le CPVP a �tabli un plan d’action pour la mise en œuvre de la norme de Gestion de la s�curit� des technologies de l’information (GSTI), et l’�ch�ance de d�cembre 2006 pour la conformit� initiale a �t� respect�e. Un exercice annuel sera effectu� par la suite afin d’assurer la conformit� � la norme GSTI. Jusqu’ici, les rapports provisoires � cet �gard sont positifs.
Un Plan de continuit� des op�rations pour le CPVP �tait en cours d’�laboration en 2006‑2007, et les travaux visant � le mettre au point se poursuivront en 2007-2008.
Des consultations ont �t� men�es dans les provinces de l’Atlantique aupr�s des bureaux des ombudsmans et des gouvernements de la Nouvelle-�cosse et du Nouveau-Brunswick, ainsi qu’avec des universitaires r�gionaux, afin de d�terminer les besoins de la r�gion. En outre, des discussions ont eu lieu sur la possibilit� de partager des bureaux et d’autres ressources avec les ombudsmans locaux.
En d�cembre 2006, le CPVP a approuv� son cadre d�taill� de mesure des r�sultats et du rendement ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre sur une p�riode de trois ans commen�ant en 2007‑2008 (pour plus de d�tails, voir le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2007‑2008 du CPVP). Afin de se pr�parer pour la premi�re ann�e de mise en œuvre du cadre en 2007‑2008, le CPVP a �labor� les instruments de mesure requis pendant le dernier trimestre de 2006‑2007. Cet exercice servira de pr�paration au CPVP pour l’�valuation de son rendement en fonction d’une premi�re s�rie d’indicateurs de rendement tir�s de son nouveau cadre dans le prochain Rapport minist�riel sur le rendement. Le CPVP a d�j� en place certaines mesures de base, par exemple le pourcentage de recommandations r�sultant de v�rifications qui ont �t� accept�es et mises en œuvre, le nombre de cas soumis au contentieux par rapport au nombre de cas r�gl�s � la satisfaction des deux parties, la distribution de documents du CPVP � divers auditoires, etc. D’autres indicateurs pour lesquels il n’y a pas encore de mesures de base seront appuy�s par d’autres renseignements sur le rendement � mesure que le cadre sera mis en œuvre selon une approche graduelle sur une p�riode de trois ans ou plus.
Section III : Information additionnelle
3.1 Renseignements sur l’organisation
La commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada est une haute fonctionnaire du Parlement qui rel�ve directement de la Chambre des communes et du S�nat. Le Commissariat compte �galement deux commissaires adjoints, un responsable de la Loi sur la protection des renseignements personnels et l’autre, responsable de la LPRPD�. Depuis 2004, le Commissariat a un comit� consultatif externe compos� de sp�cialistes de la protection de la vie priv�e, d’universitaires et de fonctionnaires œuvrant dans le domaine. Le comit� se r�unit deux fois l’an et fournit des conseils sp�cialis�s sur des pr�occupations int�ressant le Commissariat.
Le Commissariat, qui compte cinq directions op�rationnelles appuy�es par deux fonctions de gestion int�gr�e, a la structure suivante :
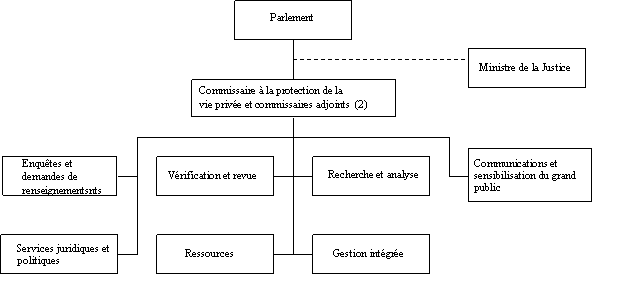
La Direction des enqu�tes et des demandes de renseignements a mission de faire enqu�te � l’�gard des plaintes d�pos�es par des personnes et des cas de mauvaise gestion des renseignements personnels. La Direction des demandes de renseignements r�pond � des milliers de demandes chaque ann�e �manant de membres du public et d’organisations.
La Direction de la v�rification et de la revue proc�de � la v�rification d’organisations afin d’�tablir si celles-ci se conforment aux dispositions des deux lois f�d�rales. Elle analyse �galement les rapports d’�valuation des facteurs relatifs � la vie priv�e qui sont soumis au Commissariat conform�ment � la politique du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor en la mati�re et fait des recommandations � leur sujet.
La Direction de la recherche et de l’analyse a pour t�che la r�alisation de recherches sur des questions concernant la protection de la vie priv�e et la technologie � l’appui de l’�laboration de politiques, des enqu�tes et des v�rifications et du programme de sensibilisation du grand public. Elle administre le programme de recherche, qui a �t� lanc� en 2004 dans le but d’appuyer la recherche sur la protection des renseignements personnels et la promotion de la protection de la vie priv�e. Elle apporte �galement son concours aux activit�s de rayonnement et vise � susciter la participation des intervenants.
La Direction des communications et de la sensibilisation du grand public met l’accent sur la prestation de conseils strat�giques et d’un soutien pour les activit�s de communication et de sensibilisation du grand public du Commissariat. En outre, elle planifie et met en œuvre les activit�s d’information et de communication, dont l’analyse de la fa�on dont le public per�oit les questions touchant la protection de la vie priv�e gr�ce � un suivi des m�dias, � des sondages de l’opinion publique, aux relations m�diatiques, aux publications et � notre site Web.
La Direction des politiques et des services juridiques offre des services sp�cialis�s de nature juridique et strat�gique sur les nouvelles pr�occupations relatives � la protection de la vie priv�e au Canada et sur la sc�ne internationale. Elle repr�sente le Commissariat devant les tribunaux et fournit des conseils aux commissaires sur l’interpr�tation et l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la LPRPD�. La Direction offre des conseils juridiques sp�cialis�s aux directions op�rationnelles du Commissariat, dont la Direction des enqu�tes et des demandes de renseignements et la Direction de la v�rification et de la revue, de m�me que des conseils d’ordre g�n�ral sur tout un �ventail de questions concernant l’organisation. Elle assure la surveillance des initiatives l�gislatives et gouvernementales, en fait l’analyse et donne des avis aux commissaires quant aux positions strat�giques � adopter dans le but de prot�ger et de favoriser le droit � la vie priv�e au Canada.
La Direction des ressources humaines offre des conseils strat�giques, des services de gestion et des programmes exhaustifs de gestion des ressources humaines dans les domaines de la dotation en personnel, de la classification, des relations de travail, de la planification des ressources humaines, de l’apprentissage et du perfectionnement, de l’�quit� en mati�re d’emploi, des langues officielles et de la r�mun�ration.
La Direction de la gestion int�gr�e, sous la direction du chef des services financiers, offre des conseils aux commissaires et des services de gestion int�gr�e aux gestionnaires et aux employ�s, notamment en ce qui concerne la planification et les rapports minist�riels, les finances, la gestion et la technologie de l’information et l’administration g�n�rale.
3.2 Autres r�alisations en mati�re de gestion
Outre les r�alisations dont il est fait �tat � la Section 2.1 du pr�sent Rapport minist�riel sur le rendement (� Autres activit�s : Excellence en gestion �), le Commissariat a accompli ce qui suit dans le domaine de la gestion.
En 2006-2007, les deux priorit�s du Commissariat en mati�re de gestion �taient la mise en œuvre de l’analyse de rentabilisation permettant au Commissariat de bien remplir sa mission, avec des ressources suffisantes, et la poursuite des efforts en vue du renforcement de nos ressources humaines.
Mise en œuvre de l’analyse de rentabilisation du Commissariat
Au cours de l’exercice 2006-2007, le Commissariat a �t� en mesure de doter en personnel l’�quivalent de 29,5 ETP, ce qui repr�sente une augmentation de 38 % par rapport � l’exercice pr�c�dant. Bien que le Commissariat n’ait pas �t� en mesure de doter tous les postes mentionn�s dans l’analyse de rentabilisation, nous avons r�cemment mis en œuvre de nouvelles strat�gies novatrices de dotation qui aideront le Commissariat � rep�rer, attirer et recruter de nouveaux employ�s afin d’atteindre ses objectifs pr�vus de dotation pour les prochaines ann�es.
Le Commissariat a �galement �t� en mesure d’acqu�rir et d’�quiper de nouveaux locaux � bureaux et de faire des investissements importants dans son infrastructure de technologie de l’information et de gestion de l’information.
Ressources humaines
Le Commissariat a entrepris une �tape importante de son renouveau institutionnel. S’inspirant de la philosophie de gestion favorisant des valeurs et des principes d�ontologiques fondamentaux dans la fonction publique, et conform�ment � la Loi sur la modernisation de la fonction publique, la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP), la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi sur la gestion des finances publiques, le Commissariat a travaill� d’arrache-pied � l’instauration des syst�mes et des processus jetant les bases d’un solide cadre de gestion de la dotation. Au d�but de mai 2006, la Commission de la fonction publique a lev� les restrictions relatives aux pouvoirs de dotation du Commissariat qui �taient en vigueur depuis 2003. Le Commissariat, avec son �quipe de gestion actuelle, a consid�rablement am�lior� ses syst�mes et pratiques de dotation. Fort d’une strat�gie de dotation assortie de plans et de politiques connexes, de strat�gies de communication pour les cadres et les employ�s et d’un processus d’autosurveillance, le Commissariat a �t� d�clar� pr�t � mener des mesures de dotation conform�ment � la nouvelle loi.
Le Commissariat continue � œuvrer en vue de l’�laboration et de la mise en œuvre d’am�liorations des pratiques de gestion et de la qualit� globale du milieu de travail, nomm�ment en modifiant consid�rablement ses politiques et pratiques de gestion du personnel.
- Le Commissariat a mis en œuvre un certain nombre de politiques en mati�re de ressources humaines apr�s avoir consult� les organismes centraux et les syndicats, conform�ment aux dispositions de la nouvelle LEFP. Les politiques guideront l’organisation � mesure que celle-ci, forte des r�ussites de l’ann�e �coul�e, continuera sur la voie du renouveau institutionnel.
- Un instrument de d�l�gation des pouvoirs en mati�re de gestion des ressources humaines a �t� �labor� afin d’informer et de guider les gestionnaires tout en leur donnant les moyens voulus pour une bonne gestion des ressources humaines.
- Un plan strat�gique des ressources humaines et une nouvelle strat�gie de dotation, de m�me qu’un plan d’action pour l’�quit� en mati�re d’emploi, aideront le Commissariat � accomplir sa mission et assureront le recrutement d’employ�s tr�s qualifi�s issus de tous les milieux de mani�re � refl�ter la diversit� de la soci�t� canadienne. De plus, le Commissariat a entrepris l’�laboration d’une strat�gie de recrutement visant des groupes donn�s. Cela comprend la r�alisation d’une analyse des besoins et des r�sultats des campagnes de recrutement pass�es au Commissariat afin de recenser et de cibler un �ventail de solutions de rechange en mati�re de recrutement pour r�pondre aux besoins de l’organisation tout en respectant l’esprit de la nouvelle LEFP.
- L’examen et l’actualisation de la Strat�gie des ressources humaines 2004‑2007 ont commenc� dans le but de combler les lacunes, d’assurer une approche concert�e dans le respect des exigences f�d�rales et de r�sumer les grandes mesures de dotation pour l’avenir. Gr�ce � cette initiative, le Commissariat sera pr�t bien avant le prochain exercice � mesure que les efforts de recrutement et de maintien de l’effectif s’intensifient dans toute l’organisation. Cela supposera le recensement des priorit�s en mati�re de ressources humaines de m�me que l’adoption d’une approche li�e au cycle de vie connexe pour diverses fonctions li�es aux ressources humaines.
- Dans le cadre de l’engagement pris par le Commissariat � l’�gard d’une plus grande transparence de ses processus de dotation, un bulletin aux employ�s a �t� cr�� et est distribu� tous les mois � tout le personnel.
Le Commissariat a accompli des progr�s importants dans le domaine de l’apprentissage, dont l’�laboration d’une strat�gie d’acquisition du savoir avec l’�cole de la fonction publique du Canada, et des s�ances de formation et d’information dans des domaines comme la dotation fond�e sur les valeurs, les exigences linguistiques, la gestion du rendement, l’�valuation des employ�s et la sensibilisation au harc�lement en milieu de travail. Le Commissariat a donn� des s�ances d’information � l’occasion des r�unions de service trimestrielles de m�me qu’� l’intention de tous les cadres sup�rieurs et tous les gestionnaires concernant les diff�rents aspects des nouvelles LMFP et LEFP. Avec la strat�gie d’acquisition du savoir et le programme d’�tudes mis au point par l’�cole de la fonction publique, les employ�s pourront continuer d’acqu�rir les comp�tences et les connaissances voulues pour exercer leurs fonctions, ce qui les habilitera � assumer de nouvelles responsabilit�s. La Strat�gie d’acquisition du savoir a �t� modifi�e de mani�re � tenir compte des besoins de formation se rapportant � la nouvelle LEFP, dont une s�ance de sensibilisation du Comit� de la haute gestion et une formation sur la LEFP � l’intention des gestionnaires investis de pouvoirs sous-d�l�gu�s, s�ances qui ont �t� offertes en mars 2006.
Planification et rapports
Avec l’�laboration et l’approbation, en d�cembre 2006, de son cadre de mesure des r�sultats et du rendement, le Commissariat a fait la transition de la planification ax�e sur les activit�s � la planification, la gestion et l’�tablissement de rapports ax�s sur les r�sultats. La mise en œuvre de ce nouveau cadre, sur une p�riode de trois ans, a commenc�. Au cours du dernier trimestre de 2006-2007, le Commissariat a �labor� les outils d’�valuation voulus pour entreprendre la mise en application d�s le prochain exercice. Il s’engagera plus avant en 2007-2008 en incluant son cadre de mesure du rendement dans les plans des directions et en mettant en œuvre les outils de mesure voulus de mani�re � pouvoir commencer l’�tablissement de rapports en fonction des r�sultats � la fin de l’exercice. De plus, toujours en 2006-2007, le Commissariat a int�gr� tous les aspects de la planification op�rationnelle (finances, ressources humaines, TI/GI) aux niveaux de l’organisation et des directions.
Pour donner suite � son engagement � l’�gard de l’excellence en gestion, le Commissariat a men� sa premi�re auto�valuation en fonction du cadre de responsabilisation de gestion en 2006-2007. La d�marche, que le Commissariat entend mener tous les ans, procure en quelque sorte un bulletin annuel sur l’�tat de la gestion et sera � la base de l’�tablissement d’objectifs en vue d’une am�lioration continue des processus et pratiques de gestion.
Finances et administration
|
Le Commissariat a �labor� ou modifi� les politiques suivantes concernant la gestion int�gr�e en 2006-2007 :
|
Depuis que le Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada a entrepris ses v�rifications du Commissariat en 2003-2004, ce dernier fait constamment l’objet d’opinions sans r�serve � l’�gard de ses �tats financiers, y compris ceux de 2006-2007.
Le Commissariat am�liore continuellement ses pratiques de gestion financi�re en examinant, simplifiant et renfor�ant ses politiques et pratiques en la mati�re tout en intensifiant les communications et la formation � l’intention du personnel.
Au fil des ans, le Commissariat a pu acqu�rir, am�nager, meubler et �quiper des locaux pour ses nouveaux employ�s et d’autres ressources obtenues � la faveur de l’analyse de rentabilisation.
Gestion de l’information/Technologie de l’information (GI/TI)
Plusieurs initiatives importantes en GI/TI ont �t� men�es � bien ou ont progress� consid�rablement au cours de l’ann�e �coul�e. En 2006-2007, le Commissariat :
- a �tabli un plan de reprise des activit�s et fait l’acquisition de tout le mat�riel n�cessaire � son centre de reprise des activit�s apr�s un sinistre;
- a actualis� son cadre d’�valuation des menaces et des risques et entrepris l’�laboration de mesures visant le renforcement de la s�curit�;
- a d�pass� le jalon de mi-parcours dans son projet relatif � la gestion de l’information et commenc� l’�valuation de syst�mes appel�s � remplacer son syst�me de suivi des plaintes;
- a trouv� un service de recherche pour la Direction des services juridiques;
- a men� � bien le zonage de ses serveurs, instaur� une strat�gie de remplacement des serveurs et entrepris l’�laboration de proc�dures de gestion des changements afin de pouvoir rapidement apporter des correctifs � ses syst�mes de serveurs;
- a achet� de nouveaux ordinateurs et instaur� une nouvelle infrastructure de TI � l’intention des nouveaux employ�s.
3.3 Tableaux des ressources
Tableau 1: Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles (y compris les �quivalents � temps plein)
| (en milliers de dollars) | 2005–2006 D�penses r�elles |
2006–2007 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles | ||
|
Activit�s de conformit� |
7 909 | 10 154 | 10 154 | 9 678 | 9 373 |
| Recherche et �laboration de politiques | 2 094 | 3 393 | 3 393 | 3 701 | 2 976 |
|
Sensibilisation |
1 628 | 2 751 | 2 751 | 2 654 | 3 367 |
|
Total |
11 631 | 16 298 | 16 298 | 16 033 | 15 716 |
|
|
|||||
|
Moins : revenus non disponibles |
- | N/A | - | N/A | - |
| Plus : co�t des services re�us � titre gracieux | 1 375 | N/A | 1 854 | N/A | 1 586 |
|
Total des d�penses |
13 006 | N/A | 18 152 | N/A | 17 302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
�quivalents temps plein |
78.5 | N/A | 125 | N/A | 108 |
Tableau 2: Ressources par activit�s de programme
|
(en milliers de dollars) |
2006-2007 | ||
|---|---|---|---|
| Activit� de programme | Fonctionnement | Contributions | Total |
|
Activit�s de conformit� |
|||
|
Budget principal des d�penses |
10 154 | - | 10 154 |
|
D�penses pr�vues |
10 154 | - | 10 154 |
|
Total des autorisations |
9 678 | - | 9 678 |
| D�penses r�elles | 9 373 | - | 9 373 |
|
Recherche et �laboration de politiques |
|||
|
Budget principal des d�penses |
3 018 | 375 | 3 393 |
|
D�penses pr�vues |
3 018 | 375 | 3 393 |
|
Total des autorisations |
3 326 | 375 | 3 701 |
|
D�penses r�elles |
2 553 | 423 | 2 976 |
|
Sensibilisation |
|||
|
Budget principal des d�penses |
2 751 | - | 2 751 |
|
D�penses pr�vues |
2 751 | - | 2 751 |
|
Total des autorisations |
2 654 | - | 2 654 |
|
D�penses r�elles |
3 367 | - | 3 367 |
Tableau 3: Postes vot�s et l�gislatifs
| Poste vot� ou l�gislatif | 2006-2007 (en milliers de dollars) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal | D�penses pr�vues | Total des autorisations | D�penses r�elles | ||
|
45 |
D�penses de programme |
14 460 | 14 460 | 14 755 | 14 446 |
|
(S) |
D�pense du produit de la vente de biens exc�dentaires de l’�tat |
- | - | 8 | - |
|
(S) |
Contributions aux r�gimes d’avantages sociaux des employ�s |
1 838 | 1 838 | 1 270 | 1 270 |
|
|
TOTAL |
16 298 | 16 298 | 16 033 | 15 716 |
Tableau 4: Services re�us � titre gracieux
| (en milliers de dollars) | D�penses r�elles de 2006-2007 |
|---|---|
|
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
863 |
|
Contributions de l'employeur aux primes du r�gime d'assurance des employ�s et d�penses pay�es par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada |
629 |
|
Services de paye fournis par Travaux publics et services gouvernementaux Canada |
4 |
|
V�rification des �tats financiers par le Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada |
90 |
|
TOTAL |
1 586 |
Tableau 5: Besoins en ressources par direction ou secteur
| (en milliers de dollars) | 2006-2007 | |||
|---|---|---|---|---|
| Direction / Division | Activit�s de conformit� |
Recherche et �laboration de politiques |
Sensibilisation | Total |
|
|
|
|
|
|
|
Bureaux de la commissaire et des commissaires adjoints |
||||
|
D�penses pr�vues |
428 | 428 | 428 | 1 284 |
|
D�penses r�elles |
441 | 441 | 441 | 1 323 |
|
Enqu�tes et demandes de renseignements |
||||
|
D�penses pr�vues |
3 567 | - | - | 3 567 |
|
D�penses r�elles |
3 233 | - | - | 3 233 |
|
Recherche et �laboration de politiques |
||||
|
D�penses pr�vues |
- | 1 713 | - | 1 713 |
|
D�penses r�elles |
- | 1 451 | - | 1 451 |
|
V�rification et revue |
||||
|
D�penses pr�vues |
1 655 | - | - | 1 655 |
|
D�penses r�elles |
1 382 | - | - | 1 382 |
|
Services juridiques |
||||
|
D�penses pr�vues |
927 | 397 | - | 1 324 |
|
D�penses r�elles |
926 | 479 | - | 1 405 |
|
Bureaux r�gionaux |
||||
|
D�penses pr�vues |
162 | - | 378 | 540 |
|
D�penses r�elles |
- | - | - | - |
|
Communications |
||||
|
D�penses pr�vues |
- | - | 1 257 | 1 257 |
|
D�penses r�elles |
- | - | 1 431 | 1 431 |
|
Gestion int�gr�e |
||||
|
D�penses pr�vues |
2 811 | 743 | 609 | 4 163 |
|
D�penses r�elles |
2 932 | 562 | 1 354 | 4 848 |
|
Ressources humaines |
||||
|
D�penses pr�vues |
604 | 112 | 79 | 795 |
|
D�penses r�elles |
459 | 43 | 141 | 643 |
|
TOTAL |
||||
|
D�penses pr�vues |
10 154 | 3 393 | 2 751 | 16 298 |
|
D�penses r�elles |
9 373 | 2 976 | 3 367 | 15 716 |
Tableau 6: Politique sur les d�placements
En tant qu’organisme vis� par l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada respecte la politique sur les d�placements du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor, les allocations et les taux pertinents.
Tableau 7: �tats financiers v�rifi�s
Les �tats financiers v�rifi�s du CPVP ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public. Les renseignements suppl�mentaires non v�rifi�s pr�sent�s dans les tableaux financiers du RMR sont pr�par�s selon la comptabilit� de caisse modifi�e afin d’�tre conformes aux principes de d�claration fond�s sur les cr�dits. La note 3 des �tats financiers v�rifi�s pr�sente un rapprochement entre ces deux m�thodes comptables.
3.4 �tats financiers v�rifi�s
Les �tats financiers v�rifi�s du CPVP ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public. Les renseignements suppl�mentaires non v�rifi�s pr�sent�s dans les tableaux financiers du RMR sont pr�par�s selon la comptabilit� de caisse modifi�e afin d’�tre conformes aux principes de d�claration fond�s sur les cr�dits. La note 3 des �tats financiers v�rifi�s pr�sente un rapprochement entre ces deux m�thodes comptables.
D�claration de responsabilit� de la direction
La responsabilit� de l'int�grit� et de l'objectivit� des �tats financiers ci-joints pour l'exercice termin� le 31 mars 2007 et toute l'information figurant dans ces �tats incombe � la direction du Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada. Ces �tats financiers ont �t� pr�par�s par la direction conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, et aux directives de fin d'exercice �mises par le Bureau du contr�leur g�n�ral.
La direction est responsable de l'int�grit� et de l'objectivit� de l'information pr�sent�e dans les �tats financiers. Certaines informations pr�sent�es dans les �tats financiers sont fond�es sur les meilleures estimations et le jugement de la direction et tiennent compte de l'importance relative. Pour s'acquitter de ses obligations au chapitre de la comptabilit� et de la pr�sentation des rapports, la direction tient des comptes qui permettent l'enregistrement centralis� des op�rations financi�res du Commissariat. L'information financi�re soumise pour la pr�paration des Comptes publics du Canada et incluse dans le Rapport minist�riel sur le rendement du Commissariat concorde avec les pr�sents �tats financiers.
La direction poss�de un syst�me de gestion financi�re et de contr�le interne con�u pour fournir une assurance raisonnable que l'information financi�re est fiable, que les actifs sont prot�g�s et que les op�rations sont conformes � la Loi sur la gestion des finances publiques, qu'elles sont ex�cut�es en conformit� avec les r�glements, qu'elles respectent les autorisations du Parlement et qu'elles sont comptabilis�es de mani�re � rendre compte de l'utilisation des fonds du gouvernement. La direction veille �galement � l'objectivit� et � l'int�grit� des donn�es de ses �tats financiers par la s�lection appropri�e, la formation et le perfectionnement d'employ�s qualifi�s, par une organisation assurant une s�paration appropri�e des responsabilit�s et par des programmes de communication visant � assurer la compr�hension des r�glements, des politiques, des normes et des responsabilit�s de gestion dans tout le Commissariat.
Les �tats financiers du Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada ont fait l'objet d'une v�rification par la v�rificatrice g�n�rale du Canada, le v�rificateur ind�pendant du gouvernement du Canada.
| La commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada, | Le directeur de la Gestion int�gr�e et agent principal des Finances, |
|
|
|
|
|
|
| Jennifer Stoddart | Tom Pulcine, CMA |
Ottawa, Canada
Le 19 juillet 2007
RAPPORT DU V�RIFICATEUR
Au pr�sident de la Chambre des communes et au pr�sident du S�nat
J’ai v�rifi� l’�tat de la situation financi�re du Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada au 31 mars 2007 et les �tats des r�sultats, de l’avoir du Canada et des flux de tr�sorerie de l’exercice termin� � cette date. La responsabilit� de ces �tats financiers incombe � la direction du Commissariat. Ma responsabilit� consiste � exprimer une opinion sur ces �tats financiers en me fondant sur ma v�rification.
Ma v�rification a �t� effectu�e conform�ment aux normes de v�rification g�n�ralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la v�rification soit planifi�e et ex�cut�e de mani�re � fournir l’assurance raisonnable que les �tats financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La v�rification comprend le contr�le par sondages des �l�ments probants � l’appui des montants et des autres �l�ments d’information fournis dans les �tats financiers. Elle comprend �galement l’�valuation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appr�ciation de la pr�sentation d’ensemble des �tats financiers.
� mon avis, ces �tats financiers donnent, � tous les �gards importants, une image fid�le de la situation financi�re du Commissariat au 31 mars 2007 ainsi que des r�sultats de son exploitation et de ses flux de tr�sorerie pour l’exercice termin� � cette date selon les principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada.
De plus, � mon avis, les op�rations du Commissariat dont j’ai eu connaissance au cours de ma v�rification des �tats financiers ont �t� effectu�es, � tous les �gards importants, conform�ment � la Loi sur la gestion des finances publiques et ses r�glements et � la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La v�rificatrice g�n�rale du Canada,
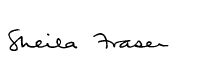
Sheila Fraser, FCA
Ottawa, Canada
Le 19 juillet 2007
�tat de la situation financi�re
|
31 mars |
2007 |
|
2006 | ||
|
|
|
|
|||
|
Actif |
|||||
|
|
|||||
|
Actifs financiers |
|
|
|||
|
|
Somme � recevoir du Tr�sor |
1 303 |
|
1 597 | |
|
|
Cr�ances et avances (note 4) |
692 |
|
48 | |
|
|
|
||||
|
Total des actifs financiers |
1 995 | 1 645 | |||
|
|
|||||
|
Actifs non financiers |
|||||
|
|
Charges pay�es d'avance |
17 |
|
47 | |
|
|
Immobilisations corporelles (note 5) |
1 187 |
|
810 | |
|
|
|
||||
|
Total des actifs non financiers |
1 204 |
|
857 | ||
|
|
|
||||
|
TOTAL |
3 199 |
|
2 502 | ||
|
|
|
||||
|
Passif et avoir du Canada |
|||||
|
|
|||||
|
Passif |
|||||
|
|
Cr�diteurs et charges � payer |
1 796 |
|
1 413 | |
|
|
Salaires � payer |
286 |
|
246 | |
|
|
Indemnit�s de vacances et cong�s compensatoires |
382 |
|
370 | |
|
|
Indemnit�s de d�part (note 6) |
1 464 |
|
1 282 | |
|
|
|
||||
|
Total du passif |
3 928 |
|
3 311 | ||
|
|
|
||||
|
Avoir du Canada (note 10) |
(729) |
|
(809) | ||
|
|
|
||||
|
TOTAL |
3 199 |
|
2 502 | ||
|
|
|
||||
Passif �ventuel (note 7)
Obligations contractuelles (note 8)
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers.
| La commissaire � la protection de la vie priv�e du Canada, | Le directeur de la Gestion int�gr�e et agent principal des Finances, |
|
|
|
|
|
|
| Jennifer Stoddart | Tom Pulcine, CMA |
Ottawa, Canada
Le 19 juillet 2007
�tat des r�sultats
|
Exercice termin� le 31 mars |
2007 |
|
2006 | ||||
| �valuation et enqu�te |
�ducation en mati�re de vie priv�e |
Politiques et recherche |
Total |
|
Total | ||
|
|
|||||||
|
Charges de fonctionnement |
|
|
|
|
|
||
|
|
Salaires et avantages sociaux |
6 507 | 1 796 | 1 684 | 9 987 | 8 193 | |
|
|
Services professionnels et sp�ciaux |
2 080 | 1 005 | 644 | 3 729 | 2 397 | |
|
|
Installations |
604 | 122 | 149 | 875 | 733 | |
|
|
D�placements et communications |
285 | 207 | 127 | 619 | 483 | |
|
|
Amortissement |
279 | 57 | 68 | 404 | 368 | |
|
|
Information |
28 | 367 | 10 | 405 | 168 | |
|
|
R�parations et entretien |
114 | 23 | 33 | 170 | 157 | |
|
|
Services publics, fournitures et approvisionnements |
80 | 28 | 22 | 130 | 106 | |
|
|
Location |
31 | 11 | 8 | 50 | 79 | |
|
|
Mat�riel |
152 | 33 | 37 | 222 | 59 | |
|
|
Autres |
7 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total des charges de fonctionnement |
10 167 | 3 650 | 2 783 | 16 600 | 12 747 | |
|
|
|||||||
|
Paiements de transfert |
- | - | 387 | 387 | 154 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Co�t de fonctionnement net |
10 167 | 3 650 | 3 170 | 16 987 | 12 901 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers.
�tat de l'avoir du Canada
|
Exercice termin� le 31 mars |
|
|
||
|
(en milliers de dollars) |
2007 | 2006 | ||
|
|
||||
|
Avoir du Canada, d�but de l'exercice |
(809) | (577) | ||
|
|
Co�t de fonctionnement net |
(16 987) | (12 901) | |
|
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement (note 3c) |
15 775 | 11 680 | |
|
|
Variation de la somme � recevoir du Tr�sor |
(294) | (386) | |
|
|
Services re�us gratuitement d'autres minist�res (note 9) |
1 586 | 1 375 | |
|
|
|
|||
|
Avoir du Canada, fin de l'exercice |
(729) | (809) | ||
|
|
|
|||
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers.
�tat des flux de tr�sorerie
|
Exercice termin� le 31 mars |
|
2007 | 2006 | |
|
(en milliers de dollars) |
|
|||
|
|
|
|||
|
Activit�s de fonctionnement |
|
|||
|
|
|
|||
|
Co�t de fonctionnement net |
|
16 987 | 12 901 | |
|
|
|
|||
|
�l�ments n'affectant pas l'encaisse : |
|
|||
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
|
(404) | (368) | |
|
Services re�us gratuitement d'autres minist�res (note 9) |
|
(1 586) | (1 375) | |
|
Perte sur ali�nation d'immobilisations corporelles |
|
(9) | - | |
|
|
|
|||
|
Variations de l'�tat de la situation financi�re : |
|
|||
|
Augmentation (diminution) des cr�ances et avances |
|
644 | (249) | |
|
Augmentation (diminution) des charges pay�es d'avance |
|
(30) | 22 | |
|
Diminution (augmentation) du passif |
|
(617) | 476 | |
|
|
|
|
||
|
Encaisse utilis�e par les activit�s de fonctionnement |
|
14 985 | 11 407 | |
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
Activit�s d'investissement en immobilisations |
|
|||
|
|
|
|||
|
Acquisition d'immobilisations corporelles |
|
790 | 273 | |
|
|
|
|
||
|
Encaisse utilis�e pour les activit�s d’investissement en immobilisations |
|
790 | 273 | |
|
|
||||
|
|
|
|
||
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement du Canada |
|
15 775 | 11 680 | |
|
|
|
|
Les notes compl�mentaires font partie int�grante des �tats financiers.
Notes compl�mentaires aux �tats financiers
1. Pouvoirs et objectifs
Le Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada (le � Commissariat �) a �t� cr�� en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en vigueur depuis le 1er juillet 1983. La commissaire � la protection de la vie priv�e est un haut fonctionnaire du Parlement, qui est ind�pendant et nomm� par le gouverneur en conseil apr�s approbation par r�solution du S�nat et de la Chambre des communes. Le Commissariat est d�sign� par d�cret comme minist�re dans l'annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et est financ� par le gouvernement du Canada au moyen de cr�dits annuels. La Commissaire rend des comptes directement au Parlement.
Les objectifs du Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada sont :
- l'examen des plaintes et la tenue de v�rifications;
- la publication des informations sur les pratiques appliqu�es dans les secteurs public et priv� en mati�re de traitement des renseignements personnels;
- l'initiative de mener des recherches sur des questions li�es � la protection de la vie priv�e;
- la sensibilisation et la compr�hension de la population canadienne sur des questions touchant la vie priv�e.
2. Sommaire des principales conventions comptables
Les pr�sents �tats financiers ont �t� pr�par�s conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, et aux directives de fin d'exercice �mises par le Bureau du contr�leur g�n�ral.
Les principales conventions comptables sont les suivantes :
(a) Somme � recevoir du Tr�sor
La somme � recevoir du Tr�sor repr�sente le montant que le Commissariat peut tirer du Tr�sor, sans cr�dits suppl�mentaires, pour pouvoir s'acquitter de ses obligations.
(b) Cr�dits parlementaires
Le Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada est financ� par le gouvernement du Canada au moyen de cr�dits parlementaires. Les cr�dits consentis au Commissariat ne correspondent pas � la pr�sentation des rapports financiers en conformit� avec les principes comptables g�n�ralement reconnus �tant donn� que les cr�dits sont fond�s, dans une large mesure, sur les besoins de
tr�sorerie. Par cons�quent, les �l�ments comptabilis�s dans l'�tat des r�sultats et dans l'�tat de la situation financi�re ne sont pas n�cessairement les m�mes que ceux qui sont pr�vus par les cr�dits parlementaires. La note 3 pr�sente un rapprochement g�n�ral entre les deux m�thodes de rapports financiers.
(c) Encaisse nette fournie par le gouvernement
Le Commissariat fonctionne au moyen du Tr�sor, qui est administr� par le receveur g�n�ral du Canada. La totalit� de l'encaisse re�ue par le Commissariat est d�pos�e au Tr�sor, et tous les d�caissements faits par le Commissariat sont pr�lev�s sur le Tr�sor. L'encaisse nette fournie par le gouvernement est la diff�rence entre toutes les rentr�es et toutes les sorties de fonds, y compris
les op�rations entre les minist�res au sein du gouvernement f�d�ral.
(d) Charges
Les charges sont comptabilis�es selon la m�thode de la comptabilit� d'exercice :
- Les contributions sont comptabilis�es dans l'exercice au cours duquel le b�n�ficiaire a satisfait aux crit�res d'admissibilit� ou a rempli les conditions de l'accord de transfert.
- Les indemnit�s de vacances et de cong�s compensatoires sont pass�es en charges au fur et � mesure que les employ�s en acqui�rent le droit en vertu de leurs conditions d'emploi respectives.
- Les services re�us gratuitement d'autres minist�res sont comptabilis�s � titre de charges de fonctionnement � leur co�t estimatif.
(e) Avantages sociaux futurs
- Prestations de retraite : Les employ�s admissibles participent au R�gime de retraite de la fonction publique, un r�gime multi-employeurs administr� par le gouvernement du Canada. Les cotisations du Commissariat au r�gime sont pass�es en charges dans l'exercice au cours duquel elles sont engag�es et elles repr�sentent l'obligation totale du Commissariat d�coulant du r�gime. En vertu des dispositions l�gislatives en vigueur, le Commissariat n'est pas tenu de verser des cotisations au titre de l'insuffisance actuarielle du r�gime.
- Indemnit�s de d�part : Les employ�s ont droit � des indemnit�s de d�part, pr�vues dans les conventions collectives ou les conditions d'emploi. Ces indemnit�s s'accumulent � mesure que les employ�s effectuent les services n�cessaires pour les gagner. L'obligation au titre des avantages sociaux gagn�s par les employ�s est calcul�e � l'aide de l'information provenant des r�sultats du passif d�termin� sur une base actuarielle pour les indemnit�s de d�part pour l'ensemble du gouvernement.
(f) Cr�ances
Les cr�ances sont comptabilis�es en fonction des montants que l'on pr�voit r�aliser. Une provision est �tablie pour les cr�ances dont le recouvrement est incertain.
(g) Passif �ventuel
Le passif �ventuel repr�sente des obligations possibles qui peuvent devenir des obligations r�elles selon que certains �v�nements futurs se produisent ou non. Dans la mesure o� l'�v�nement futur risque de se produire ou non et si l'on peut �tablir une estimation raisonnable de la perte, on comptabilise un passif estimatif et une charge. Si la probabilit� ne peut �tre d�termin�e ou
s'il est impossible de faire une estimation raisonnable du montant, l'�ventualit� est pr�sent�e dans les notes compl�mentaires aux �tats financiers.
(h) Immobilisations corporelles
Toutes les immobilisations corporelles et les am�liorations locatives dont le co�t initial est d'au moins 2 500 $ sont comptabilis�es � leur co�t d'achat. Les logiciels et les am�liorations locatives sont capitalis�s prospectivement depuis le 1er avril 2001.
Les immobilisations corporelles sont amorties selon la m�thode lin�aire sur la dur�e de leur vie utile estimative, comme suit :
| Cat�gorie d'immobilisation corporelle |
P�riode d'amortissement |
|
Mat�riel informatique |
3 ans |
|
Logiciels |
3 ans |
|
Autre mat�riel |
10 ans |
|
V�hicules |
10 ans |
|
Am�liorations locatives |
Dur�e du bail |
(i) Incertitude relative � la mesure
La pr�paration des pr�sents �tats financiers conform�ment aux conventions comptables du Conseil du Tr�sor, qui sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, et aux directives de fin d'exercice �mises par le Bureau du contr�leur g�n�ral, exige de la direction qu'elle fasse des estimations et pose des hypoth�ses qui influent sur les
montants d�clar�s des actifs, des passifs et des charges pr�sent�s dans les �tats financiers. Au moment de la pr�paration des pr�sents �tats financiers, la direction consid�re que les estimations et les hypoth�ses sont raisonnables. Les principaux �l�ments pour lesquels des estimations sont faites sont le passif �ventuel, le passif pour les indemnit�s de d�part et la dur�e de vie
utile des immobilisations corporelles. Les r�sultats r�els pourraient diff�rer des estimations de mani�re significative. Les estimations de la direction sont examin�es p�riodiquement et, � mesure que les rajustements deviennent n�cessaires, ils sont constat�s dans les �tats financiers de l'exercice o� ils sont connus.
3. Cr�dits parlementaires
Le Commissariat re�oit la plus grande partie de son financement au moyen de cr�dits parlementaires annuels. Les �l�ments comptabilis�s dans l'�tat des r�sultats et l'�tat de la situation financi�re d'un exercice peuvent �tre financ�s au moyen de cr�dits parlementaires qui ont �t� autoris�s dans des exercices pr�c�dents, pendant l'exercice en cours ou qui le seront dans des exercices futurs. En cons�quence, les r�sultats de fonctionnement nets du Commissariat diff�rent selon qu'ils sont pr�sent�s selon le financement octroy� par le gouvernement ou selon la m�thode de la comptabilit� d'exercice. Les diff�rences sont rapproch�es dans les tableaux suivants :
|
(a) Rapprochement du co�t de fonctionnement net et des cr�dits parlementaires de l'exercice en cours : |
|||
|
(en milliers de dollars) |
2007 | 2006 | |
|
|
|||
|
Co�t de fonctionnement net |
16 987 | 12 901 | |
|
Rajustements pour les �l�ments ayant une incidence sur le co�t de fonctionnement net, mais qui n'ont pas d'incidence sur les cr�dits : |
|
||
|
Ajouter (d�duire) : |
|
|
|
|
|
Services re�us gratuitement |
(1 586) | (1 375) |
|
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
(404) | (368) |
|
|
Revenu non disponible |
89 | 122 |
|
|
Indemnit�s de vacances et cong�s compensatoires |
(12) | (10) |
|
|
Indemnit�s de d�part |
(182) | (2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 892 | 11 268 |
|
Rajustements pour les �l�ments sans incidence sur le co�t de fonctionnement net, mais ayant une incidence sur les cr�dits : |
|
|
|
|
Ajouter (d�duire) : |
|||
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles |
790 | 273 |
|
|
Variation des charges pay�es d'avance |
(30) | 22 |
|
|
Autres ajustements |
64 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
824 | 363 |
|
|
|
|
|
|
Cr�dits de l'exercice en cours utilis�s |
15 716 | 11 631 | |
|
|
|
|
|
|
(b) Cr�dits fournis et utilis�s : |
|||
|
(en milliers de dollars) |
2007 | 2006 | |
|
|
Cr�dit 45 – D�penses de programme |
14 754 | 10 744 |
|
|
Cotisations l�gislatives aux r�gimes d'avantages sociaux |
1 270 | 1 163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 024 | 11 907 |
|
|
|||
|
|
Cr�dits non utilis�s : Fonctionnement |
(308) | (276) |
|
|
|
|
|
|
Cr�dits de l'exercice en cours utilis�s |
15 716 | 11 631 | |
|
|
|
|
|
|
(c) Rapprochement de l'encaisse nette fournie par le gouvernement et des cr�dits de l'exercice en cours utilis�s : |
|||
|
(en milliers de dollars) |
2007 | 2006 | |
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement |
15 775 | 11 680 | |
|
Revenu non disponible |
89 | 122 | |
|
Variation des cr�ances et des avances |
(644) | 249 | |
|
Variation des cr�diteurs et charges � payer |
383 | (325) | |
|
Variation des salaires � payer |
40 | (163) | |
|
Autres ajustements |
73 | 68 | |
|
|
|
|
|
|
Cr�dits de l'exercice en cours utilis�s |
15 716 | 11 631 | |
|
|
|
|
|
4. Cr�ances et avances
Le tableau suivant donne le d�tail des d�biteurs :
|
(en milliers de dollars) |
2007 | 2006 |
|
|
||
|
Cr�ances - Autres minist�res et organismes f�d�raux |
691 | - |
|
Cr�ances - Tiers |
- | 48 |
|
Avances aux employ�s |
1 | - |
|
Total |
692 | 48 |
5. Immobilisations corporelles
| (en milliers de dollars) | Mat�riel informa-tique | Logiciels | Autre mat�riel | V�hicules | Am�lio-rations locatives | Total |
|
Solde d'ouverture - co�t |
1 129 | 365 | 519 | 24 | 96 | 2 133 |
|
Acquisitions |
475 | 62 | 226 | - | 27 | 790 |
|
Ali�nations |
- | - | - | (24) | - | (24) |
|
Solde de cl�ture - co�t |
1 604 | 427 | 745 | - | 123 | 2 899 |
|
Solde d'ouverture – |
757 | 235 | 280 | 14 | 37 | 1 323 |
|
Ali�nations |
- | - | - | (15) | - | (15) |
|
Amortissement de l'exercice |
232 | 97 | 52 | 1 | 22 | 404 |
|
Solde de cl�ture - amortissement cumul� |
989 | 332 | 332 | - | 59 | 1 712 |
|
|
||||||
|
Valeur comptable |
615 | 95 | 413 | - | 64 | 1 187 |
|
|
||||||
|
Valeur comptable |
372 | 130 | 239 | 10 | 59 | 810 |
La charge d'amortissement de l'exercice termin� le 31 mars 2007 s'�l�ve � 404 000 $
(368 000 $ en 2006)
6. Avantages sociaux
(a) Prestations de retraite
Les employ�s du Commissariat participent au R�gime de retraite de la fonction publique, qui est parrain� et administr� par le gouvernement du Canada. Les prestations de retraite s'accumulent sur une p�riode maximale de 35 ans au taux de 2 % par ann�e de services validables multipli� par la moyenne des gains des cinq meilleures ann�es cons�cutives. Les prestations sont int�gr�es aux
prestations du R�gime de pensions du Canada et du R�gime de rentes du Qu�bec et sont index�es � l'inflation.
Tant les employ�s que le Commissariat versent des cotisations � l'�gard du co�t du r�gime. En 2006-2007, la charge s'�l�ve � 935 432 $ (860 000 $ en 2005-2006), soit environ 2,2 fois les cotisations des employ�s.
La responsabilit� du Commissariat relative au r�gime de retraite se limite aux cotisations vers�es. Les exc�dents ou les d�ficits actuariels sont constat�s dans les �tats financiers du gouvernement du Canada, en sa qualit� de r�pondant du r�gime.
(b) Indemnit�s de d�part
Le Commissariat verse des indemnit�s de d�part aux employ�s en fonction de l'admissibilit�, des ann�es de service et du salaire final. Ces indemnit�s ne sont pas capitalis�es. Les indemnit�s seront pr�lev�es sur les cr�dits futurs. Voici quelles �taient les indemnit�s de d�part au 31 mars:
|
(en milliers de dollars) |
2007 | 2006 |
|
Obligation au titre des indemnit�s constitu�es, d�but de l'exercice |
1 282 | 1 280 |
|
Charge de l'exercice |
236 | 131 |
|
Indemnit�s vers�es pendant l'exercice |
(54) | (129) |
|
Obligation au titre des indemnit�s constitu�es, fin de l'exercice |
1 464 | 1 282 |
7. Passif �ventuel
R�clamations et litiges – Des r�clamations ont �t� faites aupr�s du Commissariat dans le cours normal de ses activit�s. Des poursuites pour les r�clamations totalisant environ 50 000 $ �taient toujours en instance au 31 mars 2007. Certaines de ces obligations �ventuelles pourraient devenir des obligations r�elles selon que certains �v�nements futurs se produisent ou non. Dans la mesure o� l'�v�nement futur risque de se produire ou non et si l'on peut �tablir une estimation raisonnable de la perte, on comptabilise un passif estimatif et une charge dans les �tats financiers. Au 31 mars 2007, aucun montant n'a �t� comptabilis� dans les �tats financiers.
8. Obligations contractuelles
De par leur nature, les activit�s du Commissariat peuvent donner lieu � des obligations et � des contrats importants en vertu desquels le Commissariat sera tenu d'effectuer des paiements �chelonn�s sur plusieurs ann�es pour l'acquisition de biens ou services. Le montant pour l'exercice 2007-2008 comprend la somme de 1 229 630 $ relative � des contrats pour l'acquisition de biens et de services sign�s au cours de l'exercice 2006-2007 et qui se poursuivent au cours de l'exercice 2007-2008. Le solde restant de 44 058 $ pour l'exercice 2007-2008 sera consacr� aux contrats de location-exploitation. Les montants des exercices 2008-2009 jusqu'� 2011-2012 seront tous consacr�s aux contrats de location-exploitation (photocopieurs).
|
(en milliers de dollars) |
2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 |
|
|
1 274 | 36 | 35 | 13 | 5 |
9. Op�rations entre apparent�s
En vertu du principe de propri�t� commune, le Commissariat est apparent� � tous les minist�res, organismes et soci�t�s d'�tat du gouvernement du Canada. Le Commissariat conclut des op�rations avec ces entit�s dans le cours normal de ses activit�s et selon des modalit�s commerciales normales. Au cours de l'exercice, le Commissariat a pass� en charges 4 450 384 $ (2006 - 2 659 314 $) au titre d'op�rations conclues avec d'autres minist�res, organismes et soci�t�s d'�tat. Ce montant comprend les services re�us gratuitement d'une valeur de 1 585 560 $ (2006 - 1 375 000 $), comme il est indiqu� � la partie (a).
(a) Services re�us gratuitement :
Au cours de l'exercice, le Commissariat a re�u gratuitement des services d'autres minist�res (installations, cotisations de l'employeur aux r�gimes de soins de sant� et de soins dentaires, services de paie et services de v�rification). Ces services gratuits ont �t� constat�s comme suit dans l'�tat des r�sultats :
| (en milliers de dollars) | 2007 | 2006 |
|
Installations de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
863 | 733 |
|
Cotisations pay�es par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor correspondant � la part de l'employeur des primes d'assurance et des d�penses pour les employ�s |
629 | 529 |
|
Services de paie de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
4 | 3 |
|
Services de v�rification du Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada |
90 | 110 |
|
Total |
1 586 | 1 375 |
(b) Soldes des cr�diteurs et cr�ances avec des apparent�s � la fin de l'exercice :
|
(en milliers de dollars) |
2007 | 2006 |
|
Cr�ances – Autres minist�res et organismes |
691 | - |
|
Cr�diteurs – Autres minist�res et organismes |
259 | 468 |
10. Avoir du Canada
L'avoir du Canada, qui est pr�sentement dans une situation d�ficitaire, repr�sente le passif du Commissariat, apr�s d�duction des immobilisations corporelles, qui n'a pas encore �t� financ� par des cr�dits. Les passifs au titre des indemnit�s de d�part et des vacances en constituent les principaux �l�ments. Ces montants seront financ�s par les cr�dits parlementaires des exercices ult�rieurs � mesure qu'ils seront pay�s.
3.5 Sources de renseignements suppl�mentaires
Lois administr�es par la commissaire � la protection de la vie priv�e
|
Loi sur la protection des renseignements personnels |
L.R.C., 1985, chap. P21, modifi�e en 1997, chap. 20, art. 55 |
|
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques |
2000, chap. 5 |
Rapports annuels pr�vus par la loi, autres publications et renseignements
On peut se procurer les rapports pr�vus par la loi, les autres publications et renseignements aupr�s du Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada, � Ottawa (Canada) K1A 1H3; t�l. : 613‑995-8210 et sur le site Web du Commissariat � l’adresse www.privcom.gc.ca.
- Rapports annuels de la commissaire � la protection de la vie priv�e
- Rapport sur les plans et priorit�s pour l’ann�e 2007-2008
- Rapport au Parlement sur le rendement pour la p�riode prenant fin le 31 mars 2006
- Vos droits en mati�re de protection des renseignements personnels : Un guide � l’intention des particuliers sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques
- Protection des renseignements personnels: vos responsabilit�s; un guide sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents �lectroniques � l'intention des entreprises et des organisations
Pour de plus amples renseignements au sujet du Rapport minist�riel sur le rendement, pri�re de communiquer avec :
Monsieur Tom Pulcine
Directeur g�n�ral, Gestion int�gr�e/Chef des services financiers
Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada
Place de Ville, Tour B
112, rue Kent, bureau 300
Ottawa (Ontario) K1A 1H3
T�l�phone : 613‑996-5336
T�l�copieur : 613‑947-6850
2006-2007
Rapport sur le rendement
Commissariat � l’information du Canada
L'honorable Robert D. Nicholson, C.P., c.r., d�put�
Ministre de la Justice et procureur g�n�ral du Canada
Section I : Survol
1.1 Message du commissaire � l’information du Canada
Je suis heureux de soumettre au Parlement le Rapport sur le rendement du Commissariat � l’information du Canada (CIC) pour la p�riode se terminant le 31 mars 2007.
 Le commissaire � l’information, un agent du Parlement, constitue un prolongement du Parlement. Il est investi de la mission sp�ciale consistant � superviser le gouvernement dans son application de la Loi sur l’acc�s � l’information.
Le commissaire � l’information, un agent du Parlement, constitue un prolongement du Parlement. Il est investi de la mission sp�ciale consistant � superviser le gouvernement dans son application de la Loi sur l’acc�s � l’information.
Mon mandat en tant que 4e commissaire � l’information a commenc� le 15 janvier 2007.
L’entr�e en vigueur de la Loi f�d�rale sur la responsabilit� a eu des cons�quences directes pour le CIC. Le Commissariat a apport� une aide consid�rable au Parlement pour la conception et la mise en œuvre des dispositions de la loi C-2 relatives � l’acc�s � l’information. La nouvelle loi �largit le champ d’application de la Loi sur l’acc�s � l’information et assujettit le Commissariat � la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’acc�s � l’information. Ces nouvelles responsabilit�s et fonctions viendront accro�tre la charge de travail du Commissariat.
En 2006-2007, le CIC avait cinq grandes priorit�s :
- R�duire le temps n�cessaire au parach�vement des enqu�tes;
- R�duire le nombre d’enqu�tes figurant dans l’arri�r� de dossiers;
- R�duire le nombre de plaintes re�ues en menant des v�rifications et des enqu�tes syst�miques et en encourageant le gouvernement � donner un statut professionnel � ses pr�pos�s � l’acc�s � l’information et � sensibiliser ses cadres � leurs obligations en mati�re d’acc�s � l’information;
- Aider les ministres, les comit�s parlementaires et les d�put�s et s�nateurs � comprendre et � peser les cons�quences des projets de loi pour les droits pr�vus dans la Loi sur l’acc�s � l’information;
- Aider le Parlement � concevoir et, par la suite, mettre en œuvre les dispositions de la Loi f�d�rale sur la responsabilit� relatives � l’acc�s � l’information.
Nous avons pu donner suite � toutes ces priorit�s, � l’exception des deux premi�res. Cela s’explique en partie par le manque de bureaux o� loger des employ�s suppl�mentaires. Nous avons commen� � mettre en place un plan de r�duction de l’arri�r� qui sera pleinement mis en oeuvre en 2007-2008. De plus, afin d’accro�tre l’efficience du Commissariat, j’ai entrepris une r�organisation de sa structure.
Je prends ces r�sultats tr�s au s�rieux car nous avons pour principale raison d’�tre: assurer le respect des droits et des obligations des plaignants en vertu de la Loi sur l’acc�s � l’information; accorder aux plaignants, aux responsables d’institutions f�d�rales et � tous les tiers concern�s par les plaintes une possibilit� raisonnable de faire des repr�sentations au commissaire � l’information; et mener des enqu�tes approfondies, dans les d�lais.
Robert Marleau
Commissaire � l’information du Canada
1.2 D�claration de la direction
Je soumets, en vue de son d�p�t au Parlement, le Rapport minist�riel sur le rendement de 2006-2007 du Commissariat � l’information du Canada.
Le pr�sent document a �t� pr�par� conform�ment aux principes de pr�sentation �nonc�s dans le Guide de pr�paration de la Partie III du Budget des d�penses 2006-2007 : Rapports sur les plans et les priorit�s et Rapports minist�riels sur le rendement :
- Il est conforme aux exigences pr�cises de d�claration figurant dans les lignes directrices du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor;
- Il repose sur le r�sultat strat�gique et sur l’Architecture des activit�s de programme du minist�re approuv�s par le Conseil du Tr�sor;
- Il pr�sente une information coh�rente, compl�te, �quilibr�e et fiable;
- Il fournit une base pour la reddition de comptes � l’�gard des r�sultats obtenus avec les ressources et les autorisations qui lui sont confi�es;
- Il rend compte de la situation financi�re en fonction des montants approuv�s des Budgets des d�penses et des Comptes publics du Canada.
Suzanne Legault
Commissaire adjointe
1.3 Architecture des activit�s de programme
L’Architecture des activit�s de programme et le r�sultat strat�gique du Commissariat � l’information du Canada qui ont �t� approuv�s par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor sont rest�s essentiellement les m�mes dans leur structure; seuls des changements terminologiques mineurs ont �t� apport�s et approuv�s par le Conseil du Tr�sor en mai 2007, afin de respecter l’�tape 1 de la mise en œuvre de la Politique sur la structure de gestion, des ressources et des r�sultats.
Le CIC a pour raison d’�tre : assurer le respect des droits conf�r�s par la Loi sur l’acc�s � l’information; accorder aux plaignants, aux responsables d’institutions f�d�rales et � tous les tiers concern�s par les plaintes une possibilit� raisonnable de faire des repr�sentations au commissaire � l’information; persuader les institutions f�d�rales d’adopter des pratiques relatives � l’information qui soient conformes aux objectifs de la Loi sur l’acc�s � l’information; et d�f�rer � la Cour f�d�rale les questions d’interpr�tation de la Loi sur l’acc�s � l’information qui s’y pr�tent.
Le commissaire � l’information est un protecteur du citoyen nomm� par le Parlement pour mener enqu�te � l’�gard des plaintes �manant de particuliers qui estiment que le gouvernement n’a pas respect� les droits pr�vus dans la Loi sur l’acc�s � l’information – la l�gislation canadienne en mati�re d’acc�s � l’information. La Loi est entr�e en vigueur en 1983 et conf�re aux Canadiens et aux Canadiennes le droit g�n�ral d’acc�s � l’information consign�e sous toutes formes et d�tenue par la plupart des institutions f�d�rales. Elle donne aux institutions f�d�rales 30 jours pour r�pondre aux demandes de communication. Les institutions peuvent exiger plus de temps s’il leur faut examiner de nombreux documents, consulter d’autres organismes f�d�raux ou aviser des tiers. Le demandeur doit �tre inform� des prorogations de d�lai � l’int�rieur du d�lai initial.
Le droit d’acc�s n’est bien entendu pas absolu. Il est assujetti � des exceptions pr�cises et limit�es, en fonction du libre acc�s � l’information, d’une part, et des imp�ratifs de la protection de la vie priv�e, des secrets commerciaux, de la s�curit� nationale et des communications franches qui sont n�cessaires � une prise de d�cisions efficace, d’autre part. Ces exceptions permettent aux institutions de ne pas communiquer certains documents, ce qui cause souvent des diff�rends entre elles et les demandeurs. Les demandeurs insatisfaits peuvent s’adresser au commissaire � l’information, qui fait enqu�te dans les cas suivants :
- Lorsqu’on a refus� la communication de l’information demand�e;
- Lorsqu’on a factur� des frais excessifs pour l’information demand�e;
- Lorsque la prorogation du d�lai, au-del� des 30 jours, n’est pas justifi�e;
- Lorsque les documents ne sont pas dans la langue officielle demand�e ou que le temps pr�vu pour la traduction est excessif;
- Lorsqu’il y a un probl�me relativement au guide Info Source ou aux bulletins p�riodiques publi�s afin d’aider la population � se pr�valoir de la Loi;
- Lorsqu’un autre type de probl�me survient relativement � la Loi.
Le commissaire a de vastes pouvoirs d’enqu�te, ce qui encourage vivement les institutions f�d�rales � respecter la Loi et, par le fait m�me, les droits des demandeurs.
Comme il est un protecteur du citoyen, le commissaire ne peut pas ordonner qu’une plainte soit r�gl�e de telle ou telle fa�on. Il recourt donc � la persuasion pour r�gler les diff�rends, ne s’adressant � la Cour f�d�rale que s’il estime que les droits d’une personne n’ont pas �t� respect�s et qu’il s’est av�r� impossible de n�gocier une solution pour r�gler le diff�rend.
1.5 Ressources financi�res et humaines
Les deux tableaux suivants font �tat du total des ressources financi�res et humaines que le CIC a g�r�es en 2006-2007.
|
Ressources financi�res |
||
|
D�penses pr�vues |
Total des autorisations |
D�penses r�elles |
|
8 181 000 $ |
8 270 000 $ |
6 611 000 $ |
|
Ressources humaines |
||
|
Pr�vues |
R�elles |
�cart |
|
78 ETP |
55 ETP |
23 ETP |
1.6 Contexte relatif au rendement du CIC en 2006-2007
Plans et priorit�s
Il est indiqu� dans le Rapport sur les plans et les priorit�s 2006-2007 que les priorit�s du Commissariat sont �tablies par une loi et supposent l’exercice de fonctions propres � une protection du citoyen au regard de plaintes d�pos�es contre des institutions f�d�rales pour la non-communication d’information, les droits exig�s et les retards dans le traitement des demandes de communication. Ces fonctions sont les suivantes :
- Mener enqu�te;
- Rechercher des solutions;
- Faire des recommandations;
- Faire �tat des r�sultats.
Ces fonctions visent � faire en sorte que les priorit�s de nature statutaire du Commissariat sont accomplies avec efficacit�, efficience et �quit�. Au sujet de l’efficience, de l’efficacit� et de l’�quit�, les plans et priorit�s sp�cifiques pour l’exercice 2006-2007 �taient les suivants :
- R�duire le temps n�cessaire au parach�vement des enqu�tes;
- R�duire le nombre d’enqu�tes figurant dans l’arri�r� de dossiers;
- R�duire le nombre de plaintes re�ues en menant des v�rifications et des enqu�tes syst�miques et en encourageant le gouvernement � donner un statut professionnel � ses pr�pos�s � l’acc�s � l’information et � sensibiliser ses cadres � leurs obligations en mati�re d’acc�s � l’information;
- Aider les ministres, les comit�s parlementaires et les d�put�s et s�nateurs � comprendre et � peser les cons�quences des projets de loi pour les droits pr�vus dans la Loi sur l’acc�s � l’information;
- Aider le Parlement � concevoir et, par la suite, mettre en œuvre les dispositions de la Loi f�d�rale sur la responsabilit� relatives � l’acc�s � l’information.
Facteurs internes et externes
En 2006-2007, les facteurs externes et internes suivants ont exerc� une influence sur la fa�on dont le Commissariat s’est acquitt� de ses fonctions de protecteur du citoyen ainsi que sur la priorit� relative qui a �t� accord�e aux activit�s men�es pendant l’ann�e.
Facteurs externes
Cons�quences de l’adoption du projet de loi C-2 (Loi f�d�rale sur la responsabilit�)
L’adoption du projet de loi C-2, le 12 d�cembre 2006, a eu des cons�quences directes pour le CIC. D’abord, le CIC a consacr� des ressources consid�rables afin d’aider le Parlement � s’acquitter de sa t�che consistant � �valuer le bien-fond� des diverses dispositions du projet de loi li�es � l’acc�s � l’information (p. ex., analyse de propositions, surveillance du processus l�gislatif, �laboration de documents, comparutions devant des comit�s parlementaires). De plus, la mise en œuvre de la loi apr�s que celle-ci a re�u la sanction royale a entra�n� d’importantes cons�quences pour le Commissariat. En effet, la nouvelle loi �largit le champ d’application de la Loi sur l’acc�s � l’information en y assujettissant plus de 50 institutions f�d�rales suppl�mentaires (y compris les soci�t�s d’�tat, leurs filiales en toute propri�t� et diverses fondations). Cette mesure entra�nera n�cessairement le d�p�t d’un plus grand nombre de plaintes, ce qui aura comme pour corollaire une augmentation de la charge de travail au CIC. En outre, les nouvelles dispositions et exceptions ont n�cessit� des avis juridiques, une formation professionnelle et des communications publiques approfondies. Enfin, puisque la nouvelle loi assujettit le CIC � la Loi sur la protection des renseignements personnels et � la Loi sur l’acc�s � l’information, il nous faut cr�er de nouveaux services op�rationnels et assurer la prestation d’autres formations.
Le CIC a �labor� une analyse de rentabilisation et un plan de mise en œuvre � l’�gard de ces changements et recrut� un directeur par int�rim des Services d’information et de la gestion du savoir en octobre 2006.
R�forme prochaine de la Loi sur l’acc�s � l’information
Au cours de l’ann�e vis�e par le pr�sent rapport, le Comit� permanent de l’acc�s � l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’�thique a r�clam�, dans un rapport destin� � la Chambre des communes, le d�p�t par le gouvernement d’un projet de loi visant une r�forme en profondeur de la Loi.
Le commissaire � l’information sortant, � la demande du Comit�, a r�dig� une �bauche de projet de loi sur la r�forme de l’acc�s � l’information qui tient lieu, pour le Parlement et les membres du grand public, de point de comparaison pour tout projet de r�forme avanc� par le gouvernement – soit la Loi sur la transparence du gouvernement. Le nouveau commissaire � l’information appuie lui aussi les efforts d�ploy�s par le Parlement et le gouvernement dans l’exercice de leurs missions respectives. � cet �gard, le CIC a offert sa coop�ration, en 2006-2007, au Comit� permanent, au ministre de la Justice et au pr�sident du Conseil du Tr�sor en ce qui concerne l’�laboration de toute initiative d’ordre l�gislatif et administratif se rapportant � la r�forme de la Loi sur l’acc�s � l’information.
Exigences accrues des organismes centraux en mati�re de rapports
Les rapports demand�s et autres fonctions strat�giques impos�es par les organismes centraux (v�rification interne, �valuation, rapports aux termes de la LEFP) s’av�rent particuli�rement lourds pour les minist�res et organismes de petite taille et aux ressources limit�es.
Facteurs internes
Le Commissariat a d� consacrer temps et efforts � deux projets importants. Au sujet du projet pilote sur le financement des hauts fonctionnaires du Parlement, nous avons travaill� �troitement avec le conseil consultatif de la Chambre des communes. Par ailleurs, nous avons collabor� avec les autres hauts fonctionnaires du Parlement � la prestation de commentaires au Conseil du Tr�sor sur l’examen de la politique de v�rification interne dans le cadre du projet de refonte des politiques du Conseil du Tr�sor.
Le Commissariat a pris des mesures en vue de l’�laboration d’une fonction de v�rification interne pour se conformer � la nouvelle Politique sur la v�rification interne et de l’adoption d’un plan pour s’acquitter des nouvelles responsabilit�s pr�vues dans la Loi f�d�rale sur la responsabilit�. Essentiellement, le Commissariat sera dor�navant assujetti � la Loi sur l’acc�s � l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels.
D�s la mise en application des lois mentionn�es plus haut, le Commissariat tombera �galement sous le coup de la Loi sur la Biblioth�que et les Archives du Canada. Des dispositions ont �t� prises afin de r�pondre aux exigences du biblioth�caire et archiviste du Canada en ce qui concerne la gestion de l’information. Les fichiers de renseignements personnels du CIC sont en voie d’�tre inscrits aupr�s du Conseil du Tr�sor.
De plus, le CIC a instaur� un processus permettant la conduite d’enqu�tes ind�pendantes � l’�gard des plaintes d�pos�es contre le commissaire � l’information en vertu de la Loi. L’honorable Peter Corey, ancien juge � la Cour supr�me du Canada, a accept� de mener les enqu�tes en question.
Au cours de l’ann�e �coul�e, le manque de bureaux a emp�ch� le Commissariat de recruter les enqu�teurs suppl�mentaires pour lesquels des fonds avaient �t� accord�s. Ce sera fait en 2007-2008. Le Commissariat a eu des discussions avec Travaux publics et Services gouvernementaux Canada au cours de l’exercice afin de trouver suffisamment d’espace � cette fin.
Donc, l’efficacit� et l’efficience op�rationnelles r�duites au Commissariat (c.-�-d. les plaintes en suspens et les retards) sont attribuables � un manque de soutien op�rationnel et administratif, ce qui a influ� sur la capacit� des gestionnaires assumant des responsabilit�s fondamentales en mati�re d’acc�s � l’information de concentrer leurs efforts sur la prestation des services par le biais d’enqu�tes et d’activit�s d’application de la loi.
1.7 �tat du rendement par rapport aux priorit�s du CIC
Le CIC s’�tait donn� cinq priorit�s en 2006-2007. Le tableau qui suit fait �tat des priorit�s et des r�sultats attendus, fournit de l’information de haut niveau sur notre rendement et contient une auto-�valuation de l’�tat du rendement en fonction des cotes du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor : � ne satisfait pas aux attentes �, � satisfait aux attentes � ou � d�passe les attentes �,
On trouvera une information plus d�taill�e sur le rendement � la Section II - Analyse par activit� de programme.
|
R�sultat strat�gique : Les droits conf�r�s par la Loi sur l’acc�s � l’information sont prot�g�s. |
||||
|
Activit� de programme : �valuer, enqu�ter, r�viser, faire appel aux tribunaux et fournir des conseils. |
D�penses pr�vues : 8 181 000 $ |
D�penses r�elles : 6 611 000 $ |
||
|
Priorit�s pour 2006-2007 et R�sultats attendus |
Type |
Rendement |
�tat du rendement |
|
|
Ant�rieure |
|
Ne satisfait pas aux attentes |
||
|
Nouvelle |
|
Ne satisfait pas aux attentes |
|
|
En cours / Nouvelle |
|
Satisfait aux attentes |
|
|
Nouvelle |
|
Satisfait aux attentes |
|
|
Nouvelle |
|
Satisfait aux attentes |
|
Section II : Analyse par activit� de programme
2.1 Rendement du CIC en 2006-2007
|
Les droits des particuliers en vertu de la Loi sur l’acc�s � l’information sont prot�g�s. |
|
|
Activit� de programme 1 |
�valuer, enqu�ter, examiner, faire appel aux tribunaux et fournir des conseils. |
Voir � la Section 4.1 une description des r�alisations des services internes.
Description de l’activit� de programme
La seule activit� de programme officiellement approuv�e du CIC consiste � : �valuer, enqu�ter, examiner, faire appel aux tribunaux et fournir des conseils.
|
D�penses autoris�es |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
|
8 181 000 $ |
8 270 000 $ |
6 611 000 $ |
|
ETP pr�vus1 |
ETP r�els |
�cart |
|
78 |
55 ETP |
23 ETP |
Rendement en 2006-2007
Le CIC a �valu�, enqu�t�, examin�, fait appel aux tribunaux et fourni des conseils conform�ment � son mandat. Les activit�s men�es en 2006-2007 sont d�crites dans la pr�sente section. On peut trouver des renseignements suppl�mentaires dans le Rapport annuel du commissaire de 2006-2007 affich� sur le site Web du CIC (www.infocom.gc.ca).
Les objectifs �tablis pour l’activit� de programme sont les suivants :
- Assurer le respect des droits et des obligations des plaignants en vertu de la Loi sur l’acc�s � l’information; donner aux plaignants, aux responsables d’institutions f�d�rales et � tous les tiers concern�s par les plaintes une possibilit� raisonnable de faire des repr�sentations au commissaire � l’information; mener des enqu�tes approfondies et dans les d�lais;
- Persuader les institutions f�d�rales d’adopter des pratiques relatives � l’information qui soient conformes � la Loi sur l’acc�s � l’information;
- D�f�rer � la Cour f�d�rale les questions d’interpr�tation de la Loi sur l’acc�s � l’information qui s’y pr�tent.
Enqu�tes
|
Indicateur de rendement |
R�sultat attendu |
|
Nombre de plaintes re�ues et r�gl�es |
Les enqu�tes sont approfondies et men�es dans les d�lais, conform�ment aux normes de service �tablies |
Plaintes �manant de membres du public
Le CIC a re�u 1 257 plaintes �manant du public (soit une baisse de 9 % par rapport � l’an dernier), ce qui signifie que, sur les 25 000 demandes de communication et plus qui ont �t� trait�es � l’�chelle f�d�rale, moins de 6 % ont d�bouch� sur une plainte.
Le CIC a men� � bien les enqu�tes relatives � 1 267 plaintes dans une moyenne de 12,39 mois, un service bien en de�� des normes de service. Cependant, 72 % des enqu�tes men�es � bien concernaient des plaintes figurant dans l’arri�r� et dont le grand nombre de mois pass�s � dans le syst�me � contribue � alourdir la moyenne.
Plan de r�duction de l’arri�r�
Des 1 417 plaintes �manant de particuliers qui seront report�es sur le prochain exercice, 1 052 �taient consid�r�es comme faisant partie de � l’arri�r� � parce que leur instruction n’avait pas �t� termin�e � l’int�rieur des normes de service. L’an dernier, des 1 454 plaintes qui ont �t� report�es, 1 298 faisaient partie de l’arri�r�. Le Commissariat a donc pu cette ann�e emp�cher l’arri�r� de s’accro�tre et r�duire celui-ci de 246 dossiers.
Bien que le Commissariat ait eu un certain succ�s cette ann�e � r�duire l’ari�r� des enqu�tes inachev�es, il n’a pa pu pleinement mettre en œuvre son plan de reduction pour lequel des postes d’enqu�teurs suppl�mentaires ont �t� approuv�s en janvier 2006, et ce pour les ann�es financi�res 2006-2007 � 2009-2010. La principale raison de ce revers est d� � un d�lai, qui est independent de la volont� du commissaire, pour l’obtention des bureaux requis pour les nouveaux enqu�teurs.
Le plan de reduction de l’ari�r� sera pleinement mis en oeuvre lorsque les bureaux suppl�mentaires seront disponibles en 2007-2008. Le commisaire demeure confiant qu’au 31 mars 2010, il n’y aura plus d’ari�r� d’enqu�tes et que les nouvelles enqu�tes seront trait�es rapidement.
Plaintes syst�miques
En d�pit des efforts soutenus du Commissariat avec ses ressources limit�es, les progr�s relatifs � la r�duction de l’arri�r� de dossiers � traiter n’ont pas �t� consid�rables, particuli�rement en ce qui concerne les plaintes port�es par le commissaire contre les probl�mes syst�miques ou fr�quents de respect des dispositions de la Loi. En 2006-2007, le commissaire � l’information a d�pos� 393 plaintes contre une institution f�d�rale pour un probl�me grave et persistant de non-respect des d�lais. Chacune des plaintes concernait une demande de communication que l’institution n’avait pas trait�e dans les d�lais. Avec ces nouvelles plaintes et les 423 qui ont �t� report�es de l’exercice pr�c�dent, le Commissariat a r�gl� 579 plaintes lanc�es par le commissaire et fait �tat du r�sultat de l’enqu�te en 2006-2007.
Demandes de renseignements
Le CIC a re�u et trait� 1 085 demandes de renseignements d’ordre g�n�ral – 627 par t�l�phone et 458 par �crit – �manant de tout un �ventail de sources, dont d’autres institutions f�d�rales, des repr�sentants des m�dias et des membres du public, en 2006-2007.
Examens des minist�res (Fiches de rendement)
|
Indicateur de rendement |
R�sultat attendu |
|
Fiches de rendement |
Les institutions font l’objet d’un examen en fonction de leur respect de la Loi, et tout secteur � probl�me est relev� et analys�. |
Le CIC a men� 17 examens (fiches de rendement) en 2006-2007 : neuf (9) institutions ont re�u un A ou B, trois (3), un D, et les cinq (5) qui restent, un F.
Gr�ce � ces examens, le CIC sensibilise davantage les cadres sup�rieurs aux responsabilit�s conf�r�es � leur institution par la Loi sur l’acc�s � l’information. Par cons�quent, neuf institutions ont am�lior� leur rendement par rapport aux examens ant�rieurs.
Le processus �largi des fiches de rendement r�unit et �value des donn�es relatives � des institutions f�d�rales choisies sur tout un �ventail de variables li�es au rendement. Ces enqu�tes �largies permettent au commissaire de relever sans tarder les secteurs � probl�me, comme : le recours abusif aux prorogations de d�lai, le gonflement des droits demand�s, l’incapacit� � mettre par �crit les justifications des exceptions, le recours abusif aux exceptions, la mauvaise gestion des documents, l’incapacit� � saisir les occasions de divulgation proactive de l’information, l’ing�rence politique et le manque de ressources ou de formation.
Le Parlement juge �galement utiles ces examens. L’an dernier, le Comit� permanent de l’acc�s � l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’�thique a convoqu� les repr�sentants de cinq institutions qui avaient re�u une mauvaise note pour leur demander des comptes quant au mauvais rendement de l’institution et une description du plan �tabli pour rem�dier � la situation.
Sommaire de la charge de travail
|
1er avril 2005 au 31 mars 2006 |
1er avril 2006 au 31 mars 2007 |
|
|
Plaintes �manant du public En suspens de l’exercice pr�c�dent Ouvertes pendant l’exercice Men�es � bien pendant l’exercice En suspens � la fin de l’exercice |
1 365 1 381 1 319 1 427 |
1 427 1 257 1 267 1 417 |
|
Plaintes syst�miques lanc�es par le commissaire En suspens de l’exercice pr�c�dent Ouvertes pendant l’exercice Men�es � bien pendant l’exercice En suspens � la fin de l’exercice |
0 760 337 423 |
423 393 579 237 |
|
Fiches de rendement Examen complet Examen de suivi |
4 12 |
3 14 |
R�vision judiciaire
|
Indicateur de rendement |
R�sultat attendu |
|
Nombre de dossiers d�f�r�s aux tribunaux |
Le nombre de dossiers d�f�r�s aux tribunaux correspond � moins de 1 p. 100 |
Interventions des tribunaux
Les Services juridiques offrent une aide et des conseils juridiques au commissaire � l’information au cours des enqu�tes men�es � l’�gard des plaintes. La plupart des plaintes sont r�gl�es � l’issue du processus d’enqu�te. Cependant, s’il �tait impossible au commissaire de r�gler le litige entre un plaignant et une institution f�d�rale, il pourrait faire appel aux tribunaux.
Lorsque le commissaire � l’information conclut qu’une plainte est fond�e et fait � une institution f�d�rale des recommandations officielles auxquelles celle-ci ne donne pas suite, il a pour pratique de confier l’affaire � la Cour f�d�rale du Canada en vue d’obtenir une ordonnance for�ant l’institution f�d�rale � communiquer le document demand�.
Le commissaire � l’information n’a soumis aucune nouvelle demande de r�vision judiciaire au cours de l’exercice vis� par le pr�sent rapport. Six demandes ont toutefois �t� d�pos�es par des demandeurs insatisfaits. Des tiers s’opposant � la communication de renseignements ont d�pos� 15 demandes, et la Couronne en a fait une contre le commissaire. De plus, cette ann�e, en ce qui concerne les litiges relatifs � l’acc�s � l’information, la Cour f�d�rale du Canada a rendu neuf d�cisions (le commissaire �tait partie � l’une de ces affaires : Commissaire � l’information c. Environnement Canada T-555-05), la Cour d’appel f�d�rale, 11 d�cisions (le commissaire �tait partie � deux de ces affaires : Directeur g�n�ral du Bureau canadien d’enqu�te sur les accidents de transport et de la s�curit� des transports et al c. commissaire � l’information, A-165-05 et A-304-05), et la Cour supr�me du Canada, deux d�cisions (le commissaire �tait intervenant dans les deux affaires : Procureur g�n�ral du Canada c. H.J. Heinz Company of Canada Ltd., 30417 et ministre de la Justice c. Sheldon Blank, 30553). La Cour supr�me du Canada a rejet� la requ�te en autorisation d’appel � l’�gard de la d�cision de la Cour d’appel f�d�rale dans les affaires A-165-05 et A-304-05 (le commissaire �tait le d�fendeur dans la requ�te Directeur g�n�ral du Bureau canadien d’enqu�te sur les accidents de transport et de la s�curit� des transports c. commissaire � l’information, 31528).
Activit�s suppl�mentaires � l’appui du mandat du CIC
Prestation de conseils
Les responsables du Commissariat � l’information ont comparu huit fois devant des comit�s parlementaires relativement � des questions se rapportant aux cons�quences de projets de loi sur le droit d’acc�s, y compris la Loi f�d�rale sur la responsabilit�. En voici le d�tail : le 18 mai 2006, devant le Comit� l�gislatif charg� du projet de loi C-2; le 31 mai, le 19 juin, le 2 octobre et le 6 novembre 2006, devant le Comit� permanent de l’acc�s � l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’�thique au sujet de la r�forme de la Loi sur l’acc�s � l’information; le 21 juin 2006, devant le Comit� s�natorial permanent des banques et du commerce au sujet de l’examen de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalit� et le financement des activit�s terroristes; enfin, le 20 septembre et le 5 d�cembre 2006, devant le Comit� permanent des affaires constitutionnelles et juridiques concernant le projet de loi C-2.
Activit�s de promotion
Outre ses activit�s fondamentales (�valuer, enqu�ter, examiner, faire appel aux tribunaux et fournir des conseils), le CIC m�ne des activit�s de promotion afin de favoriser le respect de la Loi sur l’acc�s � l’information en faisant davantage conna�tre les droits relatifs � l’acc�s � l’information et en pr�conisant la cr�ation d’un statut professionnel pour les pr�pos�s � l’acc�s � l’information.
Semaine du droit de savoir
Un mouvement international a pris naissance en Bulgarie, en 2002, lorsqu’un groupe de militants en faveur de la transparence gouvernementale issus de plus d’une trentaine de pays a constitu� une coalition appel�e le � Freedom of Information Advocates Network � (r�seau des d�fenseurs de l’acc�s � l’information) et d�clar� le 28 septembre � journ�e internationale de la promotion du droit d’acc�s � l’information et de la transparence gouvernementale �. La journ�e (ou la semaine) est marqu�e aux quatre coins du monde dans la plupart des 70 pays et plus qui ont adopt� des lois sur l’acc�s � l’information.
Pour la premi�re fois en 2006, des activit�s ont eu lieu � l’�chelle du pays pour marquer la � Journ�e du droit de savoir �. Les commissaires � l’information provinciaux, territoriaux et f�d�ral, ont lanc� les premi�res activit�s c�l�brant le droit de savoir au Canada. Ils s’�taient donn� pour objectif d’aider les Canadiens et les Canadiennes � mieux conna�tre les droits relatifs � l’acc�s � l’information au Canada et � comprendre l’importance de ces droits dans une saine d�mocratie. La Semaine du droit de savoir 2006 au Canada a connu un bon succ�s initial : les diverses activit�s tenues dans tout le pays ont suscit� une attention et un int�r�t consid�rables au sein de la population de sorte que la manifestation reviendra chaque ann�e. On peut trouver une br�ve description des diverses activit�s tenues au Canada sur le site www.droitdesavoir.ca.
En 2006, le Commissariat � l’information du Canada a parrain� avec l’Association canadienne des journaux un colloque qui s’est tenu � Ottawa les 25 et 26 septembre. MM. Ian E. Wilson, biblioth�caire et archiviste du Canada, Stephen Owen et Pat Martin, d�put�s, David McKie et James Bronskill, journalistes, et Maher Arar, principal sujet de l’enqu�te O’Connor, figuraient parmi les conf�renciers et sp�cialistes ayant particip� � l’activit� de deux jours sous le th�me � Acc�s � l’information : gestion du changement et r�forme �.
Programme de certificat en acc�s � l’information et en protection des renseignements personnels de l’Universit� de l’Alberta
En 2006-2007, le CIC a poursuivi son appui tangible au seul programme de niveau postsecondaire offert en ligne par une universit� s’adressant aux administrateurs de l’acc�s � l’information et de la protection des renseignements personnels. Dispens� par la facult� de l’�ducation permanente de l’Universit� de l’Alberta, ce programme, d�j� laur�at d’un prix, a �t� lanc� en 2000. Connue sous le nom de Programme de certificat en acc�s � l’information et en protection des renseignements personnels, la formation est offerte en fran�ais et en anglais.
Le CIC investit des ressources financi�res et intellectuelles dans le programme depuis 2003 afin de faciliter l’�laboration de nouveaux cours de m�me que la publication de documents didactiques en fran�ais. L’un des conseillers juridiques du Commissariat a �t� d�tach� � l’Universit� de l’Alberta de l’automne 2004 jusqu’au 31 mars 2007 pour faire office de gestionnaire du Programme et de professeur auxiliaire adjoint.
La collaboration se poursuit : les nouveaux enqu�teurs du CIC devront toujours avoir ou obtenir le certificat en AIPRP, et le commissaire encourage le pr�sident du Conseil du Tr�sor � faire en sorte que les administrateurs de l’AIPRP de l’administration f�d�rale aient acc�s au type de formation offerte par le Programme.
Reconnaissance de la profession d’administrateur de l’AIPRP
Il existe un probl�me de recrutement et de maintien � l’effectif d’agents qualifi�s en AIPRP aux �chelons f�d�ral, provincial et municipal au Canada. Sans les ressources humaines ad�quates pour l’instruction des plaintes d�pos�es par des particuliers qui consid�rent que leurs droits en vertu de la Loi sur l’acc�s � l’information n’ont pas �t� respect�s, la loi canadienne donnant acc�s � l’information ne peut pas �tre appliqu�e.
En 2006-2007, le CIC, avec l’Universit� de l’Alberta et le Commissariat � la protection de la vie priv�e du Canada, a offert son appui � deux associations canadiennes repr�sentant les administrateurs de l’acc�s � l’information et de la protection des renseignements personnels (c.-�-d. l’Association canadienne d’acc�s � l’information et de la protection des renseignements personnels (ACAP) et la Canadian Association of Professional Access and Privacy Administrators (CAPAPA)) qui ont lanc� conjointement une initiative visant l’�laboration de comp�tences de base et d’un processus d’accr�ditation pour la nouvelle profession.
De plus, un groupe de travail consultatif compos� de neuf sp�cialistes reconnus des droits relatifs � l’acc�s � l’information et � la protection de la vie priv�e de toutes les r�gions du Canada a �t� constitu�. La premi�re �tape de l’initiative est termin�e : un ensemble de comp�tences professionnelles, ou normes, a �t� �labor� et approuv� par le groupe de travail (consulter le site Web du CIC pour une description des normes et la fa�on pour les personnes int�ress�es d’obtenir des pr�cisions et de faire des commentaires). La deuxi�me �tape du projet, soit l’�laboration d’un processus d’accr�ditation et de gouvernance professionnelles est en cours, et son �ch�ance a �t� fix�e au plus tard le 30 novembre 2007. Le CIC encouragera le Conseil du Tr�sor � jouer un r�le de premier plan dans l’octroi d’un statut professionnel aux effectifs f�d�raux en AIPRP.
Section III : Information additionnelle
3.1Renseignements sur l’organisation
Le commissaire � l’information du Canada est un haut fonctionnaire du Parlement qui rel�ve directement du S�nat et de la Chambre des communes. Outre le commissaire, le Commissariat a un sous-commissaire � l’information. Le CIC se compose de deux directions op�rationnelles appuy�es par une direction responsable des fonctions de gestion int�gr�e (finances, ressources humaines, technologies de l’information, gestion de l’information et gestion du savoir). L’organigramme du CIC est le suivant :

Un nouveau commissaire � l’information, Robert Marleau, a �t� nomm� le 15 janvier 2007, � la suite du d�part du troisi�me commissaire � l’information du Canada (qui aura exerc� ses fonctions le plus longtemps), l’honorable John M. Reid, C.P.
La Direction g�n�rale des enqu�tes et des examens voit � la conduite des enqu�tes relatives aux plaintes d�pos�es par des particuliers qui all�guent que le gouvernement n’a pas respect� les droits conf�r�s par la Loi sur l’acc�s � l’information, de m�me qu’� la conduite des enqu�tes � l’�gard des plaintes et des examens syst�miques lanc�s par le commissaire.
La Direction g�n�rale de l’avocat g�n�ral offre des conseils strat�giques, des recommandations et de l’information quant aux cons�quences juridiques de toute question relevant de l’application de la Loi sur l’acc�s � l’information, y compris les enqu�tes, les contestations judiciaires, la jurisprudence, les programmes de m�me que l’�laboration de politiques et de projets de loi s’y rapportant.
La Direction g�n�rale de la gestion int�gr�e offre les services relatifs aux ressources financi�res, aux ressources humaines, � la gestion de l’information, � la technologie de l’information de m�me que des services administratifs d’ordre g�n�ral � l’activit� principale du CIC. Les services en question sont essentiels pour permettre au Commissariat de g�rer ses op�rations de fa�on strat�gique, d’ex�cuter sa mission, de r�pondre aux attentes des d�put�s et s�nateurs et de la population canadienne et d’atteindre ses r�sultats strat�giques. Ils constituent �galement l’importante infrastructure n�cessaire pour appuyer la fonction d�cisionnelle du CIC et mettre en œuvre les initiatives de gestion visant toute l’administration f�d�rale.
3.2Tableaux des ressources
- Budget principal des d�penses – les niveaux budg�taires du CIC tels qu’ils sont �tablis dans le Budget principal des d�penses 2006-2007;
- D�penses pr�vues – les d�penses pr�vues au d�but de l’exercice telles qu’elles sont �nonc�es dans le Rapport sur les plans et les priorit�s de 2006-2007;
- Autorisations totales – pour le cycle de rapports 2006-2007, les � autorisations totales � concernent le montant total des d�penses autoris�es re�u au cours de l’exercice, de m�me que tout montant re�u du Budget suppl�mentaire des d�penses 2006-2007 et de transferts du Conseil du Tr�sor.
Tableau 1 : Comparaison des d�penses pr�vues et des d�penses r�elles (ETP compris)
Voici une comparaison du Budget principal, des d�penses pr�vues, des autorisations totales et des d�penses r�elles pour le dernier exercice financier ainsi que des donn�es chronologiques sur les d�penses r�elles.
|
|
|
|
2006-2007 |
|||
|
(en milliers de dollars) |
D�penses r�elles 2004-2005 |
D�penses r�elles 2005-2006 |
Budget principal |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
R�elles |
|
�valuer, enqu�ter, examiner, faire appel aux tribunaux et fournir des conseils |
5 556 |
5 891 |
8 181 |
8 181 |
8 270 |
6 611 |
|
Total |
5 556 |
5 891 |
8 181 |
8 181 |
8 270 |
6 611 |
|
Plus : Co�t des services re�us gratuitement |
882 |
831 |
S/O |
1 139 |
S/O |
866 |
|
Total des d�penses du Minist�re |
6 438 |
6 722 |
S/O |
9 320 |
S/O |
7 477 |
|
�quivalents temps plein (ETP) |
52 |
53 |
S/O |
78 |
S/O |
55 |
|
Les �carts entre les autorisations totales et les d�penses r�elles sont essentiellement attribuables � une p�nurie de locaux, ce qui a entra�n� des retards dans la dotation en personnel li�e � l’affectation � but sp�cial intitul�e � Arri�r� – Enqu�tes relatives aux plaintes � et aux ETP additionnels et autres postes recommand�s par le groupe consultatif de la Chambre des communes, approuv�s par le Conseil du Tr�sor et vot�s par le Parlement. |
||||||
Tableau 2 : Ressources par activit� de programme
Le tableau suivant offre des renseignements sur la fa�on dont les ressources sont utilis�es pour le plus r�cent exercice financier termin�.
|
(en milliers de dollars) |
2006-2007 |
|
|
|
Budg�taire |
|
|
Activit� de programme |
Fonctionnement |
Total |
|
�valuer, enqu�ter, examiner, faire appel aux tribunaux et fournir des conseils |
|
|
|
Budget principal des d�penses |
8 181 |
8 181 |
|
D�penses pr�vues totales |
8 181 |
8 181 |
|
Autorisations totales |
8 270 |
8 270 |
|
D�penses r�elles totales |
6 611 |
6 611 |
|
|
|
|
|
Total |
|
|
|
Budget principal des d�penses |
8 181 |
8 181 |
|
D�penses pr�vues totales |
8 181 |
8 181 |
|
Autorisations totales |
8 270 |
8 270 |
|
D�penses r�elles totales |
6 611 |
6 611 |
Tableau 3 : Postes vot�s et l�gislatifs
Le tableau qui suit explique la fa�on dont le Parlement vote les ressources accord�es au minist�re et reprend essentiellement le tableau r�capitulatif du Budget principal. Les ressources sont pr�sent�es au Parlement dans ce format. Le Parlement approuve le financement, et les renseignements requis par la loi sont pr�sent�s � titre d’information.
|
(en milliers de dollars) |
2006-2007 |
||||
|
Poste vot� ou l�gislatif |
Libell� tronqu� pour le poste vot� ou l�gislatif |
Budget principal |
D�penses pr�vues |
Autorisations totales |
D�penses r�elles |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Fonctionnement |
7 188 |
7 188 |
7 277 |
5 911 |
|
(L) |
Contributions aux avantages sociaux des employ�s |
993 |
993 |
993 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
8 181 |
8 181 |
8 270 |
6 611 |
Tableau 4 : Services re�us gratuitement
Ce tableau fait �tat des services re�us � titre gracieux par le CIC.
|
(en milliers de dollars) |
D�penses r�elles 2006-2007 |
|
Installations fournies par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada |
431 |
|
Contributions pay�s par le SCT couvrant la quote-part de l’employeur des primes d’assurances des employ�s |
346 |
|
Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada – services de v�rification |
87 |
|
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – services de paie |
2 |
|
Total des services re�us � titre gracieux en 2006-2007 |
866 |
Tableau 5 : �tats financiers
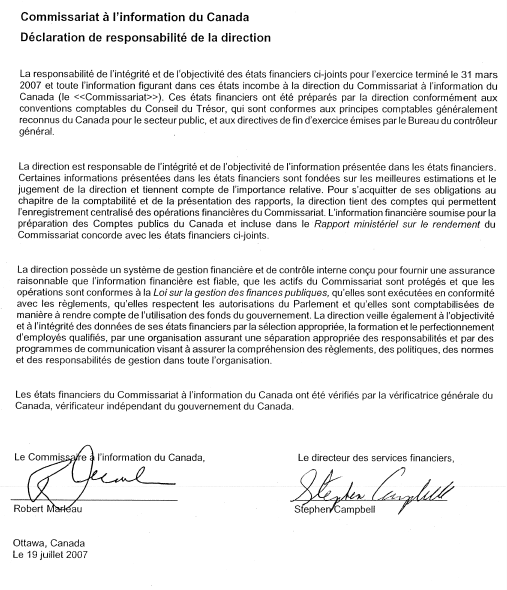


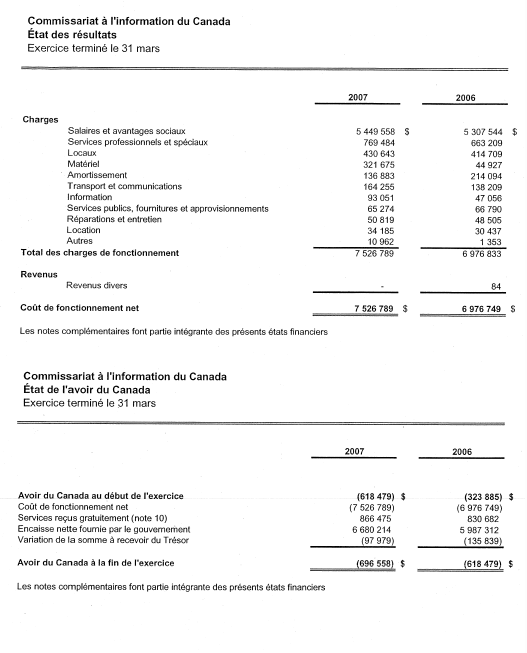

1. Pouvoirs et objectifs
Le Commissariat � l’information du Canada, appel� le Commissariat ci-apr�s, est le produit de la Loi sur l’acc�s � l’information, qui est entr�e en vigueur le 1er juillet 1983. Le Commissaire est nomm� par le gouverneur en conseil une fois que sa nomination est approuv�e par r�solution du S�nat et de la Chambre des communes. Un d�cret donne valeur de minist�re au Commissariat � l’information du Canada pour les besoins de la Loi sur la gestion des finances publiques. En tant que tel, il est �tabli sous l’autorit� de l’annexe I.1 de cette loi et il est financ� par des cr�dits annuels. Le Commissaire est responsable des r�sultats atteints et en rend compte directement au Parlement.
La Loi sur l’acc�s � l’information constitue les fondements l�gislatifs des activit�s du Commissaire � l’information et de son Commissariat. Le programme vise les objectifs suivants :
-
- mener des enqu�tes opportunes, minutieuses et �quitables � l’�gard des plaintes formul�es par des particuliers � qui on a refus� de l’information gouvernementale;
-
- favoriser une culture de transparence dans la fonction publique f�d�rale;
-
- persuader les institutions f�d�rales d’adopter des pratiques d’information conformes � la Loi sur l’acc�s � l’information;
-
- soumettre � la Cour f�d�rale les questions d’interpr�tation de la Loi sur l’acc�s � l’information qui s’y pr�tent;
-
- veiller � ce que le Parlement soit inform� des activit�s du Commissariat, de l’�tat de sant� g�n�ral du droit d’acc�s � l’information et de toute question trait�e dans le droit relatif � l’acc�s qui devrait donner lieu � une r�forme.
2. Conventions comptables importantes
a) Pr�sentation
Les �tats financiers du Commissariat � l’information du Canada ont �t� pr�par�s en conformit� avec les conventions comptables du Conseil du Tr�sor, lesquelles sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, et aux directives de fin d’exercice �mises par le Bureau du contr�leur g�n�ral.
b) Cr�dits parlementaires
Les activit�s du Commissariat � l’information du Canada sont financ�es par le gouvernement du Canada au moyen de cr�dits parlementaires. La base sur laquelle sont consentis les cr�dits parlementaires ne correspond pas aux principes comptables g�n�ralement reconnus, car les cr�dits sont �tablis essentiellement en fonction des besoins de tr�sorerie. Ainsi, les �l�ments de l’�tat des r�sultats et de l’�tat de la situation financi�re ne sont pas n�cessairement identiques � ceux que pourvoient les cr�dits parlementaires. La note 3 pr�sente un rapprochement g�n�ral des deux m�thodes d’�tablissement des rapports.
c) Encaisse nette fournie par le gouvernement
Le fonctionnement du Commissariat est assur� dans le cadre du Tr�sor, qui est administr� par le receveur g�n�ral du Canada. La totalit� de l’encaisse re�ue par le Commissariat est d�pos�e au Tr�sor, et tous les d�caissements faits par le Commissariat sont pr�lev�s sur le Tr�sor. L’encaisse nette fournie par le gouvernement est la diff�rence entre toutes les rentr�es et sorties de fonds, y compris les op�rations entre les minist�res au sein du gouvernement f�d�ral.
d) Somme � recevoir du Tr�sor
La somme � recevoir du Tr�sor repr�sente le montant que le Commissariat peut tirer du Tr�sor, sans cr�dits suppl�mentaires, pour pouvoir s’acquitter de ses obligations.
e) Revenus
Les revenus sont comptabilis�s dans l'exercice o� les op�rations ou les faits sous-jacents surviennent.
f) Charges
-
Les indemnit�s de cong�s annuels et compensatoires sont pass�es en charges au fur et � mesure que les employ�s en acqui�rent le droit en vertu de leurs conditions d'emploi respectives.
-
Les services re�us gratuitement d’autres minist�res sont comptabilis�s � titre de charges de fonctionnement � leur co�t estimatif.
g) Cr�ances
Le solde des cr�ances correspond au montant que l’on s’attend de recouvrer. Une provision est �tablie pour les comptes dont le recouvrement est jug� incertain.
h) Immobilisations corporelles
Toutes les immobilisations corporelles et les am�liorations locatives dont la valeur initiale est de 2 500 $ ou plus et dont les avantages � retirer s’�talent sur plusieurs ann�es sont comptabilis�es � leur co�t d’acquisition. Les biens semblables dont la valeur d’acquisition est inf�rieure � ce montant sont inclus dans l’�tat des r�sultats. L’amortissement est calcul� selon la m�thode lin�aire sur la dur�e de vie utile estimative des immobilisations :
|
Cat�gorie d’immobilisations |
P�riode d’amortissement |
|
Mat�riel de t�l�communications |
10 ans |
|
Mat�riel informatique |
3 ans |
|
Logiciels |
3 ans |
|
Mobilier et agencements |
10 ans |
|
V�hicules automobiles |
10 ans |
|
Am�liorations locatives |
Le moindre du reste de la dur�e du bail ou de la vie utile de l’am�lioration |
i) Avantages sociaux futurs
-
- Prestations de retraite : Les employ�s admissibles participent au R�gime de retraite de la fonction publique, un r�gime multi-employeurs administr� par le gouvernement du Canada. Les cotisations du Commissariat au r�gime sont pass�es en charges dans l'exercice au cours duquel elles sont engag�es et elles repr�sentent l'obligation totale du Commissariat en mati�re de prestations de retraite. En vertu des dispositions l�gislatives en vigueur, le Commissariat n'est pas tenu de verser des cotisations au titre de l'insuffisance actuarielle du r�gime.
- Indemnit�s de d�part : Les employ�s du Commissariat � l’information du Canada ont droit � des indemnit�s de d�part, pr�vues dans leurs conventions collectives ou les conditions d'emploi. Le co�t de ces indemnit�s est comptabilis� au fur et � mesure que les employ�s effectuent les services n�cessaires pour les gagner. L’obligation relative aux avantages sociaux gagn�s par les employ�s est �tablie � partir des r�sultats de l’�valuation actuarielle effectu�e pour estimer l’obligation relative aux indemnit�s de d�part de l’ensemble des employ�s du gouvernement.
La pr�paration des pr�sents �tats financiers selon les conventions comptables du Conseil du Tr�sor, lesquelles sont conformes aux principes comptables g�n�ralement reconnus du Canada pour le secteur public, et aux directives de fin d’exercice �mises par le Bureau du contr�leur g�n�ral, oblige la direction � faire des estimations et � formuler des hypoth�ses qui ont une incidence sur les montants des actifs, des passifs, des revenus et des charges pr�sent�s dans les �tats financiers. La direction a jug� que les estimations et les hypoth�ses retenues au moment de pr�parer les �tats financiers �taient raisonnables. Les �l�ments les plus importants pour lesquels une estimation a �t� utilis�e sont la dur�e de vie utile estimative des immobilisations corporelles et les indemnit�s de d�part. Les montants r�els pourraient diff�rer consid�rablement des estimations. Les estimations de la direction sont examin�es p�riodiquement et, � mesure que les rajustements deviennent n�cessaires, ils sont constat�s dans les �tats financiers de l'exercice o� ils sont connus.
3. Cr�dits de l’exercice en cours
|
2007 |
2006 |
|
|
Co�t de fonctionnement net |
7 526 789 $ |
6 976 749 $ |
|
Rajustements pour les �l�ments ayant une incidence sur le co�t de fonctionnement net, mais qui n’ont pas d’incidence sur les cr�dits |
||
|
Amortissement des immobilisations corporelles |
(136 883) |
(214 094) |
|
Services re�us gratuitement d’autres minist�res |
(866 475) |
(830 682) |
|
Variation des cong�s annuels et compensatoires |
(48 480) |
(5 461) |
|
Variation des indemnit�s de d�part |
(39 164) |
(111 721) |
|
Autres |
15 720 |
(397) |
|
Total partiel |
6 451 507 |
5 814 394 |
|
Rajustements pour les �l�ments sans incidence sur le co�t de fonctionnement net, mais ayant une incidence sur les cr�dits |
||
|
Acquisition d’immobilisations corporelles |
148 304 |
74 782 |
|
Variation des charges pay�es d’avance |
3 367 |
1 828 |
|
Revenus divers |
- |
84 |
|
Autres |
7 763 |
- |
|
Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
6 610 941 $ |
5 891 088 $ |
|
2007 |
2006 |
|
|
Cr�dits parlementaires approuv�s : |
||
|
Cr�dit 40 – D�penses de fonctionnement |
7 276 571 $ |
5 185 476 $ |
|
Montants l�gislatifs : |
||
|
Cotisations aux r�gimes d’avantages sociaux |
699 503 |
748 097 |
|
7 976 074 |
5 933 573 |
|
|
Moins : Cr�dits non utilis�s - Fonctionnement |
(1 365 133) |
(42 485) |
|
Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
6 610 941 $ |
5 891 088 $ |
|
2007 |
2006 |
|
|
Encaisse nette fournie par le gouvernement |
6 680 214 $ |
5 987 312 $ |
|
Revenu non disponible |
- |
1 515 |
|
Variation de l’encaisse et des cr�ances |
(287 670) |
101 368 |
|
Variation des cr�diteurs, charges � payer et salaires � payer |
194 914 |
(197 279) |
|
Autres ajustements |
23 483 |
(1 828) |
|
Cr�dits de l’exercice en cours utilis�s |
6 610 941 $ |
5 891 088 $ |
4. Cr�ances
|
Description |
2007 |
2006 |
|
Cr�ances – Tiers |
3 691 $ |
16 800 $ |
|
Cr�ances – Autres minist�res |
307 325 |
6 546 |
|
Total – Cr�ances |
311 016 $ |
23 346 $ |
5. Cr�diteurs et charges � payer
|
Description |
2007 |
2006 |
|
Cr�diteurs – Tiers |
280 813 $ |
134 656 $ |
|
Cr�diteurs – Autres minist�res |
77 276 |
13 946 |
|
Total – Cr�diteurs et charges � payer |
358 089 $ |
148 602 $ |
6. Immobilisations corporelles
|
CO�T |
31 mars 2006 |
Acquisitions |
31 mars 2007 |
|
Mat�riel de t�l�communications |
259 080 $ |
12 802 $ |
271 882 $ |
|
Mat�riel informatique |
162 378 |
122 269 |
284 647 |
|
Logiciels |
545 656 |
- |
545 656 |
|
Mobilier et agencements |
258 121 |
13 233 |
271 354 |
|
V�hicules automobiles |
23 926 |
- |
23 926 |
|
Am�liorations locatives |
313 922 |
- |
313 922 |
|
1 563 083 $ |
148 304 $ |
1 711 387 $ |
|
|
AMORTISSEMENT CUMUL� |
31 mars 2006 |
Amortissement |
31 mars 2007 |
|
Mat�riel de t�l�communications |
138 925 $ |
26 166 $ |
165 091 $ |
|
Mat�riel informatique |
127 663 |
35 131 |
162 794 |
|
Logiciels |
504 217 |
41 439 |
545 656 |
|
Mobilier et agencements |
127 691 |
26 159 |
153 850 |
|
V�hicules automobiles |
7 179 |
2 393 |
9 572 |
|
Am�liorations locatives |
291 544 |
5 595 |
297 139 |
|
1 197 219 $ |
136 883 $ |
1 334 102 $ |
|
|
Valeur comptable nette |
365 864 $ |
377 285 $ |
Il n’y a pas eu d’ali�nations ni de radiations durant l’exercice.
La charge d’amortissement de l’exercice termin� le 31 mars 2007 s’�l�ve � 136 883$ (214 094$ en 2006).
7. Avantages sociaux
Tant les employ�s que le Commissariat versent des cotisations � l’�gard du co�t du r�gime. En 2006-2007 les charges s'�l�vent � 515 534 $ (553 592 $ en 2005-2006), soit environ 2,5 fois les cotisations des employ�s.
La responsabilit� du Commissariat relative au r�gime de retraite se limite aux cotisations vers�es. Les exc�dents ou les d�ficits actuariels sont constat�s dans les �tats financiers du gouvernement du Canada, en sa qualit� de r�pondant du r�gime.
b) Indemnit�s de d�part : Le Commissariat � l’information du Canada verse des indemnit�s de d�part aux employ�s en fonction de l'admissibilit�, des ann�es de service et du salaire final. Le r�gime d’indemnit�s n’est pas capitalis�; par cons�quent, il n’a pas d’actif, de sorte que le d�ficit du r�gime �quivaut � l’obligation au titre des indemnit�s constitu�es. Les indemnit�s seront pr�lev�es sur les cr�dits futurs. Voici quelles �taient les indemnit�s de d�part au 31 mars :
|
2007 |
2006 |
|
|
Obligation au titre des indemnit�s constitu�es, d�but de l’exercice |
833 383 $ |
721 662 $ |
|
Charge de l’exercice |
116 525 |
152 625 |
|
Indemnit�s vers�es pendant l’exercice |
(77 361) |
(40 904) |
|
Obligation au titre des indemnit�s constitu�es, fin de l’exercice |
872 547 $ |
833 383 $ |
8. Avoir du Canada
L’avoir du Canada repr�sente le passif du Commissariat, apr�s d�duction des immobilisations corporelles, qui n’a pas encore �t� financ� par des cr�dits. Le passif au titre des indemnit�s de d�part et des cong�s annuels en constituent les principaux �l�ments. Ces montants seront financ�s par les cr�dits des exercices ult�rieurs � mesure qu’ils seront pay�s.
9. Obligations contractuelles
De par leur nature, les activit�s du Commissariat peuvent donner lieu � des contrats et des obligations en vertu desquels il sera tenu d’effectuer des paiements �chelonn�s sur plusieurs ann�es pour l’acquisition de biens ou services. Voici les principales obligations contractuelles pour lesquelles une estimation raisonnable peut �tre faite :
|
Exercice |
Total |
|
2007-2008 |
18 372 $ |
|
2008-2009 |
18 372 |
|
2009-2010 |
9 792 |
|
46 536 $ |
10. Services re�us gratuitement
Au cours de l’exercice, le Commissariat a re�u gratuitement des services d’autres minist�res (installations, cotisations de l’employeur aux r�gimes de soins de sant� et de soins dentaires, services de v�rification, de paie et d’�mission de ch�ques). Ces services gratuits ont �t� constat�s comme suit dans l’�tat des r�sultats du Commissariat:
|
Description |
2007 |
2006 |
|
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – Installations |
430 643 $ |
414 709 $ |
|
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor – Quote-part de l’employeur des primes d’assurance |
346 400 |
328 903 |
|
Bureau du v�rificateur g�n�ral du Canada – Services de v�rification |
87 000 |
85 000 |
|
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – Services de paie |
2 432 |
2 070 |
|
Total des services re�us gratuitement |
866 475 $ |
830 682 $ |
11. Op�rations entre apparent�s
En vertu du principe de propri�t� commune, le Commissariat � l’information du Canada est apparent� � tous les minist�res, organismes et soci�t�s d’�tat du gouvernement du Canada. Le Commissariat conclut des op�rations avec ces entit�s dans le cours normal de ses activit�s et selon des modalit�s commerciales normales. Au cours de l’exercice, le Commissariat a pass� en charges 1 774 714 $ (1 755 761 $ en 2005-2006) au titre d’op�rations conclues avec des minist�res, des organismes et des soci�t�s d’�tat. Ce montant inclut les services re�us gratuitement d’une valeur de 866 475 $ d�crits � la note 10.
Tableau 6 : R�ponse aux comit�s parlementaires, v�rifications et �valuations pour l’exercice financier 2006–2007
|
R�ponse aux comit�s parlementaires |
|
Sans objet pour l’exercice vis� par le pr�sent rapport. |
|
R�ponse � la v�rificatrice g�n�rale, y compris le commissaire � l’environnement et au d�veloppement durable (CEDD) |
|
Sans objet pour l’exercice vis� par le pr�sent rapport. |
|
V�rifications externes |
|
Le CIC n’a pas fait l’objet d’une v�rification externe par la Commission de la fonction publique ou le Commissariat aux langues officielles. |
|
V�rifications internes ou �valuations |
|
Sans objet pour l’exercice vis� par le pr�sent rapport. |
Tableau 7 : Approvisionnement et march�s
|
�l�ments � traiter |
Commentaires de l’organisation |
|
1. R�le jou� par l’approvisionnement et les march�s dans l’ex�cution des programmes |
L’approvisionnement et les march�s jouent un r�le important dans l’ex�cution du programme du Commissariat. En particulier, l’approvisionnement permet � celui-ci d’obtenir des biens et services en appui � sa politique et � l’ex�cution de son programme. En outre, les march�s lui permettent de r�pondre � ses besoins op�rationnels, mais aussi de stimuler la croissance de l’�conomie canadienne. |
|
2. Survol de la fa�on dont le minist�re administre sa fonction d’approvisionnement |
Le Commissariat fonctionne dans un environnement centralis�. L’autorit� contractante y est limit�e � un petit nombre de personnes. Cette restriction traduit la volont� de garder un contr�le strict sur le processus de passation des march�s, tout en facilitant le r�le des gestionnaires dans la prestation de services de qualit� et la r�alisation des programmes. Le directeur g�n�ral de la Gestion int�gr�e prend part � chacun des march�s attribu�s au Commissariat. Les besoins importants et(ou) � venir sont abord�s � l’occasion des r�unions du Comit� de la haute direction, qui ont lieu une fois par semaine. L’organisme se conforme aux exigences en mati�re d’information relative aux march�s en affichant sur son site Web tout contrat de plus de 10 000 $. |
|
3. Progr�s et nouvelles initiatives permettant des pratiques efficaces et efficientes en mati�re d’approvisionnement |
Le Commissariat n’a aucune nouvelle initiative � signaler pendant l’exercice 2006-2007. |
Tableau 8 : Politiques sur les voyages
Le Commissariat � l’information du Canada se conforme � la Directive sur les voyages, aux taux et aux indemnit�s du SCT. Nous adh�rons aussi � la politique sur la divulgation proactive. Pour de plus amples renseignements sur la divulgation de l’information sur les voyages, consulter notre site Web � l’adresse www.infocom.gc.ca.
3.3 Sources de renseignements suppl�mentaires
Lois appliqu�es par le Commissaire � l’information
Le Commissaire � l’information doit surveiller pour le Parlement l’application de la Loi sur l’acc�s � l’information, L.R.C., 1985, chap. A-1, tel qu’amend�e en 1997, c. 23, art. 21.
Rapports annuels pr�vus par la loi et autres publications
On peut se procurer les rapports pr�vus par la loi, les autres publications et renseignements aupr�s du Commissariat � l’information du Canada, � Ottawa, Canada, K1A 1H3; t�l. : 613-995-2410 et sur le site Web du Commissariat � l’adresse : www.infocom.gc.ca
- Rapports annuels du Commissaire � l’information
- Rapport sur les plans et priorit�s pour 2007-2008
- Rapport sur le rendement au Parlement pour la p�riode prenant fin le 31 mars 2006.
Personne � contacter pour de plus amples renseignements
Christian Picard
Directeur, Gestion de l’information et des connaissances
Commissariat � l’information du Canada
Place de Ville, tour B
112, rue Kent, 4e �tage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3
T�l�phone : 613-996-5839
T�l�copieur : 613-995-1501
les responsables et les institutions f�d�raux, les intervenants externes, les membres du public et les m�dias.
Section IV : Autres sujets d’int�r�t
4.1 R�alisations de la direction
L’activit� � Gestion � de l’Architecture des activit�s de programme vient appuyer l’ex�cution de l’Activit� de programme 1. La pr�sente section fait �tat des services internes qui constituent l’activit� � Gestion � de m�me que des r�alisations de chaque service en 2006-2007.
Contr�le de la gestion et responsabilit�
Au cours de l’exercice vis� par le pr�sent rapport, le CIC a lanc� le processus d’�tablissement d’un r�gime de v�rification interne afin de se conformer � la nouvelle politique du Conseil du Tr�sor du Canada sur la v�rification interne qui est entr�e en vigueur le 1er avril 2006 et qui pr�voit l’�talement de la mise en œuvre entre le 1er avril 2006 et le 1er avril 2009. La politique vise � renforcer la reddition de comptes, la gestion des risques, la gestion des ressources et la saine conduite des affaires publiques dans la fonction publique en r�organisant et en favorisant la v�rification interne � l’�chelle f�d�rale. Pour la premi�re fois, le commissaire � l’information doit �tablir une fonction de v�rification interne, constituer un comit� de v�rification ind�pendant, nommer un responsable de la v�rification et approuver un plan de v�rification interne ax� sur le risque. Le CIC demandera des fonds suppl�mentaires pour cette initiative � la faveur d’une pr�sentation au Conseil du Tr�sor. Au cours de la p�riode vis�e par le pr�sent rapport, le CIC a commenc� � �laborer la charte de son comit� de v�rification interne tout en poursuivant l’�laboration de son premier plan de v�rification interne.
Ressources humaines
En 2006-2007, le CIC est pass� � l’�tape subs�quente de la mise en œuvre de la Loi sur la modernisation de la fonction publique – soit l’exercice pl�nier et efficace des nouveaux pouvoirs, responsabilit�s et r�les d�coulant de la Loi. Certaines des activit�s et initiatives men�es �taient la poursuite de l’�laboration du cadre de surveillance des mesures de dotation du CIC, la r�daction de politiques sur les ressources humaines de m�me que la r�vision des politiques en vigueur. Le CIC r�pond d�sormais � toutes les exigences r�sultant de la nouvelle Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
De plus, des efforts ont �t� entrepris en 2006-2007 en vue de l’approfondissement de la formation des enqu�teurs au moyen du programme de formation �largi destin� aux enqu�teurs nouvellement recrut�s et d�j� en poste et du nouveau programme d’avancement professionnel de l’enqu�teur.
Gestion de l’information / Technologie de l’information (GI/TI)
Le CIC a appris le 22 f�vrier 2007 qu’il serait, � l’instar de tous les autres hauts fonctionnaires du Parlement, assujetti � la Loi sur l’acc�s � l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels � compter du 1er avril 2007. Au cours de la p�riode vis�e, le CIC a comenc� � mettre en place les conditions l�gales et op�rationnelles requises pour se conformer aux deux lois. Un coordonnateur de l’acc�s � l’information et de la protection des renseignements personnels a �t� nomm� et a re�u les pleins pouvoirs pour r�pondre aux demandes de communication. Le CIC a �tabli un processus permettant l’instruction ind�pendante des plaintes d�pos�es en vertu de la Loi contre le commissaire � l’information : l’honorable Peter Corey, ancien juge de la Cour supr�me du Canada, a accept� la responsabilit�.
Des dispositions sont en voie d’�tre prises afin de r�pondre aux exigences du biblioth�caire et archiviste national au sujet de la gestion de l’information, et les fichiers de renseignements personnels du CIC sont en voie d’�tre inscrits aupr�s du Conseil du Tr�sor. Le CIC est en train de r�diger une pr�sentation au Conseil du Tr�sor en vue d’obtenir des fonds suppl�mentaires � cette fin.
D’importantes composantes du r�seau ont �t� remplac�es au cours de l’exercice, en raison de l’augmentation de la demande en documents �lectroniques et aussi parce que certaines dataient de plus de cinq ans. De plus, un plan de travail strat�gique a �t� �labor� en vue de la mise � niveau de l’application utilis�e par le CIC pour la gestion des documents et des dossiers (le SGDDI).
Le CIC a �galement d� int�grer des syst�mes de suivi de la correspondance � sa principale application pour les enqu�tes : des �tudes de cas sur les utilisateurs et les prescriptions techniques ont �t� recens�es en vue de la mise en œuvre d’un nouveau syst�me de suivi de la correspondance.
En 2006, pour la premi�re �dition de la Semaine du droit de savoir au Canada, le CIC a �labor� une page Web avec une adresse distincte, soit www.righttoknow.ca/ www.droitdesavoir.ca. L’adresse et la page deviendront la �r�f�rence � pour le droit de savoir et les activit�s c�l�brant le droit de savoir au Canada. Ce sera un outil officiel de sensibilisation de la population canadienne aux questions se rapportant � l’acc�s � l’information.
Le site Web sur le droit de savoir est sur le site Web du CIC, dans un dossier temporaire. Il deviendra un site distinct de sorte que le site Internet du CIC (www.infocom.gc.ca) reste le portail officiel du Commissariat et ses op�rations (p. ex., enqu�tes, rapports annuels, rapports sp�ciaux, discours, etc.). Il sera le compl�ment du site du CIC. Le but recherch�, � cet �gard, est la conception d’un site Web qui plaise � un vaste public. Si les utilisateurs veulent en savoir davantage sur les activit�s du CIC, ils n’auront qu’� cliquer sur un lien les menant au site Web officiel.
Administration
La Loi f�d�rale sur la responsabilit� est entr�e en vigueur le 1er avril 2007. Le CIC est d�sormais assujetti � la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’acc�s � l’information. Le CIC s’est dot� d’un coordonnateur de l’acc�s � l’information pour assurer le respect des deux lois. Du financement additionnel sera demand� et des ressources humaines et technologiques devront �tre acquises pour ce programme.
Communications
� la faveur d’une pr�sentation au Conseil du Tr�sor, le CIC a re�u des fonds suppl�mentaires en vue de la mise sur pied d’une direction des communications charg�e de l’am�lioration des communications. Le CIC a amorc� le processus de dotation en personnel de trois nouveaux postes. Les employ�s aideront le Commissariat � intensifier ses communications avec